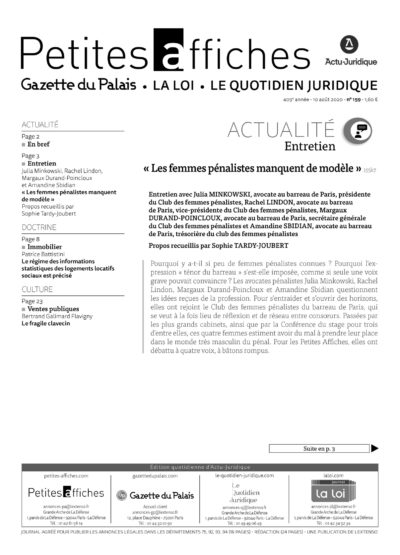« Les femmes pénalistes manquent de modèle »
Pourquoi y a-t-il si peu de femmes pénalistes connues ? Pourquoi l’expression « ténor du barreau » s’est-elle imposée, comme si seule une voix grave pouvait convaincre ? Les avocates pénalistes Julia Minkowski, Rachel Lindon, Margaux Durand-Poincloux et Amandine Sbidian questionnent les idées reçues de la profession. Pour s’entraider et s’ouvrir des horizons, elles ont rejoint le Club des femmes pénalistes du barreau de Paris, qui se veut à la fois lieu de réflexion et de réseau entre consœurs. Passées par les plus grands cabinets, ainsi que par la Conférence du stage pour trois d’entre elles, ces quatre femmes estiment avoir du mal à prendre leur place dans le monde très masculin du pénal. Pour les Petites Affiches, elles ont débattu à quatre voix, à bâtons rompus.

Les Petites Affiches : Pourquoi avez-vous fondé ou rejoint ce club ?
Julia Minkowski : L’idée était de créer un lieu de rencontre et d’échange entre femmes pénalistes. Le club propose des rencontres informelles – les femmes pénalistes étant peu nombreuses, beaucoup d’entre nous se connaissent bien –, ainsi que des rencontres plus thématiques avec des invités débattant d’un sujet au cœur de l’exercice pénal. Nous proposons aussi des rencontres avec d’autres femmes de la justice : nous avons récemment convié les femmes du ministère de l’Intérieur, les magistrates de l’association Femmes de justice et les femmes de l’association de la presse judiciaire. Nous débattons volontiers avec les hommes également. Nous avons d’ailleurs en préparation un séminaire sur le mouvement #Metoo et la présomption d’innocence, qui se tiendra en septembre. Y interviendront, pêle-mêle, des avocats représentants des plaignantes, des journalistes, des magistrats.
Rachel Lindon : Julia a eu l’idée de ce club il y a une dizaine d’années, après l’élection d’une femme bâtonnier à Bordeaux. Un confrère avait commenté son élection en disant qu’elle n’aurait pas les épaules pour ce rôle. Peu avant, Paris Match avait fait une couverture sur les 30 avocats qui comptent. À côté de 29 hommes, seule Dominique de La Garanderie, première femme a avoir été élue bâtonnière du barreau de Paris en 1998, avait sa place sur la photo. L’idée a alors germé de créer un club, non pas contre les hommes, mais pour permettre aux consœurs de s’entraider. Ce club est aussi une forme de réseau, qui doit nous aider à nous recommander entre nous. Nous aimerions d’ailleurs nous ouvrir davantage à nos consœurs qui exercent en province.
Margaux Durand-Poincloux : J’ai prêté serment après que Julia Minkowski et Rachel Lindon eurent fondé ce club. Finalement, les choses n’ont pas tellement changé. Je suis issue de l’avant-dernière promotion de la Conférence du stage. Cette promotion comptait seulement 3 femmes sur 12, alors que nous étions pourtant 45 % de candidates à passer le concours. En audience, j’ai vécu des scènes extrêmement gênantes. Quand mes confrères se faisaient respectueusement appeler « Maître », on s’adressait à la collaboratrice que j’étais en disant « mon petit ». Un client à qui je demandais ce qui pourrait le retenir de désigner une femme comme conseil m’a confié qu’il ne serait pas confortable pour lui de partager ses difficultés avec une femme, avec laquelle ses rapports spontanés seraient plus de l’ordre de la séduction…
LPA : Cette problématique est-elle spécifique au pénal ?
J.M. : C’est une problématique qui concerne le barreau dans son ensemble. Vous n’avez pas plus d’avocates femmes renommées pour les fusions acquisitions que de femmes pénalistes médiatiques. Depuis Christine Lagarde, managing partner d’un gros cabinet anglo-saxon, il n’y a plus eu d’exemples similaires. Lorsque les journaux publient des classements des meilleurs cabinets d’affaires, vous trouvez surtout des hommes. Les femmes avocates réputées se trouvent seulement dans quelques spécialités, comme le droit de la famille. Cette problématique, générale, est néanmoins exacerbée au pénal. On vient nous dire que si on n’a pas une grosse voix et une barbe, cela ne convient pas. C’est un métier de parole, il faut de l’éloquence. Mais il n’y a aucune raison pour qu’on ne puisse pas inventer une manière féminine d’être éloquente.
Amandine Sbidian : Les magistrats ne s’adressent pas à nous comme à nos confrères hommes, même jeunes. Ils sont avec nous dans un rapport paternaliste, voire maternaliste, car cela vient aussi des nombreuses femmes magistrates. Il faut que les femmes s’emparent de ces questions car les hommes ne vont pas le faire à notre place. D’où la nécessité de créer ce club et d’organiser des événements.
R.D. : Nous-mêmes pouvons avoir des comportements limitants. Une des premières réunions du club m’avait marquée, car nous nous étions aperçue que nous-mêmes refusions de nous exprimer dans les médias, ne nous jugeant pas assez compétentes et expérimentées. Alors que nos confrères n’ont aucune crainte à y aller. Quand bien même ils ne sont pas experts des sujets pour lesquels ils sont sollicités, ils ne renverront pas vers quelqu’un d’autre. Moi, je me suis vue décliner des invitations de journalistes, ne pas oser me mettre en avant. Pourquoi ne pas exploiter toutes les options de visibilité qui s’offrent à nous ? Nous avons tendance à nous auto-limiter. En parler entre nous m’avait aidée à en prendre conscience. C’était un début de progression.
M.D.-P. : Le syndrome de l’imposteur est beaucoup plus féminin dans les professions techniques, et cela se vérifie chez les avocats.
LPA : Qu’apporte ce club à la profession ?
J.M. : Le seul fait que ce club existe a provoqué des discussions. Les hommes ont trouvé l’initiative un peu ridicule, nous avons fait comme si nous ne nous en rendions pas compte. Je pense qu’il a poussé des femmes à s’exposer. Elles savent désormais qu’elles sont soutenues par les jeunes générations. Quelque chose change. Jacqueline Laffont qui va être l’avocate de Nicolas Sarkozy à l’automne est désormais plus présente dans les médias. Notre consœur, Marie Dosé, vient de faire l’objet d’un portrait paru dans Le Monde. Jusqu’à récemment, il y avait assez peu d’avocates dont on pouvait s’inspirer. Pendant longtemps, les deux seules figures féminines étaient Françoise Cotta et Monique Smadja. On mentionne souvent Gisèle Halimi, mais elle était davantage dans un combat politique et n’a d’ailleurs pas toujours exercé la profession d’avocate. On ne la croisait pas à la buvette du palais. Pour notre génération, il commence à y avoir des modèles féminins. Les femmes pénalistes ne se cachent plus derrière leur patron, certaines s’installent. Je pense que le club a contribué à faire évoluer les mentalités. Certaines avocates, pourtant, ne l’ont pas vu d’un bon œil. Soucieuses d’être considérées comme égales des hommes, elles cherchent à se fondre dans ce milieu, ne veulent pas mettre en avant leur féminité. Il y a sur ce sujet un clivage générationnel : les femmes nées entre 1945 et 1960 ont fait partie de la génération féministe. Nous leur sommes extrêmement reconnaissantes car elles ont incontestablement fait progresser la cause des femmes. Leur a succédé une génération qui ne veut pas mettre le féminisme en avant. Nous, trentenaires et quadragénaires, sommes dans un nouvel élan où l’on revendique l’héritage féministe, et voulons le poursuivre. Nous avons conscience qu’il reste à faire, que le plafond de verre et l’autocensure existent.
A.S. : Je suis arrivée dans la profession avec en tête peu d’images de femmes, qu’elles soient pénalistes ou avocates médiatiques. J’ai pourtant eu la chance d’être formée par des femmes. Élève-avocate, j’ai pu travailler avec Julia, et j’ai ensuite exercé en collaboration dans un cabinet créé par deux femmes. Les voir plaider m’a montré que c’était possible !
LPA : Y a-t-il une éloquence féminine ?
R.L. : Évidemment. Le problème est que la société a associé l’éloquence à la voix grave et à l’occupation de l’espace. On a tant été habitué à cela qu’il est difficile d’imaginer autre chose. C’est pourtant parfois une grossière erreur : il n’y a rien de pire et de moins efficace qu’un avocat qui hurle dans une salle d’audience. Je pense qu’il y a autant de formes d’éloquence que de personnes. J’ai eu la chance de faire mon stage avec Frédérique Beaulieu, une des rares pénalistes reconnue tant par ses consœurs que par ses confrères. Elle est discrète, délicate, n’a pas une grosse voix. Seulement, elle use des bons mots. Et elle est très écoutée. J’ai également le souvenir d’avoir vu en audience une avocate plaider d’une petite voix. Cela forçait son auditoire à porter attention à ce qu’elle disait. N’est-ce pas là une forme d’éloquence ?
M.D.-P. : La prise de parole en audience pour une femme n’a rien d’évident. On entend régulièrement des critiques qui les visent exclusivement : « la vulgarité dans la bouche d’une femme est insupportable », ou encore « elle a une voix aiguë et agaçante ». Nous-mêmes avons tendance à penser que la voix grave est plus agréable aux oreilles car nous avons intégré ce que l’on nous a dit en formation.
J.M. : J’ai plaidé en 2019 au procès de Bernard Tapie. Entre tous les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, les deux procureurs, nous étions 15 : 14 hommes et moi-même. Je suis la seule femme à m’être levée pour parler. En plus d’être une femme, j’étais la plus jeune, j’étais enceinte de sept mois et demi. J’ai sans doute bénéficié d’une certaine écoute de par mon originalité mais on ne peut pas se satisfaire de cela.
R.L. : Si je peux me permettre, cette relaxe était loin d’être étrangère au travail de Julia. Pourtant, dans le compte-rendu d’audience du Monde, d’ailleurs écrit par une femme, elle n’a pas été citée une seule fois !
LPA : Les rapports avec les magistrats sont-ils différents selon qu’on est un homme ou une femme ?
M.D.-P. : Je vais vous raconter une anecdote. Je ne suis plus collaboratrice ni avocate junior. J’ai passé la trentaine, et cela se voit. Je suis récemment rentrée dans une réunion, avec des avocats et des mandataires judiciaires, tous des hommes blancs d’une cinquantaine d’années. Je représentais mon client, un dirigeant du groupe. Pour me placer dans la salle, on m’a demandé de qui j’étais la collaboratrice ! Cela se voulait gentil. Cela m’a mise mal à l’aise vis-à-vis de mon client. Cela laisse entendre que je suis pas prise au sérieux.
J.M. : Les magistrats et les greffiers ont l’habitude de voir des avocats hommes avec leur collaboratrice. L’avocate qui est là ne peut pas être là que pour elle-même. Ce n’est pas elle qu’on s’attend à voir venir plaider.
LPA : Et avec les clients ?
J.M. : Nos clients sont des hommes et choisissent de préférence un homme pour les défendre. Ce n’est pas un hasard. C’est l’inconscient collectif qui veut ça. Très peu de femmes comparaissent devant les tribunaux correctionnels et encore moins devant les cours d’assises. Il y a bien moins de femmes que d’hommes en détention. On a différentes catégories de clients. Des machos qui ne prennent pas une femme au sérieux ou même qui considèrent qu’une femme ne doit pas travailler. Mais cela ne s’arrête pas là ! Au pénal financier, les grands chefs d’entreprise sont presque tous des hommes. Une seule femme dirigeait une boîte du CAC 40 : elle a été évincée ! Ces hommes choisissant de préférence des hommes pour s’entourer comme pour se défendre, il ne nous reste pas grand-chose.
LPA : Comment parvenez-vous à gagner leur estime ?
J.M. : C’est rare que j’ai une barrière avec un client une fois la relation établie. Toute la difficulté est d’être désignée. Face à cela, j’ai une arme terrible : je travaille avec Hervé Temime. Comme il ne peut pas assister tout le monde, il renvoie des clients vers ses associés. Quand il nous présente à eux, il nous met extrêmement en valeur. C’est lui qui crée la confiance du client à notre abord. Il les aide à me choisir. Quant aux clients que j’apporte, ils arrivent à moi par le biais du droit de la presse, que je pratique en plus du pénal. Au lieu de renvoyer vers des confrères exerçant en droit de la presse, j’ai fini par en faire moi-même. Je remarque qu’il est plus facile de rentrer par la petite porte du droit de la presse. Une femme dans cette matière n’étonne personne, cela paraît cohérent. Une fois qu’ils me connaissent, ces clients peuvent faire appel à moi au pénal.
M.D.-P. : Quand il n’y pas une figure tutélaire masculine, c’est moins facile de se placer sur une grosse affaire. Dans mon cabinet, nous sommes 4 trentenaires, en construction de notre clientèle. Je constate qu’il y a une réaction différente des clients à nos égards respectifs. Mes plus gros clients sont ceux qui m’ont été adressés par un confrère homme. Il y a manifestement un cliquet difficile à passer sans être adoubé par un homme.
A.S. : Je n’ai pas de technique et c’est un problème. Nous devons travailler sur ce point. Quand je vois que le client est réfractaire dès le début, je me bats peu pour le garder et il change pour prendre un homme. Il faut y réfléchir pour éviter de perdre des clients de ce seul fait.
LPA : Arrive-t-il néanmoins qu’être une femme soit un atout ?
J.M. : Il existe à mon sens un seul domaine plus facile pour les femmes : celui des agressions à caractères sexuels. Là, les hommes préfèrent être défendus par des femmes. Ils pensent, à raison, que nous disposons d’une plus grande liberté de parole que nos confrères. On ne peut pas nier que la personne qui parle compte. Si je mets en cause la parole d’une victime, ce ne sera pas pris de la même manière que si un homme le dit. Chacun peut comprendre que je peux me mettre à la place de la victime. Certains hommes ont peur, dans le contexte actuel, de se faire traiter de misogyne s’ils interviennent en défense d’un prévenu dans une affaire à caractère sexuel.
M.D.-P. : C’est un domaine restreint, mais nous avons en effet une très légère avance sur ce sujet. Les hommes sont plus difficilement audibles sur ce type de dossiers.
LPA : Comment réagissent les hommes avocats à votre arrivée dans le domaine du pénal ?
J.M. : C’est à eux qu’il faudrait poser la question. J’observe personnellement que, même quand ils sont plein de bonnes intentions, on sent les limites au bout de quelques minutes de conversation à peine. Très vite, ils vous laissent entendre que ce n’est pas un métier pour les femmes car elles veulent avoir des enfants, qu’elles ont besoin de repos et de vacances, quand ce métier demande qu’on lui sacrifie tout. Je pense aussi que nombre de nos confrères considèrent que les femmes pénalistes ne sortent pas du lot, et que cela suffit à expliquer qu’on les voit peu. C’est d’ailleurs ce qu’ils disent pour justifier qu’il n’y ait pas plus de femmes élues secrétaires générales de la Conférence du stage. Rares sont les femmes avocates véritablement respectées par leurs confrères, à part une ou deux peut-être.
LPA : Que faire pour permettre aux femmes de prendre leur place ?
A.M. : Il faut se forcer à réagir quand, dans un échange professionnel, on s’adresse à nous de manière déplacée, en soulignant que l’on est jolie ou agréable. Cela arrive encore très souvent qu’un confrère, au lieu de nous parler de notre travail, nous enferme dans ces qualificatifs. Quand cela se produit, on est généralement tellement soufflée qu’on n’a pas de répartie. Après, on s’en veut. Il ne faut plus laisser passer ça.
J.M. : La féminisation de la magistrature change également la donne, même si les postes hiérarchiques restent largement occupés par des hommes. La nouvelle génération d’hommes agit différemment. Nos jeunes confrères qui sont pères, et ont des femmes elles-mêmes très prises. Ils doivent comme nous se libérer pour aller chercher leur enfant à la crèche. Agissant ainsi, ils font bouger les lignes. Je fais partie de l’association « Jamais sans elle ». Elle rassemble des hommes qui refusent de se rendre à toute invitation, notamment médiatique, si seuls des hommes sont invités à s’exprimer. C’est pragmatique et pratique et cela fonctionne. Si les hommes n’y vont pas, les organisateurs des colloques sont bien obligés d’inviter les femmes. C’est terrible à dire, car cela signifie que nous mettons, encore une fois, notre destin entre leurs mains.