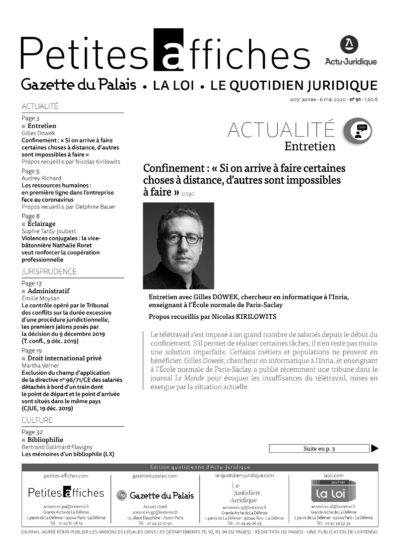Violences conjugales : la vice-bâtonnière Nathalie Roret veut renforcer la coopération professionnelle
Nathalie Roret, vice-bâtonnière du barreau de Paris, organisait le 5 mars dernier un colloque sur les droits des femmes à la maison du barreau. Ce thème fut abordé en deux tables rondes. La première fut consacrée au témoignage de Sima Samar, pionnière de la lutte pour le droit des femmes en Afgahnistan. La deuxième, concernant la coopération des professionnels de justice, a présenté la politique menée par la juridiction de Pontoise, donnée en exemple.
« J’avais choisi de secouer ce couvercle d’injustices et de discriminations qui m’étouffait. Je devenais très jeune et sans le savoir féministe ». C’est avec ces mots de Gisèle Halimi que Nathalie Roret, vice-bâtonnière du barreau de Paris, depuis le mois de janvier dernier, a ouvert ce colloque. Elle a commencé par dresser un panorama factuel et chiffré de l’égalité homme/femme dans le monde. « Nous vivons dans un monde dominé par les hommes. La représentation des femmes dans les parlements du monde entier est inférieure à 25 %. Les salaires des femmes sont inférieurs de 23 % à ceux des hommes dans le monde. Leurs voix et leurs opinions sont encore régulièrement ignorées. Le projet mondial de surveillance des médias a constaté que seulement 24 % des personnes entendues ou vues dans les médias sont des femmes, alors qu’elles constituent la moitié de la population mondiale », a-t-elle rappelé. « Pouvons nous être satisfaits lorsque 219 000 femmes sont reconnues victimes de violences conjugales ? 100 % de femmes harcelées au moins une fois dans les transports en commun. 68 % des femmes sont confrontées à des violences. Selon la Banque mondiale, les cas de viol et de violences conjugale représentent un risque plus grand pour une femme âge de 15 à 44 ans que le cancer, les accidents de la route, le paludisme réunis ». Fait moins connu, elle a rappelé que les femmes sont les grandes absentes des négociations internationales. Citant les chiffres d’un rapport du secrétariat général de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, elle a rappelé que les femmes sont ainsi quasi absentes dans les négociations des processus de paix et de médiation. « Elles constituent 2 % des médiateurs, 8 % des négociateurs, et 5 % des témoins signataires des principaux accords de paix. Seuls 11 % des accords signés en 2018 contiennent des dispositions relatives à la parité », a dénoncé Nathalie Roret.
Ce constat posé, elle a donné le ton et la raison d’être de ce colloque. « Nous avons voulu que nos travaux de ce jour relient deux dimensions : internationale et interprofessionnelle. Le combat des femmes transcende les nations et les frontières. La réponse aux discriminations ne peut être que forgée dans l’universalité », a-t-elle estimé. « Nous ne pouvons nous contenter de nous payer de mots et devons travailler à des solutions concrètes ici et maintenant ». Elle appela l’assistance à se mobiliser, « en tant qu’avocat, que magistrat, que juriste ». « Les acteurs du droit que nous sommes doivent pleinement jouer leur rôle. Le combat ne se gagnera que si toute la famille judiciaire fait front ».
Ce fut pourtant un homme qui monta le premier à la tribune. « Nous avons besoin d’hommes qui aident les droits des femmes », a-t-elle justifié en appelant le bâtonnier Burguburu, récemment élu président de la commission consultative des droits de l’Homme. Celui-ci souffla d’ailleurs que cette commission, composée d’une trentaine de personnalités et d’une trentaine d’ONG, pourrait être bientôt rebaptisée, sur le modèle de l’anglais « human rights », « commission consultative des droits humains », pour mettre hommes et femmes à égalité. Il présenta les missions de la commission, garante des engagements humanitaires internationaux de la France et en charge d’un rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations remis chaque année au Premier ministre. Sous les applaudissements de la salle, il s’engagea à profiter de son mandat pour œuvrer pour les droits des femmes.
S’ouvrit alors la première table ronde, autour d’une invitée de marque : la médecin afghane, Sima Samar, présentée par la vice-bâtonnière comme « une femme extraordinaire de courage et de combativité, une figure emblématique de la défense du droit des femmes ». Elle fut présentée par l’avocate Charlotte Butruille-Cardew, qui tenta de résumer son impressionnant CV en quelques minutes. Médecin, exilée au Pakistan après l’invasion soviétique de son pays, elle travailla dans un service de réfugiés et tenta de donner accès aux femmes à la contraception. De retour dans son pays après la chute des Talibans, elle fut aussi la première femme à être nommée vice-présidente d’Aghanistan, lorsqu’un gouvernement intérimaire fut mis en place. « Elle obtint alors la réintégration des femmes fonctionnaires à leur poste, le retour des filles à l’école, créa un service juridique en charge de défendre les droits des femmes. Elle ouvrit au sein du ministère une école pour filles mariées, offrit des cours de couture et de broderie mais aussi d’alphabétisation », résuma Charlotte Butruille-Cardew. Sima Samar fut aussi ancienne ministre de la Condition des femmes en Afghanistan, puis rapporteure spéciale de Nations unies et présidente de la commission nationale afghane pour les droits de l’homme, qui avait pour but de poursuivre les responsables de violations des droits de l’Homme. Un engagement sans faille pour les droits humains qui lui valut d’être plusieurs fois nommée pour le prix Nobel des droits de l’Homme, mais aussi d’être menacée, ainsi que sa famille. « Quand on demande à Sima Samar de venir à un événement qui aura lieu dans six mois, elle vous dit qu’elle ne sait pas si elle sera encore là », témoigne l’avocate.
Contrastant avec la tonalité grave de cette présentation, Sima Samar, une femme d’une soixantaine d’années, petites lunettes et cheveux coupés courts, fit montre d’un certain sens de l’humour et d’une grande liberté de ton. Interrogée par l’avocate Rusen Aytac, elle n’hésita pas à aller à rebours des idées reçues sur les droits des femmes et sur son pays, l’Aghanistan. Leur échange fut ainsi l’occasion de rappeler que l’Afghanistan donna le droit de vote aux femmes en 1919, soit un an après le Royaume-Uni et un an avant les États-Unis. Interrogée sur le fait de savoir si l’arrivée d’une femme au pouvoir était un bon signal, elle fut très diserte et très nuancée. Elle estima que « quand vous arrivez au pouvoir, être une femme ou un homme ne fait aucune différence ». Elle cita le cas du Sri Lanka, premier pays au monde à avoir eu une femme comme chef du gouvernement. « Cela n’a pas empêché que la répression fasse un grand nombre de morts », pointa-t-elle, avant de prendre un exemple plus porche de son audience. « Margaret Thatcher était bien une femme, avez-vous réellement vu une différence ? Ce n’est pas suffisant d’avoir des femmes à des postes de pouvoir. Il faut y mettre des féministes pour réellement améliorer les droits des femmes. Les femmes font face à un manque de reconnaissance de leur existence. Nous devons toujours prouver que nous sommes là. Le féminisme est la reconnaissance d’une dignité égale de tous les êtres humains, cela ne veut pas dire ignorer les hommes », précisa-t-elle. Avant de quitter la tribune, elle dit l’importance, pour elle, du soutien du barreau de Paris. « Cela me donne de l’énergie de savoir que j’ai de par le monde des amis qui soutiennent mon travail ».
En deuxième partie de colloque, les professionnels « revinrent sur leur territoire », selon les mots de Nathalie Roret, pour aborder les sujets de la nécessaire coopération interprofessionnelle. « La coopération interprofessionnelle a du sens, encore plus après ces semaines qui ont abîmé les relations interprofessionnelles dans les juridictions ; Je me sens l’ambassadrice dans la magistrature », commença Gwenola Joly-Coz, fondatrice de l’association Femmes de justice qui promeut l’égalité au sein du ministère. Aujourd’hui, présidente du TGI de Pontoise, après avoir exercé comme directrice de cabinet de la secrétaire d’État aux droits des femmes, Pascale Boistard, elle commença par faire un édifiant état des lieux de la parité dans les professions du droit.
Elle montra, chiffres à l’appui, que si la magistrature se féminise d’année en année – les dernières promotions de l’ENM étant composées jusqu’à 85 % de femmes –, les postes de pouvoir restent l’apanage des hommes. « En réalité, les femmes ont pour rôle de faire tenir l’activité juridictionnelle, d’être de permanence JLD, de tenir les centaines d’audiences JAF qui ont lieu chaque mois », dénonça-t-elle sans langue de bois, rappelant que seuls 25 % des tribunaux, les plus petits, sont dirigés par des femmes. Présidente du TGI de Pontoise, elle fait figure d’exception. Sur les 12 plus gros tribunaux français, classés hors hiérarchie, seuls trois sont présidés par des femmes : le TGI de Marseille, présidé par Isabelle Gorce, le TGI de Nanterre présidé par Catherine Pautrat, et celui de Pontoise, dont elle est la présidente. « Il faut aller à rebours de l’idée que l’égalité se mettra en place mécaniquement au vu de la féminisation de la profession », posa-t-elle, insistant sur la capacité des femmes « à diriger la magistrature et à prendre des décisions au plus haut niveau ».
Elle revint sur la loi Sauvadet, adoptée en 2012, alors qu’elle était directrice de cabinet de la secrétaire d’État du Droit des femmes, pour que soit respectée une parité dans la direction de la fonction publique. « Le ministère de la Justice a été le premier condamné au titre de la loi Sauvadet pour ne pas avoir respecté les nominations de femmes aux postes à responsabilité », rappela-t-elle. Elle se prononça pour les quotas ! « Il y a 15 ans j’étais résolument universaliste et contre les quotas. Je suis désormais résolument différentialiste car il va être compliqué que nous avancions sans borne, sans obligation légale. Elle insista également sur la nécessité de féminiser les fonctions, se dit heureuse que Nathalie Roret ait choisi le titre de vice-bâtonnière. « La sémantique a du sens, la féminisation des titres n’est pas un gadget. Féminiser nos rôles c’est lutter contre l’invisibilisation ».
Faisant écho aux mots de Sima Samar, elle rappela qu’être femme à un poste de pouvoir ne suffit pas. « Il faut être engagée, compétente, avoir une vision. Avoir des postes à responsabilité sert à mettre à l’agenda les sujets qui nous importent , par exemple l’engagement pour les femmes vulnérables ». Son expérience en cabinet ministériel à l’appui, elle se dit frappée de voir « à quel point les sujets mis à l’agenda sont ceux des hommes, avec le tempo choisi par les hommes »!
Anne-Laure Casado, avocate en droit de la famille, fit le pendant pour les avocats du constat dressé par la magistrate. Elle rappela que les femmes, représentant 55 % du barreau de Paris, sont minoritaires parmi les plus hautes rémunérations. Seuls 20 % des avocats qui perçoivent les plus hautes rémunérations, de plus de 75 000 euros par an, sont en effet des hommes. « Des progrès ont eu lieu depuis 10 ans », concéda-t-elle, notamment il y a de plus en plus d’associées. « Pour autant on n’arrive pas à faire la bascule ». Clotilde Lepetit, avocate pénaliste et ancienne présidente de la première commission sur l’égalité mise en place par le CNB, compléta son propos. Elle rappela les conclusions d’une enquête dirigée par l’université de Lausanne pendant son mandat. « Contrairement à ce qu’on pouvait penser au barreau de Paris, les femmes n’étaient pas cantonnées au droit de la famille. Elles étaient investies à égalité dans les matières lucratives que sont le droit des affaires ou le droit fiscal. L’étude a montré par ailleurs que les femmes travaillent à plein temps dans les mêmes proportions que les hommes. Au vu de l’étude, les différences de salaires ne s’expliquaient pas ».
Cet état des lieux dresé, les professionnelles ont mis le sujet de la coopération professionnelle sur la table. Gwenola Joly-Coz mit en avant la nécessité de restaurer le lien entre avocates et magistrates, qui « partagent cette volonté d’œuvrer pour la justice ». « Ce sont deux grandes professions qui doivent s’écouter, travailler ensemble, se former ensemble, être des partenaires de l’application du droit », souligna-t-elle. Elle présenta les « cafés du Palais » instaurés à Pontoise à des horaires « girl friendly » pour que des représentantes de ces deux professions puissent se parler. Le prochain portera sur la prise de parole des femmes dans les audiences. « Il faut des lieux pour se parler en dehors des audiences. Pour la jeune JAF qui verra plaider une jeune avocate aux affaires familiales avec laquelle elle aura discuté, ce sera différent. Cela est propice à créer de la confiance, on en a besoin ». Elle invita également à penser des formations réunissant les deux professions. « Je dirige à l’ENM une session de lutte contre les violences faites aux femmes, qui n’est pas ouverte aux avocats alors que des policiers, des gendarmes, des associations, peuvent y prendre part. Pourquoi ne pas l’ouvrir aux avocats ? ».
Les échanges se concentrèrent ensuite sur l’ordonnance de protection, disposition permettant aux juges aux affaires familiales d’éloigner un conjoint de la vie d’une femme victime de violences. Cette disposition, très protectrice, est encore peu appliquée, peut-être en raison, justement, d’un manque de communication entre les deux professions. L’avocate Anne-Laure Casado fit part de ses difficultés. « La difficulté d’utiliser l’ordonnance de protection, c’est que quand le magistrat le refuse, c’est un séisme. Le retour chez soi est ensuite très violent, dans tous les sens du terme malheureusement. On préfère donc passer par d’autres chemins dans nos dossiers ».
Gwenola Joly-Coz témoigna à nouveau de l’expérience de son tribunal. « L’ordonnance de protection, on ne savait pas faire, cela nous a tous surpris. Cela a posé des problèmes de territoires dans les tribunaux », dit-elle, estimant que les juges aux affaires familiales ont pu avoir du mal à se saisir de cette prérogative pénale. « On a signé un protocole ordonnance de protection. On les a multipliées par dix parce qu’on s’est parlé et qu’on a compris nos difficultés respectives », assura-t-elle. Elle expliqua avoir mis autour de la table la commission des affaires familiales du barreau et les juges aux affaires familiales de Pontoise pour définir un protocole. « Il faut des politiques juridictionnelles. C’est la moindre des choses de demander à une institution d’avoir une pratique commune. Ce n’est pas normal que vous puissiez avoir des réponses différentes selon les cabinets. Les chefs de juridiction doivent être à la manœuvre pour donner une unité ». Avec des ordonnances de protection multipliées par dix, elle estime les résultats au rendez-vous. « Une fois qu’on s’est mis d’accord sur le fonctionnement, ça roule impeccable et vous pouvez vous lancer dans l’ordonnance de protection. Ce ne sera pas toujours oui, mais ce sera toujours la même méthode, ce qui est extrêmement sécurisant ». Elle insiste sur la nécessité d’écrire ces politiques, de mettre en place des protocoles, des conventions, à passer aux juges arrivant en poste. « Je connais le turn over des juridictions. Vous, avocats, restez et vous voyez les juges passer »…
Il revint à Gwenaelle Thomas-Maire et Jerôme Giusti, respectivement directrice et président de l’association Droits d’urgence, de clore ce colloque. L’association, créée il y a une vingtaine d’années pour aller à la rencontre des citoyens qui n’oseraient pas d’eux-mêmes solliciter un avocat, compte 46 salariés et 310 bénévoles et assure 12 000 permanences par an. « Notre ADN et notre méthologie est de travailler avec d’autres professionnels : les travailleurs sociaux, les médecins », a affirmé Gwenaelle Thomas-Maire. Dans le XXe arrondissement de Paris, l’association a ouvert un point d’accès entièrement dédié aux femmes victimes de violences conjugales, un fléau qui, rappela la directrice, fait au moins 220 000 victimes chaque année. « Faire des permanences ne suffit pas. On a mis en place un réseau violences conjugales, on travaille avec des psychologies, des commissariats de police, Pôle emploi, la PMI. La capacité à mutualiser les efforts nous permettra de sortir plus rapidement les victimes de violences », a-t-elle expliqué.
L’association a dévoilé en fin de matinée la plate-forme Droitsdirect, tout juste inaugurée et actuellement expérimentée à Montreuil-sur-Mer. Elle devrait permettre à la fois d’informer les victimes, et surtout de les mettre en lien avec les professionnels situés à proximité de chez elles. Si elle concéde que rien ne remplacera l’échange en face-à-face, Gwenaelle Thomas-Maire estime que le numérique peut « être un levier, aider à trouver des solutions ». La plate-forme, disposant d’un espace privé pour chaque usager, permettra aux différents professionnels d’accéder aux informations de la victime, évitant à celle-ci de répéter maintes fois son histoire douloureuse.
Cette plate-forme a été initiée par le président de Droits d’urgence, Jérôme Giusti, avocat en propriété intellectuelle et bon connaisseur du monde de l’économie numérique. Il fut le seul homme à prendre part à cette deuxième table ronde. Se présentant comme « un homme blanc, CSP + représentant de la domination masculine », il s’excusa presque de siéger à la tribune. Il rappela que la défense des droits des femmes ne doit pas être seulement une question de femmes. S’étonnant de voir si peu d’hommes dans la salle, ceux présents se comptant effectivement sur les doigts d’une main, il dit à l’adresse de la vice-bâtonnière Nathalie Roret qu’il allait lui « falloir aller chercher les confrères ».
À l’issue de ce colloque, dont les interventions furent riches et variées, nous revinrent les mots de Benoîte Groult, prononcés par Nathalie Roret entre deux interventions. « Le féminisme ne se limite pas à une revendication de justice parfois rageuse. C’est aussi la promesse ou du moins l’espoir d’un monde différent et qui pourrait être meilleur ».