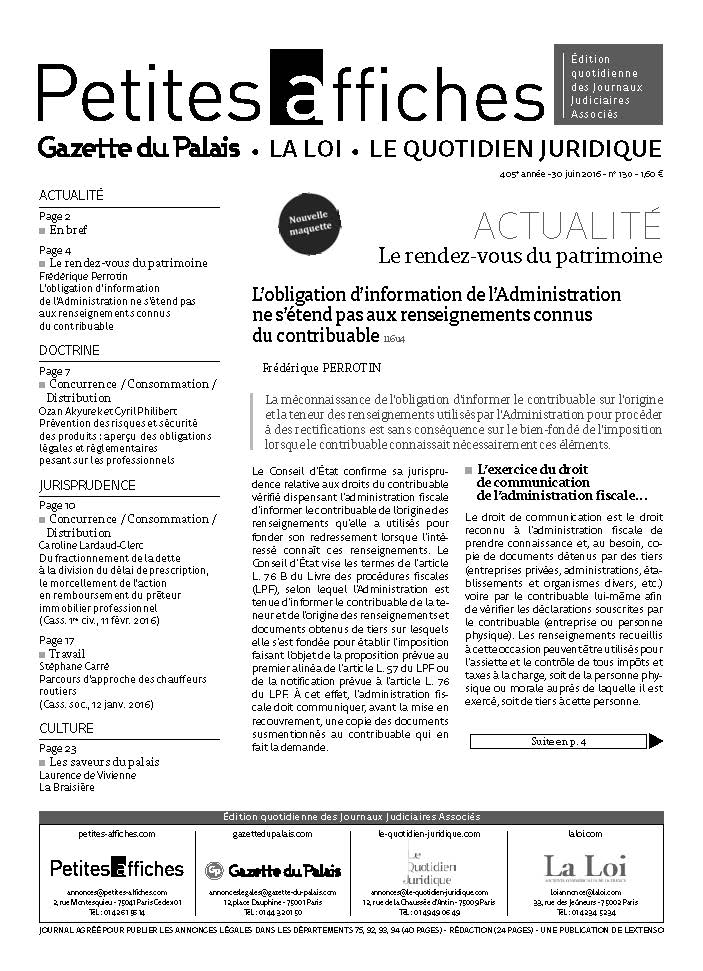Parcours d’approche des chauffeurs routiers
La durée des parcours d’approche entre le domicile du chauffeur routier et le lieu de prise en charge d’un véhicule lourd se trouvant à l’extérieur de l’établissement de rattachement du salarié participe du temps de travail effectif, quelle que soit la longueur de ce trajet.
Cass. soc., 12 janv. 2016, no 13-26318, FS–PB
Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation a pu être remarqué parce qu’il dit de l’intangibilité des conditions de travail des salariés protégés faisant l’objet d’une procédure de licenciement. Mais nous l’aborderons surtout par un autre angle, celui du droit social des transports, car il est également instructif et novateur concernant le calcul de la durée du travail des conducteurs du secteur du transport routier de marchandises (TRM).
Les faits peuvent être ainsi résumés. Un chauffeur routier, engagé en mars 2007 par un groupe de transport, est désigné représentant syndical au comité d’entreprise en juin 2008. Dès juillet 2008, ce salarié fait l’objet d’une modification importante de ses conditions de travail car l’employeur réduit drastiquement sa durée du travail (de 210 heures à 169 heures mensuelles). Cependant, le chauffeur refuse cette baisse à compter de décembre 2008 et arrête de se rendre au travail. L’employeur engage à ce moment une procédure de licenciement par une demande d’autorisation à l’inspection du travail. Mais cette autorisation lui est refusée tant par l’inspecteur du travail que par le ministre du Travail (en septembre 2009). En octobre 2009, le salarié reprend son travail mais le litige n’est pas clos puisque les décisions administratives sont attaquées devant les tribunaux de droit public. De plus, le salarié commet des fautes professionnelles et pour celles-ci une nouvelle procédure de licenciement est engagée. L’inspection du travail autorise cette fois la rupture du contrat de travail, qui intervient en janvier 2012. Néanmoins, le 31 mai 2012, la cour administrative d’appel, statuant sur le précédent litige, annule les décisions administratives refusant l’autorisation de licencier. Mais sur le plan judiciaire, le litige portait globalement sur des rappels de salaires durant toute cette période de conflit allant de juillet 2008 à début 2012, période durant laquelle le travailleur fut confronté à une baisse de ses temps de service et prit un temps l’initiative de ne plus venir au travail.
Concernant la décision patronale d’une réduction des temps de service du chauffeur, choix qui avait convaincu le travailleur d’arrêter sa prestation de travail de décembre 2008 à fin septembre 2009, la chambre sociale casse l’arrêt de la cour d’appel. Pour la période considérée, et alors que les demandes d’autorisation auprès de l’inspection du travail puis du ministre chargé du Travail ne connaissaient pas encore leur dénouement, les juges du fond avaient jugé que la demande de rappel de salaires, fondée sur les anciens horaires de travail, ne pouvait prospérer. Mais pour les juges du droit, qu’importe le fait que la cour administrative d’appel ait ultérieurement annulé les décisions de refus d’autorisation au motif que le chauffeur n’était pas en droit de s’opposer à la réduction de la durée de son travail. Le juge judiciaire aurait dû pourtant décider au bénéfice du travailleur du maintien des précédents horaires de travail et des rémunérations liées, même en sachant que le salarié n’y avait finalement pas droit et ne s’était au surplus pas présenté au travail, cela au nom du principe de l’intangibilité des conditions de travail antérieures du salarié protégé, tant qu’une décision administrative n’était pas prise1. En l’espèce, cette décision de la Cour de cassation apporte un complément intéressant à la jurisprudence constante de la juridiction suprême à l’intangibilité absolue au maintien des conditions de travail, notamment dans la période charnière s’écoulant entre le début de la procédure d’une demande d’autorisation administrative auprès de l’inspection du travail et la décision de cette administration. Un changement des conditions de travail nécessite donc toujours l’accord préalable et sans ambiguïté du salarié protégé2.
Mais cet arrêt comporte d’autres dimensions intéressantes, liées cette fois au droit social routier. Et d’abord, de façon liminaire, notons que pour la période allant de son retour au travail en octobre 2009, et alors que l’employeur n’avait pas même obtenu du ministre une quelconque autorisation de licenciement, à celle de son licenciement définitif en janvier 2012, le salarié échoue à obtenir un rappel de salaires, spécialement sur la base de l’existence d’une convention de forfait. Or, et nonobstant la mise en œuvre du principe d’intangibilité présenté ci-avant, pour toutes les périodes litigieuses s’étalant de juillet 2008 à début 2012, une même question reste sous-jacente : sur quelle base juridique l’employeur pouvait-il réduire unilatéralement la durée de service du chauffeur de 210 heures mensuelles à 169 heures mensuelles – et probablement, pourquoi la cour administrative d’appel jugeait-elle fautif le refus par le salarié d’une telle baisse ? En l’occurrence, le travailleur tendait à soutenir que la durée mensuelle de service était fondée sur une telle convention de forfait, qui suppose l’accord explicite et individuel du travailleur. Mais dans le secteur du TRM, une telle durée du travail peut en réalité être mise en place indépendamment de toute convention individuelle pour certains chauffeurs routiers. En effet, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à l’aménagement du temps de travail dans ce secteur, autorise dès cette époque à ce qu’il soit calculé une durée de service sur des périodes de référence supérieures à la semaine et il est encore admis qu’il puisse y avoir une durée maximale de service de 56 heures par semaine (53 heures en moyenne par trimestre). En bref, l’employeur peut ainsi unilatéralement décider de périodes de référence allant jusqu’au trimestre. Par ailleurs, l’accord du 23 novembre 1994 (dit « Grands routiers ») fixait un temps de service maximal mensuel de 200 heures et beaucoup d’entreprises pratiquait un calcul de la durée du service inspiré de cet accord pour cette catégorie de chauffeurs. En l’occurrence, cette réglementation bien spécifique ne permettait donc pas au conducteur de se prévaloir forcément d’un accord individuel. Si les conventions de forfait sont courantes dans cette profession, de telles normes en matière de temps de service peuvent très bien être mise en place pour la collectivité des chauffeurs sans recourir à un avenant contractuel. Au demeurant, en ce qui concerne le principe d’intangibilité pour les salariés protégés, on soulignera qu’il s’applique non seulement vis-à-vis de toute modification du contrat de travail mais plus globalement par rapport à toute modification des conditions de travail, d’où le fait qu’il puisse opérer indépendamment même d’une convention de forfait.
Cependant, en matière de droit social routier, c’est sur un autre sujet que cet arrêt doit être tout spécialement commenté. La Cour de cassation rejette en effet une demande de l’employeur tendant à faire annuler la décision des juges du fond à considérer les temps de trajet entre le domicile et les lieux de prise en charge des poids lourds comme relevant d’un temps de travail effectif. Or, si l’on peut logiquement soutenir une telle solution de la réglementation européenne sociale et professionnelle particulière à ce secteur d’activité, elle n’est pas textuellement inscrite dans la législation française.
L’employeur soutenait que le droit routier devait être rattaché au droit commun du travail. Partant de l’article L. 3121-4 du Code du travail affirmant que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif » et que « s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait [seulement] l’objet d’une contrepartie », il en tirait la conclusion que les trajets du chauffeur entre son domicile et divers lieux de prise en charge des camions, en dehors de l’établissement de rattachement du salarié n’étaient donc pas un temps de travail effectif puisque l’article 5, 1° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à l’aménagement du temps de travail dans le secteur du TRM reprend une définition similaire du temps de travail effectif donnée à l’article L. 3121-1 du Code du travail. Cependant, speciala generalibus derogant, l’employeur ne pouvait méconnaître l’existence d’une réglementation spécifique dérogeant aux règles générales, encore qu’il pouvait soutenir que les deux textes n’étaient pas strictement comparables. Effectivement, l’article 9, § 3 du règlement (CE) n° 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route indique que « tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche ». En clair, dès lors qu’un conducteur utilise un véhicule léger pour rejoindre le lieu de prise en charge d’un véhicule lourd et ce que dernier ne se trouve pas positionné précisément sur le lieu d’établissement du conducteur, le temps passé à conduire ledit véhicule léger (qui peut être le véhicule personnel du travailleur) n’est, au sens de cette réglementation sur les temps de conduite des chauffeurs routiers, ni un temps de pause ni un temps de repos. Mais ce lapse de temps est-il pour autant un temps de travail effectif, au sens du droit du travail français ?
La réglementation communautaire sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers sur véhicules lourds renvoie ici à la législation sociale communautaire propre à ce secteur : selon l’article 4, e) du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, les autres tâches sont « toute activité, à l’exception de la conduite3, définie comme temps de travail à l’article 3, point a) de la directive n° 2002/15/CE ». Mais la réglementation communautaire sur les temps de conduite est en réalité d’une réglementation professionnelle applicable à tous les conducteurs sur véhicules lourds, même s’il s’agit de travailleurs indépendants. Cette législation communautaire distingue les temps de pause de sécurité routière (qui ne sont pas exactement des repos), des temps de repos, des temps de conduite et enfin des temps consacrés à « d’autres tâches » (par exemple, des opérations de chargement ou, comme en l’espèce, la conduite d’un véhicule léger). L’employeur tirait donc argument que les « autres tâches » ne sont pas nécessairement un temps de travail effectif au sens du droit du travail français pour dénier cette qualification à un temps de conduite sur véhicule léger afin de rejoindre un lieu d’affectation autre que l’établissement du chauffeur salarié. Du moins, pouvait-on soutenir que la règle dérogatoire devait être d’interprétation stricte.
Mais la Cour de cassation distingue très nettement la situation propre à ces chauffeurs routiers et celle relative aux temps de trajet des salariés suivant simplement le droit commun du travail. Quelle que soit la durée du trajet d’approche d’un chauffeur routier pour rejoindre un véhicule lourd en dehors de l’établissement de rattachement, et même si ce parcours s’avère moins long qu’un trajet vers ledit établissement, il s’agira d’un temps de travail effectif dès lors que le conducteur est un salarié. Priorité est donc donnée à la réglementation communautaire de sécurité routière pour en permettre la coordination avec le droit social. La jurisprudence européenne allait déjà dans ce sens4 . Il faut aussi rappeler le récent arrêt de la CJUE du 10 septembre 2015 qui considère que la durée des parcours d’approche de travailleurs espagnols sans lieu de travail fixe vers leur premier client devait être comprise dans le temps de travail effectif5. Pour sa part, la Cour de cassation avait déjà jugé que le parcours d’approche nécessaire à la première prise en charge du camion durant la journée, hors de l’établissement habituel de rattachement du conducteur, entrait dans l’amplitude journalière de travail, mais sans indiquer formellement que ces parcours participaient de la durée effective du travail6. La présente affaire l’affirme expressément. La directive n° 2002/15/CE du 11 mars 2002, quoique non citée dans cet arrêt, apporte aussi quelques arguments à cette solution car elle inclut dans le temps de travail des travailleurs mobiles (dont les salariés) du secteur des transports routiers diverses activités, comme la conduite, les opérations de chargement, de nettoyage et finalement « tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours ».
Certes, il n’existe pas une corrélation totale entre la notion de « autre tâche » du règlement (CE) n° 561/2006 et la notion de « autres travaux » de la directive n° 2002/15/CE. Mais les trajets d’approche vers des lieux de prise en charge sont de ceux qui sont effectués à la demande de l’employeur et pour lesquels le travailleur effectue déjà une tâche, présentement de conduite, ce qui peut avoir une incidence sur la sécurité routière, ce que constatait déjà l’arrêt susmentionné Skills Motors Coaches. Notons aussi qu’en se fondant précisément sur le règlement n° 561/2006 du 15 mars 2006 en matière de temps de conduite pour considérer que ces parcours d’approche entraient dans la durée du travail, cet arrêt des juges du droit tend à rendre applicable cette solution non seulement aux conducteurs de véhicules lourds du secteur du TRM mais aussi à tout conducteur sur véhicule lourd dans le cadre d’un transport pour compte propre.
Notes de bas de pages
-
1.
C. trav., art. L. 2411-1 et C. trav., art. L. 2411-8.
-
2.
V., par ex., Cass. soc., 15 févr. 2006 : JCP S 2006, 1265, note Kerbourc’h J.
-
3.
Règl. CE n° 561/2006, 15 mars 2006, « activité de conduite enregistrée ».
-
4.
CJCE, 18 janv. 2001, n° C-297/99, Skills Motors Coaches.
-
5.
CJUE, 10 sept. 2015, n° C-266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras.
-
6.
Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-12875, Transports Gautier : Rev. dr. transp. 2013, comm. 51, Carré S.