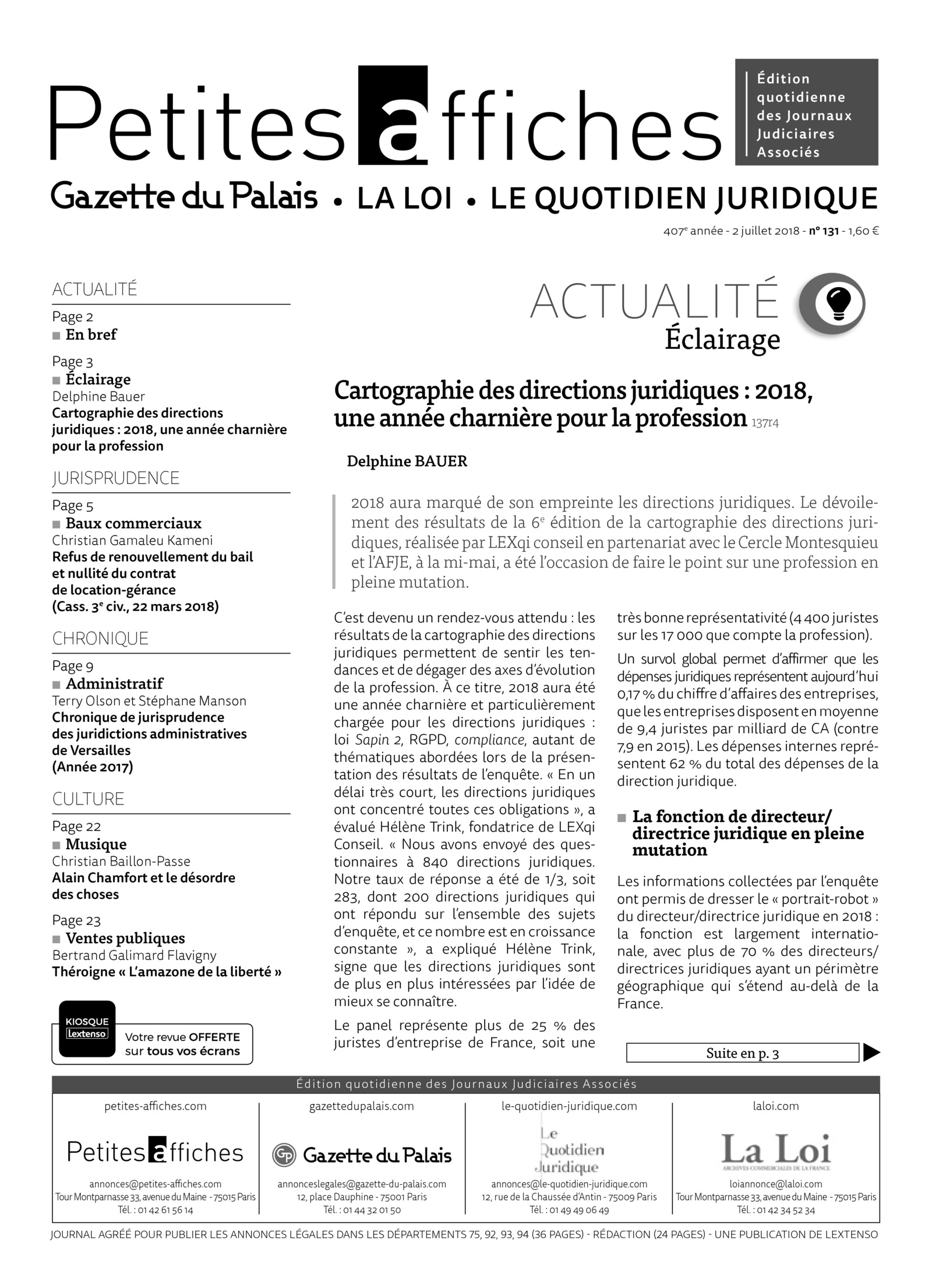Chronique de jurisprudence des juridictions administratives de Versailles (Année 2017)
Le nouvel opus de la chronique de jurisprudence des juridictions administratives de Versailles réunit une sélection des décisions les plus marquantes de l’année 2017. Magistrats administratifs de la Cité royale et jeunes chercheurs du laboratoire VIP ont annoté douze décisions relatives à des domaines variés (fiscalité, contentieux des contrats, responsabilité, droit du contentieux, droit de l’urbanisme, fonction publique territoriale, contentieux des examens). L’exercice témoigne de l’intense activité des juridictions administratives versaillaises autant que de l’heureuse pérennité des liens noués entre les deux juridictions et la jeune recherche en droit public.
I – Sont soumis à la TVA les frais facturés à la clientèle à l’occasion du traitement par les banques des avis à tiers détenteur émis par le Trésor public, car ils constituent des opérations de « recouvrement de créances » au sens du c) du 1° de l’article 261 C du CGI
CAA Versailles, 18 mai 2017, n° 16VE02479, SA Caisse d’épargne CEPAC. La société anonyme Banque de la Réunion a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l’issue de laquelle l’Administration a estimé que les frais facturés par la banque à ses clients faisant l’objet d’un avis à tiers détenteur ne pouvaient être exonérés de TVA sur le fondement de l’article 261 C du Code général des impôts, au motif que les opérations accomplies à cette occasion se rapportaient à des opérations de recouvrement de créances pour le compte du Trésor public.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions du c) du 1° de l’article 261 C du Code général des impôts, prises pour transposer en droit national le d) du 1 de l’article 135 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, les opérations bancaires et financières portant sur les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce sont exonérées de TVA, à l’exception du recouvrement de créances. Les opérations de « recouvrement de créances » ne sont pas définies et ont été regardées par le juge communautaire comme des opérations financières tendant à obtenir le paiement d’une dette d’argent1. La cour, saisie de manière inédite de la problématique des frais facturés par une banque à ses clients à l’occasion d’un avis à tiers détenteur, interprète les dispositions de l’article 261 C du Code général des impôts à la lumière de ce cadre jurisprudentiel, conformément à la décision d’assemblée du 22 décembre 19892.
En l’espèce, le recouvrement de créances n’était pas effectué par la banque au profit du client, mais au profit d’un tiers, le Trésor public, en vertu d’une disposition légale. La cour relève que la banque avait signé avec ses clients une convention de compte, stipulant qu’elle prélèverait des frais dans l’hypothèse où elle procéderait à des opérations liées à un avis à tiers détenteur dont le client ferait l’objet. Elle en déduit qu’il existe ainsi un rapport juridique entre la banque et son client, sur le fondement duquel des prestations réciproques sont échangées, et en conclut que, bien que ces prestations ne constituent pas un service rémunéré rendu par la banque au Trésor public, l’ensemble de ces opérations entre dans le champ d’application de la TVA.
La cour précise ensuite que la notion de « recouvrement de créances » doit recevoir une interprétation large. Elle reprend ainsi les principes posés par la Cour de justice de l’Union européenne3.
En l’espèce, elle relève que si le service rendu par la banque à ses clients faisant l’objet d’un avis à tiers détenteur comprend des opérations de virements, en principe exonérées de TVA, il comporte également diverses opérations visant notamment à vérifier, dans les 15 jours qui suivent la notification de l’avis à tiers détenteur, si le solde du compte permet le paiement total ou partiel de l’acte de poursuites, à procéder au blocage de ce solde pendant un délai de 15 jours ouvrables ainsi qu’à calculer le solde effectivement disponible sur les comptes en fonction des opérations en cours et, à l’issue de cette procédure, à effectuer le cas échéant le paiement requis auprès du Trésor public à l’issue du délai légal de 2 mois. Elle en conclut que ces opérations, qui ne se limitent pas à un transfert de fonds entre le compte du client et celui du Trésor et tendent à obtenir le paiement par la banque d’une dette d’argent pour le compte de ce dernier, constituent une opération unique de « recouvrement de créances » au sens des dispositions de l’article 261 C du Code général des impôts, soumise à la TVA. Par suite, elle rejette la requête de la société Cepac, venant aux droits de la SA Banque de la Réunion.
L’arrêt fait l’objet d’un pourvoi enregistré sous le n° 412570.
Sandrine RUDEAUX
II – Un faisceau d’indices concordants permet à la cour d’identifier « un risque de perte définitive d’une somme » (CJA, art. R. 811-16) et d’accorder à l’administration fiscale le sursis à exécution d’un jugement de première instance
CAA Versailles, 23 mai 2017, n° 17VE00782, ministre de l’Économie et des Finances c/ Sté So Chocolat. La société So Chocolat, qui exerçait une activité de vente de chocolat par l’intermédiaire d’une plate-forme internet, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’Administration a remis en cause un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2011 et l’a assujettie à un supplément d’impôt sur les sociétés à hauteur de 57 423 €. La société a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à la décharge de ces impositions, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 8 décembre 2016. Le ministre de l’Économie et des Finances a régulièrement relevé appel de ce jugement, et a par ailleurs saisi la cour administrative d’appel de Versailles d’une demande de sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-16 du Code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 811-16 du Code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l’article R. 541-6, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Pour déterminer le risque de perte définitive, le juge administratif applique un régime de preuve objective4.
La notion de risque de perte définitive ne saurait être définie, et requiert une approche casuistique. Ainsi, le sursis à exécution a été accordé à l’Administration pour une société de droit américain qui ne disposait pas en France d’une installation fixe d’affaires, dans un contexte où les conventions fiscales conclues entre la France et les États-Unis ne contenaient pas de clause d’assistance administrative permettant à l’Administration française de demander à l’administration fiscale des États-Unis de lui apporter son aide dans le recouvrement d’une créance en matière de TVA5. La même solution a été adoptée pour une société établie au Royaume-Uni, pour les mêmes motifs6. En revanche, le juge a refusé de surseoir à l’exécution d’un jugement lorsque la partie perdante en première instance faisait état de ce qu’une société n’avait plus aucune activité, alors que cette dernière soutenait sans être sérieusement contredite qu’elle ne supportait plus aucune charge et qu’elle disposait d’une trésorerie supérieure au montant de la condamnation litigieuse7.
En l’espèce, le ministre faisait valoir que la société So Chocolat avait cédé son fonds de commerce en septembre 2015 et était désormais sans aucune activité et dépourvue de salariés. Il soutenait également que cette dernière ne respectait pas ses obligations fiscales dès lors, d’une part, qu’elle n’avait pas souscrit sa déclaration de résultats de l’exercice de cessation d’activité et que, d’autre part, indépendamment du crédit d’impôt recherche toujours en litige devant la cour, elle restait redevable de rappels de TVA à hauteur de 11 882 €, et de la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 373 €. La société ne contestait aucun des éléments factuels mis en avant par le ministre. Pris isolément, chacun d’entre eux aurait sans doute été insuffisant mais, de manière conjuguée, ces éléments constituaient un faisceau suffisamment sérieux pour que la cour admette qu’il existait un risque sérieux de ce que la société, si le ministre remboursait la créance en litige, ne reverse pas ensuite les sommes perçues au cas où elle perdrait en cause d’appel.
Dans ces conditions, la cour fait droit aux conclusions du ministre et décide qu’il sera sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours dirigé contre ce jugement.
Sandrine RUDEAUX
III – Une pénalité de 80 % pour activité occulte peut être appliquée lorsque l’Administration a mis au jour l’existence d’un montage relevant de l’article 155 A du CGI (sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une personne domiciliée ou établie en France ou hors de France)
CAA Versailles, 20 juill. 2017, n° 16VE02004, M. et Mme A. L’arrêt commenté apporte un éclairage utile sur les modalités de mise en œuvre et les effets de l’article 155 A du Code général des impôts (CGI) qui, issu des lois de finances pour 1973 et 1980, permet, dans une logique de lutte contre l’évasion fiscale, d’imposer les rémunérations versées à l’étranger pour des prestations pourtant réalisées en France par des personnes qui y sont domiciliées ou établies. À ce titre, il montre précisément l’importance de l’office du juge dans l’agencement de la loi, des conventions fiscales internationales et des jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la juridiction administrative. En l’espèce, M. A. était à la fois le dirigeant et l’associé majoritaire de la société Serdiplast, établie en France, et l’administrateur unique et le détenteur – avec son épouse – du capital de la société Serdi International, sise en Suisse, deux entreprises ayant respectivement pour objet la distribution de matières plastiques techniques et le développement international de matières plastiques brutes. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a effectué des rectifications sur les exercices 2010 et 2011, estimant que les sommes facturées pendant cette période par la société Serdi International à la société Serdiplast étaient imposables en France dans la catégorie des BIC au nom des époux A. Ces derniers ont alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Montreuil8 en vue d’obtenir la décharge des impositions litigieuses et des pénalités afférentes. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Versailles a toutefois rejeté la requête du couple, tant concernant les impositions (I), que les pénalités (II), au terme d’un raisonnement qui interroge sur une possible amélioration de la loi (III).
I – S’agissant d’une part du bien-fondé des impositions, la cour vérifie que, dans l’affaire en cause, les conditions étaient effectivement remplies pour l’application de l’article 155 A du CGI, d’après lequel : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération des services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services (…). – II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (…) ». Dans un premier temps, la juridiction rappelle que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’État de 2013 selon laquelle « les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte »9. Tel était le cas dans les faits, au regard aussi bien des constatations opérées sur place par l’administration fiscale, que de l’absence d’élément contraire apporté par les requérants. Puis, dans un second temps, la juridiction contrôle que la situation des époux A. n’entre pas dans le champ des limites conventionnelles et constitutionnelles à l’application des dispositions précitées. L’article 5 de la convention fiscale franco-suisse de 1966 (convention entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966, modifiée) ne constitue ainsi pas un obstacle, puisque M. A. exerce son activité au titre de la société Serdi International « exclusivement » à partir de l’« établissement stable (…) situé » en France que constitue la société Serdiplast. De même, la cour souligne que, si le Conseil constitutionnel a subordonné en 2010 la constitutionnalité des dispositions concernées de l’article 155 A du CGI au non assujettissement « à une double imposition au titre d’un même impôt »10, cette réserve vaut uniquement – ainsi qu’elle l’a elle-même jugé dans un arrêt M. et Mme Régist Couckuyt11 de 2014 – pour les impositions françaises.
II – Concernant d’autre part le bien-fondé des pénalités, la cour prend d’abord soin de rappeler les conditions d’application de la majoration de 80 % pour découverte d’une activité occulte, telles qu’elles résultent de l’article 1728 du CGI, d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel de 199912 et d’une jurisprudence du Conseil d’État de 201513. Ensuite, s’inspirant en cela des conclusions du rapporteur public, mais sans aller jusqu’à consacrer une relation d’automaticité, la juridiction vient confirmer la sanction prononcée en se fondant pour partie sur la réunion des conditions prévues à l’article 155 A du CGI.
III – Si le présent arrêt met parfaitement en exergue le rôle essentiel, et complémentaire de celui du législateur, que jouent le Conseil constitutionnel et le juge administratif pour assurer l’intégration de la loi dans l’ordonnancement juridique, il semble aussi appeler à envisager des solutions aux interprétations « en cascade » formulées par ces deux institutions vis-à-vis de la loi. En effet, dans le respect de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi14, peut-être serait-il par exemple judicieux pour le législateur de réfléchir à l’opportunité de formaliser les interprétations faites, de l’article 155 A du CGI par le Conseil constitutionnel, d’abord, et de la réserve d’interprétation de 2010 par le juge administratif, ensuite, en matière de double imposition.
Olivier PLUEN
IV – Une société peut renoncer à percevoir une contrepartie financière de la part de sa société-sœur à l’occasion de la concession de l’usage d’une marque
CAA Versailles, 20 juill. 2017, n° 16VE00638, SHCD. En l’espèce, la société Hôtels et Casino de Deauville (SHCD) est la société-mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime d’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du Code général des impôts (CGI), et qui regroupe notamment – toutes deux sous forme de SA – la société d’exploitation de la marque « Le Fouquet’s » (SEMF) et, gérant en particulier le fameux établissement situé sur l’avenue des Champs Élysées, la société d’exploitation du restaurant Le Fouquet’s (SERF). À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a effectué des rectifications sur les exercices 2000 à 2002 vis-à-vis de la SEMF, estimant que cette dernière aurait dû facturer à la SERF les redevances correspondant à l’utilisation de la marque « Le Fouquet’s » pour cette période. La société-mère a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise15 en vue d’obtenir la décharge des impositions litigieuses et des pénalités afférentes, avant d’interjeter appel du jugement de rejet devant la cour administrative d’appel de Versailles16. La requête ayant également été rejetée à ce niveau, la SHCD s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État17, qui a annulé l’arrêt de la cour en tant que portant sur les redevances, et a renvoyé l’affaire devant celle-ci sur ce point. La nouvelle décision rendue le 20 juillet 2017 constitue une première application de la jurisprudence du Conseil d’État du 10 février 2016, venue approfondir les exceptions à l’acte anormal de gestion justifiant fiscalement un renoncement à des recettes, et plus spécifiquement à une contrepartie financière à une concession de licence de marque.
La cour revient dans un premier temps sur les apports successifs de la jurisprudence administrative en la matière. Elle rappelle tout d’abord que l’abandon d’une créance au profit d’un tiers, comme c’est le cas avec le renoncement susvisé, « ne relève pas en règle générale d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt »18. Puis, partant de cette dernière exception, elle rappelle également que la charge de la preuve incombe alors à l’entreprise, qui doit « justifier de l’existence d’une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant », à moins que l’Administration ne démontre ensuite « que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d’intérêt pour l’entreprise ou insuffisantes »19. Enfin, la cour reprend la solution jurisprudentielle de l’arrêt susmentionné du 10 février 2016, d’après laquelle : « [S]i la valorisation potentielle d’actifs ne constitue en principe pas un mode de rémunération normale d’une concession de licence de marque, une entreprise peut en revanche apporter les justifications nécessaires en démontrant que l’avantage a été consenti en vue de la préservation de l’existence même d’actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d’une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus »20.
Ces rappels effectués, la cour passe ainsi, dans un second temps, à l’examen de l’espèce. Comme elle le souligne, reprenant en ce sens l’argumentation du requérant, l’abandon des redevances avait pour objet de ne pas aggraver la situation financière de la SERF, étant donné que « la fermeture du restaurant parisien exploité » par cette dernière, et dont « a procédé la réputation internationale » de la marque « Fouquet’s », aurait « emporté une dévalorisation certaine et durable dudit actif ». La cour en déduit alors que, en accordant à cette entreprise l’avantage contesté, la SEMF a « agi dans son intérêt propre » et que, faute de démonstration contraire de l’administration fiscale, la renonciation litigieuse ne pouvait être « qualifiée d’acte anormal de gestion ».
Olivier PLUEN
V – Une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel peut constituer un événement au sens du c) de l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales susceptible de rouvrir le délai de réclamation
TA Versailles, 28 nov. 2017, n° 1504746, M. X. Un contribuable a demandé au tribunal la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue à l’article 223 sexies du Code général des impôts, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2011, à raison de revenus de capitaux mobiliers déjà soumis au prélèvement forfaitaire libératoire au titre de cette année, l’Administration ayant rejeté, comme tardive, sa réclamation préalable du 27 janvier 2015.
Selon l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013 : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’Administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 (…) », c’est-à-dire les décisions, arrêts et avis rendus par le Conseil d’État, la Cour de cassation, le tribunal des conflits et la Cour de justice de l’Union européenne.
Les décisions du Conseil constitutionnel statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité ne sont donc pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis, ne constituant pas un « événement », mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 auxquels renvoient les dispositions du c) de l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales.
Pour l’application et l’interprétation d’une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition21.
Les dispositions de l’article 223 sexies du Code général des impôts, issues du I de l’article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, sont applicables, en vertu du III de cet article « à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul ». Par sa décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 » figurant au III de l’article 2 de la loi n° 2011-1977, sous la réserve qu’ils ne puissent être interprétés comme permettant d’inclure dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre de l’année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du Code général des impôts. Cette réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, qui prohibe le cumul, pour des mêmes revenus de capitaux mobiliers, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et du prélèvement forfaitaire libératoire, doit être regardée, dès lors qu’il n’est prévu aucune restriction quant à sa portée22 et qu’elle ne relève pas du cas prévu, en matière d’abrogation d’une disposition déclarée inconstitutionnelle, par le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, comme un événement, au sens du c) de l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, permettant de motiver une réclamation tendant à obtenir « la réparation d’erreurs commises dans l’assiette (…) des impositions » et « le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative », au sens du premier alinéa de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales. La réclamation préalable, en date du 27 janvier 2015, n’était donc pas tardive.
Cette solution inédite, et contraire à deux jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise23, s’inscrit cependant dans le prolongement de la jurisprudence selon laquelle « doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu, les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul »24, ce qui était le cas, par exemple, avant la modification du c) de l’article R. 196-1 par le décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013, d’une décision du Conseil d’État jugeant illégales les dispositions de l’article 236 de l’annexe II au Code général des impôts issues du décret du 29 décembre 1979 en tant qu’elles avaient exclu du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des frais tels que d’hébergement, de réception, de restaurant ou de spectacles « utilisés par des tiers »25.
Thomas BESSON
VI – Au-delà de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, est frappé de nullité le contrat administratif contenant une clause (indivisible du contrat) méconnaissant une disposition fiscale qui s’impose aux parties
CAA Versailles, 12 oct. 2017, n° 15VE00762, INRAP C/ Sté REP. Les conventions portant sur des opérations de diagnostics et de fouilles d’archéologie préventive sont très encadrées. La rémunération, qui se situe hors du champ contractuel, n’est pas proportionnelle au service rendu et se caractérise par le versement d’une redevance archéologique par l’aménageur dont le montant est calculé conformément à l’article L. 524-7 du Code du patrimoine ou s’agissant du litige dont la cour était saisie conformément à l’article 9 de la loi de 2001. Elle tient compte des prestations que l’aménageur peut être amené à effectuer pour l’opérateur, des dégrèvements pouvant être accordés. Le montant des dégrèvements pouvant être accordés est plafonné. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2000-439 du 16 janvier 2001, a qualifié la redevance archéologique d’imposition de toute nature. Son contentieux est administratif et est régi par les dispositions applicables aux participations d’urbanisme26. Le contentieux du recouvrement est, pour sa part, encadré par les articles 163 et 134 du décret du 29 décembre 1962. C’est dans ce cadre que la société REP, propriétaire et aménageur d’un terrain situé dans la commune du Plessis-Gassot (Val d’Oise), a signé avec l’INRAP opérateur, le 25 novembre 2002, une convention portant sur des opérations de diagnostics et de fouilles d’archéologie préventive après que le préfet de Paris ait prescrit un diagnostic archéologique préalablement à l’opération d’aménagement. Un avenant conclu en 2003 a précisé « les apports de l’aménageur » et fixé le montant des prestations délivrées par la société REP à l’INRAP ouvrant droit à une réduction du montant de la redevance d’archéologie préventive due par la société. Le montant de ces prestations étant supérieur au dégrèvement auquel pouvait prétendre la société REP en application de l’article 9 de la loi du 17 janvier 2001, l’INRAP a toutefois refusé d’en déduire l’intégralité et a émis un titre exécutoire aux fins de paiement du solde de la redevance, dont il a ensuite poursuivi le recouvrement.
La cour a rappelé les dispositions applicables pour ce type de conventions et indiqué que le litige est né, en cours d’exécution du contrat, du refus de l’INRAP de dégrever, sur la redevance d’archéologie préventive due par la société REP, la totalité des frais d’apport en matériels supportés par la société tels que prévus par l’avenant de 2013 et de l’émission d’un titre exécutoire aux fins de paiement du solde de la redevance. Elle a ensuite précisé que le refus était fondé sur le fait que le montant des prestations réalisées par la société REP était supérieur au dégrèvement auquel la société pouvait prétendre.
Puis elle a procédé à l’étude de la validité de la convention en faisant application de la jurisprudence d’assemblée du Conseil d’État Béziers I27. Elle a constaté que si le contenu du contrat est constitué des obligations que les parties se sont données, il ne peut pas contenir de clauses méconnaissant une norme supérieure qui s’impose aux parties, comme une règle fiscale. Puis elle en a déduit qu’en l’espèce, le montant du dégrèvement fixé par l’avenant étant supérieur au plafond de dégrèvement de la redevance d’archéologie préventive prévu par les dispositions précitées du III de l’article 9 de la loi du 17 janvier 2001, cette clause financière méconnaissait une disposition fiscale ; ce qui revêt un caractère illicite de nature à vicier gravement la convention. Puis elle a estimé que la clause financière n’était pas divisible de l’ensemble de l’avenant et de la convention et en a conclu qu’il convenait d’écarter la convention et compte tenu de la gravité de l’illégalité de ne pas régler le litige sur le terrain contractuel.
Ensuite, le contrat ayant été invalidé, la cour a recherché si la responsabilité de l’INRAP pouvait être engagée sur le terrain quasi contractuel ou quasi délictuel28. Elle a, d’une part, sur le terrain de l’enrichissement sans cause, fait droit aux dépenses qui ont été utiles à l’INRAP portant sur la mise à disposition du matériel. Elle a, d’autre part, sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle, estimé que la société REP avait commis une faute de nature à justifier un partage de responsabilité de 50/50, l’INRAP, étant un établissement public chargé de l’archéologie préventive, et la société REP, un professionnel avéré, et a déterminé le manque à gagner de la société REP après déduction des dépenses utiles. Tout cela a conduit la cour à réduire la condamnation prononcée par le tribunal et à réformer le jugement.
Sylvie MÉGRET
VII – L’interdiction soudaine, par le législateur, du recours à la fracturation hydraulique et l’abrogation des permis de recherche d’hydrocarbures précédemment délivrés engagent la responsabilité sans faute de l’État
CAA Versailles, 21 déc. 2017, n° 16VE01097, Sté Shuepback Energy Llc. La société Shuepback Energy Llc s’est vue délivrer par l’État, le 1er mars 2010, deux permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, qui après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2011 interdisant le recours à cette technique pour l’exploitation comme pour l’exploration des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux et prévoyant l’abrogation des permis accordés comportant des projets ayant recours à cette technique, ont été abrogés par les ministres chargés de l’Environnement et de l’Industrie par un arrêté du 12 octobre 2011. Elle a alors demandé la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices en résultant.
La cour rejette la demande de la société Shuepback Energy Llc sur le terrain de la responsabilité pour faute, l’abrogation litigieuse ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société tel que protégé par l’article 1er du premier protocole de la Convention EDH. Comme l’a expliqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, les permis exclusifs de recherches sont accordés pour une durée limitée et dans des périmètres définis et ne peuvent être assimilés à un bien, objet pour son titulaire, d’un droit de propriété. Toutefois, cela ne suffit pas pour écarter l’atteinte puisque l’abrogation des permis constitue la réglementation de l’usage d’un bien au sens de la Convention EDH. C’est pourquoi même si la loi compromet les projets de recherche par fracturation hydraulique, eu égard au but d’intérêt général poursuivi tenant à la protection de l’environnement, l’abrogation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété tel que protégé par l’article 1er du premier protocole.
Puis, elle écarte l’inconventionnalité de la loi résultant de l’atteinte alléguée au principe de sécurité juridique reconnu par le droit de l’Union européenne, inconventionnalité invoquée pour engager la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi inconventionnelle29. Pour ce faire, elle relève que le législateur a limité l’interdiction posée au recours à la seule technique de la fracturation hydraulique de la roche et que l’obligation d’abroger les permis de recherches délivrés antérieurement à son intervention ne concerne que les titulaires qui ne satisfont pas à leurs obligations déclaratives ou indiquent, dans leur déclaration, recourir à des forages suivis de la fracturation hydraulique de la roche. Dès lors, la cour rejette la demande fondée sur le caractère inconventionnel de la loi résultant d’une atteinte au principe de sécurité juridique reconnu par le droit de l’Union européenne. Puis, après avoir constaté que le silence de la loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre, ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques30, elle déduit de plusieurs rapports, qui ne préconisent pas une interdiction de principe au recours à la technique de la fracturation hydraulique de la roche mais seulement un strict encadrement de celle-ci ainsi qu’une phase expérimentale en vue de mieux en évaluer et maîtriser les impacts et qui concluent à l’absence de cas avérés de pollution des nappes phréatiques liée à l’utilisation de cette technique, que l’activité en cause ne saurait être regardée comme une activité intrinsèquement nuisible ou dangereuse. Elle en conclut que l’interdiction soudaine par le législateur du recours à la fracturation hydraulique et la remise en cause des autorisations précédemment accordées engage la responsabilité de l’État.
Enfin, la cour recherche si le préjudice de la société présente un caractère anormal et spécial31 et constate compte tenu de ce qui précède son existence après avoir estimé que la loi de 2011 n’excluait pas toute indemnisation des titulaires des permis abrogés. Néanmoins, en l’espèce, elle rejette la demande d’indemnisation du manque à gagner en raison du caractère éventuel du préjudice ainsi invoqué. Toutefois, la cour ordonne une expertise afin d’évaluer le préjudice résultant des frais que la société a engagés pour l’obtention et la gestion des permis exclusifs de recherches abrogés en application de cette loi.
Sylvie MÉGRET
VIII – La cour fait application des critères d’imputabilité de l’infection de type « myofasciite » à la vaccination obligatoire contre l’hépatite B
CAA Versailles, 25 avr. 2017, n° 12VE00943, Mme D. La question de la responsabilité de l’État en cas de vaccination professionnelle obligatoire, contenant un adjuvant aluminique, notamment le vaccin contre l’hépatite B, repose, faute de certitude scientifique, sur l’établissement d’un lien de causalité présomptif entre les symptômes constatés et la vaccination effectuée. Partant, afin de rationaliser ce contentieux indemnitaire des plus délicats, le Conseil d’État a posé différentes combinaisons de critères d’imputabilité pour chaque type d’affection observée. Concernant les affections de type « myofasciite à macrophages », le Conseil d’État a jugé32 que le lien de causalité est établi, et donc la responsabilité étatique engagée, sous réserve de la réunion de quatre critères, à savoir : la présence de lésions musculaires de myofasciite à macrophages aux points d’injection ; le développement par la personne vaccinée des symptômes de la myofasciite à macrophages, notamment une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires, des troubles du sommeil ainsi que des troubles cognitifs ; l’apparition de ces symptômes doit se faire dans un délai raisonnable33 suite à la vaccination, ou bien il doit être fait preuve d’une aggravation anormale et imprévisible des troubles s’ils sont apparus antérieurement à celle-ci ; enfin, ces troubles primaires ou aggravés ne doivent pas résulter d’une autre cause que la vaccination.
Dans tous les cas, la preuve du lien causal, qui doit être apportée par le demandeur34, peut être faite par tous moyens35. En l’espèce, la requérante a subi plusieurs vaccinations professionnelles obligatoires contre l’hépatite B contenant de l’aluminium. Si aucunes lésions musculaires de myofasciite à macrophages n’a aété trouvée, la requérante a néanmoins, dans un délai raisonnable suivant les vaccinations, développé différents symptômes assimilables à ceux de la myofasciite à macrophages, à savoir : une importante fatigue, des troubles du sommeil, notamment une narcolepsie, des douleurs musculaires, des troubles moteurs, des vertiges ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire. Ces symptômes l’ont conduite à être licenciée pour inaptitude. Estimant ainsi être affectée d’une myofasciite à macrophages dont la survenance est imputable aux vaccins reçus, la requérante fait une demande indemnitaire auprès du ministre de la Santé, qui la rejette, tout comme le juge administratif de première instance, saisi à sa suite. Ayant interjeté appel, la requérante demande alors à la cour administrative d’appel de Versailles d’assouplir sa lecture de la jurisprudence de 2012, considérant « qu’un faisceau d’indices et l’absence de preuve contraire doivent (…) suffire pour retenir l’imputabilité de troubles à la vaccination »36. Notamment, elle demande que le critère relatif à la présence de lésions musculaires de myofasciite à macrophages aux points d’injection, ne soit pas strictement exigé lorsqu’il est fait état d’un doute sur la zone d’injection, lorsque l’existence d’une myofasciite à macrophages est induite par des prédispositions génétiques, et lorsqu’une expertise médicale, même ancienne, établit l’imputabilité des troubles développés aux vaccinations reçues, malgré l’absence de lésions musculaires. En réponse, la cour fait une stricte application des critères de 2012. Le juge considère ainsi, que, puisqu’aucune des expertises menées n’a révélé la présence de lésion musculaire caractéristique aux points d’injection généralement pratiqués, puisqu’aucun élément médical attestant de l’existence d’une autre zone d’injection n’a été apporté, et puisqu’aucun élément probant n’est apporté concernant une quelconque prédisposition génétique au développement d’une myofasciite à macrophages chez la requérante, le critère jurisprudentiel de 2012 exigeant la présence de lésions musculaires caractéristiques aux points d’injection est totalement opérant et fonde, par sa seule absence, le rejet de la requête. Malgré les différents éléments apportés, le doute n’a pas bénéficié à la requérante, montrant ainsi la volonté de la cour de s’en tenir à la lettre de la jurisprudence du Conseil d’État. Cependant, force est de constater que l’argument de la prédisposition génétique est « troublant », de l’aveu même du rapporteur public. Si la cour est restée passive, le Conseil d’État pourrait saisir cette occasion d’être « troublé » à son tour ; à charge pour lui d’infléchir sa jurisprudence de 2012.
Anaëlle BOSSIÈRE
IX – La délivrance d’un nouveau permis de construire n’entraîne pas automatiquement un non-lieu à statuer sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un précédent permis délivré au même bénéficiaire sur le même terrain d’assiette
TA Versailles, 10 nov. 2017, n° 1400478, Mme B. Le tribunal était saisi de huit requêtes dirigées contre trois arrêtés par lesquels le maire de la commune de Poissy a délivré, dans un premier temps, un permis de construire valant permis de démolir et, dans un second temps, deux permis de construire modificatifs n° 2 et n° 3 (le 1er ayant été retiré), le tout portant sur une opération immobilière d’habitation. Le troisième permis modificatif était identique au deuxième, son seul apport étant de régulariser des vices de procédure entachant ce dernier. Le pétitionnaire a donc soutenu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le deuxième permis de construire modificatif, le troisième s’étant substitué à lui.
Le tribunal, qui a rejeté les huit requêtes, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, dans sa version applicable aux deux permis de construire modificatifs, pour écarter le non-lieu à statuer. Aux termes de ces dispositions : « (…) le permis de construire ou d’aménager (…) ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de 3 mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Cette rédaction implique qu’un permis ne puisse pas être regardé comme implicitement retiré par un nouveau permis si celui-ci est accordé plus de 3 mois après son édiction et sans que cela fasse l’objet d’une demande expresse du pétitionnaire.
L’interprétation ainsi retenue peut apparaître en contradiction avec la jurisprudence récente du Conseil d’État. En effet, même après la réforme de 2007, le Conseil d’État a jugé qu’en référé, la délivrance d’un nouveau permis de construire a, « implicitement mais nécessairement », pour effet de rapporter le permis de construire accordé par le premier arrêté et de mettre fin aux effets de l’ordonnance attaquée. Par suite, alors même que ce nouveau permis de construire serait encore susceptible d’être annulé, le pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance ayant suspendu le premier arrêté devient sans objet37. Cet arrêt semble laisser subsister la solution jurisprudentielle antérieure à la réforme de 2007 selon laquelle il n’y avait plus lieu de statuer sur un permis de construire lorsqu’un nouveau permis, devenu définitif, était délivré au même bénéficiaire sur le même terrain. La formule consacrée était que le second permis « a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis »38.
Les termes de l’abstract de l’arrêt du 23 juin 2014 ont toutefois conduit le tribunal à estimer que la solution qu’il retient est confinée au domaine de la cassation en matière de référé, et n’a ni pour objet ni pour effet d’infléchir la portée des dispositions à valeur législative issues de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, en dehors de ce cas précis. Cette interprétation peut être confortée par le rapprochement avec deux décisions antérieures. La première a retenu le non-lieu dans le cas d’un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de rejet d’une demande de suspension, soit lorsque la décision en litige a été retirée postérieurement à l’introduction du pourvoi39. La seconde a jugé qu’un appel contre un jugement ayant accordé le sursis à exécution d’un permis de construire se trouvait privé d’objet en raison de l’intervention en cours d’instance d’un jugement rejetant une demande de sursis à exécution formée contre un nouveau permis de construire s’étant substitué à celui en litige40.
Naïla BOUKHELOUA
X – La radiation d’un fonctionnaire territorial pour abandon de poste est illégale en raison de l’absence de déclaration explicite d’aptitude à l’emploi
CAA Versailles, 26 oct. 2017, n° 16VE00388, Cne de Romainville c/ Mme V. Le présent arrêt témoigne de la vivacité du contentieux lié à la « technique controversée »41 de la radiation pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable, qui subsiste comme « un îlot »42 au sein du droit de la fonction publique, protecteur des droits des agents. La question de la légalité d’une telle mesure se trouve au cœur du litige.
Après un congé longue maladie, suite à l’avis du comité médical départemental du 2 octobre 2014, Mme V., agent public d’entretien titulaire, est déclarée apte à reprendre ses fonctions. C’est en mi-temps thérapeutique qu’elle est placée. Elle est affectée, afin de tenir compte de ses contraintes horaires personnelles, à partir du 1er décembre 2014, dans une école.
Au lendemain de la date de la fin du congé maladie ordinaire, du 24 novembre 2014 au 7 décembre 2014, Mme V. n’a pas rejoint son poste. Ce jour-là, le 8 décembre 2014, elle a adressé à la commune employeur une demande de congés annuels du 8 au 30 décembre 2014 qui lui a été refusée. Depuis lors, l’agent se trouvait donc dans une situation d’absence injustifiée. Avant le 5 janvier 2015, date de réception du courrier envoyé le 26 décembre 2014 par le maire de la commune employeur la mettant en demeure de reprendre ses fonctions sous 15 jours, Mme V. lui fait parvenir, le 30 décembre 2014, un avis d’interruption de travail pour maladie couvrant la période du 30 décembre 2014 au 7 janvier 2015. À l’issue d’un renouvellement, ce dernier a pris fin le 23 janvier 2015. La commune employeur recourt à une contre-visite médicale le 6 janvier 2015. Au regard de son résultat, le maire, par un arrêté, le 21 janvier 2014, prononce la radiation des cadres pour abandon de poste à l’encontre de Mme V. Cette dernière saisit le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 11 décembre 2015, annule l’arrêté du maire, enjoint à la commune de réintégrer l’agent et met à la charge de la commune une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. La commune relève appel de ce jugement. L’arrêt de la cour administrative d’appel suscite intérêt à trois égards au moins.
Premièrement, il met l’accent sur l’appréciation d’une maladie en tant que cause permettant de légitimer l’absence. « Déserter son service »43 témoigne qu’un fonctionnaire rompt de sa propre initiative le lien avec le service44. Pour apprécier si un tel abandon a lieu, une mise en demeure de reprendre les fonctions dans un délai approprié est notifiée à l’intéressée. Cet acte doit être écrit et contenir la précision sur le risque encouru45. La présentation par un agent dans ce délai d’un arrêt maladie est de nature à justifier l’absence de reprise de ses fonctions. Pour cette raison, en l’espèce, un avis d’interruption de travail pour maladie envoyé le 30 décembre 2014 permet de maintenir le lien avec le service.
Deuxièmement, la décision met en relief le fait qu’une attestation produite par un médecin agréé doit être formulée de manière explicite. L’arrêté prononce la radiation pour abandon de poste à la suite d’une contre-visite médicale dont le résultat ne peut fonder un tel dénouement. Le médecin agréé se borne à relever que l’arrêt maladie était en lien avec un antérieur congé de longue maladie de Mme V. et qu’un aménagement de poste et des horaires mettrait fin aux arrêts en cours. Ainsi, il n’établit ni que l’arrêt maladie en cours manque de justification au regard de son état de santé ni qu’elle est apte à reprendre son poste d’agent d’entretien auquel elle avait été affectée le 1er décembre 2014. Une telle formulation, contenue dans une attestation d’un médecin agréé, ne constitue pas un fondement permettant la remise en cause des congés maladie en cours. En outre, la déclaration, le 9 juin 2015, par le comité médical départemental de son aptitude à exercer les fonctions au poste d’agent d’entretien n’a pas d’incidence sur la justification médicale de janvier 2015.
Troisièmement, le sens de la décision induit, de manière sous-jacente, le strict respect de la procédure. Pour que la radiation pour abandon de poste soit légale, même si l’appréciation par la cour du sens de l’attestation du médecin agréé avait été effectuée dans un sens contraire, encore aurait-il fallu qu’une nouvelle mise en demeure soit adressée par le maire à Mme V. car la remise en cause des congés maladie n’a d’effet que pour l’avenir46.
Au regard de tous ces éléments, la cour n’a pu que rejeter la requête de la commune employeur.
Katarzyna KMONK
XI – Extension aux tiers à un permis de construire du principe selon lequel une décision individuelle ne peut être indéfiniment contestée
TA Versailles, 15 févr. 2017, n° 1402665, M. V. c/ Cne de Saint-Germain-en-Laye. La présente espèce fait une application remarquable du principe de sécurité juridique en matière d’annulation d’un permis de construire délivré en 2007 par le maire de Saint-Germain-en-Laye. Le requérant faisait valoir un défaut d’affichage continu du permis de construire délivré à ses voisins et notamment une indication erronée du délai de recours empêchant donc son déclenchement. La saisine du juge plus de 6 années après l’affichage du permis de construire conduit le tribunal administratif de Versailles à concilier l’information suffisante des tiers sur les délais de recours et l’exigence de stabilité des situations juridiques. Pour ce faire, le tribunal examine au fond les prétentions du requérant sans lui opposer de fin de non-recevoir et applique la jurisprudence du Conseil d’État Czabaj47 précisant que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle par son destinataire. Le jugement étend donc aux tiers ce principe, faisant ainsi bénéficier le titulaire du permis de construire d’un droit à la sécurité juridique.
I – L’opposabilité du principe de sécurité juridique à un tiers en matière de permis de construire.
Le tribunal poursuit dans « la dialectique qui oppose le principe de légalité et l’exigence de stabilité des situations juridiques »48. Conformément à l’article R. 421-5 du Code de justice administrative ayant codifié le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’Administration et les usagers49, les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. On sait qu’à défaut de mention, le délai de recours ne court pas. Cette solution s’applique également, comme dans cette affaire, dans le cas d’une indication erronée du délai de recours. En l’espèce, le panneau d’affichage dudit permis de construire contesté faisait référence à l’article R. 490-7 du Code de l’urbanisme qui n’était alors plus en vigueur et qui fixait de façon différente le point de départ du délai de recours contentieux. Le tribunal en déduit logiquement que l’information des tiers n’avait pas été correctement satisfaite n’entraînant donc pas le déclenchement du délai de saisine du juge. Dans pareille hypothèse, si le défaut d’information des tiers sur les voies et délais de recours ne permet pas que leur soit opposé ce délai, le tiers ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, en règle générale, ne saurait excéder 1 an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision. Cette solution issue de la décision Czabaj est étendue aux tiers et était déjà préconisée par le rapporteur public ayant conclu sous cette affaire faisant valoir la nécessité de ne pas « exposer les autorisations à une insécurité juridique excessive en accordant aux tiers une faculté de recours indéfinie (…) refusées aux destinataires des mêmes décisions »50.
C’est donc très logiquement que le tribunal a suivi les conclusions du rapporteur public Nathalie Syndique conduisant à déclarer irrecevables les conclusions dirigées contre l’arrêté adopté le 6 novembre 2007 par le maire de Saint-Germain-en-Laye. Cette décision s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle de la haute assemblée qui, ces dernières années, tend à protéger des situations consolidées par l’effet du temps empêchant qu’on puisse remettre en cause sans condition de délai des décisions individuelles créatrices de droit51.
II – Une application classique de la théorie du retrait des actes administratifs créateurs de droit en matière de permis de construire.
Le requérant demandait par ailleurs l’annulation de la décision ayant rejeté son recours gracieux en date du 7 avril 2014 tendant au retrait du permis de construire délivré en 2007. Pour ce faire, il invoquait l’existence d’une fraude entachant le permis de construire dont les allégations ne sont pas tenues pour établies par le tribunal. Ce dernier rappelle qu’en l’absence de fraude, le maire était tenu de ne pas procéder au retrait du permis de construire sans méconnaître les droits acquis du bénéficiaire. Il s’agit là d’une application a contrario de la jurisprudence Ternon52 fixant un délai de 4 mois pour procéder au retrait d’une décision individuelle créatrice de droits si elle est illégale, aujourd’hui reprise à l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’Administration. Or, l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme institue un délai spécifique de 3 mois pour retirer un permis de construire qui ne peut avoir lieu qu’à la double condition que le permis soit illégal et que le délai de retrait ne soit pas expiré. En l’espèce, la fraude ayant été écartée et le délai expiré, le maire était logiquement et nécessairement tenu de rejeter la demande de retrait53.
Cette solution doit, à bien des égards, être saluée. Elle parvient à concilier tout à la fois le droit au recours effectif, les intérêts d’une bonne administration de la justice et la stabilité des situations administratives protégeant aussi bien l’Administration que les justiciables.
Tania EINAUDI
XII – Le tribunal précise la nature du contrôle qu’il exerce dans le contentieux des examens (baccalauréat). S’il confirme le contrôle restreint de la notation, il admet toutefois de contrôler pleinement le respect de la procédure
TA Versailles, 30 juin 2017, n° 1607414, M. C. Un candidat a obtenu la note de huit sur vingt à l’épreuve de mathématiques du baccalauréat. Il a par la suite obtenu la même note au rattrapage. Son père a formé un recours gracieux auprès du service interacadémique des examens et concours (SIEC) d’Île de France afin d’obtenir la révision de la note de son fils à l’écrit et à l’oral. Ce dernier a été rejeté par deux décisions conjointes des 12 et 23 septembre 2016. Le requérant a saisi le tribunal administratif d’un recours afin d’obtenir l’annulation de ces décisions, assortie d’une injonction d’exécution avec astreinte. Il soutient que la copie de l’examen écrit est irrégulière en ce qu’aucun point n’a été attribué à l’exercice numéro trois, ce qui ne permet pas de vérifier la note finale sur vingt. Il soutient également que l’épreuve orale de rattrapage de mathématiques est irrégulière en ce qu’elle a duré moins que les vingt minutes prévues par une circulaire du ministre de l’Éducation nationale du 3 avril 2012. Le SIEC d’Île de France a contesté ces moyens en arguant qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyait que la note globale doive se déduire de la correction détaillée, et qu’aucune pièce ne permettait d’établir le fait que l’examen oral ait duré moins de vingt minutes, durée indicative au surplus. Il conteste également la compétence territoriale du tribunal.
En premier lieu, le tribunal statue sur sa compétence territoriale. Il estime que le recours contentieux dirigé contre le rejet de la demande gracieuse de révision de la note vise en réalité à contester la délibération du jury. Dès lors, le tribunal est compétent dans la mesure où le siège de l’autorité administrative visée ressort de son périmètre de compétence. Cette solution s’explique aisément par le fait que le SIEC d’Île de France ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause la délibération d’un jury. Il ne pouvait donc faire droit au recours gracieux exercé par le requérant. Le juge administratif en a tiré toutes les conséquences en estimant que la délibération était indirectement contestée.
En deuxième lieu, le juge a confirmé sa réticence à contrôler les notations d’examen. Il fait application d’une jurisprudence constante54, se bornant à exercer un contrôle restreint de la note. Il précise ainsi qu’aucun texte ni principe ne prévoit que la note globale d’une épreuve doive se justifier à partir des notes de chacun des exercices la constituant, sous peine d’irrégularité. Le juge administratif préserve ainsi la souveraineté du jury, en estimant que ce dernier n’a pas à justifier de l’application d’une méthode de notation. Si cette position prétorienne soulève certaines interrogations doctrinales, elle semble toutefois s’expliquer par la nature du contrôle exercé par le juge administratif ; lequel ne se situe pas ici sur le terrain de la matérialité des faits, mais sur celui de leur qualification juridique55.
En troisième lieu, le juge administratif innove toutefois en acceptant de contrôler pleinement le respect de la procédure des examens. Il considère ainsi que les modalités sont fixées par la circulaire du ministre de l’Éducation du 3 avril 2012, dotée d’une portée réglementaire. Dès lors, il accepte de contrôler le respect de cette dernière, limitant ainsi le pouvoir d’appréciation du jury. Il estime que la mention par l’examinateur des heures de début et de fin de l’épreuve sur le bordereau constitue « une garantie pour le candidat dont le défaut entraîne la nullité de l’épreuve ». Il fait donc de cette garantie une règle substantielle, qui, en application de jurisprudence établie56, entraîne la nullité de la délibération du jury. Il tempère toutefois cette avancée en précisant qu’une durée de passage à l’examen inférieure à la durée réglementaire n’entraîne pas la nullité de l’examen dès lors qu’elle a été suffisante au jury pour évaluer le candidat. Le tribunal fait ainsi œuvre de compromis en conciliant la protection des droits et garanties des administrés avec la souveraineté des jurys.
Lauriane TANGUY
Notes de bas de pages
-
1.
CJUE, 6e ch., 26 juin 2003, n° 305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH : RJF 10/03, n° 1193.
-
2.
CE, 22 déc. 1989, n° 86113, Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier : RJF 2/90, n° 130.
-
3.
CJUE, 3e ch., 28 oct. 2010, n° 175/09, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs c/ Axa UK plc : RJF 2/11, n° 258 – CJUE, 3e ch., 27 oct. 2011, n° 93/10, Finanzamt Essen-NordOst c/ GFKL Financial Services AG : RJF 1/12, n° 88.
-
4.
CE, 19 déc. 1988, n° 100175, Min. c/ Furminieux : Lebon T. ; RJF 2/89, n° 248.
-
5.
CAA Versailles, 9 déc. 2014, n° 14VE00567, ministre de l’Économie et des Finances c/ Sté Marriott Rewards Llc.
-
6.
CAA Paris, 16 mai 2007, n° 07-234, Sté Abbey National Treasury Services : RJF 3/08, n° 365 – CE, 8e sous-sect., 12 déc. 2007, n° 307970, Sté Abbey National Treasury Services : RJF 3/08, n° 365, concl. Olléon L. ; BDCF 3/08, n° 43.
-
7.
CAA Marseille, 5 oct. 2009, n° 09MA01353, communauté d’agglomération de Montpellier.
-
8.
TA Montreuil, 2 mai 2016, n° 1505076.
-
9.
CE, 20 mars 2013, n° 346642, Piazza, cons. 5.
-
10.
Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-70 QPC, M. Pierre-Yves M. [Lutte contre l’évasion fiscale], cons. 4.
-
11.
CAA Versailles, 30 déc. 2014, n° 12VE03396, M. et Mme C., cons. 5. V., dans le même sens, et avant l’arrêt commenté, CAA Nancy, 12 déc. 2017, n° 16NC01007, M. A. C., cons. 9.
-
12.
Cons. const., 29 déc. 1999, n° 99-424 DC, loi de finances pour 2000, cons. 54.
-
13.
CE, 7 déc. 2015, n° 368227, Min. c/ Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL, cons. 3.
-
14.
Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC, Codification par ordonnance, cons. 13.
-
15.
TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2011, n° 0708716.
-
16.
CAA Versailles, 21 mai 2013, n° 11VE02628.
-
17.
CE, 10 févr. 2016, n° 371258, SA Hôtels et Casino de Deauville.
-
18.
CE, 16 juin 2004, n° 235647, SA Imprimerie Borel.
-
19.
CE, 26 sept. 2011, n° 328762, Min. c/ SARL Holding Financière Séguy.
-
20.
CE, 10 févr. 2016, n° 371258, préc., cons. 2.
-
21.
CE, 26 juin 2006, n° 294505, Mme X, Mlle H : Lebon, p. 279 ; CE, 26 mars 2012, n° 340466, Mme D : Lebon, p. 128 ; CE, 23 mai 2012, n° 352534, GISTI ; CE, 15 mai 2013, n° 340554, Cne de Gurmençon, s’agissant même d’un moyen d’ordre public : Lebon, p. 741.
-
22.
V. au contraire en matière fiscale, Cons. const., 4 déc. 2015, n° 2015-503 QPC, pts 14, 15 et 16 ; Cons. const., 26 juin 2015, n° 2015-473 QPC, pt 6, ou en matière pénale, Cons. const., 18 nov. 2011, n° 2011-191/194/195/196/197 QPC, pt 20 ; Cons. const., 17 déc. 2010, n° 2010-62 QPC, pt 7.
-
23.
TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2017, n° 1503174 ; TA Cergy-Pontoise, 25 avr. 2017, n° 1503955.
-
24.
CE, 5 oct. 2007, n° 294318, Sté C : Dr. fisc. 2010, 47, comm. 993; RJF 12/07, n° 1479.
-
25.
CE, 27 mai 2002, n° 205634, Assoc. Comité Colbert : RJF 8-9/02, n° 925.
-
26.
C. patr., art. L. 524-14.
-
27.
CE, 28 déc. 2009, n° 304802 : Lebon, p. 509.
-
28.
CE, 19 avr. 1974, n° 82518, Sté Entreprises Louis Segrette : Lebon T., p. 1052 – CE, sect., 10 avr. 2008, n° 244950, Sté Decaux et département des Alpes-Maritimes : Lebon.
-
29.
CE, ass., 8 févr. 2007, n° 279522, Gardedieu, p. 78.
-
30.
CE, ass., 14 janv. 1938, Sté anonyme des produits laitiers « La Fleurette » – GAJA ; CE, 2 nov. 2005, n° 266564, Coopérative agricole Ax’ion : Lebon.
-
31.
CE, ass., 14 janv. 1938, Sté anonyme des produits laitiers « La Fleurette ».
-
32.
CE, 21 nov. 2012, n° 344561.
-
33.
4 mois, v. not. CE, 4 juill. 2008, n° 299832 ; CE, 24 oct. 2008, n° 305622.
-
34.
CSP, art. L. 3111-9.
-
35.
CE, 6 nov. 2013, n° 345696.
-
36.
Comme l’indique Mme Orio, rapporteur public, que nous remercions pour la communication de ses conclusions.
-
37.
CE, 23 juin 2014, n° 366498, Sté C. : Lebon T.
-
38.
CE, 7 avr. 2010, n° 311694, SCI la T. : Lebon T.
-
39.
CE, 27 juill. 2001, n° 234146, SA S.
-
40.
CE, 30 avr. 1993, nos 122075, 122096 et 133115, Cne d’Arcangues.
-
41.
Melleray F., Droit de la fonction publique, 4e éd., 2017, Paris, Économica, p. 339.
-
42.
Glaser E., concl. sur CE, 24 nov. 2003, n° 242443, Cne de Laroque d’Olmes : BJCL 2004, p. 121, cité par Melleray F., Droit de la fonction publique, préc.
-
43.
L’expression est de R. Matta-Duvignau (« La radiation des cadres pour abandon de poste », AJFP 2014, p. 105).
-
44.
CE, 21 avr. 1950, Gicquel : Lebon, p. 225 – CE, 26 févr. 1959, Dame Maïza Khelidja : AJDA 1960, p. 49.
-
45.
CE, sect., 11 déc. 1998, Casagranda : Lebon, p. 474.
-
46.
CE, 16 nov. 1992, n° 93928, min. du Budget c/ M. Malbrunot.
-
47.
CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj : Lebon ; AJDA 2016, p. 16, chron. Dutheillet de Lamothe L. et Odinet G. ; RFDA 2016, p. 927, concl. Henrard O.
-
48.
Henrard O., concl. sous CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj : RFDA 2016, p. 927.
-
49.
D. n° 83-1025, 28 nov. 1983, concernant les relations entre l’Administration et les usagers : JO, 3 déc. 1983, p. 3492.
-
50.
Concl. préc.
-
51.
CE, sect., 15 juill. 2004, n° 266479, Épx Damon : Lebon, p. 331 ; AJDA 2004, p. 1926 – CE, 22 janv. 2015, n° 382902, EURL 2B : AJDA 2015, p. 880 – CE, 15 avr. 2016, n° 375132, Marcon, confirmant une solution dégagée par CE, 27 juill. 2005, n° 278337, Épx Marchand.
-
52.
CE, ass., 26 oct. 2001, n° 197018, Ternon : Lebon, p. 497 ; AJDA 2001, p. 1037 ; AJDA 2001, p. 1034, chron. Guyomar M. et Collin P. ; AJDA 2002, p. 738, étude Gaudemet Y. ; RFDA 2002, p. 77, concl. Séners F. ; RFDA 2002, p. 88, note Delvolvé P. ; Rev. UE 2015, p. 370, étude Eckert G.
-
53.
V. en ce sens, CE, 27 janv. 2016, n° 385448, Montserrat.
-
54.
CE, 7 nov. 2006, Langlois ; plus récemment, TA Melun, 29 nov. 2016, n° 1409374.
-
55.
CE, 4 avr. 1914, Gomel ; CE, 14 janv. 1916, Camino.
-
56.
CE, 23 déc. 2011, Danthony.