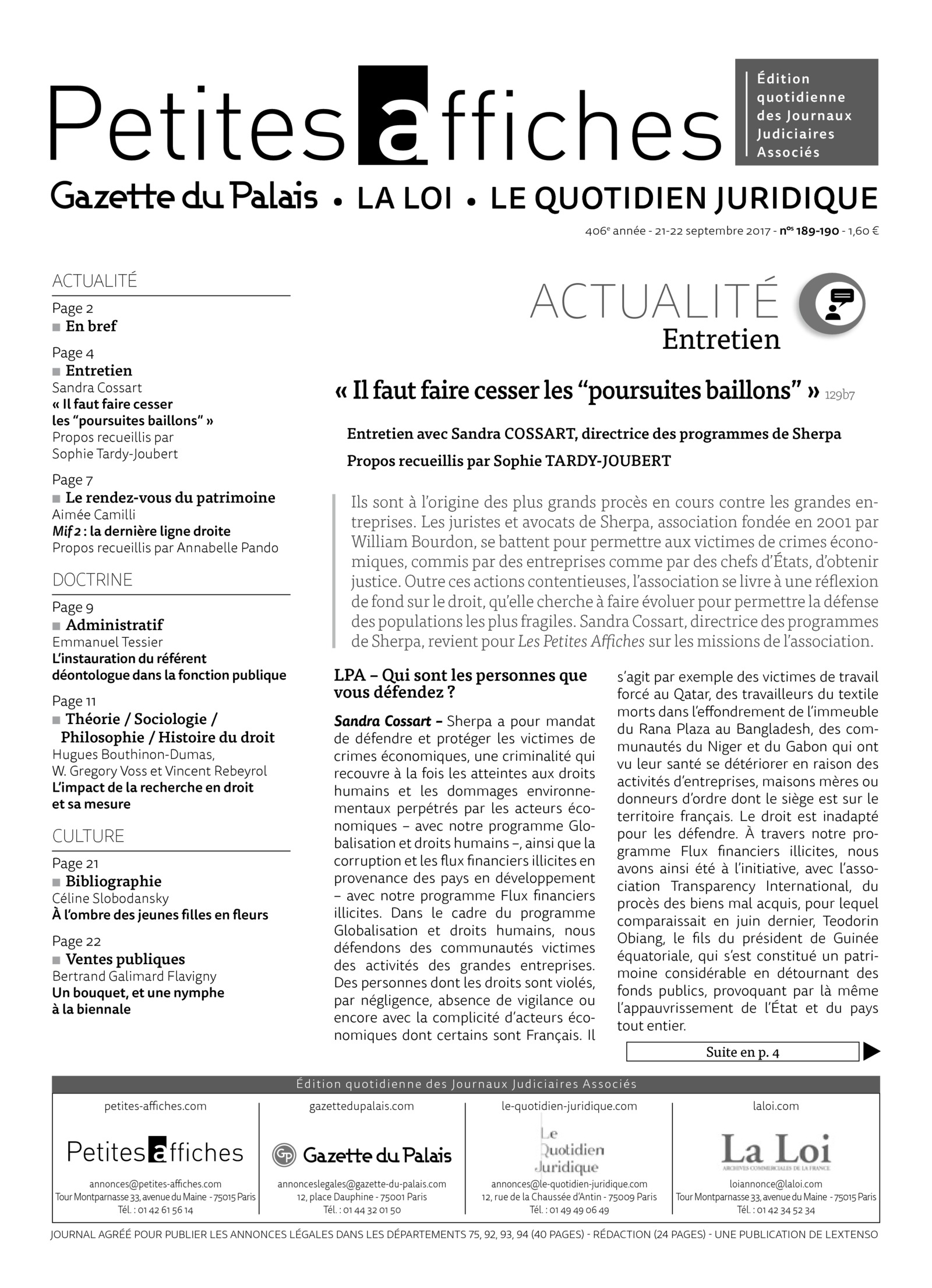« Il faut faire cesser les “poursuites baillons” »
Ils sont à l’origine des plus grands procès en cours contre les grandes entreprises. Les juristes et avocats de Sherpa, association fondée en 2001 par William Bourdon, se battent pour permettre aux victimes de crimes économiques, commis par des entreprises comme par des chefs d’États, d’obtenir justice. Outre ces actions contentieuses, l’association se livre à une réflexion de fond sur le droit, qu’elle cherche à faire évoluer pour permettre la défense des populations les plus fragiles. Sandra Cossart, directrice des programmes de Sherpa, revient pour Les Petites Affiches sur les missions de l’association.
LPA – Qui sont les personnes que vous défendez ?
Sandra Cossart – Sherpa a pour mandat de défendre et protéger les victimes de crimes économiques, une criminalité qui recouvre à la fois les atteintes aux droits humains et les dommages environnementaux perpétrés par les acteurs économiques – avec notre programme Globalisation et droits humains –, ainsi que la corruption et les flux financiers illicites en provenance des pays en développement – avec notre programme Flux financiers illicites. Dans le cadre du programme Globalisation et droits humains, nous défendons des communautés victimes des activités des grandes entreprises. Des personnes dont les droits sont violés, par négligence, absence de vigilance ou encore avec la complicité d’acteurs économiques dont certains sont Français. Il s’agit par exemple des victimes de travail forcé au Qatar, des travailleurs du textile morts dans l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza au Bangladesh, des communautés du Niger et du Gabon qui ont vu leur santé se détériorer en raison des activités d’entreprises, maisons mères ou donneurs d’ordre dont le siège est sur le territoire français. Le droit est inadapté pour les défendre. À travers notre programme Flux financiers illicites, nous avons ainsi été à l’initiative, avec l’association Transparency International, du procès des biens mal acquis, pour lequel comparaissait en juin dernier, Teodorin Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, qui s’est constitué un patrimoine considérable en détournant des fonds publics, provoquant par là même l’appauvrissement de l’État et du pays tout entier.
LPA – En quoi le droit est-il inadapté pour défendre ces personnes ?
S. C. – Dans un contexte de mondialisation, les entreprises ne doivent plus pouvoir se cacher derrière les frontières. Or aujourd’hui, elles en ont la possibilité, car le droit a été pensé par et pour ces acteurs. En effet, la majorité des normes adoptées dans le monde régissant les affaires (droit fiscal, des sociétés, social, de la concurrence, de l’arbitrage, de la consommation, etc.) est directement le fruit du lobbying des entreprises. Les impacts sociaux et environnementaux de l’activité des sociétés transnationales ne peuvent, en l’état actuel du droit, être appréhendés efficacement. C’est notamment dû à un double concept fondamental du droit des sociétés, les principes d’autonomie juridique et de responsabilité limitée, qui ont pour effet d’isoler chaque membre d’un groupe transnational des conséquences civiles ou pénales de l’action des autres membres du groupe. Une société mère peut ainsi toucher les profits de ses filiales sans être responsable comptable des conséquences environnementales et humaines de leurs activités. Par ailleurs, très souvent, les juridictions des pays du Sud dans lesquels opèrent ces multinationales ne sont pas en mesure d’offrir réparation aux victimes. L’ADN de Sherpa, c’est non seulement de défendre ces populations impactées par l’activité de ces acteurs économiques, mais également de faire évoluer le cadre juridique pour qu’il colle davantage à la réalité économique.
LPA – Vous menez pourtant des actions contentieuses…
S. C. – Nous avons en effet initié une procédure contre Auchan, pour le drame du Rana Plaza au Bangladesh, et une autre contre Samsung, concernant le travail des enfants dans des usines chinoises, sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses. Nous voulions mettre en cause la chaîne de sous-traitance, mais nos plaintes ont été classées sans suite par le parquet. Dans l’affaire du Rana Plaza, nous nous sommes portés parties civiles dans l’affaire afin de permettre la désignation d’un juge d’instruction. Cependant, même si l’enquête se poursuit, nous obtiendrons dans le meilleur des cas la reconnaissance du fait que le consommateur français a été trompé par la publicité mensongère d’Auchan dans son code de bonne conduite. Cela ne permettra pas la réparation des victimes directes du Rana Plaza. Nous tentons toujours de contourner les obstacles juridiques mais l’accès à la justice de ces victimes est extrêmement difficile.
LPA – Comment êtes-vous financés ?
S. C. – Nous essayons d’élargir la liste de nos bailleurs pour assurer notre indépendance. Cependant pour vraiment remplir notre mandat, il faudrait que notre budget soit largement augmenté. Certains de nos projets ont été financés par l’Union européenne, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), le barreau de Paris ou encore certaines fondations anglo-saxonnes. Il est très difficile de faire financer des contentieux qui ont tendance à faire peur. Certains bailleurs craignent les procès potentiels en diffamation, ou pression de certains acteurs économiques. Mais nous n’acceptons pour des raisons évidentes pas d’argent des entreprises ni même de fondations d’entreprise, et cela nous limite évidemment mais permet d’assurer notre indépendance. Depuis peu, nous faisons appel à des dons du public, notamment lorsque nous déposons des plaintes, comme nous l’avons récemment fait contre Lafarge en Syrie pour financement de terrorisme ou contre la BNP pour complicité de génocide au Rwanda.
LPA – Les entreprises ont-elles pour habitude d’attaquer ?
S. C. – Auparavant, en réponse à une procédure judiciaire, déposée notamment par des associations, et visant à dénoncer des actes de corruption ou de violations environnementales ou de droits humains ; les plus agressives d’entre elles se contentaient d’une procédure en diffamation et demandaient un euro symbolique de dommages et intérêts. Aujourd’hui, elles contre-attaquent dans des proportions inouïes. À titre d’exemple, Vinci a lancé six procédures contre Sherpa et certains de ses membres, sur des fondements comme la diffamation ou l’atteinte à la présomption d’innocence. Il s’agit de moyen d’intimidation des acteurs de la société civile car une seule condamnation pourrait dans certains cas faire taire les associations de défenses des droits de l’Homme ou de l’environnement. Nous ne sommes pas les seuls à subir ce type de poursuites. Un journaliste d’investigation de France 2, auteur d’un film sur Socapalm, s’est vu demander 50 millions d’euros sur le fondement du dénigrement. Ces poursuites se durcissent, à la fois sur les montants demandés et sur les fondements juridiques invoqués. Nous appelons cela les « poursuites baillons », car elles ont pour effet de faire taire les voix dissonantes.
LPA – Qui sont les personnes visées par ces “poursuites baillons” ?
S. C. – Elles visent les journalistes d’investigation, les défenseurs des droits de l’Homme, dont certains craignent pour leur vie. Elles tendent à s’étendre et visent même désormais des professeurs de droit qui sont poursuivis pour avoir commenté des arrêts dans un sens qui déplaît à l’entreprise. C’est toute une chaîne, depuis le terrain jusqu’aux universitaires, que l’on tente de déstabiliser. Cela induit un rétrécissement de la parole publique, et muselle des acteurs dont le discours sert pourtant l’intérêt général. Nous dénonçons ces pratiques mais nous ne nous contentons pas de dénonciation. Nous avons également une action de plaidoyer. Notre souhait est d’aboutir à des propositions pour changer le cadre juridique. Aujourd’hui, nous faisons des recommandations pour que soient interdites ces « poursuites baillons ». On pourrait par exemple considérer que c’est de l’abus de droit. La mobilisation pour faire cesser ces pratiques et restaurer la liberté de parole va être une de nos principales actions de plaidoyer cette année.
LPA – Comment faites-vous pour peser sur les orientations législatives ?
S. C. – Les ONG comme les syndicats mènent un travail de plaidoyer pour à la fois sensibiliser le grand public et les parlementaires sur ces thématiques. En 2013, une plate-forme nationale a été créée à l’initiative de la société civile, sous l’égide du Premier ministre pour mettre tous les acteurs de la RSE autour de la table. Notre volonté était évidemment que l’État puisse trancher entre des intérêts divergents et légiférer sur les pratiques des entreprises, mais cela ne s’est pas passé ainsi. S’en sont suivies deux années de discussions qui devaient se faire sur la base d’un consensus entre les parties. Or ce consensus est impossible ! La société civile demande des règles pour réguler l’activité des acteurs économiques et des sanctions dans le cas où elles ne seraient pas respectées. Les entreprises demandent, elles, que la RSE relève uniquement de normes volontaires. Il faut accepter que l’on ne soit jamais d’accord sur cette question de la régulation des acteurs du marché.
LPA – Quelle a été la contribution de Sherpa à cette plate-forme ?
S. C. – Nous avons pris part à ces discussions dès 2013, dans le cadre de deux groupes de travail. Au sein du premier, consacré à la chaîne de sous-traitance, nous avons notamment contribué à nourrir le débat sur le devoir de vigilance et fait part de notre expérience. En tant que praticiens du droit, nous en constatons quotidiennement les limites. Nous nous sommes particulièrement impliqués dans le deuxième groupe de travail, dont nous étions co-rapporteurs. Il avait pour but de mettre en place un plan d’application des principes directeurs votés par les Nations unies en 2011. Cela répond à une injonction de l’Union européenne, qui a demandé à chacun de ses États membres de penser un plan pour les appliquer. Ce groupe de travail a produit un avis de la plate-forme pour le plan national des droits de l’Homme. Ce document compte 70 pages, dont 60 pages de consensus. Lorsqu’en mai 2017, la France a adopté son plan national, le gouvernement n’a repris de nos travaux que les pages de consensus. Seules quelques propositions non consensuelles ont été reprises dans une annexe au rapport, mais ne correspondent en rien dans leur étendue et leur précision à celles présentes dans l’avis.
LPA – Pourquoi cette logique de consensus vous gêne-t-elle autant ?
S. C. – L’État a abandonné sa fonction de régulation et laisse les différentes parties prenantes s’arranger entre elles. On est passé d’une logique de régulation à une logique de co-régulation. Or en faisant de l’État une partie prenante comme une autre, on impose de fait une logique très libérale. Selon moi, l’État devrait reprendre sa place au centre de ces débats. La logique de consensus prévaut aujourd’hui dans tous les colloques consacrés à la RSE. Dernièrement encore, un cycle était consacré à ce sujet à la Cour de cassation. Dans le panel des tables rondes, on trouvait des entreprises et des universitaires, mais très peu de syndicats ou d’ONG. C’est symptomatique d’une manière de voir, qui met les entreprises au centre du débat et considère que leurs intérêts prévalent sur ceux des autres acteurs. De manière générale, la tendance actuelle est de prendre en considération l’entreprise en premier lieu, et de s’intéresser ensuite éventuellement aux autres parties, comme les salariés ou les communautés.
LPA – La loi sur le devoir de vigilance, adoptée en mars dernier, ne va-t-elle pas néanmoins vous ouvrir des perspectives ?
S. C. – Pour voir adopter ce texte, nous avons travaillé plusieurs années de façon très intensive lors des débats à l’Assemblée nationale pour apporter notre expertise juridique aux parlementaires. Le travail de plaidoyer s’est fait collectivement avec nos partenaires membres du forum citoyen pour la RSE – dont Amnesty International, le CCFD, les Amis de la Terre, la CGT et la CFDT. Notre travail commun a permis de peser sur le législateur. Nos propositions initiales allaient bien au-delà du texte adopté, mais nous sommes satisfaits de cette nouvelle loi. Elle crée, dans le Code de commerce, une obligation pour les grands acteurs économiques de mettre en œuvre un plan de vigilance. Cela concerne environ 120 entreprises, qui doivent désormais réellement réfléchir à la gestion de leurs risques pour éviter les dommages à l’environnement, la santé et les droits humains. S’il n’y a pas eu de rédaction de plan de vigilance, ou de mise en œuvre effective, l’entreprise peut être tenue pour responsable. Le lobby patronal a été particulièrement fort contre cette proposition, et nous avions également peur que le Conseil constitutionnel détricote cette loi sur le fondement de la liberté d’entreprendre, mais tel n’a pas été le cas, et le 23 mars, la loi a été adoptée.
LPA – Quelles étaient vos propositions initiales ?
S. C. – On voulait inverser la charge de la preuve. Aujourd’hui, il revient à un travailleur du Niger ou du Bangladesh d’apporter la preuve d’un dommage, et de démontrer qu’il est bien imputable à la maison mère. C’est ce que tente de faire Sherpa pour assister ces victimes depuis plus de 15 ans mais c’est extrêmement difficile. Nous avions proposé de demander plutôt à la maison mère de prouver qu’elle a tout mis en œuvre pour prévenir le dommage. Cette proposition a été rejetée par le législateur. Dans le contexte actuel, notre discours n’est pas toujours audible.
LPA – Poursuivez-vous le travail aujourd’hui ?
S. C. – Nous travaillons actuellement sur ce que devrait être le plan de vigilance idéal d’une entreprise et souhaitons que ce travail soit inclusif et reflète bien les demandes de toutes les parties prenantes. Nous poursuivons à cette fin notre collaboration avec nos partenaires syndicaux et associatifs. Nous essayons de montrer également que la France n’est pas le seul pays en Europe à prendre ce genre de dispositions. Des discussions similaires ont lieu en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas… Si l’opinion publique prend conscience de cela, nous pouvons espérer voir émerger un mouvement général de responsabilisation. Les acteurs économiques cherchent de plus en plus à se présenter comme des acteurs responsables. Les instruments volontaires ou dits « de droit mou » ont montré leurs limites. Il faut que les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements soient sanctionnées, que cela représente pour elles un coût économique, et que les entreprises qui sont vertueuses en retirent à l’inverse un avantage économique.