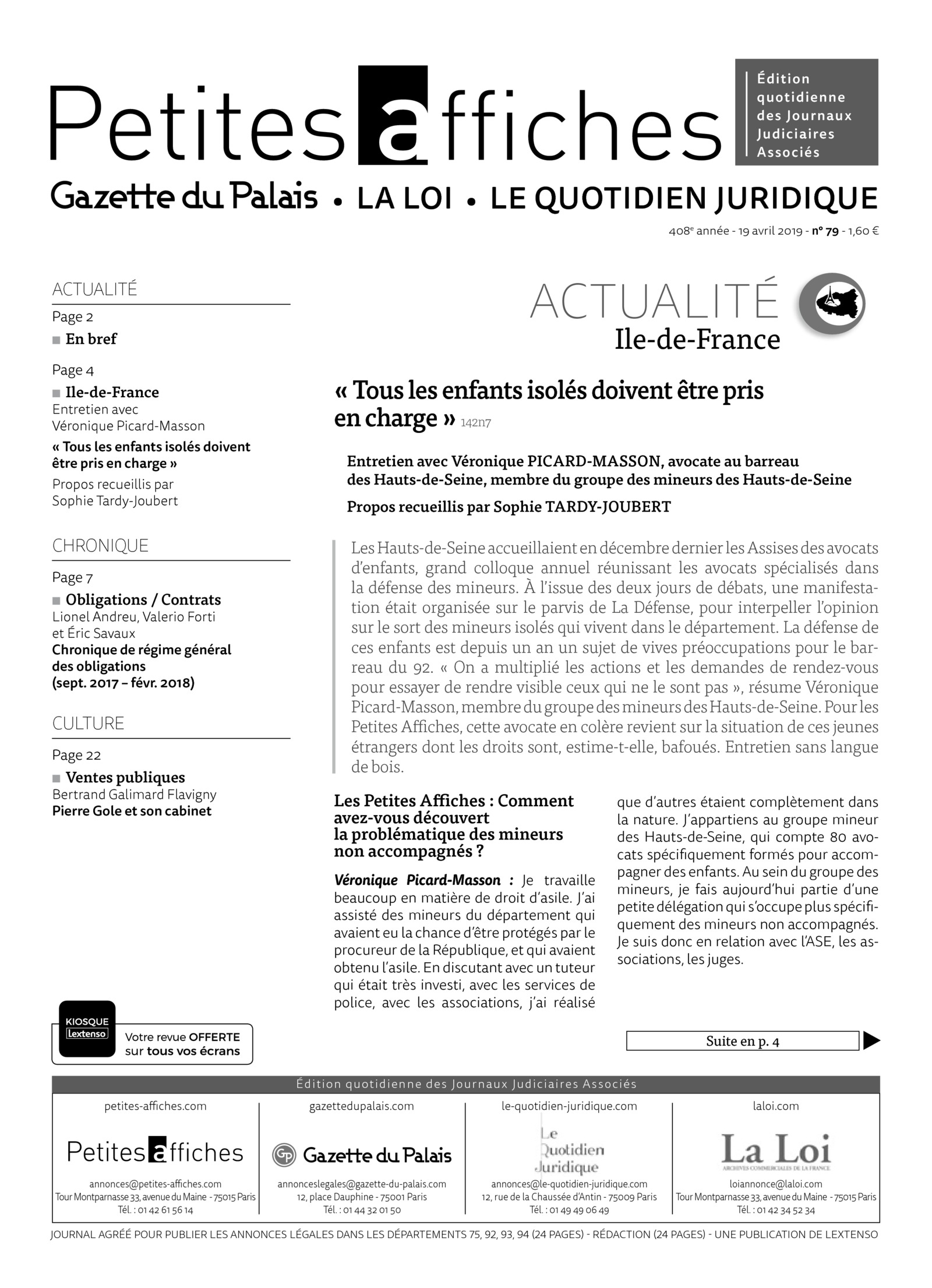Chronique de régime général des obligations (sept. 2017 – févr. 2018)
I – Les droits du créancier (…)
A – Le droit à l’exécution (…)
B – Les actions protectrices (…)
II – Les modalités de l’obligation
A – Les modalités temporelles (…)
B – Les modalités structurelles
La division de la dette solidaire entre les héritiers
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14583. Le sort de l’obligation solidaire en cas de décès de l’un des codébiteurs est techniquement complexe. Cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation l’illustre parfaitement.
Lors de son décès, A. avait laissé pour lui succéder deux héritiers, B. et C. L’un de ces deux héritiers, C., était à son tour décédé. Ce dernier avait trois héritiers : son épouse, C1, et leurs deux enfants C2 et C3. L’épouse, C1, avait saisi le juge en annulation de deux avis de mise en recouvrement correspondant au solde des droits dus au titre de la succession de A. ainsi qu’au salaire du conservateur des hypothèques. Pour rejeter la demande de l’épouse, C1, le juge avait énoncé que si, en application de l’article 1790 – alors qu’il s’agit en réalité de l’article 1709 – du Code général des impôts, les ayants-droit du cohéritier décédé deviennent débiteurs de la dette, ils peuvent, selon l’ancien article 1220 du Code civil, être poursuivis au paiement de leur part dans la dette solidaire divisible à leur égard, de sorte que la moitié de la dette initiale constitue l’obligation au paiement des héritiers de A., laquelle doit être distinguée de leur contribution finale à la dette. Un pourvoi avec un moyen unique composé de sept branches avait été formé. L’arrêt est cassé en s’appuyant sur les deux premières branches, mais uniquement la deuxième sera ici examinée. Après avoir rappelé qu’« il résulte de (l’ancien article 1220 du Code civil) que les héritiers du codébiteur solidaire ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu’au prorata de leurs droits respectifs dans sa succession appliqué à la dette globale », la première chambre civile décide que l’épouse, à savoir C1, « ne pouvait être poursuivie qu’au prorata de ses droits dans la succession de son époux ».
La solution est bien ancrée en jurisprudence. Elle se rencontre déjà au XIXe siècle1 et au début du XXe siècle2. La Cour de cassation la réaffirme régulièrement : « le décès de l’un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n’efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires ; (…) il en modifie seulement les effets pour les héritiers, tenus dans la proportion de leurs parts héréditaires »3 ; « les dettes d’une succession se divisent entre les héritiers qui n’en sont tenus personnellement qu’au prorata de leurs droits respectifs »4.
Cette solution est, pour partie, fondée sur l’ancien article 1220 du Code civil ou sur le nouvel article 1309 du même code. Bien que la formulation varie quelque peu, la règle est en effet la même : l’obligation solidaire se divise entre les héritiers. Il s’agit là d’un trait essentiel du régime de la solidarité, qui la distingue de l’indivisibilité et qui explique que le créancier souhaite souvent que l’obligation soit à la fois solidaire et indivisible. Là où la solidarité ne joue pas à l’égard des héritiers du débiteur solidaire, l’indivisibilité s’impose aux héritiers du débiteur, en ce sens qu’ils sont tenus au tout5.
Mais qu’est-ce à dire exactement ? Dire que la dette solidaire se divise entre les héritiers du codébiteur solidaire décédé, ce n’est pas dire qu’elle se divise entre le codébiteur survivant et les héritiers du codébiteur solidaire décédé. Concrètement, les deux aspects doivent être traités distinctement. Pris collectivement, les héritiers ne sont pas tenus uniquement de la part personnelle du défunt dans la dette globale, ils demeurent tenus de la totalité de cette dette globale. Pris individuellement, néanmoins, chaque héritier n’est tenu à l’égard du créancier que pour sa part, bien qu’elle soit calculée à partir de la dette globale. Pour le dire par l’exemple, si deux codébiteurs sont tenus solidairement d’une somme de 30 et que l’un d’eux décède laissant trois héritiers – dont les parts dans la dette sont par hypothèse égales –, chacun de ces héritiers est tenu pour 10 : la dette globale (30) est divisée par le nombre d’héritiers du codébiteur solidaire (3). Or, en l’espèce, le juge du fond avait appliqué ces règles de manière symétriquement inversée. Il avait considéré que, pris collectivement, les héritiers n’étaient tenus que pour la part personnelle du défunt dans la dette globale, à savoir la moitié de cette dette. Qui plus est, il avait jugé que pris individuellement, chaque héritier était tenu à l’égard du créancier pour la totalité de cette assiette, c’est-à-dire pour la moitié de la dette globale. En appliquant le raisonnement tenu par le juge au même exemple, chaque héritier aurait été tenu pour 15 : la dette globale (30) aurait été divisée par le nombre de codébiteurs solidaires originaires (2).
Cela étant dit, l’ancien article 1220 du Code civil ou le nouvel article 1309 du même code ne suffisent pas à fonder entièrement la solution rappelée par le présent arrêt. En effet, affirmer que la dette solidaire se divise entre les héritiers ne permet pas de savoir dans quelles proportions cette division opère. Le régime général des obligations étant muet sur ce point, c’est le droit des successions qui suggère un critère de division : l’article 837 du Code civil dispose que « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale (…) ». C’est de ce texte que la jurisprudence tire comme conséquence que les héritiers ne sont pas tenus à l’égard du créancier par parts égales, ils le sont au prorata de leurs droits respectifs dans la succession. En l’espèce, l’auteur du pourvoi, à savoir la veuve du codébiteur solidaire, non seulement n’était pas tenue pour la moitié de la dette globale, mais elle n’était probablement pas non plus tenue pour un tiers de la dette globale. Si par exemple l’épouse avait opté pour un quart de la succession en propriété, sa part s’élevait à un quart de la dette globale.
Valerio FORTI
Clause de solidarité réputée non écrite lors de la première cession du bail : sort en cas de nouvelle cession du même bail
Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-19131. L’arrêt rapporté est stimulant. Car il invite à s’interroger sur le sort de la clause instituant une solidarité passive dans un cas particulier : celui où le contrat contenant cette clause fait l’objet de deux cessions successives.
A. avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Dans ce cadre, son fonds de commerce, exploité dans des locaux donnés à bail, avait été acquis par B. B. avait par la suite cédé le fonds de commerce à C. Après un certain temps, C. avait cessé de payer les loyers et avait été mis en liquidation judiciaire. Le bailleur avait alors assigné B. en paiement des loyers, en se prévalant de la clause de garantie insérée au contrat de bail. Pour s’y opposer, B. avait fait valoir que cette clause devait être réputée non écrite en vertu de l’article L. 622-15 du Code de commerce, puisqu’il avait lui-même acquis le fonds, avec le droit au bail, dans le cadre de la liquidation judiciaire de A. Le juge avait tout de même condamné B. au paiement des loyers. Celui-ci s’était alors pourvu en cassation. Son pourvoi est rejeté au motif que « si l’article L. 641-12, alinéa 2, du Code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l’activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu’au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu’une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun ».
Commençons par rappeler la règle sur laquelle la chambre commerciale se fonde. L’article L. 641-12, alinéa 2 du Code de commerce dispose qu’en cas de liquidation judiciaire, « le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent », en ajoutant qu’« en ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite ». La même règle est posée à l’article L. 622-15 du Code de commerce pour les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. La raison d’être de la règle est simple : éviter que le passif du débiteur à l’encontre duquel la procédure collective est ouverte soit aggravé par des clauses de solidarité ayant pour objet des dettes futures6.
Passons maintenant à la question soumise à la chambre commerciale. La cession de bail dans le cadre d’une procédure collective conduit à réputer non écrite l’éventuelle clause de solidarité passive entre le cédant et le cessionnaire contenue dans le bail. Mais quid en cas de nouvelle cession du même bail, en dehors cette fois de toute procédure collective ? Le premier cessionnaire, qui acquiert ici le statut de cédant, est-il solidairement tenu avec le second cessionnaire à l’égard du cédé ?
Deux arguments militent en faveur d’une réponse négative. L’un est un argument technique. Affirmer que la clause de solidarité est réputée non écrite, c’est affirmer qu’elle n’existe pas. Ce qui n’existe pas pour l’un (le premier cessionnaire) n’existe pas pour l’autre (le second cessionnaire). Cet argument pourrait être contré par la considération selon laquelle le réputé non écrit est une fiction juridique7. Façon de dire que la clause de solidarité existe bel et bien, mais que le droit fait simplement comme si elle n’existait pas. Ce qui autoriserait à appliquer cette sanction uniquement au profit du premier cessionnaire, et de personne d’autre. Toutefois, ce raisonnement ne s’impose pas avec la force de l’évidence. Si bien que certains considèrent que le réputé non écrit opère de plein droit, en ce sens que le juge ne doit pas le prononcer mais simplement le constater8. L’autre argument en faveur d’une réponse négative est d’ordre logique. Si le premier cessionnaire acquiert la qualité de partie à un contrat ne contenant pas (ou plus) la clause de solidarité, le second cessionnaire qui vient à son tour occuper cette place ne peut pas être partie à un contrat contenant une telle clause. On ne peut pas transmettre plus que ce qu’on a recueilli.
Deux autres arguments plaident en faveur d’une réponse positive à la question de savoir si le premier cessionnaire est solidairement tenu avec le second cessionnaire. Un argument est littéral. L’article L. 641-12, alinéa 2 dispose que le liquidateur peut céder le bail, et qu’« (e)n ce cas » toute clause de solidarité est réputée non écrite. Le réputé non écrit joue en cas de cession du bail par le liquidateur ; a contrario, elle ne joue pas dans les autres cas, notamment lors d’une nouvelle cession du bail par le premier cessionnaire. L’autre argument est téléologique : la finalité de la règle prévue au profit du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective disparaît à l’égard du repreneur. Au nom de quoi le cédant d’un bail en dehors de toute procédure collective devrait-il bénéficier d’une règle édictée pour le cédant d’un bail dans le cadre d’une procédure collective ?
Remarquons, pour conclure, que les arguments passés en revue montrent que la solution rendue par la chambre commerciale est plus justifiée en opportunité qu’elle n’est inattaquable en droit. À dire vrai, l’embarras ne résulte pas de l’arrêt. Il résulte du texte de loi dont il fait interprétation. Le législateur aurait été mieux avisé de prévoir que la clause de solidarité est inopposable au cédant faisant l’objet d’une procédure collective, au lieu d’opter pour le réputé non écrit9.
Valerio FORTI
III – Les opérations sur obligations
A – Les opérations modificatives
Cession du contrat de bail au bailleur
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-23498. Quels sont les effets d’une cession d’un bail commercial au profit du bailleur lui-même ? C’est à cette question que répond, sous deux aspects, l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation10.
En pratique, l’hypothèse est fréquente : le locataire souhaitant céder son bail11 ou son fonds12, le bailleur se montre intéressé, afin de rendre les lieux libres de toute occupation. C’est qu’en cas d’acquisition du bail, auquel le bailleur est déjà partie, il s’opère une confusion au sens de l’article 1349 du Code civil (C. civ., art. 1300 anc.), qui emporte extinction des liens contractuels et obligationnels. C’est ce qui conduit souvent le bailleur, pour libérer les lieux, à se porter acquéreur du bail dont la cession est projetée. Il aura d’ailleurs souvent pris la peine d’introduire dans le bail un pacte de préférence pour le cas de cession.
Avant la réforme du droit des obligations, la Cour de cassation avait eu l’occasion d’avaliser l’opération, en précisant qu’elle n’était pas nulle pour absence de cause : « l’acquisition par le bailleur du droit au bail mis en vente par son locataire, laquelle permet au premier de recouvrer la jouissance matérielle des lieux loués, a une cause »13. On admettra aujourd’hui que la libération que permet l’opération constitue une « contrepartie convenue » au sens du nouvel article 1169 du Code civil, qui ne sera donc pas un obstacle à ce type de cessions.
Reste que la cession de contrat n’opère classiquement que pour l’avenir14. La cour d’appel avait refusé d’en tirer toutes les conséquences en jugeant que l’acquisition par les bailleurs du bail avait entraîné l’extinction totale de celui-ci, donc la libération complète du cédant, y compris pour les loyers antérieurs à la cession. Erreur d’analyse, car seules les échéances futures sont transmises au cessionnaire du bail, de sorte que la confusion n’opère pas pour les échéances antérieures qui restent dues par le cédant. La confusion de contrat n’opère donc en principe que partiellement lorsqu’elle résulte d’une cession de contrat. C’est donc très logiquement que l’arrêt d’appel est censuré par la Cour de cassation, qui juge « la dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire, de sorte que celui-ci ne réunit pas sur sa personne les qualités de débiteur et de créancier de cette obligation ».
L’arrêt va plus loin, car la cour d’appel avait également jugé que la dette de remise en état des lieux avait été transmise au bailleur et s’était trouvée éteinte par confusion. La solution paraissait conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que « les cessions successives d’un bail commercial opèrent transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat qui devient débiteur envers le bailleur des dégradations causées par ses prédécesseurs »15. Pourtant, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en invoquant la confusion qui empêcherait le transfert de l’obligation de remise en état : « la cession du bail au profit du bailleur a eu pour effet d’opérer son extinction, par la confusion des qualités de propriétaire et de preneur, de sorte que l’obligation de remise en état des lieux loués, à laquelle était tenu le dernier titulaire du bail, n’a pas été transmise au cessionnaire bailleur qui en demeure créancier ». Le raisonnement est assez artificiel, comme l’a clairement exposé un auteur : « Si l’on comprend bien – et si l’on donne toute sa portée à la locution “de sorte que” –, c’est parce que le bail s’était éteint par confusion que la dette de remise en état n’avait pas pu être transmise. Un tel raisonnement semble pourtant fautif : la confusion n’étant qu’une conséquence de la cession, comment pourrait-elle en déterminer rétrospectivement la portée ? Le “dernier titulaire du bail” n’était pas le cédant mais le cessionnaire, qui a forcément eu la qualité de preneur un instant de raison avant la confusion, sans quoi cette dernière n’aurait jamais eu lieu »16.
En réalité, il faut sans doute comprendre que la Cour de cassation opère une distinction. Dans le cas de cession de bail ordinaire, où le contrat change de titulaire sans jamais s’éteindre par confusion, la Cour de cassation admettrait que le dernier titulaire se voit transmettre la dette de remise en état à titre de garantie du bailleur17, mais sans préjuger des recours en contribution possibles entre les différents locataires successifs18. En revanche, dans le cas où le bail est cédé au bailleur, cette garantie du dernier cessionnaire n’a pas de sens s’agissant d’une cession destinée à éteindre le bail. Seuls les locataires successifs doivent en rester tenus, de sorte que la confusion du contrat ne les libère pas de cette dette19.
Lionel ANDREU
L’exclusion du retrait litigieux en cas de cession de créance à titre gratuit
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-21097. Le présent arrêt relatif au retrait litigieux recèle un paradoxe. Alors que la première chambre civile y fixe expressément un principe clair, les faits qui lui en donnent l’occasion rappellent implicitement à quel point la mise en œuvre de ce principe peut se révéler délicate.
Les faits de l’espèce étaient alambiqués. Pour les synthétiser, il convient de les organiser en trois temps. Dans un premier temps, deux sociétés avaient conclu la vente d’une parcelle de terrain sous diverses conditions suspensives. La vente prévoyait le versement d’un complément de prix lors de la réalisation de ces conditions. Le vendeur avait cédé sa créance conditionnelle de complément de prix à une troisième société. Dans un deuxième temps, un litige était né entre l’acquéreur de la parcelle et le cessionnaire de la créance de complément de prix. Dans un troisième temps, la société cessionnaire avait fait l’objet d’une dissolution, à l’occasion de laquelle il avait été décidé de l’attribution à ses associés de l’universalité de son patrimoine, incluant notamment la créance de complément de prix. À ce stade, le débiteur cédé (c’est-à-dire l’acquéreur) avait notifié aux associés son droit de retrait sur cette créance. Le juge du fond avait considéré que le débiteur cédé avait valablement usé de son droit de retrait, au motif qu’une cession de créance à titre gratuit permet l’exercice d’un tel droit. L’arrêt est censuré en s’appuyant sur une formule de principe, coiffant cet arrêt publié au Bulletin : « l’exercice du droit de retrait prévu par (l’article 1699 du Code civil) suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige ».
Cette formule est inédite. Elle est heureuse. Car la clarté avec laquelle le principe est formulé vient dissiper un doute semé par un arrêt rendu en 199820. En l’occurrence, le juge du fond n’avait pas retenu la qualification de cession de droit litigieux puisque, selon lui, celle-ci suppose le versement par le cessionnaire au cédant d’un prix réel de cession, inexistant en l’espèce. L’arrêt avait été cassé tout simplement au motif que « la cession de créance peut être faite à titre gratuit ». Il faut dire que cette affirmation ne signifiait déjà pas que le retrait litigieux peut être exercé même en cas de cession de créance à titre gratuit. Mais les choses sont désormais clairement établies : l’exercice du retrait litigieux suppose que la créance a été cédée moyennant un prix.
Le principe est pleinement justifié21. L’article 1699 du Code civil, sur lequel ce principe est fondé, oriente clairement vers lui. Le contexte de l’article met sur la piste. Certes il était naguère difficile de conférer une portée normative à la place de l’article 1699 du Code civil au sein du titre du Code civil consacré à la vente. Ce titre contenait en effet également le régime de la cession de créance, bien que celle-ci pouvait être réalisée aussi bien à titre onéreux qu’à titre gratuit. Il n’en demeure pas moins que depuis que la cession de créance a été extraite de ce titre, la place de l’article 1699 du Code civil permet de considérer que son domaine couvre uniquement les cessions à titre onéreux. Mais c’est surtout le texte de l’article 1699 du Code civil qui confirme que l’on est sur la bonne piste. Cet article dispose que le débiteur cédé doit restituer au créancier cessionnaire « le prix réel de la cession ». Par où l’on voit que le retrait litigieux ne peut pas être exercé à l’encontre d’une créance cédée sans contrepartie monétaire.
Toutefois, autant le principe est clair, autant sa mise en œuvre est délicate. La présente affaire l’illustre. La cassation intervient sur un point qui se situe en aval de l’opération : le juge du fond avait considéré que le retrait litigieux peut être exercé en cas de cession de créance à titre gratuit, alors qu’en réalité il ne peut être exercé qu’en cas de cession de créance à titre onéreux. Or il s’agit là d’un détour inutile, car la cassation aurait pu être prononcée en se plaçant en amont, c’est-à-dire en réfutant l’existence même d’une cession de créance22. La transmission d’une universalité de droit (le patrimoine de la société dissoute) n’est pas la cession d’une créance à titre particulier.
Une autre affaire illustre également combien la mise en œuvre du principe selon lequel le retrait litigieux suppose une cession de créance à titre onéreux est délicate23. Les faits peuvent être utilement rapprochés de ceux de la présente affaire. Une société créancière d’une indemnité litigieuse de cessation d’un contrat d’agence commerciale avait fait l’objet d’une dissolution amiable. Une véritable cession de ses créances à ses propres associés avait eu lieu à cette occasion. Cette cession avait été réalisée pour le montant d’un euro. Le débiteur cédé, à savoir la tête du réseau de distribution, avait demandé à exercer le retrait litigieux pour racheter à un euro la dette d’indemnité de cessation du contrat. Les juges du fond avaient rejeté sa demande, mais l’arrêt avait été cassé. Quel enseignement peut-on tirer de la comparaison entre les deux solutions – la question de l’existence ou non d’une véritable cession mise à part ? Si la cession de créance est à titre gratuit, le retrait litigieux ne peut pas être exercé. En revanche, il suffit que la cession de créance soit réalisée pour un euro symbolique, pour que le retrait litigieux puisse aboutir. Si la cohérence est sauve sur le plan technique, elle est ruinée du point de vue pratique. Il serait souhaitable que la jurisprudence traite la cession de créance pour un prix symbolique comme une cession à titre gratuit24. Dans cette attente, la précaution rédactionnelle est de mise : un renvoi à l’article 1321, alinéa 1er du Code civil, qui envisage expressément la cession de créance à titre gratuit, peut mettre le cessionnaire à l’abri d’un retrait litigieux.
Valerio FORTI
La cession Dailly renforcée : régularité du bordereau et de la notification
Cass. com., 11 oct. 2017, n° 15-18372. La cession Dailly alimente souvent l’actualité du régime général des obligations. En témoigne ce nouvel arrêt qui renforce, à trois titres, l’efficacité de l’opération25.
En l’espèce, un créancier avait cédé ses créances par voie Dailly à un cessionnaire. Malgré la notification de l’opération au débiteur, ce dernier avait réglé le cédant. Le cessionnaire lui réclama le paiement des créances et obtint gain de cause devant les juges du fond. En cassation, le débiteur se battait sur trois fronts. Il contestait d’abord la régularité du bordereau, lequel contenait des mentions erronées sur les textes applicables. Il faisait ensuite valoir que la cession ne lui avait pas été notifiée au domicile qu’il avait contractuellement élu. Il opposait enfin au cessionnaire une clause prévoyant que « toute cession de créance à une banque ou à une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d’un mois sera réputée nulle et non avenue ».
Le pourvoi est rejeté.
S’agissant de la régularité du bordereau, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir constaté que toutes les mentions obligatoires figuraient dans le bordereau et que l’ajout d’une référence, non imposée par les textes, à des textes réglementaires « fussent-ils abrogés, n’a pas d’incidence sur la validité de la cession ». La solution se comprend, car ce qui compte pour la régularité du bordereau est qu’il comporte les mentions requises par la loi sans lesquelles il ne peut valoir acte de cession Dailly. Les textes d’exception étant d’interprétation stricte, il serait difficile d’admettre que l’ajout d’une mention non requise par les textes puisse conduire à l’irrégularité du bordereau qu’aucun texte ne fonderait. « Il ne faut pas être plus formaliste que la loi ! »26.
L’argument tiré du non-respect du domicile élu est pareillement balayé par la Cour de cassation, qui relève que le débiteur avait eu une connaissance effective de la notification de la cession et ne pouvait se méprendre sur les conséquences de celle-ci, peu important que cette notification n’ait pas été effectuée au domicile élu par lui. Sur ce point, l’hésitation était permise, dès lors que la clause d’élection de domicile figure dans l’acte dont le cessionnaire puise précisément ses droits. Il était tentant d’en déduire qu’elle s’impose à lui, dans la mesure où il souhaite notifier au débiteur l’acquisition de la créance. Telle n’est pas néanmoins l’analyse faite par la Cour de cassation qui a sans doute préféré renforcer la simplicité et la rapidité de l’opération, en dispensant le cessionnaire de se plonger dans les contrats litigieux afin de déterminer de quelle manière il devra faire valoir ses droits27.
La même faveur pour l’efficacité de la cession Dailly se retrouve s’agissant de la troisième réponse apportée par la Cour de cassation – où l’on a vu une « interdiction d’un alourdissement conventionnel du régime [de la cession Dailly] »28. Selon la Cour, « une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance » (motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués). On peut, ici encore, voir dans cette solution une réponse au besoin de simplicité et de rapidité qui gouverne la matière. Elle conduit à empêcher la paralysie des droits du cessionnaire sur la base d’une clause de l’acte qu’il pourrait ignorer29. L’analyse retenue le dispense ainsi d’analyser les contrats dont les créances cédées sont issues pour vérifier s’il existe des obstacles à l’exercice de ses droits acquis.
Reste que si l’on délaisse les arguments de politique juridique, la solution retenue dérange30. Elle opère un étonnant détachement entre l’acte générateur de la créance cédée et l’acte de cession lui-même, alors pourtant que c’est du premier que le cessionnaire tire ses droits. Autoriser le cessionnaire à invoquer un contrat dont une créance lui a été cédée pour agir contre le débiteur sans respecter les clauses qui y ont été introduites est gênant. Par le passé, un débat similaire31 avait eu lieu concernant l’efficacité des clauses interdisant un contractant la cession de ses créances. Après un premier arrêt favorable au cessionnaire32, la Cour de cassation avait rendu un arrêt en son contraire33, et c’est, plus tard, la thèse de l’efficacité de ces clauses qui a été retenue dans l’ordonnance du 10 février 201634. La Cour de cassation saura peut-être s’inspirer de ce précédent pour revenir sur la jurisprudence dont le présent arrêt est porteur.
Lionel ANDREU
La qualité à agir du cessionnaire Dailly d’une créance fiscale devant le juge de l’impôt
CE, 9e /10e ch., 20 sept. 2017, n° 393271. Voilà qui est assez inhabituel pour être souligné : le Conseil d’État a rendu une décision en matière de cession de créances professionnelles, dite cession Dailly. Pour mémoire, la cession Dailly peut avoir pour objet toute créance détenue sur une « (…) personne morale de droit public ou de droit privé (…) »35. Il est vrai que la précision que le Conseil d’État apporte ici ne concerne que la procédure devant le juge de l’impôt. Il n’empêche que cette précision est susceptible d’intéresser tous les établissements bancaires cessionnaires.
Une société avait demandé le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée et avait, par ailleurs, transmis cette créance à un établissement bancaire dans le cadre d’une cession Dailly. La demande étant restée sans réponse de la part de l’administration fiscale, l’établissement bancaire cessionnaire avait saisi un tribunal administratif. Celui-ci avait toutefois rejeté sa demande. Une cour administrative d’appel avait, à son tour, rejeté son appel. L’établissement de crédit s’était alors pourvu en cassation. Ce qui donne l’occasion au Conseil d’État d’affirmer que « la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la SA Monte Paschi Banque n’était pas recevable à saisir le juge de l’impôt en sa qualité de cessionnaire de la créance sur le Trésor litigieuse, au motif que le juge ne peut être valablement saisi d’une contestation relative à l’existence ou au montant d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée que par l’assujetti bénéficiaire du droit à déduction ».
Il y a quelques années, le Conseil d’État avait déjà été sollicité au sujet d’une question voisine36. Les faits étaient partiellement différents : la cession de la créance fiscale à l’encontre de l’Administration avait eu lieu après la saisine du juge de la part du créancier cédant. La question était alors de savoir si la notification de la cession au cours de la procédure contentieuse faisait perdre au créancier cédant sa qualité de contribuable et par suite sa qualité pour agir. Ce à quoi le Conseil d’État avait répondu par la négative.
Dire que le créancier cédant ne perd pas la qualité pour agir ne renseigne toutefois pas sur le créancier cessionnaire. Celui-ci a-t-il également la qualité pour agir ? Oui, affirme le Conseil d’État. En somme : le contribuable, créancier cédant, et l’établissement bancaire, créancier cessionnaire, ont tous deux qualité pour poursuivre le paiement de la créance fiscale. Pour cela, peu importe que la cession ait été notifiée au débiteur cédé, en l’occurrence l’administration fiscale.
La solution est à la fois techniquement justifiée et pratiquement opportune. Elle est techniquement justifiée car, comme le rappelle le Conseil d’État, la cession Dailly « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, (…) sans qu’il soit besoin d’autre formalité (…) »37. La solution est en pratique opportune puisqu’il peut arriver que le créancier cédant ne puisse pas agir en raison du fait qu’il a été mis, comme en l’espèce, en liquidation judiciaire.
Valerio FORTI
B – Les opérations créatrices
L’intention de nover peut résulter des faits de la cause
Cass. 3e civ., 19 oct. 2017, n° 16-22608. En apparence, l’arrêt commenté38 procède à simple rappel des principes régissant la novation : si la novation ne se présume pas, il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée en termes formels39. Mais quand on y regarde de plus près, on se demande si ce rappel n’était pas dépourvu de pertinence, pour reposer sur une erreur d’analyse de la question litigieuse.
Un bailleur prétendait devant les juges du fond que son métayage avait été nové en une simple mise à disposition de parcelle. Sa prétention est rejetée par les juges du fond qui observent que « la volonté de nover l’engagement résultant du bail en un autre engagement ne ressort d’aucun acte conclu entre les parties, tandis que le contrat initial a été passé en la forme authentique, et [qu’il existe] un indice de l’exécution par les parties du contrat de bail originaire, stipulant le versement d’un métayage basé sur la règle du tiercement ». L’arrêt est cassé. Un attendu de principe précise que « si l’intention de nover ne se présume pas, il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu’elle est certaine et résulte des faits de la cause »40. La Cour en tire la conséquence que, sans rechercher « si le paiement d’une redevance annuelle fixe, sans relation de proportion avec le tiers de la production, ne démontrait pas la commune intention des parties de renoncer au bénéfice du bail et de convenir d’une mise à disposition des parcelles (…), la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
En apparence, tout se tient : tant l’ancien article 1273 du Code civil, applicable en l’espèce, que le nouvel article 1330, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, précisent que la volonté d’opérer la novation « doit résulter clairement de l’acte », sans exiger une formule spécifique ou un écrit. Il était donc logique que les juges du fond soient censurés pour avoir déduit l’absence de novation de l’inexistence d’un « acte conclu entre les parties »41.
Mais la question a-t-elle été bien formulée ? En se focalisant sur la preuve de l’intention de nover, la cour d’appel a peut-être entraîné le pourvoi et la Cour de cassation sur une fausse piste. Car, de fait, la question de la preuve de l’intention de nover ne se pose qu’en présence d’un acte juridique dont l’existence n’est pas discutée ou dont la preuve est rapportée conformément aux règles probatoires applicables. Or, en évoquant maladroitement la preuve de l’intention de nover, les juges du fond paraissent avoir en réalité voulu justifier l’absence de preuve d’un acte novatoire intervenu entre les parties – ce qui est tout autre chose. Comme l’écrit un auteur, « la preuve de l’intention de nover qui, en tant que fait juridique, peut être rapportée par tout moyen, ne doit pas absorber la totalité des débats et éclipser la question de la preuve de la novation, envisagée en tant que contrat. En d’autres termes, il est nécessaire que soit distinguée la preuve de l’intention de nover, qui est un élément de la novation, et la preuve de la novation elle-même, cette dernière obéissant aux règles spécifiques applicables aux actes juridiques »42.
Devant la cour d’appel de renvoi, il serait bon que le débat soit replacé sur son terrain naturel et que soit discutée la preuve de la novation conformément aux règles juridiques applicables.
De ce point de vue, l’auteur précité indique que « puisque la novation est un contrat et, par conséquent, un acte juridique, elle ne devrait pouvoir être prouvée que par écrit, dès lors que la somme en jeu dépasse 1 500 €. Or, en l’espèce, la novation portait sur la substitution d’une somme fixe de 2 900 € à un pourcentage des produits du terrain. Ne fallait-il pas, dans ces conditions, rapporter la preuve de l’existence de la novation par écrit, indépendamment de la preuve de l’intention de nover ? En outre, pour prouver contre un écrit, ne faut-il pas, aux termes mêmes de l’article 1359, alinéa 2, du Code civil, produire un autre écrit, et ce “même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant”. Or, prétendre que le contrat initial, rédigé en la forme authentique, a été remplacé par un nouveau contrat, n’est-ce pas chercher à prouver contre un écrit ? »43.
Il faut cependant sans doute nuancer le propos, en tenant compte des spécificités du bail rural, où les principes du droit de la preuve sont aménagés. L’article L. 411-1 du Code rural, applicable en la cause, prévoit en effet que « La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ». Il faut à notre sens en déduire, non seulement la preuve du bail rural peut être faite librement, mais également qu’il en va ainsi des conventions qui l’affectent44. En quoi la preuve du contrat de novation affectant un bail rural pourrait être apportée par tous moyens.
Lionel ANDREU
IV – L’extinction de l’obligation
A – Les modes d’extinction satisfactoires
L’exigence de réciprocité de la clause d’indexation d’une obligation monétaire
Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-40069. À l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a rendu une décision intéressante par laquelle elle renforce sa position jurisprudentielle récente relative aux clauses d’indexation.
Sept baux commerciaux contenaient une clause stipulant que « l’indexation ne pourra avoir pour effet de réduire le loyer par rapport à celui de l’année précédente ». Le locataire avait assigné le bailleur en annulation de cette clause. Le bailleur avait alors demandé au juge du fond de poser une question prioritaire de constitutionnalité pour « déterminer si les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier, tels qu’interprétés par la Cour de cassation, sont ou non conformes aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et 34 de la constitution, aux principes de sécurité juridique et de garantie des droits et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ». Le juge du fond avait reformulé la question, en la libellant ainsi : « Les dispositions législatives contestées, à savoir les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier, portent-elles atteinte à la liberté contractuelle, à l’économie des contrats sans motifs suffisants d’intérêt général et au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ? ».
On passera rapidement sur les aspects relatifs aux sources du droit. La Cour de cassation ne se laisse pas enfermer par la question telle que reformulée par le juge du fond. Elle rappelle que « si la question posée peut être reformulée par le juge à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n’appartient pas au juge de la modifier ». Puis elle ajoute que « dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ».
On s’arrêtera plus longuement sur les aspects relevant du régime de l’obligation monétaire. C’est l’appréciation que fait la Cour de cassation de la question posée qui mérite attention. Selon elle, « sous le couvert d’une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation constante conférerait aux articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier, la question posée tend en réalité à contester le principe jurisprudentiel suivant lequel est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse ». Ce qui la conduit à déclarer la question irrecevable et, par conséquent, à ne pas la transmettre au Conseil constitutionnel.
Pour saisir la portée de ce choix, il faut rappeler que la Cour de cassation avait forgé une nouvelle solution à l’occasion d’un arrêt remarqué rendu en 201645. Elle y avait décidé qu’« est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse ».
Au-delà de l’opportunité de la solution, son fondement avait suscité des interrogations. C’est principalement vers les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier que les commentateurs s’étaient tournés, raison pour laquelle la question prioritaire de constitutionnalité avait ces articles en ligne de mire. Du point de vue substantiel, il n’allait pourtant pas de soi de songer à ces articles. En effet, leur lettre ne fait aucune mention de l’exigence de réciprocité de la clause d’indexation. Tout au plus peut-on considérer que leur esprit commande une telle solution, en ce qu’ils visent à lutter contre les effets inflationnistes de la clause d’indexation. À dire vrai, il était encore moins évident du point de vue formel de convoquer les articles 112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier46. Bien sûr, ces articles figuraient dans la motivation des arrêts rendus par les juges du fond dans l’affaire ayant conduit la Cour de cassation à interdire la clause d’indexation uniquement à la hausse47. Mais la Cour de cassation elle-même n’y avait fait aucune allusion : elle avait fondé la nouvelle solution sur un attendu de principe.
Avec la présente décision qui déclare la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable, le doute n’est plus permis. La Cour de cassation qualifie elle-même de « principe jurisprudentiel » la règle selon laquelle est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation.
Quelle conséquence concrète cette qualification emporte-t-elle ? Vraisemblablement, le domaine de ce principe jurisprudentiel en ressort élargi. Il est en effet légitime de penser que l’exigence de réciprocité de la clause d’indexation ne se limite pas aux seuls baux commerciaux ; elle a vocation à embrasser tous les contrats48.
Valerio FORTI
Retour sur les recours contre le débiteur de celui qui a payé la dette d’autrui sans intention libérale
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-14753. La formule ici reprise est classique : « il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée »49. Elle figure dans de nombreux arrêts50 depuis le revirement opéré par la Cour de cassation en 199251. Elle mérite néanmoins qu’on s’y arrête à nouveau, après que l’ordonnance du 10 février 2016 en a sapé les bases théoriques.
L’hypothèse est courante : une personne paye la dette d’une autre – sans erreur52 et sans intention libérale53. Peut-elle se faire rembourser ? Non (en principe)54.
Cette réponse s’est construite par opposition à un arrêt de 1990 qui, tout au contraire, avait jugé que « le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur »55. La formule était sans doute excessive, car le recours ne saurait être toujours admis56. Mais la solution qu’on lui a substituée l’est davantage encore. Avec la formule sibylline reprise dans le présent arrêt, la Cour de cassation semble en effet exiger du solvens la preuve des raisons pour lesquelles il a procédé à un paiement, lesquelles doivent impliquer un remboursement juridiquement fondé57. Mais faute de fondement juridique identifié pour un tel recours58, l’analyse revient à refuser tout remboursement du solvens par le débiteur et lui fait supporter définitivement la charge d’une dette qui ne lui incombe pas. Quant à celui dont la dette a été acquittée, il s’en sort à bon compte puisqu’il sera finalement dispensé de payer sa dette.
On a déjà eu l’occasion d’écrire ce que l’on pense de cette jurisprudence59 et d’appuyer les projets de réforme du droit des obligations qui tendaient à la renverser60 ou la contourner61. On se contentera ici de regretter que la Cour de cassation n’ait pas su s’inspirer de ces projets de réforme ou de l’ordonnance du 10 février 2016 pour infléchir sa position62. C’est justement pour offrir à celui qui paye la dette d’autrui un recours juridiquement fondé que l’ordonnance a réécrit les textes sur la subrogation. Désormais, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette »63. Le solvens qui paye la dette d’autrui sans erreur et sans intention libérale dispose donc aujourd’hui indubitablement d’un recours contre le débiteur.
Appliquant en l’espèce les textes antérieurs à l’ordonnance, la Cour de cassation ne pouvait certes pas ouvrir au solvens un recours subrogatoire que la loi ne lui offrait alors pas. Mais elle pouvait se saisir de la présente affaire pour faire évoluer sa jurisprudence. Un arrêt rendu huit mois plus tôt laissait présager une telle évolution64. Alors qu’un associé avait payé les dettes d’une société sans se faire subroger (hypothèse très proche de celle de l’arrêt commenté), il avait obtenu des juges du fond une condamnation du débiteur à son profit. La solution n’était-elle pas contraire à la jurisprudence ici discutée ? C’est en tout cas ce que faisait valoir le demandeur au pourvoi, dont les prétentions furent néanmoins rejetées par la Cour de cassation. Celle-ci approuva en effet les juges du fond, qui avaient constaté le paiement par l’associé de dettes qui incombaient à la société, d’avoir « ainsi fait ressortir que [le solvens] avait justifié que les paiements effectués par lui impliquaient l’obligation pour la société de lui rembourser les sommes litigieuses ». On peine alors à comprendre en quoi le fait pour une personne de payer la dette d’autrui suffise ici à impliquer l’obligation pour le débiteur de lui rembourser les sommes litigieuses mais pas ailleurs.
Où l’on verra, peut-être, le début d’un infléchissement que la Cour de cassation pourrait prolonger. Il serait utile qu’elle franchisse le Rubicon et reconnaisse que celui qui paie la dette d’autrui sans être subrogé dispose en principe, sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016, d’un droit à remboursement personnel du débiteur65.
Lionel ANDREU
B – Les modes d’extinction non satisfactoires
Précisions sur le fonctionnement de la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce : répétition de l’indu, compensation et fraude
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-12942. À l’occasion d’un procès relatif à des factures fictives établies par un transporteur avec la complicité d’un salarié du débiteur, la Cour de cassation apporte deux précisions sur le fonctionnement de la prescription annale que l’article L. 133-6 du Code de commerce applique aux actions relatives au contrat de transport66.
La première est que, sauf cas de fraude ou d’infidélité, « toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, en ce compris les demandes de répétition de l’indu et les demandes reconventionnelles de compensation, sont soumises à la prescription annale prévue à l’article L. 133-6 du Code de commerce ». Est ainsi rejeté le pourvoi qui faisait valoir que la compensation n’est pas empêchée par la prescription et que la prescription de droit commun devait s’appliquer s’agissant d’une action, non pas contractuelle, mais quasi-contractuelle.
Une telle lecture globalisante de l’article L. 133-6 précité n’est pas nouvelle. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de l’appliquer à une action en répétition de l’indu67 et une demande reconventionnelle68. Où il faut voir, sans doute, la volonté de la haute juridiction de tarir le contentieux généré par le contrat de transport.
Reste que s’agissant de la compensation, la portée de la précision est sujette à discussion. Certes, on comprend que la demande en cause puisse être frappée par la prescription généreuse de l’article L. 133-6 précité, car elle suppose une créance dont la reconnaissance et la liquidation sont demandées par voie reconventionnelle69. Mais la solution serait-elle la même dans le cas où la créance opposée en compensation serait certaine, liquide et exigible, de sorte que c’est une simple compensation « légale » qui serait opposée ? Il serait alors possible de prétendre que cette compensation serait opposée sous la forme, non d’une demande reconventionnelle happée par l’article L. 133-6 précité, mais d’une défense au fond qui ne le serait pas70. Cette analyse ne suffirait cependant pas, car il faudrait encore admettre, avec la réforme de la compensation opérée par l’ordonnance du 10 février 201671, que la compensation puisse être « invoquée »72 après l’écoulement du délai de prescription73. On ne reprendra cependant pas ici ce débat lié aux inconvénients du nouveau système de compensation adopté par la réforme, auquel on a déjà consacré de nombreux développements74.
La deuxième précision de l’arrêt a trait à l’hypothèse d’une fraude, où le délai de prescription annal disparaît au profit du délai quinquennal de droit commun. La Cour de cassation retient ainsi que « l’article L. 133-6 du Code de commerce n’impose pas la preuve de l’impossibilité d’agir dans le délai d’un an suivant la découverte de la fraude ». Se trouve ainsi censuré l’arrêt d’appel qui avait refusé de faire jouer l’exception de fraude en présence de fausses factures établies par le créancier et l’un des salariés du débiteur, motif pris que l’impossibilité dans laquelle le créancier s’était trouvé d’agir lui était imputable, pour être due à l’absence ou l’inefficience de ses procédures de contrôles internes. Comme le remarque un auteur75, l’arrêt traduit l’absence d’incidence de la compliance sur la mise en œuvre de l’exception de fraude prévue par l’article L. 133-6 précité, mais il ne faut pas croire qu’il en ira de même ailleurs. L’article 2224 du Code civil prévoit en effet que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu « ou aurait dû connaître » les faits lui permettant de l’exercer. Dans ce cadre, il serait possible de reprocher à un créancier l’insuffisance de ses procédures de contrôles internes pour fixer le point de départ de la prescription à une date antérieure à sa connaissance effective des faits lui permettant d’exercer ses droits. Par quoi on rejoindra l’auteur précité dans son observation que « la rencontre de la compliance avec le droit de la prescription promet d’être riche et subtile ! »76.
Lionel ANDREU
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement des honoraires de l’avocat
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-23599. On se souvient que par une décision rendue en 201577, la Cour de cassation a soumis l’action en paiement d’honoraires engagée par un avocat à l’encontre de son client consommateur au délai biennal de prescription prévu par le Code de la consommation78. L’arrêt commenté, publié au Bulletin, traite lui aussi de la prescription de l’action en paiement des honoraires. Mais il apporte une précision relative à un aspect différent, tout aussi crucial : celui du point de départ de ce délai biennal de prescription.
Les faits étaient assez banals. Une dame avait confié à son avocat la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral. Par un jugement du 16 juillet 2012, ce tribunal avait accordé à cette dame une certaine somme. Elle avait informé son avocat de son intention d’être assistée d’un autre conseil devant la cour d’appel et l’avait donc dessaisi du dossier. L’avocat avait alors établi une facture d’honoraires le 14 août 2012. Sa cliente n’ayant pas acquitté cette facture, l’avocat avait saisi le 28 juillet 2014 le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation de ses honoraires. L’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel avait déclaré la demande prescrite. Cette ordonnance était le résultat du raisonnement suivant : la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l’avocat a pris fin, à savoir la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l’avocat a défendu les intérêts de son client ; cette décision est intervenue le 16 juillet 2012 ; l’avocat a saisi le bâtonnier de sa demande le 28 juillet 2014, soit deux ans et douze jours après la fin de son mandat ; or, le délai de prescription applicable en la matière est de deux ans. L’ordonnance est cassée, au motif que « la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin » et qu’« en soi le prononcé de la décision que l’avocat a été chargé d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandat qu’il a reçu de son client ».
Depuis la réforme de la prescription extinctive en matière civile, deux tendances peuvent être observées. Elles sont complémentaires. Les délais de prescription sont plus courts ; mais, en quelque sorte en contrepartie, les points de départ de la prescription sont souvent glissants. C’est pourquoi les plus grandes difficultés se concentrent autour de la détermination du point de départ de la prescription. Pour les résoudre, ou du moins les réduire, la jurisprudence se réfère volontiers à des faits standards, qui conduisent à alléger la preuve à la charge des parties79. Ce qui est curieux dans l’arrêt sous commentaire, c’est que la Cour de cassation fait usage d’un fait standard, tout en le vidant de son potentiel.
D’une part, la Cour de cassation affirme que « la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ». Deux ans, oui, mais à compter de la fin du mandat. Le recours à ce fait standard pour fixer le point de départ de la prescription n’est pas nouveau. Par trois arrêts rendus en 2011 le même jour, la Cour de cassation avait forgé ce principe80. C’est ce principe qui est repris au mot près dans le présent arrêt. Qu’est-ce qui fonde un tel principe ? Sans doute, l’article 2224 du Code civil suffit-il comme fondement, qui se réfère au « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Pour autant, il est difficile de ne pas déceler l’empreinte de l’article suivant, aux termes duquel : « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ». Après tout, pourquoi ne pas aligner le point de départ de la prescription de l’action en paiement exercée par l’avocat à l’encontre du client (la fin du mandat) sur le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité exercée par le client à l’encontre de l’avocat (la fin de la mission) ?
D’autre part, la Cour de cassation décide qu’« en soi le prononcé de la décision que l’avocat a été chargé d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandat qu’il a reçu de son client ». La solution est inédite. Elle semble de prime abord s’écarter de la jurisprudence antérieure, qui se contentait parfois du prononcé de la décision : « le mandat de M. X avait pris fin avec la décision d’une cour administrative d’appel »81. À la réflexion, il n’y a pas de revirement. Dire qu’« en soi » le prononcé de la décision ne met pas fin au mandat, n’est pas dire que le prononcé de la décision ne peut, en aucun cas, mettre fin au mandat. C’est simplement dire que le principe selon lequel la prescription court à compter de la fin du mandat de l’avocat ne dispense pas le client débiteur du paiement des honoraires d’apporter la preuve du fait que ce mandat a concrètement pris fin. Que faut-il en penser ? Il est vrai que la souplesse ainsi introduite est justifiée : le prononcé de la décision est loin de mettre un terme aux diligences de l’avocat, qui doit toujours donner au client son avis sur l’exercice éventuel d’une voie de recours, et qui doit parfois veiller à l’exécution de la décision. Il n’empêche que cette solution réduit la prévisibilité qu’était censée apporter la référence au fait standard qu’est la fin du mandat.
Valerio FORTI
La prescription de l’action du créancier contre la caution
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-15331. Encore une fois, les cautions alimentent l’actualité jurisprudentielle, dans une affaire relative à la prescription82. C’était plus précisément l’article L. 137-2 du Code de la consommation83 qui était ici en cause, lequel prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
De manière désespérée, la caution tentait ici de faire valoir que le cautionnement par elle souscrit entrait dans le champ d’application du texte84. Selon son raisonnement, « l’action en paiement exercée par la banque contre une caution a pour objet le remboursement par un tiers garant du prêt consenti par un professionnel à l’emprunteur de sorte qu’exercée contre un consommateur elle est soumise à la prescription biennale ». On peine cependant à comprendre l’argument. La caution est la seule à s’engager par la sûreté envers le créancier, qui ne fournit pour sa part aucun « bien ou service » à celle-ci. Tout au plus pourrait-on dire que le cautionnement trouve sa « cause »85 dans un prêt, qui constitue un « service » au sens du texte, mais il ne faut pas réfléchir longuement pour comprendre que ce service est fourni à l’emprunteur (qui n’était d’ailleurs pas un consommateur en l’espèce, mais une personne morale) et non à la caution, tandis que c’était la prescription du contrat de cautionnement qui était ici en cause – et non le contrat, distinct, de prêt, conclu avec le débiteur.
Le rejet du pourvoi était inévitable. De manière logique, la Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir relevé que « la banque avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation [ce dont la cour d’appel a] exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l’action en paiement litigieuse ».
Tout au plus l’arrêt laisse-t-il subsister une embarrassante question – qui n’était, il est vrai, pas posée à la Cour de cassation – consistant à savoir si la caution, qui ne peut elle-même se prévaloir de la prescription biennale au titre de sa dette de cautionnement, pourrait s’en prévaloir par voie accessoire, lorsque le débiteur peut s’en prévaloir. Autrement dit, la caution pourrait-elle ainsi faire valoir que si l’emprunteur est lui-même fondé à invoquer la prescription biennale de sa dette, elle s’en trouverait elle-même déchargée, lors même que son cautionnement ne serait pas prescrit par voie principale ?
La réponse ne va pas de soi, car la tentation serait grande de tirer argument des arrêts retenant que la prescription « n’éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d’exiger l’exécution de son obligation »86 pour opposer à la caution le raisonnement retenu dans une autre affaire, où la Cour de cassation a distingué la remise de dette (qui éteint le droit) de la simple renonciation à agir (qui ne l’éteint pas), pour maintenir l’engagement de la caution alors que le débiteur ne pouvait plus être poursuivi (selon la Cour, « la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur, de sorte que la clause précitée ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire »87). Combinant ces différents arrêts, on pourrait ainsi considérer que la prescription n’éteignant pas le droit du créancier, elle ne ferait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution.
À notre sens, une telle analyse serait cependant excessive. D’abord, on sait que l’article 2253 du Code civil prévoit que « les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce ». On pourrait déduire de ce texte que « le régime de la prescription s’apparente alors à celui de la nullité absolue, de ce point de vue : en tant que personne intéressée, la caution va pouvoir provoquer l’extinction de la dette principale en invoquant sa prescription, afin de faire valoir la caducité de sa propre obligation »88. Ensuite, il faut se rappeler que l’article 2290 du Code civil, protecteur de la caution, prévoit fort justement que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». Lorsque le débiteur est déchargé de sa dette, même sans extinction de celle-ci, il n’y a pas de raison de refuser d’en faire profiter la caution, hors du cas où le moyen de défense en cause peut être considéré comme « personnel » au débiteur et insusceptible d’être invoqué par la caution89. Que l’on admette que le créancier puisse renoncer à agir uniquement contre le débiteur et préserver ses recours contre la caution, comme l’a admis la Cour de cassation, ne devrait pas conduire à admettre également que la caution reste tenue alors que le débiteur a été libéré de sa dette par l’effet du temps90. À admettre le contraire, on aura du mal à expliquer à nos collègues étrangers comment une caution, qui doit la dette d’autrui, peut être contrainte de payer, quand celui-ci ne peut plus l’être91.
Lionel ANDREU
Le point de départ de la prescription des droits de la victime d’un dommage corporel ne peut dépendre de son choix de cesser des traitements
Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 14-13351. Quand peut-on dire qu’un dommage est « consolidé » ? La réponse est essentielle pour la détermination du point de départ de la prescription des droits de la victime d’un dommage corporel, l’article 2226 du Code civil prévoyant que son action en responsabilité « se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Faute de définition légale, on ne sera pas surpris que l’arrêt commenté conduise la Cour de cassation à préciser les contours de la consolidation.
L’arrêt concernait l’affaire du Distilbène, déjà bien connue des tribunaux92. Le demandeur ayant été exposé in utero à la molécule dommageable avait agi en responsabilité contre le laboratoire l’ayant commercialisée en indemnisation des préjudices résultant de son infertilité. Celui-ci avait opposé en défense la prescription de l’action, faisant valoir que la consolidation était acquise depuis 1994. Les juges du fond avaient retenu l’argument, motif pris que la victime n’avait entrepris aucun nouveau traitement en vue de vaincre son infertilité après plusieurs fausses couches (de 1989 à 1991) et cinq procédures de fécondation in vitro restées inefficaces (en 1992 et 1993), ce dont il se déduisait que son état clinique se trouvait stabilisé en 1994.
Cassation, au visa de l’article 2226 : « en se déterminant ainsi, par des motifs pris du choix de [la victime] de cesser tout traitement contre l’infertilité, impropres à caractériser la consolidation de son état, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
L’arrêt n’est pas d’une parfaite limpidité.
Selon une première lecture, minimaliste, il procéderait à une cassation d’ordre essentiellement « disciplinaire »93. Ainsi, l’arrêt d’appel serait seulement censuré pour avoir fait référence au comportement de la victime, mais ses énonciations relatives à la stabilisation de l’état de cette dernière en 1994 ne seraient « pas dénuées de pertinence pour l’appréciation de la consolidation. Il semble bien en effet que, dès cette époque, l’infertilité était définitive et l’état de la victime consolidé. Le tort des juges fut essentiellement d’avoir relevé que la victime n’avait pas entrepris de nouveaux traitements, ce qui semblait faire dépendre la consolidation de son comportement. Malgré tout, la censure de l’arrêt attaqué est sévère et la Cour de cassation aurait tout aussi bien pu juger ce dernier motif surabondant pour ne s’attacher qu’à ceux qui soulignaient le caractère définitif du préjudice représenté par l’infertilité »94.
Reste que l’absence de cassation pourrait suggérer une seconde lecture, plus riche de conséquences. L’arrêt pourrait ainsi être compris comme une nouvelle illustration de la préservation de la liberté de choix des victimes d’entreprendre ou de poursuivre un traitement à la suite d’un dommage. Ce choix étant libre, une victime qui cesserait un traitement ne pourrait ainsi être traitée différemment de celle qui continuerait à tenter « quelque chose », de sorte que la consolidation de l’état de la première devrait être fixée de la même manière que si elle avait entrepris ou continué un traitement. En quoi la consolidation pourrait être plus tardive que la stabilisation de l’état de la victime ayant cessé tout traitement. Le raisonnement ne serait certes pas facile à mettre en œuvre, et présenterait une certaine part d’artifice, mais ce ne serait pas la première fois que la Cour de cassation nous obligerait à des contorsions intellectuelles pour favoriser l’indemnisation des victimes d’un dommage corporel !
Lionel ANDREU
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. civ., 22 déc. 1873 : DP 1874, 1, 73.
-
2.
Cass. civ., 14 mars 1916 : DP 1922, 1, 32.
-
3.
Cass. 1re civ., 10 mai 1988, n° 86-15278 : Bull. civ. I, n° 140 ; JCP N 1989, II 10, note Salvage P. ; RTD civ. 1989, p. 77, obs. Mestre J.
-
4.
Cass. 1re civ., 1er juill. 2003, n° 01-00563 : Bull. civ. I, n° 154 ; JCP 2004, I 155, obs. Le Guidec R. ; Defrénois 15 nov. 2003, n° 37830, p. 1409, note Brémond V.
-
5.
Pour une critique de cette analyse en cas d’indivisibilité purement conventionnelle, v. Andreu L., « L’obligation à prestation indivisible dans le nouveau droit des obligations », in Forti V. et Andreu L. (dir.), Le nouveau régime général des obligations, 2016, Dalloz, p. 63, n° 17.
-
6.
Kendérian F., obs. sous Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-19131 : Gaz. Pal. 16 janv. 2018, n° 311e6, p. 64.
-
7.
Andreu L., obs. sous Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-19131 : LEDEN janv. 2018, n° 111f2, p. 5.
-
8.
Gaudemet S., La clause réputée non écrite, 2006, Economica.
-
9.
Barbier H., obs. sous Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-19131 : RTD civ. 2018, p. 116.
-
10.
Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-23498 : AJ contrat 2018, p. 95, obs. Forti V. ; D. 2018, p. 1511, obs. Dumont-Lefranc M.-P. ; AJDI 2018, p. 277, obs. Blatter J.-P. ; RTD com. 2018, p. 57, obs. Saintourens B. ; Gaz. Pal. 12 déc. 2017, n° 309u6, p. 30, obs. Berlaud C. ; Defrénois 4 oct. 2018, n° 140n6, p. 29, obs. Ruet L. ; Defrénois 17 mai 2018, n° 136g8, p. 35, obs. Seube J.-B. ; Gaz. Pal. 20 mars 2018, n° 316d8, p. 57, obs. Barbier J.-D. ; RDC mars 2018, n° 114w6, p. 56, obs. Seube J.-B.
-
11.
Comme la loi le lui permet en principe : v. C. civ., art. 1717.
-
12.
Dans cette hypothèse, l’article L. 145-16 prévoit que sont « réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ».
-
13.
Cass. 3e civ., 13 oct. 2004, n° 03-12035.
-
14.
Andreu L., JCl Civil Code, art. 1327 à 1328-1, nos 36 et 63.
-
15.
Comp. Cass. 3e civ., 9 juill. 2003, n° 02-11794.
-
16.
Julienne M., obs. préc.
-
17.
À notre sens, tous ces locataires successifs restent tenus envers le bailleur de l’obligation solidaire de remise en état.
-
18.
Contra, Forti V., AJ contrat 2018, p. 95, qui remarque que « la jurisprudence qui décide que l’obligation de remise en l’état de la chose louée pèse sur le dernier locataire, et non sur celui qui l’a dégradée, se justifie notamment par le fait que le prix de cession du bail est censé prendre en considération la position du cédant. On ne voit pas pourquoi cette justification ne vaudrait pas en cas de cession au bailleur : par hypothèse, celui-ci a payé un prix minoré, qui tient compte du coût de la remise en état ». À suivre l’auteur, la charge de la dette pèserait effectivement sur le dernier cessionnaire, lequel ne serait pas simplement tenu à titre de garantie.
-
19.
Comp. avec le « raisonnement alternatif » proposé par Julienne M, obs. préc.
-
20.
Cass. com., 31 mars 1998, n° 96-12897.
-
21.
Forti V., « Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux », in Andreu L. et Mignot M. (dir.), Les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations, 2017, LGDJ, p. 46.
-
22.
Barbier H., obs. sous Cass. com., 31 mars 1998, n° 96-12897 : RTD civ. 2018, p. 409 ; Leveneur L., Contrats, conc. consom. 2018, comm. 62 ; Marty R., JCP E 2018, 1205.
-
23.
Cass. com., 15 janv. 2013, n° 11-27298.
-
24.
Forti V., « Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux », in Andreu L. et Mignot M. (dir.), Les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations, 2017, LGDJ, p. 46.
-
25.
Cass. com., 11 oct. 2017, n° 15-18372 : RTD civ. 2018, p. 186, obs. Crocq P. ; AJ contrat 2017, p. 527, obs. Forti V. ; RTD civ. 2017, p. 861, obs. Barbier H. ; JCP 2017, 1381, note Borga N. ; Banque et droit 2017, n° 176, p. 29, obs. Bonneau T. ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, n° 306y9, p. 65, obs. Moreil S. ; JCP E 2017, 1668, note Marty R. ; Rev. proc. coll. 2018, comm. 27, obs. Aynès A.
-
26.
V. obs. Aynès A., Rev. proc. coll. 2018, comm. 27.
-
27.
La Cour de cassation prend néanmoins soin de relever que la notification litigieuse n’avait pas empêché le débiteur d’avoir connaissance de l’opération. Il faut peut-être en déduire que le non-respect du domicile contractuellement élu pourrait avoir une incidence dans le cas contraire, où il aurait empêché le débiteur d’avoir connaissance de la notification ou d’en mesurer les conséquences. En revanche, on ne saurait en déduire que la connaissance effective de la cession Dailly suffirait à interdire au débiteur tout paiement du cédant. C’est seulement la notification qui produit un tel effet (C. mon. fin., art. L. 313-28) et la connaissance effective de la cession dans le présent arrêt paraît seulement permettre de couvrir l’irrégularité conventionnelle de celle-ci.
-
28.
Selon l’expression de Forti V., AJ contrat 2017, p. 527.
-
29.
Sur l’hypothèse d’une analyse plus subtile de l’arrêt commenté, v. Forti V., AJ contrat 2017, p. 527, qui s’interroge sur la possibilité de distinguer les clauses qui auraient trait à l’efficacité de la cession Dailly et celles qui auraient trait à ses conditions.
-
30.
V. égal. Crocq P., RTD civ. 2018, p. 186. Contra, Barbier H., obs. préc. RTD civ. 2017, p. 861, Aynès A. : Rev. proc. coll. 2018, comm. 27, et Marty R., note préc. (« En matière financière, l’effet translatif prime l’effet obligationnel, l’article 544 du Code civil fait échec à l’article 1103 du même code »).
-
31.
Pour certains auteurs, la question serait exactement la même : v. Marty R., note préc. : JCP E 2017, 1668.
-
32.
Cass. com., 21 nov. 2000, n° 97-16874.
-
33.
Cass. com., 22 oct. 2002, n° 99-14793.
-
34.
V. C. civ., art. 1321, al. 4.
-
35.
C. mon. fin., art. L. 313-23, al. 1er.
-
36.
CE, sect., 10 juill. 2002, n° 244411 : Lebon, p. 271 ; Dr. fisc. 2002, n° 47, comm. 938, par Lefeuvre A.
-
37.
C. mon. fin., art. L. 313-27, al. 1er.
-
38.
Cass. 3e civ., 19 oct. 2017, n° 16-22608 : RDC mars 2018, n° 114w3, p. 46, obs. Latina M. ; AJ contrats 2018, 1, p. 40, obs. Forti V.
-
39.
V. déjà, avec une formule identique, Cass. soc., 15 oct. 2002, n° 00-42364.
-
40.
V. déjà, Cass. soc., 15 oct. 2002, n° 00-42364.
-
41.
Encore que la question se discute : en relevant l’absence d’acte conclu entre les parties, mais aussi un « indice de l’exécution par les parties du contrat de bail originaire », l’arrêt d’appel aurait tout aussi bien pu être compris comme rejetant simplement la preuve de l’intention de nover.
-
42.
Latina M., RDC mars 2018, n° 114w3, p. 46.
-
43.
Latina M., RDC mars 2018, n° 114w3, p. 46.
-
44.
Rappr., pour une question similaire, Pellet S., L’avenant au contrat, préf. Stoffel-Munck P., 2010, IRJS Éditions, n° 319.
-
45.
Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24681 : D. 2016, p. 199, obs. Rouquet Y. ; RTD com. 2016, p. 56, obs. Kenderian F. et Monéger J. ; RDC juin 2016, n° 113b7, p. 258, obs. Boffa R. ; JCP E 2016, 1132, note Brignon B. ; D. 2016, p. 1613, note Dumont-Lefrand M.-P. ; Loyers et copr. 2016, comm. 66, obs. Brault P.-H. ; AJDI 2016, p. 365, note Planckeel F.
-
46.
Regnault S., « Les avatars de la clause d’indexation », AJ contrat 2018, p. 166.
-
47.
CA Paris, 2 juill. 2014, n° 12/14759 : AJDI 2014, p. 787, note Denizot C. et Trautmann G.
-
48.
Comp. Seube J.-B., note sous Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-40069 : RDC juin 2018, n° 115c3, p. 220.
-
49.
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-14753.
-
50.
Cass. 1re civ., 12 oct. 1999, n° 97-16099 ; Cass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 10-28475 ; Cass. com., 5 juill. 2017, n° 15-20806. Rappr. Cass. com., 13 janv. 2009, n° 07-17961. Comp. Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-11633.
-
51.
Cass. 1re civ., 2 juin 1992, n° 90-19374.
-
52.
En cas d’erreur, la répétition de l’indu peut être admise : Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-22515.
-
53.
Les juges du fond sont censurés lorsqu’ils déduisent un recours de l’absence d’intention libérale (ex : Cass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 10-28475), raison pour laquelle on raisonnera précisément sur cette hypothèse, qui est celle qui pose un problème.
-
54.
Sauf à prouver un droit d’action contre le débiteur, par exemple sur le fondement de la gestion d’affaires, dont les conditions ne sont cependant pas évidentes à satisfaire : Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, n° 10-24512.
-
55.
Cass. 1re civ., 15 mai 1990, n° 88-17572.
-
56.
On pense évidemment au cas où le paiement s’explique par une intention libérale ou à celui où il est fait avec l’intention de porter préjudice au débiteur en exerçant le recours acquis contre lui.
-
57.
Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, n° 91-19443 ; Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 08-14516. La seule preuve de l’absence d’intention libérale ne suffit pas : Cass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 10-28475.
-
58.
V. cependant supra, note 24.
-
59.
Andreu L., « Le paiement dans les projets de réforme du droit des obligations », in Mignot M. et Lasserre Capdeville J. (dir), Le paiement, 2014, L’Harmattan.
-
60.
Art. 1221 du projet Catala.
-
61.
Art. 85 du projet Terré.
-
62.
V. François C., « Application dans le temps et incidence sur la jurisprudence antérieure de l’ordonnance de réforme du droit des contrats », D. 2016, p. 506 ; Andreu L., « L’intégration jurisprudentielle des projets de réforme dans le droit positif », D. 2013, p. 2108.
-
63.
V. Deshayes O., « La subrogation “conventionnelle” », in Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Decoopman, 2014, PUF, p. 131.
-
64.
Cass. 1re civ., 26 avr. 2017, n° 15-21563.
-
65.
Pour l’admission d’un recours personnel sur le fondement du « quasi-contrat de remboursement », v. Andreu L. et Martin D. R., « La subrogation personnelle », in La réforme du régime général des obligations, dir. Andreu L., 2011, Dalloz, p. 93.
-
66.
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-12942 : RTD civ. 2018, p. 121, obs. Barbier H. ; D. 2018, p. 1412, obs. Kenfack H. ; RTD com. 2017, p. 984, obs. Bouloc B.
-
67.
Cass. com., 3 mai 2001, n° 10-11983.
-
68.
Cass. com., 3 nov. 1980, n° 79-11360.
-
69.
Par quoi, d’ailleurs, le pourvoi pouvait être rejeté, qui invoquait la jurisprudence selon laquelle la prescription n’éteint pas le droit de créance et n’interdit pas de compenser : la compensation prenant en l’espèce la forme d’une demande reconventionnelle c’est cette demande elle-même qui est frappée par la prescription.
-
70.
Sur la discussion, v. nos obs. sous Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-29893 : LPA 31 mai 2017, n° 125v5, p. 7, spéc. p. 16-17, « La possible invocation de la compensation devant le juge de l’exécution ».
-
71.
Sur celle-ci, v. nos observations, LPA 1er août 2016, n° 118e4, p. 6 et « L’extinction de l’obligation », Dr. & patr. mensuel 2016, n° 258, p. 86 ; Hontebeyrie A., « La compensation », in Le nouveau régime général des obligations, 2016, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 151.
-
72.
C. civ., art. 1347.
-
73.
Sur la question, v., avant la réforme, Collin A., « Du caractère volontaire du déclenchement de la compensation », RTD civ. 2010, p. 229.
-
74.
V. les références précitées et Andreu L. et Martin D. R., JCl. Civil Code, art. 1347-4 à 1347-7.
-
75.
Barbier H., RTD civ. 2018, p. 121.
-
76.
Barbier H., RTD civ. 2018, p. 121.
-
77.
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11599 : Bull. civ. II, n° 74.
-
78.
C. consom., art. L. 137-2 anc., devenu C. consom., art. L. 218-2.
-
79.
Hontebeyrie A., V° Prescription extinctive, Rép. civ. Dalloz, n° 248.
-
80.
Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, nos 10-17575, 10-17576 et 10-17577.
-
81.
Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-17576.
-
82.
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-15331 : AJ Contrat 2017, p. 496, obs. Jacomino ; JCP E 2017, 1637, obs. Mathey N. ; Contrats, conc. consom. 2017, n° 232, obs. Bernheim-Desvaux ; BRDA 17/19, p. 20 ; LPA 21 déc. 2017, n° 130p0, p. 7, note Dupré M. ; RD bancaire et fin. 2017, n° 210, obs. Legeais D. ; Gaz. Pal. 21 nov. 2017, n° 307e4, p. 32, obs. Albiges C. ; ibid., n° 39, p. 56, obs. Bourassin M.
-
83.
Devenu C. consom., art. L. 218-2.
-
84.
L’hypothèse est complètement différente de celle de Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-12494, où la banque était la caution.
-
85.
V. en ce sens l’arrêt Lempereur (Cass. com., 8 nov. 1972, n° 71-11879) ; mais il faut rappeler que la cause a disparu et a été remplacée par un texte (C. civ., art. 1169), d’application difficile au cautionnement : Andreu L. et Pellier J.-D., « Les sûretés personnelles et la réforme du droit des obligations », in Les contrats spéciaux et la réforme du droit des obligations, dir. Andreu L. et Mignot M., 2017, Institut universitaire Varenne, p. 499.
-
86.
Cass. 3e civ., 25 avr. 2007, n° 06-10283 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-16894 ; (arrêts dont l’interprétation est débattue dès lors que la Cour de cassation ne vise pas la prescription en général mais seulement « la prescription libératoire extinctive de cinq ans prévue par l’article 2277 du Code civil alors applicable »).
-
87.
Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-12196.
-
88.
Cottet M., Essai critique sur la théorie de l’accessoire en droit privé, préf. Rochfeld J., 2013, LGDJ, n° 483.
-
89.
C. civ., art. 2313.
-
90.
V., déjà en ce sens, Cass. 2e civ., 2 févr. 1886 : S. 1887, 1, p. 5, note Labbé.
-
91.
Rappelons à toutes fins utiles que l’hypothèse est très différente de celle à l’œuvre dans Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15602 et Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-20398, où la Cour de cassation a interdit à la caution d’invoquer le dol subi par le débiteur dans le cas où la nullité n’avait pas été demandée – donc prononcée par le juge – par le débiteur. Tant que la nullité n’a pas été prononcée, le débiteur reste juridiquement tenu à l’égard de son cocontractant. On pourrait néanmoins faire valoir que la prescription suppose elle-même une invocation (v. C. civ., art. 2247) pour produire son effet, mais il nous semble que cette règle a une nature purement procédurale et ne devrait pas être comprise comme différant la libération du débiteur à cette invocation de la prescription. Il faudrait tout au contraire admettre que le débiteur est libéré du fait de la prescription, son invocation étant seulement une nécessité pour faire valoir celle-ci en justice.
-
92.
V. Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, nos 08-10081 et 08-16305 (deux arrêts) ; D. 2018, p. 169 ; RTD civ. 2018, p. 426, obs. Jourdain P. ; Gaz. Pal. 29 mai 2018, n° 323q4, p. 45, note Boyer F.
-
93.
Pour reprendre l’expression de Jourdain P., obs. préc.
-
94.
Jourdain P., obs. préc.