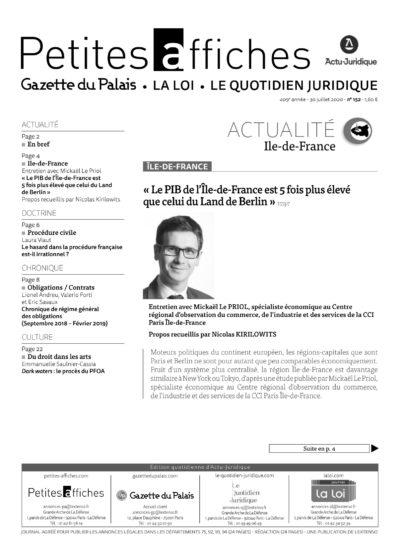Chronique de régime général des obligations (Septembre 2018 – Février 2019)
La chronique est assurée par Lionel Andreu, Valerio Forti et Éric Savaux, respectivement professeur, maître de conférences et professeur à l’Université de Poitiers et concerne la période allant de septembre 2018 à février 2019.
I – Les droits du créancier
A – Le droit à l’exécution
(…)
B – Les actions protectrices
L’action directe organise-t-elle un droit au paiement de la créance d’autrui ? (Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 17-31306) On sait que l’action directe en paiement permet à un créancier de réclamer paiement au débiteur de son débiteur1. Malgré l’ancienneté de l’institution, le temps n’a pas permis d’en révéler de manière décisive la structure2. L’action directe n’est-elle qu’une prérogative procédurale permettant à son bénéficiaire de mettre en œuvre une créance qui n’est pas la sienne ou contre un débiteur qui n’est pas le sien3 ? Ou bien est-elle à l’origine de l’attribution à son bénéficiaire d’un véritable droit substantiel l’unissant au sous-débiteur et permettant de réclamer à celui-ci le paiement de sa propre créance4 ou de celle de son débiteur5 ou encore le paiement d’une créance nettement distincte des obligations fondamentales6?
Pour résoudre une question de compétence juridictionnelle, l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 octobre 2018 apporte un élément de réponse à ces différentes interrogations7. En écho à quelques précédents jurisprudentiels8, il suggère que l’action directe organiserait un droit substantiel au paiement de la créance d’autrui, plus précisément un droit au paiement de la créance dont le débiteur intermédiaire est titulaire contre le sous-débiteur.
L’affaire concernait l’action de la victime d’un dommage contre l’assureur du responsable. Ce dernier souleva une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative qui fut accueillie par les juges du fond. En cassation, la victime reprochait à ces derniers de s’être déclarés incompétents. Selon le demandeur au pourvoi « les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l’action directe intentée par la victime d’un accident médical contre l’assureur du responsable, peu important que ce contrat d’assurance soit de droit public »9. Reprenant une analyse du Conseil d’État10, la Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir indiqué que « si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du Code des assurances à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance ; que la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat ». Le contrat d’assurance ayant en l’espèce un caractère administratif, les juridictions administratives se trouvaient seules compétentes11.
Au regard de la théorie de l’action directe, l’arrêt met en exergue que cette action « se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance ». Il faut ainsi comprendre deux choses. Premièrement, le créancier bénéficiaire dispose non seulement d’un droit substantiel contre le responsable, mais également, par le truchement de l’action directe, d’un droit de même nature, donc substantiel, contre le sous-débiteur : l’action directe n’a pas une nature purement procédurale12. Deuxièmement, ce droit substantiel fonde le créancier à exercer contre le sous-débiteur, non pas un droit qui lui serait complètement propre13, mais la créance du débiteur contre le sous-débiteur : l’action directe organise un droit au paiement de la créance d’autrui.
L’analyse s’inscrit dans la logique historique de l’institution. C’est en effet de l’action oblique que l’action directe a été extraite14. On comprend dès lors l’idée que la seconde, comme la première – quoique de manière différente : l’une est une action directe, tandis que l’autre est une action indirecte –, autorise l’exercice par le créancier des droits de son débiteur contre le sous-débiteur. Dans le sens de cette analyse s’inscrivent également les auteurs ayant théorisé l’action directe15 et un certain nombre de solutions jurisprudentielles16, en particulier l’opposabilité au bénéficiaire par le sous-débiteur des exceptions issues de sa dette17 ou la possibilité pour le créancier agissant d’invoquer les sûretés de la créance du débiteur contre le sous-débiteur18. D’autres décisions tirent cependant l’analyse dans un sens différent19 et la position de la Cour de cassation paraît heurter l’analyse traditionnelle selon laquelle l’action directe est à la source d’une cotitularité passive d’obligation qui donne au bénéficiaire deux débiteurs pour une seule et même dette, suggérant que le sous-débiteur serait rendu débiteur de la dette du débiteur intermédiaire (débiteur pour autrui)20. Au contraire, à suivre la décision commentée, le sous-débiteur ne serait pas rendu débiteur de la dette d’autrui, mais sa dette l’obligerait désormais envers deux créanciers, le bénéficiaire étant rendu créancier de la créance d’autrui (créancier pour autrui)21. En quoi l’action directe se rapprocherait de certaines formes de délégation22 et, surtout, du nantissement de créance23.
L’avenir de cette analyse jurisprudentielle reste cependant incertain. Celle-ci paraît en effet formellement incompatible avec les textes issus de l’ordonnance de réforme du droit des obligations du 10 février 2016. L’article 1341-3 du Code civil qui en est issu consacre en effet la théorie de l’action directe en indiquant qu’elle permet au créancier d’« agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur ». À suivre ce texte, le droit que le créancier exerce contre le sous-débiteur serait donc bien « sa (propre) créance », dont la force contraignante pour le débiteur est étendue au sous-débiteur, et non la créance du débiteur intermédiaire, dont le bénéfice serait étendu au créancier bénéficiaire. C’est dire qu’il faudra attendre que des décisions soient rendues sous l’empire du nouveau texte pour voir si la jurisprudence maintiendra son analyse de l’action directe ou si elle tirera profit de la réforme du droit des obligations pour achever pleinement l’émancipation de l’action oblique24.
Lionel ANDREU
II – Les modalités de l’obligation
A – Les modalités temporelles
(…)
B – Les modalités structurelles
Les critères de contribution à la dette des coobligés in solidum (Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20099). À première vue, le présent arrêt se borne à rappeler une solution bien ancrée en jurisprudence. À y regarder de plus près, il présente l’intérêt de réaffirmer une fois encore cette solution, alors que ses assises vacillent et que son avenir semble incertain.
Dans le cadre de travaux d’élargissement d’une autoroute, une société avait fait appel à une autre société pour lui livrer des enrobés. Cette dernière avait loué auprès d’une troisième société une semi-remorque avec benne. Un accident s’était produit sur le chantier à la suite de la rupture d’un axe de rotation de la benne, dans lequel un véhicule avait été endommagé. Le propriétaire du véhicule endommagé avait obtenu réparation, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, de la part de l’assureur du locataire de la benne. Ce dernier avait alors exercé un recours pour le tout, sur le fondement de la responsabilité pour faute, contre le loueur de la benne qui avait négligé d’entretenir la pièce mécanique à l’origine de l’accident. La cour d’appel avait décidé de ne pas faire droit pour le tout au recours contributif, dès lors que la responsabilité des deux coauteurs avait été admise. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, au motif qu’« un coauteur, responsable d’un accident sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du Code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ».
Cette solution est l’une de celles qui ont été forgées depuis longtemps par la Cour de cassation pour doter l’obligation in solidum d’un régime complet au plan de la contribution à la dette25. Voici, en peu de mots, les trois critères de contribution à la dette des coobligés in solidum : d’abord, si une faute est retenue à l’encontre de tous les coauteurs, ceux-ci contribuent à proportion de la gravité de leurs fautes respectives ; ensuite, si aucun n’a commis de faute, ils contribuent par parts égales ; enfin, si certains n’ont pas commis de faute (et sont par exemple déclarés responsables sur le fondement de la garde de la chose) et d’autres en ont commis une, seuls ces derniers supportent la charge définitive de la réparation. Mais ces trois critères pris conjointement sont connus, et il ne convient pas qu’on y revienne longuement.
Il est plus intéressant de s’attarder séparément sur le dernier critère, celui dont la Cour de cassation fait application en l’espèce. Car ce critère est moins acquis qu’il n’y paraît. S’agissant du présent, des auteurs commencent à le contester avec une certaine virulence : « Ce byzantinisme n’apparaît guère justifié, et est anachronique : il est en effet une survivance archaïque de la supériorité de la responsabilité pour faute, par rapport aux responsabilités objectives (qui seraient subsidiaires, ce qui est erroné depuis longtemps) »26. S’agissant de l’avenir, le projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars 2017 dispose, en son article 1265, alinéa 2, que « si toutes ou certaines (parmi les personnes responsables) ont commis une faute, elles contribuent entre elles à proportion de la gravité et du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable ». Par où l’on voit que le système du tout ou rien auquel aboutit le critère applicable en droit positif est davantage porté par des choix de politique juridique que par des exigences techniques.
Questionner le bien-fondé de la solution supposerait une réflexion bien plus vaste sur les fonctions, notamment préventive et sanctionnatrice, de la responsabilité civile27. Aussi convient-il de se contenter ici de constater l’attachement à cette solution dont fait preuve, une fois de plus, la Cour de cassation ainsi que la conséquence pratique qui en résulte : si au stade de l’obligation à la dette, la recherche d’une éventuelle faute d’un coauteur peut être indifférente pour la victime qui dispose d’autres fondements pour en engager la responsabilité, une telle recherche pourrait se révéler déterminante lorsque, au stade de la contribution à la dette, un autre coauteur ayant commis une faute souhaite exercer un recours contributif28.
Valerio FORTI
L’absence de présomption de solidarité active en matière commerciale (Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-28133). En dépit du principe légal selon lequel la solidarité ne se présume pas29, l’obligation est présumée solidaire du côté passif en vertu d’une exception commerciale fondée sur une coutume contra legem30. La Cour de cassation l’affirme depuis 1920 : « Selon un usage antérieur à la rédaction du Code de commerce et maintenu depuis, les tribunaux de commerce sont conduits à considérer que la solidarité entre débiteurs se justifie par l’intérêt commun du créancier, qu’il incite à contracter et des débiteurs, dont il augmente le crédit »31.
En matière commerciale, donc, la solidarité passive est présumée. Mais quid de la solidarité active ? Suit-elle le même sort ?
Jusqu’ici, on répondait volontiers par la négative, mais en citant quelques arrêts soit anciens soit d’espèce32. L’arrêt rapporté a donc le mérite de trancher la question de façon claire et nette.
Les deux associés d’une société à responsabilité limitée avaient cédé leurs parts à trois cessionnaires. L’acte de cession stipulait une garantie de passif pouvant être invoquée dans un délai précis. Deux cessionnaires avaient mis en jeu cette garantie dans le délai prévu, contrairement au troisième. Ce dernier s’était alors joint à eux ultérieurement, faisant valoir que l’action des deux autres cessionnaires avait interrompu, y compris à son profit, le cours du délai pour agir. Les juges du fond avaient adhéré à ce raisonnement, en s’appuyant sur le fait que « la solidarité est présumée en matière commerciale ». La chambre commerciale de la Cour de cassation censure l’arrêt en affirmant que « la solidarité active ne se présume pas », jamais donc, pas même en matière commerciale. Précisons que, bien que la solution soit rendue sur le fondement des textes antérieurs à la réforme du droit des obligations de 2016, rien dans les nouveaux textes ne permet de considérer qu’elle serait aujourd’hui révolue.
Reste à comprendre ce qui justifie cette différence de régime, l’explication n’étant pas livrée dans l’arrêt. Pour ce faire, il suffit de revenir à l’arrêt de 1920 ayant formulé la règle de la présomption de solidarité passive en matière commerciale33. La Cour de cassation y a fait preuve de pédagogie : inciter le créancier à contracter et augmenter, conséquemment, le crédit des débiteurs, voici la finalité de la présomption de solidarité passive. En peu de mots, la raison d’être de la présomption de solidarité passive en matière commerciale est la favor creditoris commercialiste, le régime de faveur accordé au créancier, qui rompt avec la favor debitoris civiliste. On s’explique alors que la présomption ne soit pas élargie à la solidarité active. Il est vrai que la solidarité active a la vertu de simplifier le paiement de la part du débiteur34. Il n’empêche que ceci ne revient nullement à favoriser le crédit. Là où la solidarité passive réduit le risque pour le créancier d’insolvabilité de l’un des codébiteurs en le mettant à la charge de l’autre codébiteur, la solidarité active fait au contraire naître un risque pour chaque cocréancier d’insolvabilité de l’autre cocréancier qui aurait reçu l’intégralité du paiement de la part du débiteur commun.
Ce qui précède ne suffit probablement pas à écarter de façon définitive le parallélisme entre la solidarité passive et la solidarité active35. Car, ponctuellement, il se peut que la solidarité active se révèle elle aussi profitable au créancier. C’est d’ailleurs précisément le cas dans l’arrêt commenté, ce qui explique peut-être que les juges du fond aient retenu la présomption de solidarité. En l’espèce, un cocréancier invoquait à son profit le bénéfice de l’interruption d’un délai, bien que l’acte d’interruption ait été réalisé par les autres cocréanciers. De prime abord, la raison d’être de la présomption de solidarité passive, à savoir la favor creditoris, pourrait en l’occurrence jouer également en faveur d’une présomption de solidarité active. À la réflexion, ce serait aller vite en besogne. En effet, l’interruption d’un délai au profit de l’ensemble des cocréanciers relève des effets dits secondaires de la solidarité active. Mais l’effet principal, à savoir le fait que le débiteur commun puisse se libérer valablement en payant l’un quelconque des cocréanciers, n’en représente pas moins un danger pour ces derniers. Or on ne saurait faire une application distributive des effets de la solidarité, selon qu’ils sont ou non favorables au créancier. La présomption de solidarité active en matière commerciale est en somme exclue en dépit du fait qu’elle puisse être parfois favorable aux cocréanciers, pour la raison que les effets secondaires suivent, si l’on ose dire, l’effet principal : accessorium sequitur principale.
Valerio FORTI
III – Les opérations sur obligations
A – Les opérations modificatives
L’opposabilité de la cession de créance ne suppose pas que la convention ait date certaine (CA Paris, 6 sept. 2018, n° 17/15845). On se souvient que l’ordonnance du 10 février 2016 a réformé le droit applicable à la cession de créance en abandonnant l’exigence d’une signification de la cession au débiteur pour son opposabilité aux tiers36. À la place, un principe d’opposabilité immédiate de la cession a été retenu : « Le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment (…) »37.
Ce nouveau système pose néanmoins la question de son articulation avec l’article 1377 du Code civil. Inspiré de l’ancien article 1328 du même code, le texte précise que « l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique ». On en tire comme conséquence qu’« un acte sous signature privée ne fait donc pas foi de sa date vis-à-vis des tiers qui peuvent la considérer comme inexacte ; en d’autres termes, elle leur est inopposable et, corollairement, l’acte en son entier »38.
Dès lors, on pouvait se demander si le principe d’opposabilité immédiate de la cession de créance instaurée par les nouveaux textes se trouvait étouffé par les règles régissant la date certaine des actes sous signature privée. C’est une réponse négative que retient fort logiquement la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 6 septembre 201839.
Les faits mettent en exergue l’intérêt du débat – en même temps que la légitimité des craintes d’une fraude par antidate que le nouveau système pourrait favoriser40. En exécution d’une ordonnance du 31 janvier 2017 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, un comptable du service des impôts avait fait pratiquer, le 8 février 2017, des saisies conservatoires de créances auprès des clients d’un redevable. Le débiteur contestait cette saisie conservatoire en présentant un acte de cession de ses créances à une tierce société daté du 1er février 2017 et enregistré le 10, ainsi qu’une lettre de notification de ladite cession en date du 2 février, émargée par le destinataire le même jour. Pressentant peut-être une fraude compte tenu de la chronologie des faits, le contribuable se retranchait devant la cour d’appel derrière l’article 1377 précité pour dénier à l’acte de cession une date opposable antérieure à la saisie conservatoire41. En vain, car la cour d’appel de Paris admet la pleine opposabilité de l’acte de cession de créance antérieur. Selon elle, « sauf à priver de portée les nouvelles dispositions spéciales de l’article 1323, le comptable public ne saurait y opposer celles de l’article 1377 du même code, conditionnant la date certaine d’un acte sous seing privé et donc son opposabilité à l’égard des tiers, à son enregistrement ». En foi de quoi « l’antériorité de la cession de créances à la saisie conservatoire étant établie, il convient d’ordonner mainlevée de la mesure conservatoire ».
Au fond, la décision ne surprend pas. L’idée que le principe d’opposabilité immédiate d’un transfert de créance va de pair avec une éviction de l’exigence d’une date certaine avait déjà été avancée par quelques auteurs : « La date de l’acte devient décisive. Quelle est-elle ? C’est celle qui figure sur l’écrit dont la rédaction est imposée par l’article 1322. Contrairement à la règle générale posée par l’ancien article 1328, cette date peut être opposée aux tiers même si elle n’est pas “certaine” »42. De manière plus générale, il existe un courant de contestation de la portée que l’on prête à l’article 1377 précité. Sa formulation diffère en effet de celle de l’ancien article 132843. Ce dernier excluait toute opposabilité aux tiers de la date d’un acte sous signature privée en l’absence d’évènement lui attribuant date certaine, tandis que le nouveau se contente d’indiquer quand un acte sous signature privée a date certaine sans préciser qu’une telle date certaine serait exigée pour l’opposabilité aux tiers44. Dans cette vision des choses, la date mentionnée sur un acte sous signature privée n’ayant pas date certaine « peut néanmoins être invoquée contre les tiers, mais sans avoir de force probante absolue »45.
De fait, le comptable aurait été mieux avisé de se prévaloir des textes sur la cession de créance, qui lui offraient un chef de contestation de la cession plus intéressant. Car après avoir indiqué que la cession de créance est opposable aux tiers immédiatement, l’article 1323 précise : « En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen ». La portée exacte de ce texte est certes discutée46, mais on peut regretter que le comptable ne l’ait pas opposé à son débiteur, ce qui aurait obligé la cour d’appel, en attendant une décision de la Cour de cassation, à prendre parti.
Lionel ANDREU
La notification de la cession de créance peut être faite par voie de conclusions (CA Orléans, 13 déc. 2018, n° 17/017711). Le principe d’opposabilité immédiate de la cession de créance47 ne s’applique pas à l’égard du débiteur cédé pour lequel le nouvel article 1324 du Code civil prévoit : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Comment opérer concrètement la « notification » mentionnée par le texte ? Aucun texte ne répond à cette question48. Il est néanmoins admis qu’une telle notification puisse être faite par tout moyen49. Ainsi, « une lettre simple suffirait à rendre l’opération opposable au débiteur »50. On a même suggéré que la notification pourrait être faite par « appel téléphonique si n’était la difficulté d’en rapporter la preuve »51. Sans aller jusque-là, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 13 décembre 2018 précise que cette notification peut opérer « par voie de conclusions »52.
Le litige concernait le remboursement d’un prêt accordé à deux coemprunteurs. La créance de remboursement ayant été cédée à un cessionnaire, celui-ci est intervenu volontairement à l’instance afin de solliciter la condamnation des emprunteurs à son profit – portant de ce fait la cession à la connaissance des emprunteurs. C’est cette intervention qui était discutée par ces derniers, lesquels prétendaient à l’irrecevabilité du cessionnaire. Ils soutenaient à cet effet que « la cession de créance dont se prévaut [le cessionnaire] leur est inopposable faute de leur avoir été notifiée ». L’irrecevabilité sera écartée par la cour d’appel. Après avoir repris in extenso la lettre de l’article 1324, la cour d’appel relève « qu’en l’espèce, [le cessionnaire] justifie de la cession de créance qui lui a été consentie par la société [cédante] par la production de l’acte de cession du 28 février 2017 qui a été régulièrement notifié aux intimés par voie de conclusions ». Elle en déduit que « le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’intervention [du cessionnaire] pour absence de notification de la cession de créance n’est pas fondé ».
L’analyse ne surprend guère. Sous l’empire des anciens textes, la jurisprudence admettait déjà que la signification puisse être opérée par voie de conclusions émanant soit du cédant53, soit du cessionnaire54. Il n’y avait donc pas de raison qu’il en aille différemment sous l’empire des nouveaux textes, qui sont plus libéraux. Dans la même veine, il ne fait pas de doute que la notification puisse résulter d’une assignation55 ou plus généralement d’un acte signifié56.
Tout au plus demeure-t-on dans l’incertitude concernant les éléments qui doivent être portés à la connaissance du débiteur pour que la notification soit considérée comme réalisée. En matière de cession de créances professionnelles, la difficulté est résolue par l’article R. 313-15 du Code monétaire et financier qui liste trois « mentions obligatoires » pour l’écrit notifié57. Aucun texte équivalent n’existe en matière de cession de créance de droit commun, tandis que le texte financier ne saurait lui être appliqué par analogie (exceptio est strictissimae interpretationis). À notre sens, il devrait suffire que le cédant ou le cessionnaire indique au débiteur que le changement de créancier a eu lieu58, le débiteur pouvant néanmoins exiger, dans le cas où la notification émane du cessionnaire, qu’une preuve de la cession lui soit fournie59.
Reste à voir si la jurisprudence saura s’orienter dans une direction aussi libérale.
Lionel ANDREU
B – Les opérations créatrices
(…)
IV – L’extinction de l’obligation
A – Les modes d’extinction satisfactoires
(…)
B – Les modes d’extinction non satisfactoires
Nouvelle précision sur le point de départ de la prescription de l’action en paiement des honoraires de l’avocat (Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20508). Depuis quelques années, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rebâtit, arrêt après arrêt, le régime de la prescription de l’action en paiement d’honoraires engagée par un avocat à l’encontre de son client consommateur. L’ouvrage n’est cependant pas encore achevé. Pour s’en convaincre, il convient d’agencer ces divers arrêts les uns à côté des autres.
Le délai de prescription de cette action est assez bref : c’est, depuis un arrêt rendu en 201560, le délai biennal de prescription consumériste61.
La brièveté de ce délai de prescription est, du moins en partie, compensée par le fait que son point de départ est glissant. La solution inaugurée en 201162, réaffirmée en 201763, est reprise encore dans l’arrêt sous commentaire : « Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat ». Sur le plan technique, rien n’interdit de considérer que l’article 2224 du Code civil, qui vise le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », constitue déjà, à lui seul, un fondement suffisant pour cette solution. Mais sur le plan de l’opportunité la solution se nourrit également, et peut-être plus encore, de l’article suivant, qui dispose que « l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission ». Le point de départ de la prescription de l’action en paiement exercée par l’avocat à l’encontre du client (la fin du mandat) est, en effet, de la sorte aligné sur le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité exercée par le client à l’encontre de l’avocat (la fin de la mission).
Le caractère glissant du point de départ est le défaut de sa qualité. Autrement dit, la souplesse de la règle générale risque d’amener avec elle une imprévisibilité des solutions particulières. Or il ne faut pas que la finesse des solutions confine au pointillisme. Pourquoi alors ne pas recourir à un fait standard, permettant d’alléger la charge de la preuve du point de départ de la prescription de l’action en paiement d’honoraires engagée par un avocat à l’encontre de son client consommateur64 ? C’est, au fond, ce que la référence à la « fin du mandat » semblerait suggérer. Recourir à un fait standard ne serait pas lier les juges du fond ; ceux-ci continueraient à avoir les mains libres, dans la mesure où il ne s’agirait que d’une présomption pouvant être renversée.
Pourtant, ce n’est pas la voie que semble privilégier la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Par le passé, elle a déjà eu l’occasion d’exclure que la fin du mandat puisse coïncider avec le prononcé de la décision : « En soi le prononcé de la décision que l’avocat a été chargé d’obtenir n’a pas pour effet de mettre fin au mandat qu’il a reçu de son client »65. Dans le présent arrêt, publié au Bulletin, elle exclut également que la fin du mandat puisse être fixée au jour où l’avocat établit la facture, jour qu’elle qualifie ici d’« indifférent », alors que cette solution est retenue en matière d’action en paiement de la part de l’entrepreneur66.
Certes, on comprenait déjà que le prononcé de la décision ne met pas forcément un terme aux diligences de l’avocat, auquel il appartient toujours de donner au client son avis sur l’exercice éventuel d’une voie de recours et, parfois, de veiller à l’exécution de la décision. Certes aussi, on comprend qu’il puisse être peu opportun de laisser le soin à l’avocat, créancier, de fixer, en choisissant la date d’établissement de la facture, le point de départ de la prescription de sa propre action. Il n’en demeure pas moins que le recours à un fait standard serait bienvenu pour éviter un contentieux aussi nourri qu’imprévisible.
Valerio FORTI
L’« effacement d’une dette » ne fait pas disparaître le manquement contractuel de celui qui n’a pas exécuté l’obligation (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-21774). Dans un arrêt du 10 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions relatives à l’« effacement » des dettes, en opposant cette technique au paiement67.
L’arrêt posait une question simple : un débiteur ayant profité d’un rétablissement personnel emportant « effacement »68 de ses dettes peut-il subir une résiliation judiciaire pour inexécution du contrat dont la dette effacée était issue ? Le demandeur au pourvoi le contestait et reprochait aux juges du fond d’avoir admis la résiliation d’un contrat de bail « alors, selon le moyen, que l’effacement d’une dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement fait obstacle au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers couverts par la mesure d’effacement ». Sa prétention est rejetée par la Cour de cassation qui retient, tout au contraire, que « l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail ».
Dans cette formule, deux centres de gravité s’opposent.
D’un côté, la Cour de cassation « fait une nette distinction entre le paiement de l’obligation et son effacement »69 et « confirme ainsi que l’effacement de la dette n’a pas la nature juridique d’un paiement »70. La solution s’inscrirait ainsi dans la continuité de la jurisprudence antérieure71 et serait, à en croire certains auteurs, « logique : la procédure de surendettement suspend la procédure d’expulsion et permet l’effacement des dettes non apurées, mais cet effacement ne valant pas paiement, une fois la procédure terminée, l’expulsion est de nouveau possible, si elle apparaît justifiée »72.
D’un autre côté, la Cour de cassation ne s’arrête pas là et observe que l’effacement « ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer », ce dont il résulte la possibilité d’une résiliation judiciaire73. Le raisonnement est alors tout autre. L’idée à l’œuvre est ici plutôt que lorsque l’effacement advient, il ne remet pas en cause (« ne fait pas disparaître ») l’inexécution passée, qui a bel et bien eu lieu74.
Ces deux raisonnements mêlés par la Cour de cassation paraissent contradictoires. Leur mélange conduit à penser que c’est parce que l’effacement n’est pas un paiement qu’il ne ferait pas disparaître le manquement contractuel passé du locataire. Or il n’en est rien, pour la simple et bonne raison que le paiement ne fait pas non plus disparaître le manquement contractuel passé du débiteur qui paye sa dette avec retard75. Il n’empêche pas non plus le juge, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de prononcer la résiliation du contrat s’il considère le retard de paiement suffisamment grave. Une exécution tardive reste une inexécution76. En foi de quoi la différenciation opérée par l’arrêt du paiement et de l’effacement, qui suscite en soi une évidente adhésion, est indifférente à la solution retenue77.
On ne rejoindra donc pas les auteurs pour qui l’arrêt permettrait de mieux cerner la nature juridique de l’effacement78. Sa portée nous paraît plus réduite et avoir seulement trait au régime de l’effacement : il ne couvre pas l’inexécution antérieure du débiteur, ce dernier continuant à être exposé à la résolution malgré le prononcé du rétablissement personnel ou, en droit des entreprises en difficulté, le prononcé d’un rétablissement professionnel79. Reste que, comme l’a remarqué un auteur, « De ce point de vue, il manque au droit du surendettement et au rétablissement professionnel des mesures paralysant la résiliation du contrat. Ce n’est pas pour rien qu’il existe dans les procédures collectives des entreprises un régime des contrats en cours permettant d’exiger la poursuite du contrat malgré les inexécutions antérieures, ainsi que des textes interdisant l’action en résolution pour ces inexécutions »80.
Lionel ANDREU
La divisibilité de la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir en cas de pluralité de débiteurs solidaires (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18219). L’arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation apporte un éclairage important concernant les règles régissant la prescription à l’égard de codébiteurs solidaires81. Il retient qu’une cause de suspension de la prescription, tirée en l’occurrence de l’impossibilité d’agir du créancier, s’apprécie sur la tête de ce seul débiteur, alors même que le créancier serait en mesure d’agir contre un codébiteur. De manière plus discrète, l’arrêt paraît également indiquer que cette suspension de prescription ne produit effet qu’à l’égard du débiteur contre lequel l’impossibilité d’agir existe, et non à l’égard des autres.
L’affaire opposait une banque et différents débiteurs : les héritiers d’un débiteur décédé et la codébitrice de ce dernier. La banque avait tardé à introduire son action en justice. La cour d’appel jugea dès lors celle-ci prescrite à l’égard tant de l’épouse que des héritiers. Pour les juges du fond, la banque n’était pas dans l’« impossibilité d’agir » malgré son ignorance du décès de l’époux et de l’identité des héritiers lui ayant succédé : elle pouvait exercer des poursuites contre l’épouse, ce qui aurait eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs (C. civ., art. 2245). Le créancier ne pouvait donc profiter d’une suspension de la prescription ni à l’égard de l’épouse, ni à l’égard des héritiers.
Cette décision est censurée. La Cour de cassation commence par viser l’article 2234 du Code civil (relatif à la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir), ensemble l’ancien article 1203 du même code (relatif à la possibilité pour un créancier d’agir contre le codébiteur solidaire de son choix). Elle en tire ensuite le principe selon lequel « l’impossibilité d’agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire »82. Dès lors, la possibilité d’agir contre l’épouse est jugée impuissante à exclure l’impossibilité d’agir contre les héritiers, contrairement à ce qu’avaient décidé les juges du fond : « En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la banque n’avait eu connaissance de la dévolution successorale de [l’époux] que le 27 juin 2013, de sorte qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt jusqu’à cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La cassation est cependant partielle : l’arrêt d’appel est censuré, « mais seulement en ce qu’il déclare prescrite l’action en paiement formée contre [les héritiers] ». La prescription de la dette à l’égard de l’épouse n’est donc pas remise en cause.
En doctrine, l’arrêt a suscité une double série de critiques.
La première a trait à l’admission par la Cour d’une suspension de la prescription pour impossibilité d’agir. On a observé que le fait pour un créancier d’ignorer que son débiteur est décédé et quels sont ses héritiers peut difficilement être qualifié d’impossibilité d’agir83. On peine en tout cas à percevoir le « cas de force majeure » qui serait à l’œuvre84. L’impossibilité d’agir paraît ici appréciée avec une trop grande mansuétude par la Cour de cassation85. En revanche, l’appréciation de cette impossibilité d’agir sur la tête d’un seul des codébiteurs, et non en vérifiant qu’il y a une impossibilité générale d’agir à l’égard de tous, ne paraît pas inadmissible86. L’appréciation de l’impossibilité d’agir à l’égard de chaque débiteur pris isolément se révèle non seulement conforme à la structure de la solidarité (qui repose sur une pluralité de liens entre le créancier et chaque débiteur solidaire : chaque lien fait naître un droit de poursuite distinct), mais également à sa logique (la solidarité passive laisse le créancier « choisir »87 le débiteur qu’il souhaite poursuivre et on ne saurait le priver de son action contre un débiteur qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre au motif qu’il pouvait en poursuivre un autre contre lequel il n’a pas souhaité agir : sa liberté de choix ne doit pas être méconnue).
La seconde série de critiques a trait aux conséquences de la suspension de la prescription ainsi retenue. D’après les premiers commentateurs de l’arrêt, la Cour de cassation aurait ici consacré un « effet collectif de la suspension en matière de solidarité »88. Elle aurait ainsi « logiquement étendu l’effet de la suspension à l’ensemble des codébiteurs »89, ce dont découlerait « une cruauté annexe (…) : le coobligé non solidaire “d’origine” non décédé sera tenu solidairement d’autant plus longtemps »90. L’analyse nous semble cependant reposer sur une erreur de lecture91. Elle est en tout cas démentie par la cassation partielle intervenue qui conduit au maintien de la suspension de la prescription au profit de l’épouse92. On comprend dès lors que la prescription peut être acquise à l’égard d’un codébiteur solidaire (en l’occurrence, l’épouse), mais pas à l’égard d’un autre (en l’occurrence, les héritiers)93, ce qui conduit à admettre l’absence d’effet nécessairement collectif de la suspension de la prescription94 et à rejeter la thèse habituellement défendue selon laquelle la prescription serait une exception inhérente à la dette en matière de solidarité passive95.
Reste que si elle n’est pas une exception inhérente à la dette, c’est qu’elle constitue une exception personnelle à celui pour qui la prescription est acquise. On pourrait dès lors songer à appliquer à son codébiteur la dernière phrase de l’article 1315 du Code civil qui prévoit que « lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci (…), il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette ». Pour ce faire, il resterait cependant à déterminer si la prescription « éteint la part divise » du codébiteur qui en profite au sens de ce texte – question qui obligerait à rouvrir le débat, bien plus large, de la portée de l’effet extinctif de la prescription96.
Lionel ANDREU
Notes de bas de pages
-
1.
Solus H., L’action directe et l’interprétation des articles 1753, 1798, 1994 du Code civil, 1914, Sirey ; Cozian M., L’action directe, t. 92, 1969, LGDJ préf., Ponsard A. ; Jamin C., La notion d’action directe, t. 215, 1991, LGDJ, préf. Ghestin J.
-
2.
Rappr. Gréau F., in Rép. civ. Dalloz, vo Actions directes, 2019, n° 13.
-
3.
Sur le rejet, désormais classique, de cette analyse, v. infra, note 12.
-
4.
En ce sens paraît la doctrine qui voit dans l’action directe une forme de cotitularité passive. V. par ex. Briand P., Éléments d’une théorie de la cotitularité des obligations, thèse, Collart-Dutilleul F. (dir.), 1999, Nantes, n° 299, pour qui, en cas d’action directe accordée à un créancier, « La loi lui procure ainsi un second débiteur (le sous-débiteur), contre lequel il pourra récupérer ce que lui doit son propre débiteur (le débiteur intermédiaire), mais seulement à concurrence de ce que le sous-débiteur doit au débiteur intermédiaire. Il s’agit bien ici de cotitularité puisque le créancier dispose de deux débiteurs qui, au moins à concurrence de la plus faible des deux dettes, lui doivent la même chose ».
-
5.
V. par ex. Marty G., Raynaud P. et Jestaz P., Les obligations, t. 2, Le régime, 2e éd., 1989, Sirey, n° 164, pour lesquels « le créancier exerce le droit de son débiteur ».
-
6.
En ce sens, v. par ex. Mignot M., Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, 2002, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, nos 649 et s., pour qui l’action directe organise une « synthèse parfaite » des deux obligations en cause.
-
7.
Cass. 1re civ., 24 oct. 2018, n° 17-31306 : Procédures 2019, comm. 2, obs. Strickler Y. ; Resp. civ. et assur. 2019, comm. 28, obs. Bloch L. ; Procédures 2019, chron. 5, obs. Bléry C.
-
8.
V. infra les arrêts cités notes 9 et 10.
-
9.
Il s’inspirait de T. confl., 3 mars 1969, n° 01924, Esposito c/ Cie La Foncière : Lebon, p. 681. V. égal. T. confl., 15 avr. 2013, n° 3892. La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite loi MURCEF) affirma que les marchés passés en application du Code des marchés publics (dont peuvent relever certains contrats d’assurance) « ont le caractère de contrats administratifs ». V., en conséquence, T. confl., 22 mai 2006, n° 3503 et Cass. 1re civ., 23 janv. 2007, n° 04-18630, qui retiennent la compétence des juridictions administratives lorsque le contrat d’assurance est soumis au Code des marchés publics.
-
10.
CE, avis, 31 mars 2010, n° 33362.
-
11.
Cet aspect de la décision n’est pas davantage abordé dans ces observations qui s’intéressent à la structure obligatoire de l’action oblique.
-
12.
À vrai dire, l’analyse ne fait pas de doute. Depuis que la doctrine a théorisé la distinction du droit substantiel et de l’action, les auteurs s’accordent à relever que l’action directe porte mal son nom, car elle est plus un droit qu’une action (v. par ex. Marty G., Raynaud P. et Jestaz P., Les obligations, t. 2, Le régime, 2e éd., 1989, Sirey, n° 156).
-
13.
Que l’on raisonne sur la créance dont il dispose contre le débiteur ou d’un droit nouveau opérant la synthèse des deux obligations fondamentales.
-
14.
Dross W., in JCl. Civil, Art. 1341-3, n° 9. L’action directe apparaît ainsi comme une « amélioration de l’action oblique » (Ta I., Le renouveau de l’action oblique, thèse, Aynès L. (dir.), 2018, Paris 1, n° 132).
-
15.
Solus H., L’action directe et l’interprétation des articles 1753, 1798, 1994 du Code civil, 1914, Sirey, v. spéc. n° 81 (rapprochement à la solidarité active) et n° 66 (« le créancier exerc[e] en réalité des droits qui sont ceux de son débiteur »). V. égal. Cozian M., L’action directe, thèse, 1966, dact., p. 300, pour qui l’action directe conduit à un transfert de la créance du débiteur intermédiaire (mais l’auteur y voit également plus loin une forme d’obligation in solidum pour les débiteurs). Comp. avec l’analyse de Jamin C., La notion d’action directe, t. 215, 1991, LGDJ, nos 376 et s.
-
16.
En matière de compétence matérielle, c’est déjà elle qui fondait la position traditionnelle du Tribunal des conflits dans le sens, avant la loi MURCEF (v. supra, note 9), des juridictions judiciaires : v. T. confl., 3 mars 1969, n° 01924, retenant que « l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ».
-
17.
Sur cette question délicate, v. en part. Dross W., in JCl. Civil, Art. 1341-3, nos 100 et s.
-
18.
Sur laquelle, v. Jamin C., La notion d’action directe, t. 215, 1991, LGDJ, n° 400.
-
19.
V. par ex. Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-10951, qui retient que l'action directe contre l’assureur « trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit dès lors par même délai que l'action de la victime contre le responsable ». Sur l’inopposabilité de la clause attributive de compétence territoriale, v. égal. Cass. 1re civ., 19 mars 2008, n° 07-10216.
-
20.
V. en ce sens par ex., Cass. 1re civ., 14 nov. 1995, n° 92-18200 (qui retient de manière contradictoire cette analyse après avoir pourtant observé que « l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance »).
-
21.
Sur la figure du créancier pour autrui, v. notre thèse, Andreu L., Du changement de débiteur, vol. 92, 2009, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de thèses, v. spéc. n° 29.
-
22.
On pense à la délégation incertaine dans laquelle le délégataire est rendu créancier de la créance dont le délégant dispose sur le délégué (v. Andreu L., Du changement de débiteur, vol. 92, 2009, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de thèses, v. spéc. n° 29). Sur l’incidence de l’ordonnance du 10 février 2016 sur cette figure, v. Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 4e éd., 2019, Gualino, nos 2167 et 2173.
-
23.
V. déjà, Julienne M., Le nantissement de créance, 2012, Economica, préf. Aynès L., n° 158.
-
24.
On ne saurait au demeurant exclure que la jurisprudence tienne compte de la grande variété des actions obliques pour leur prêter une structure distincte selon les hypothèses concernées.
-
25.
Cass. 2e civ., 11 juill. 1977, n° 75-15669.
-
26.
Le Tourneau P. (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, 11e éd., 2018, Dalloz action, n° 2132.146. V. aussi Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 4e éd., 2016, Lexisnexis, n° 592 ; Hacene A., obs. sous Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20099 : Dalloz actualité, 9 oct. 2018.
-
27.
Comp. Jacquemin Z., « Responsable mais pas coupable : la contribution à la dette ou le rétablissement des priorités », obs. sous Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20099 : Gaz. Pal. 15 janv. 2019, n° 339j9, p. 24.
-
28.
Quézel-Ambrunaz C., obs. sous Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20099 : D. 2019, p. 38.
-
29.
V., auj., C. civ., art. 1310.
-
30.
Dondero B., « La présomption de solidarité en matière commerciale : une rigueur à modérer », D. 2009, p. 1097.
-
31.
Cass. req., 20 oct. 1920.
-
32.
V. not. Cass. civ., 15 juin 1914 ; Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-16905.
-
33.
Cass. req., 20 oct. 1920.
-
34.
Pellier J.-D., note sous Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-28133 : D. 2018, p. 2404.
-
35.
Sur la question, comp. Libchaber R., « Les embarras de la solidarité dite “commerciale” », sous Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-28133 : RDC 2019, n° 115w5, p. 50.
-
36.
V. notre chronique, Andreu L., Forti V. et Savaux E., « Chronique de régime général des obligations (Septembre 2015 - février 2016) (2e partie) », LPA 2 août 2016, n° 119u1, p. 6.
-
37.
C. civ., art. 1324, al. 1 et 2. Pour l’opposabilité particulière au débiteur, v. infra, nos obs. sous CA Orléans, 13 déc. 2018, n° 17/017711.
-
38.
Lardeux G., in Rép. civ. Dalloz, v° Preuve : modes de preuve, 2019, n° 194.
-
39.
CA Paris, 6 sept. 2018, n° 17/15845, inédit.
-
40.
Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 4e éd., 2019, Gualino, n° 2090.
-
41.
Rappelons qu’en cas de conflit sur créance, est préféré celui qui a acquis le premier des droits opposables aux tiers : prior tempore potior jure (arg. C. civ., art. 1325). Sur le conflit entre un saisissant et un cessionnaire de créance, v. Andreu L., in JCl. Civil Code, Art. 1321 à 1326, fasc. 20, n° 37.
-
42.
Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2018, LexisNexis, p. 740.
-
43.
Sur l’origine de cette modification, v. Gijsbers C., « La preuve par écrit : une ambition modeste servie par des textes perfectibles », Dr. & patr. mensuel 2015, p. 55.
-
44.
Selon un auteur, « Cette mince différence rédactionnelle rend possible une importante évolution substantielle, ainsi que l'ont relevé Messieurs Deshayes, Genicon et Laithier. En affirmant que l'acte sous signature privée ne peut acquérir date “certaine” que par la réalisation des événements énumérés par la loi, l’article 1377 indique en creux que l'acte peut avoir une date indépendamment de cette réalisation. L'acte serait alors doté d'une date hypothétique, éventuelle, discutable, controversée, mais d'une date malgré tout et, quelque fragile que soit sa date, l'acte pourrait être opposé » (Ferrié S.-M., « La date des actes sous signature privée après l'ordonnance du 10 février 2016 », D. 2019, p. 652).
-
45.
Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2018, LexisNexis, p. 1002. Contra Lardeux G., in Rép. civ. Dalloz, v° Preuve : modes de preuve, 2019, n° 195, pour qui « Une telle analyse n'est cependant pas incontestable dans la mesure où elle tend à réduire à néant la portée de l’article 1377 du Code civil : s'il est permis de prouver la date par tous moyens, ce texte perd en effet toute son utilité. Pourquoi alors le législateur l'aurait-il reconduit ? Si sa règle est inopportune, le nombre élevé d'exceptions pouvant le faire penser (Ferrié S.-M., « La date des actes sous signature privée après l'ordonnance du 10 février 2016 », D. 2019, p. 652), seule son abrogation peut y mettre un terme. À noter au demeurant que la Cour de cassation a déjà précisé que l’article 1377 du Code civil avait repris, sans changement, les dispositions de l'ancien article 1328 (Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 15-28023) ». L’arrêt mentionné par l’auteur paraît cependant surinterprété (la Cour de cassation n’affirme aucunement que la règle aurait été reprise sans changement) et il n’est pas exact d’écrire qu’avec cette analyse l’article 1377 n’aurait aucune utilité (il permettrait de déterminer quand un acte sous signature privé a date certaine, ce qui est déjà beaucoup).
-
46.
V. Andreu L., in JCl. Civil Code, Art. 1321 à 1326, fasc. 20, n° 34.
-
47.
V. ci-dessus, nos obs. sous CA Orléans, 13 déc. 2018, n° 17/017711.
-
48.
Comp., en matière de cession de créances professionnelles, l’article R. 313-15 du Code monétaire et financier, mentionné à la note suivante.
-
49.
Rappr. C. mon. fin., art. R. 313-15 : « La notification prévue à l’article L. 313-28 peut être faite par tout moyen ».
-
50.
V. Andreu L., in JCl. Civil Code, Art. 1321 à 1326, fasc. 10, n° 43. Comp., sous l’empire du droit antérieur, Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-15151. Pour des raisons probatoires, la lettre recommandée est fortement conseillée. Sur l’admission de celle-ci, v. CA Versailles, 6 déc. 2018, n° 18/03921.
-
51.
V. Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2018, LexisNexis, p. 743.
-
52.
CA Orléans, 13 déc. 2018, n° 17/017711. Sur cet arrêt, v. les obs. de Latina M. sur le blog relatif à la réforme du droit des obligations : http://reforme-obligations.dalloz.fr/. Rappr. CA Orléans, 6 déc. 2018, n° 17/03600.
-
53.
Cass. 1re civ., 8 oct. 1980, n° 79-13748 : « La signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant est valable, dès lors que la cour d'appel a relevé souverainement qu'elle contenait les éléments nécessaires à l'exacte information de la caution quant au transfert de la créance ».
-
54.
Cass. com., 29 févr. 2000, n° 95-17400 : « Les conclusions de l'assureur du 21 mars 1995 valaient signification de la cession de créance faite en sa faveur ».
-
55.
Cass. com., 18 févr. 1969 : Bull. civ. IV, n° 65 : « Il suffit, pour que l'assignation vaille signification de la cession de créance, qu'elle donne, comme la signification, un extrait de la cession rendant le transport certain ».
-
56.
Andreu L., in JCl. Civil, Art. 1321 à 1326, fasc. 10, n° 43. V. par ex. CA Paris, 17 oct. 2019, n° 19/05051 : « La notification de la cession de créance peut parfaitement résulter de la signification d'un commandement aux fins de saisie, s'il contient tous les éléments d'information du débiteur cédé tels qu'envisagés par la loi ».
-
57.
« La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes : 1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :
-
58.
“Nous a cédé/ nanti la/ les créance(s)” ;
-
59.
2° La désignation de la (ou les) créance(s) cédée(s) ou nantie(s), comme suit :
-
60.
“Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.
-
61.
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance(s) à…” ;
-
62.
3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :
-
63.
“En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de… (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué).” ».
-
64.
Contra Julienne M., Régime général des obligations, 2e éd., 2018, LGDJ, n° 171, note 119, pour qui « le régime de la cession Dailly pourrait ici servir de modèle ». À notre sens, d’ailleurs, l’injonction de payer le cessionnaire ne devrait pas avoir à être expressément formulée (comp. avec C. mon. fin., art. R. 313-15). Elle est implicite. Le cédant ou le cessionnaire devrait néanmoins pouvoir demander au débiteur de se libérer entre les mains du cédant jusqu’à nouvel ordre.
-
65.
Comp. art. 11 :303 (2) des Principes du droit européen des contrats : « Toutefois, si la notification émane du cessionnaire, le débiteur peut, dans un délai raisonnable, lui demander d’apporter une preuve digne de foi de la réalité de la cession et suspendre l’exécution dans l’intervalle ».
-
66.
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11599 : Bull. civ. II, n° 74.
-
67.
C. consom., art. L. 137-2 anc., devenu C. consom., art. L. 218-2.
-
68.
Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-17575 ; Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-17576 ; et Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, n° 10-17577.
-
69.
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-23599 : LPA 19 avr. 2019, n° 142q2, p. 7, obs. Forti V.
-
70.
Sur la question en général, v. Hontebeyrie A., in Rép. civ. Dalloz, v° Prescription extinctive, 2016, n° 248.
-
71.
Cass. 2e civ., 26 oct. 2017, n° 16-23599.
-
72.
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-10908.
-
73.
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-21774 : D. 2019, p. 411, note François J. ; D. 2019, p. 1129, obs. Damas N. ; D. 2020, p. 624, obs. Aubry H. ; AJDI 2019, p. 909, obs. Damas N. ; JCP G 2019, 183, note Grosser P. ; JCP G 2019, 749, obs. Billiau M. ; JCP N 2019, 1308, obs. Monéger J. ; JCP N 2019, 1401, note Stefania T. ; Gaz. Pal. 9 avr. 2019, n° 346r5, p. 25, obs. Houtcieff D. ; Gaz. Pal. 23 avr. 2019, n° 350r1, p. 28, obs. Mouial-Bassilana E. ; RDC 2019, n° 116b9, p. 63, note Julien J. ; Dalloz actualité, 6 févr. 2019, obs. Dreveau C. ; LEDC mars 2019, n° 112d7, p. 7, obs. Cattalano G. ; Defrénois 23 mai 2019, n° 148t5, p. 37, obs. Seube J.-B. ; Procédures 2020, chron. 3, obs. Cardini C. et Lemoine S.
-
74.
Le vocable d’effacement était naguère employé par l’article L. 332-5 du Code de la consommation. Le texte est devenu l’article L. 741-3, puis l’article L. 741-2 de ce code. Le vocable d’effacement a également été employé par le législateur relativement au rétablissement professionnel organisé par le livre VI du Code de commerce : v. les articles L. 645-11 et L. 645-12 de ce code. Pour une analyse de la notion d’effacement, v. D. 2019, p. 411, note François J. intitulée « Qu’est-ce que l’effacement de la dette d’un débiteur insolvable ? ». Sur les limites de l’analyse au regard du présent arrêt, v. cep., infra.
-
75.
AJDI 2019, p. 909, obs. Damas N.
-
76.
Dreveau C., in Dalloz actualité, 6 févr. 2019.
-
77.
Dans le cas où une clause de réserve de propriété garantit une créance, la Cour de cassation juge que l’effacement, qui ne vaut pas paiement, n’entraîne pas le transfert de propriété, Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-10891 : « L'extinction de la créance (…) du fait de l'effacement des dettes [de l’acheteur] consécutif à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel dont elle avait bénéficié, n'équivalait pas à son paiement de sorte que le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l'acquéreur ».
-
78.
D. 2020, p. 624, obs. Aubry H. À notre sens, le fait que l’effacement ne se ramène pas au paiement n’explique, à lui seul, rien du tout. Une fois la différence entre les deux techniques admise – ce qui ne pose d’ailleurs absolument aucune difficulté –, il reste à expliquer pourquoi, sur une question donnée, il ne pourrait lui être assimilé. Rappr. Defrénois 23 mai 2019, n° 148t5, p. 37, obs. Seube J.-B., qui prend l’exemple de la prescription.
-
79.
Ou, par extension, d’une résiliation non judiciaire. Sur l’absence de règle susceptible d’empêcher la poursuite en résolution, v. Lafaurie K., La force obligatoire du contrat à l’épreuve des procédures d’insolvabilité, 2020, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, v. spéc. nos 145 et s.
-
80.
Rappr. Stefania T., note préc., qui commence ainsi sa note : « Si la mesure d'effacement entraîne l'extinction de la dette, elle ne fait point table rase du passé. Tel est l'enseignement livré par la décision du 10 janvier 2019 » (nous soulignons).
-
81.
Quand bien même tel serait le cas, il resterait à expliquer pourquoi l’effacement ne pourrait pas être assimilé au paiement de ce point de vue : v. supra, note 72.
-
82.
L’article 1217 nouveau du Code civil le confirme au demeurant en prévoyant la résolution du contrat lorsque « l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement ».
-
83.
Bien évidemment, le juge chargé d’apprécier la résiliation pourra tenir compte du fait qu’un effacement de la dette n’est pas équivalent à paiement tardif, mais il s’agit d’une autre question.
-
84.
V. par ex. Stefania T., note préc., pour qui il faut déduire de l’arrêt que « seul le paiement fait disparaître le défaut de règlement du loyer » et empêche « le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire [de] se prononcer dans les conditions prévues à l’article 1184 du Code civil ». L’auteur précise dans le même sens plus loin : « La Cour de cassation semble donc considérer que le paiement est la seule cause d'extinction des obligations susceptible de faire disparaître le défaut de règlement de loyer à l'origine de la demande de résiliation judiciaire ». Comp., François J., in D. 2019, p. 411, pour qui le présent arrêt conduit à admettre que l’effacement n’est pas, comme le paiement, une cause d’extinction de l’obligation : « En effet, si l'effacement de la dette entraînait son extinction, comment le débiteur pourrait-il être considéré comme étant défaillant pour ne pas l'avoir exécutée ? L'effacement purgeant l'inexécution, son créancier ne devrait pas pouvoir invoquer les suites attachées à cette dernière, par exemple (…) en réclamant la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ». V. égal. Defrénois 23 mai 2019, n° 148t5, p. 37, obs. Seube J.-B. : « La vraie question est de savoir si l’effacement emporte ou non extinction de la dette. La réponse est négative : si l’effacement de la dette entraînait son extinction, on peinerait à concevoir que le débiteur soit considéré comme défaillant de ne l’avoir pas exécuté ».
-
85.
Il faut néanmoins nuancer la portée de l’arrêt au regard des évolutions apportée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ÉLAN) : v. Lafaurie K., La force obligatoire du contrat à l’épreuve des procédures d’insolvabilité, 2020, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, in fine.
-
86.
Lafaurie K., La force obligatoire du contrat à l’épreuve des procédures d’insolvabilité, 2020, LGDJ, Bibliothèque de droit privé.
-
87.
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18219 : D. 2019, p. 840, obs. Vitse S. ; AJ fam. 2019, p. 349, obs. Casey J. ; AJCA 2019, p. 129, obs. Houtcieff D. ; AJDI 2019, p. 707, obs. Moreau J. ; Contrats, conc. consom. 2019, comm. 60, obs. Leveneur L. ; RDC 2019, n° 116a8, p. 31, obs. Libchaber R. ; JCP G 2019, doctr. 749, obs. Billiau M. ; Defrénois 23 mai 2019, n° 148t6, p. 38, obs. Seube J.-B. ; LEDC févr. 2019, n° 112b9, p. 7, obs. Leblond N. ; Gaz. Pal. 9 avril 2019, n° 346r4, p. 24, note Houtcieff D. ; Gaz. Pal. 11 juin 2019, n° 353u9, p. 58, obs. Roussille M. ; Dalloz actualité, 15 févr. 2019, obs. Pellier J.-D.
-
88.
La Cour ajoute « peu important que le créancier ait la faculté, en application de l’article 2245, alinéa 1er, du Code civil, d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l’un quelconque d’entre eux ». La précision, sur ce point, se comprend : ce n’est pas parce qu’un créancier n’est pas empêché d’interrompre la prescription qu’il n’est pas empêché d’agir. Il s’agit de deux questions distinctes.
-
89.
V. par ex. les substantielles observations de Houtcieff D., in AJCA 2019, p. 129, ou celles de Casey J., in AJ fam. 2019, p. 349, qui insistent sur le caractère « absolu » de l’impossibilité d’agir dans la jurisprudence de la Cour de cassation. On reconnaîtra néanmoins que celle-ci admettait déjà l’impossibilité d’agir de celui qui a « de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit » (ex Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-30551). De ce point de vue, l’arrêt procéderait seulement d’une extension du raisonnement tiré de l’ignorance par un créancier de son droit à l’hypothèse dans laquelle il ignore contre qui il doit l’exercer (rappr. Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n° 15-27574).
-
90.
L’irrésistibilité, en particulier, paraît difficile à caractériser. Le créancier ne devrait-il pas démontrer qu’il a été dans l’impossibilité de déterminer qui était son débiteur ? La Cour de cassation paraît pour sa part se contenter du fait que « la banque n’avait eu connaissance de la dévolution successorale [du débiteur] » pour en déduire (« de sorte que ») que celle-ci « s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt jusqu’à cette date ». Elle paraît ainsi faire un mauvais mélange entre l’article 2224 (qui prend en compte l’ignorance des faits permettant d’exercer une action pour faire courir à prescription) et l’article 2234 (qui suppose une impossibilité d’agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure).
-
91.
La jurisprudence antérieure relative à l’ignorance du créancier réservait pour sa part la légitimité de celle-ci (v. supra, note 83), ce que ne fait pas ici la Cour de cassation qui censure la décision d’appel pour violation de la loi (et non manque de base légale).
-
92.
Contra, Houtcieff D., AJCA 2019, p. 129. Comp. avec ce qui est écrit supra, note 82.
-
93.
Ce choix, réservé par l’ancien article 1203 du Code civil, est expressément rappelé par la Cour de cassation pour asseoir son raisonnement.
-
94.
Houtcieff D., AJCA 2019, p. 129. V. égal. Mignot M., Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, 2002, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, et Pellier J-D., in Dalloz actualité, 15 févr. 2019.
-
95.
AJDI 2019, p. 707, obs. Moreau J.
-
96.
AJDI 2019, p. 707, obs. Moreau J.
-
97.
On l’a fait reposer sur la mention par la Cour de l’ancien article 1203 (v. par ex. AJDI 2019, p. 707, obs. Moreau J.) et l’indifférence d’une possibilité d’interrompre la prescription en agissant contre l’épouse (v. par ex. Mignot M., Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, 2002, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses), ce qui peut être discuté (v. supra, notes 82 et 87).
-
98.
V. égal. en ce sens, Leveneur L., in Contrats, conc. consom. 2019, comm. 60, et Libchaber R., in RDC 2019, n° 116a8, p. 31.
-
99.
Comp., s’agissant de la solidarité active, v. l’ancien article 1199, devenu l’article 1312 (mais le texte suppose un « acte »).
-
100.
L’analyse pourrait valoir également sous l’empire des textes issus de l’ordonnance du 10 février 2016. Certes, l’article 1312 du Code civil prévoit que « Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers », mais le texte (relatif à la seule solidarité active) suppose un « acte » suspensif, tandis que la plupart des causes de suspension découlent d’une situation (minorité, mariage, etc.).
-
101.
V. par ex. François J., Les obligations, Régime général, 4e éd., 2017, Economica, n° 300 : « La prescription est inhérente à la dette et il est logique de décider qu'elle doive courir de la même manière contre tous ». Comp., Cass. com., 24 sept. 2003, n° 01-12770, qui retient « qu'en cas de solidarité, la suspension de la prescription ne peut être invoquée que par les personnes au profit desquelles la loi l'a établie et qu'elle ne joue que contre les personnes à l'égard desquelles la loi l'accorde ». V. égal., CE, 10 oct. 2014, n° 364344 : « Le jugement d'ouverture de la procédure collective ne suspend la prescription qu'à l'égard de la personne visée par cette procédure ». Comp. Mignot M., in JCl. Civil, Art. 1309 à 1319, fasc. 20, n° 107.
-
102.
Sur lequel, v. par ex. François J., Les obligations, Régime général, 4e éd., 2017, Economica, n° 221.