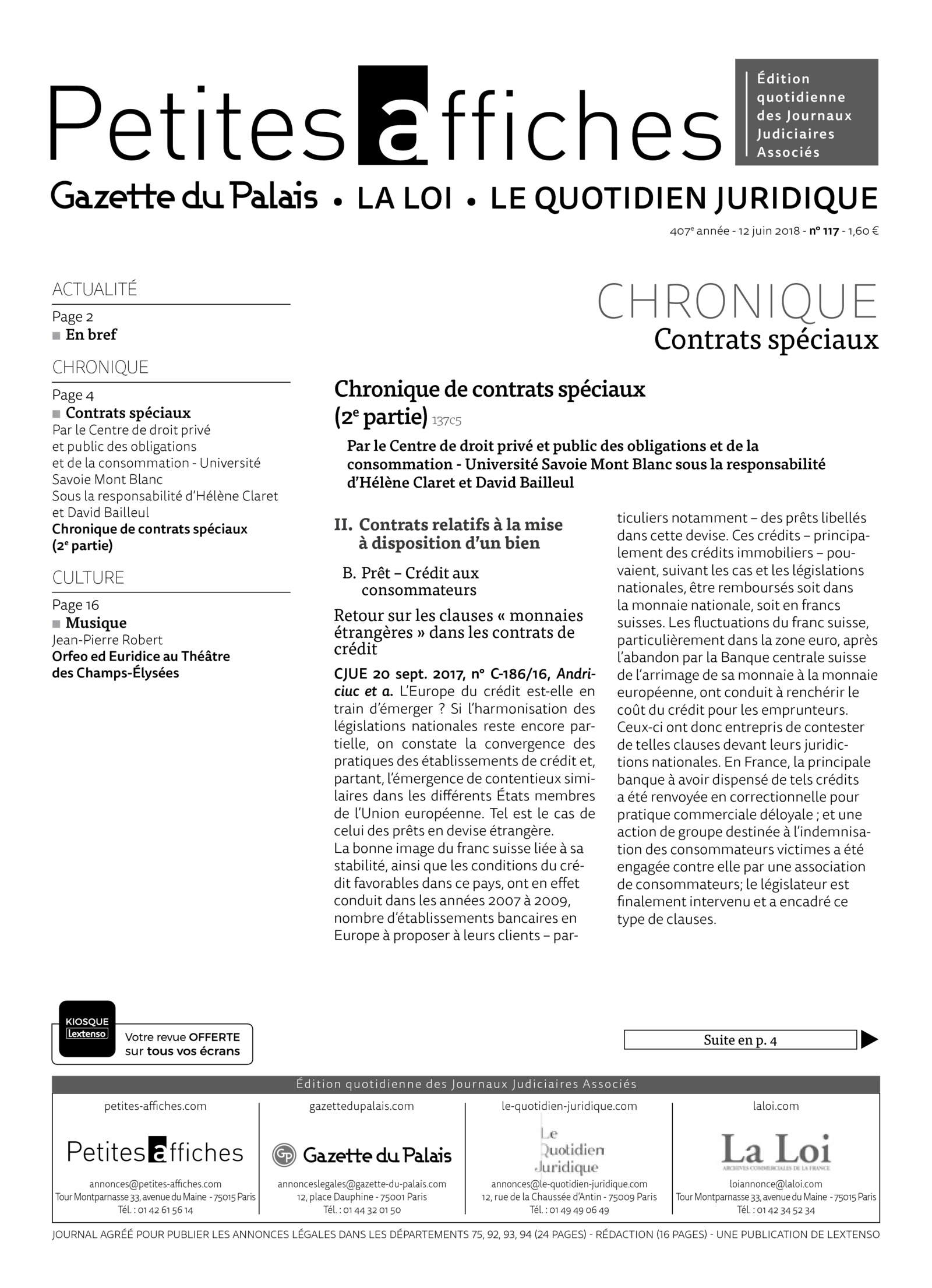Chronique de contrats spéciaux (2e partie)
I – Contrats relatifs au transfert de propriété d’un bien : vente immobilière
II – Contrats relatifs à la mise à disposition d’un bien
A – Bail
B – Prêt – Crédit aux consommateurs
Retour sur les clauses « monnaies étrangères » dans les contrats de crédit
CJUE 20 sept. 2017, n° C-186/16, Andriciuc et a. L’Europe du crédit est-elle en train d’émerger ? Si l’harmonisation des législations nationales reste encore partielle, on constate la convergence des pratiques des établissements de crédit et, partant, l’émergence de contentieux similaires dans les différents États membres de l’Union européenne. Tel est le cas de celui des prêts en devise étrangère.
La bonne image du franc suisse liée à sa stabilité, ainsi que les conditions du crédit favorables dans ce pays, ont en effet conduit dans les années 2007 à 2009, nombre d’établissements bancaires en Europe à proposer à leurs clients – particuliers notamment1 – des prêts libellés dans cette devise. Ces crédits – principalement des crédits immobiliers2 – pouvaient, suivant les cas et les législations nationales, être remboursés soit dans la monnaie nationale, soit en francs suisses. Les fluctuations du franc suisse, particulièrement dans la zone euro, après l’abandon par la Banque centrale suisse de l’arrimage de sa monnaie à la monnaie européenne, ont conduit à renchérir le coût du crédit pour les emprunteurs. Ceux-ci ont donc entrepris de contester de telles clauses devant leurs juridictions nationales. En France, la principale banque à avoir dispensé de tels crédits a été renvoyée en correctionnelle pour pratique commerciale déloyale ; et une action de groupe destinée à l’indemnisation des consommateurs victimes a été engagée contre elle par une association de consommateurs3 ; le législateur est finalement4 intervenu et a encadré ce type de clauses5. Par ailleurs, non seulement en France mais dans d’autres États membres, particulièrement la Roumanie6, les emprunteurs ont contesté ces clauses sur le terrain des clauses abusives7. C’est ainsi que la Cour de justice a été amenée à se prononcer à plusieurs reprises8 et encore par le présent arrêt, sur le caractère abusif de telles clauses.
Ainsi de nombreux consommateurs en Roumanie9 avaient souscrit ce type de crédits auprès d’une banque roumaine. À la différence de ceux qui avaient été soumis à la Cour de cassation10 ou aux juridictions hongroises11, ces crédits émis en francs suisses devaient être remboursés dans cette même devise. À la suite des fluctuations du leu par rapport à cette monnaie, beaucoup d’emprunteurs se sont trouvés en grandes difficultés financières et, contestant les clauses monétaires contenues dans leur contrat de crédit, ont saisi les juridictions roumaines. Celles-ci estimant que l’affaire posait des questions d’interprétation de la directive n° 93/13, ont renvoyé en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice. Au-delà de la question de la recevabilité du renvoi, 3 questions étaient posées : sur le moment de la prise en compte du déséquilibre significatif, la notion d’objet principal du contrat de prêt et le sens de l’exigence du caractère « clair et compréhensible » de la clause contractuelle. Si la réponse à la première question reste classique (le caractère abusif doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat en tenant compte de l’ensemble des circonstances de nature à influer sur son exécution ultérieure, dont le professionnel pouvait avoir connaissance à ce moment), l’arrêt apporte des précisions intéressantes sur les deux autres points. La Cour va ainsi considérer qu’au cas particulier la clause relève bien de l’objet principal du contrat, déportant le débat sur son caractère clair et compréhensible.
I. L’objet principal du contrat de crédit
L’une des questions posées par la juridiction de renvoi portait sur le point de savoir si une clause par laquelle le remboursement du prêt devait avoir lieu dans la même monnaie que celle dans laquelle les fonds avaient été versés, relevait de la notion d’« objet principal du contrat », échappant ainsi à l’examen de son caractère abusif suivant l’article 4, § 2, de la directive12. Comme elle avait déjà eu l’occasion de l’affirmer13, la Cour pose en principe que cet alinéa instaure une exception dans un dispositif dont l’objectif est la protection du consommateur et, partant, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. L’affirmation ne va pas de soi, au moins dans la conception française du dispositif des clauses abusives. L’exclusion des clauses portant sur l’objet principal du contrat ainsi que sur l’adéquation du prix à la rémunération est en effet en droit français fondée sur la liberté contractuelle et la liberté des prix. On la rattache ainsi à l’absence de sanction de la lésion. À cet égard d’ailleurs, l’existence d’une clause « monnaie étrangère » induit un aléa qui devrait chasser la lésion14.
Partant de cette conception restrictive de l’objet principal, la Cour avait eu l’occasion de définir les clauses se rapportant à l’objet principal du contrat de prêt comme « celles qui fixent les prestations essentielles du contrat et qui comme telles, caractérisent celui-ci »15. N’en relèvent pas, les clauses qui présentent un « caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ». Ce caractère principal ou accessoire de la clause devant être appréciée par le juge national « en fonction de la nature, de l’économie générale et des stipulations du contrat de prêt, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel ». Dans un tel cas, la Cour de cassation a pu considérer de manière implicite que la clause par laquelle un prêt libellé en devise étrangère et devant être remboursé en euros pouvait être appréciée au regard de son caractère abusif, l’excluant donc du champ de l’objet principal du contrat16.
Dans la présente affaire, l’économie du contrat était cependant différente puisque le prêt souscrit en francs suisses devait être remboursé dans cette même devise. Ce type de prêt, dès lors qu’il est interne, a pu être considéré comme nul par des juges du fond en France17. L’arrêt Andriciuc n’en est pas moins intéressant en ce qu’il permet à la Cour de justice de préciser sa jurisprudence sur ces clauses. À cette occasion en effet, suivant en cela les conclusions de son avocat général, elle va considérer au contraire que ce type de clause relève bien de l’objet principal du contrat, faisant dès lors une distinction entre les prêts dont les clauses prévoient que la remise des fonds et le remboursement ont lieu en monnaie étrangère et ceux dans lesquels la monnaie sert seulement à évaluer le montant des mensualités. Un tel distinguo est-il fondé ? Il ne le semble pas : la distinction est largement artificielle ; dans tous les cas, le taux d’intérêt est lié à la monnaie (il est en général plus bas en raison de cette particularité), et les fluctuations de cette dernière déterminent le montant des remboursements ou la durée du prêt, donc le quantum de la dette et les obligations de l’emprunteur18. Clairement donc, elles s’inscrivent dans l’objet principal du contrat et l’adéquation des prestations et ne constituent pas une clause accessoire au contrat de prêt. C’est l’équilibre économique qui est en cause ici et non l’équilibre juridique19. L’article L. 313-64 du Code de la consommation ne distingue d’ailleurs pas entre ces deux types de prêts.
Sur un plan plus général, l’arrêt est également l’occasion pour la Cour de préciser son interprétation de la notion d’objet principal du contrat de crédit. Certes, ceux-ci présentent une très grande variété, qui rend difficile toute théorie générale. Observons néanmoins qu’en matière de clauses abusives, l’objet principal du contrat n’est pas déterminé de manière abstraite, par référence aux grandes catégories contractuelle, à la qualification du contrat en cause, mais de manière concrète, en fonction des stipulations qu’il comporte. Ce qui n’a rien de surprenant, puisque la recherche du caractère abusif porte sur une ou des clauses particulières et non sur le contrat dans son ensemble.
L’immunité des clauses portant sur l’objet principal du contrat n’est cependant pas totale puisqu’elle ne vaut que pour autant qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible. Là encore l’arrêt Andriciuc apporte des précisions intéressantes.
II. Le caractère clair et compréhensible des clauses définissant l’objet principal
La Cour de justice rappelle tout d’abord que « clair et compréhensible » signifie non seulement intelligible sur les plans formel et grammatical mais également que la clause doit exposer de manière claire et compréhensible par un consommateur moyen, le fonctionnement du mécanisme de conversion et la relation entre ce mécanisme et d’autres stipulations. Il s’agit de permettre à l’emprunteur potentiel d’évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui découleraient pour lui de la souscription de ce type de contrat.
Ce glissement du fond (l’abus) vers la forme (la clarté de l’information)20 invite à s’interroger sur la place de ce dispositif dans le cadre de la nouvelle réglementation des crédits aux consommateurs et en particulier du crédit immobilier.
L’exclusion des clauses définissant l’objet principal du contrat ne joue en effet que pour autant que ces dernières « sont rédigées de façon claire et compréhensible »21. Si la confusion qui entoure cette limite a pu être soulignée et critiquée, il s’agit en fait davantage de prendre en compte le cas où la rédaction de la clause peut induire le consommateur en erreur sur l’intérêt pour lui du contrat ou ses droits. Une telle imprécision est alors assimilée à un abus de la part du professionnel. Tel n’est pas toujours le cas : en France, certains juges du fond ont pu estimer que la rédaction de la clause était suffisamment claire pour ne pas conduire à retenir le caractère abusif de la clause d’indexation22. Mais pour quelle sanction ? La sanction prévue consiste à éradiquer la clause en la réputant non écrite ; dès lors qu’elle ne porte que sur l’intérêt, elle n’empêche pas le maintien du contrat23, ce qui, au demeurant, peut correspondre à ce que souhaite le consommateur. Faudrait-il y substituer le taux légal24 ? Ou priver complètement d’effet la clause stipulant les intérêts, le crédit devenant gratuit ? La sanction s’apparenterait alors à une déchéance totale du droit aux intérêts, prévue en cas de manquement du professionnel à ses obligations d’information. Le droit commun du contrat de consommation et le droit du crédit convergeraient alors.
Cette difficulté pose cependant la question de l’articulation du mécanisme des clauses abusives avec le nouveau dispositif de protection de l’emprunteur, spécialement en matière de crédit immobilier25.
En effet, les prêts assortis de clause « monnaie étrangère » ne sont pas interdits. Ils peuvent encore être souscrits sous certaines conditions : soit que les emprunteurs perçoivent plus de 50 % de leurs revenus ou détiennent un patrimoine représentant au moins 20 % de l’emprunt dans la devise considérée26, soit qu’ils n’assument pas le risque de change, notamment parce que ce risque est couvert par une assurance. Ces prêts peuvent d’ailleurs être remboursables en euros ou dans la devise concernée et l’on observera qu’il ne s’agit pas nécessairement de contrats internationaux. Par ailleurs, la possibilité d’octroyer le prêt repose sur une déclaration sur l’honneur de l’emprunteur qu’il répond à ces conditions27. Cette simple exigence semble peu cohérente avec l’obligation faite au prêteur de procéder à une « évaluation rigoureuse »28 de la solvabilité de l’emprunteur ; et, en matière immobilière, en tout état de cause, la souscription par l’emprunteur d’un tel prêt alors qu’il n’y a pas accès pourrait sans doute conduire à des sanctions pour le prêteur sur ce terrain même si la déclaration sur l’honneur a été fournie.
Quoi qu’il en soit, la souscription d’un tel prêt emporte que certaines informations doivent figurer dans la fiche standardisée européenne (FISE) et notamment un avertissement sur les risques de change, assorti, lorsque l’emprunteur est exposé à une variation du taux de change, d’un exemple illustrant l’incidence d’une fluctuation de 20 %29. Sous l’angle de la clarté et de l’intelligibilité, un tel formalisme devrait limiter l’intervention du mécanisme des clauses abusives. De même, la consécration de l’obligation de conseil voire de mise en garde30. Toutefois dès lors que ces clauses ont pu être considérées comme ne relevant pas de l’objet principal du contrat, il n’est pas impossible qu’elles puissent manifester un déséquilibre significatif. Dans les affaires soumises à la Cour de cassation, l’existence d’un tel déséquilibre résidait, selon cette dernière, dans l’existence d’un risque de change assumé par le seul emprunteur. La directive prévoit à cet égard que les États membres doivent prévoir que le risque de change ne peut peser sur le seul emprunteur ou que celui-ci doit pouvoir convertir son prêt dans sa monnaie31. Mais ces limites sont assez théoriques puisque dépendant largement des stipulations contractuelles, de sorte qu’il n’est pas exclu que le dispositif des clauses abusives, puisse continuer à s’appliquer à la marge. L’articulation du droit commun de la consommation et du droit spécial du crédit aux consommateurs se révèle plus complexe à mesure que les textes se multiplient et se précisent.
Hélène CLARET
C – Dépôt
À propos de la responsabilité du dépositaire : quand le droit spécial (du dépôt) épouse les règles du droit commun (civil)
1. Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-23239, D. Le contrat de dépôt, une figure juridique en pleine métamorphose. Le dépôt façon 2017 n’a que peu de ressemblances avec celui du Code civil de 1804, petit contrat, dormant, passé entre amis et reposant sur la confiance mutuelle entre déposant et dépositaire. En effet, nombre de dépôts sont aujourd’hui reçus par des professionnels32, ce qui change substantiellement l’économie d’un tel contrat. Le contenu et la portée des clauses limitatives, voire exonératoires, insérées dans ces types de contrats reflètent cette spécificité, comme en atteste le contentieux soulevé devant la chambre commerciale ayant abouti à l’arrêt rendu le 27 avril 2017.
2. Dépôt professionnel et détermination du contenu du contrat. La société Aventis Pharma Distriservices Aventis (APDA, ci-après désignée le déposant) a conclu un contrat de dépôt portant sur le stockage de ses produits avec la société Centre spécialités pharmaceutiques (CSP, ci-après désignée le dépositaire). Le contrat stipulait que la société APDA ferait son affaire personnelle de l’assurance des stocks entreposés dans les locaux de la société CSP, en souscrivant une ou plusieurs polices pour couvrir tous les dommages matériels et que les parties renonçaient et s’engageaient à faire renoncer leurs assureurs respectifs à l’exercice de tout recours de l’une contre l’autre en cas de sinistre indemnisé. La société APDA devenue après absorption Sanofi (le déposant), a signé avec la société CSP (le dépositaire) un avenant au contrat stipulant que celle-ci souscrirait une assurance couvrant tout dommage et/ou détérioration jusqu’à 100 000 € pendant le stockage des marchandises dans ses entrepôts. Un incendie survenu dans un entrepôt de la société CSP ayant détruit les produits de la société Sanofi qui s’y trouvaient stockés, cette dernière et ses assureurs ont assigné les assureurs de la société SCP en remboursement de la somme versée à leur assurée (la société CSP) après déduction de la franchise. Pour le dire avec plus de précision, les assureurs du déposant reprochaient à ceux du dépositaire d’avoir donné effet aux clauses du contrat stipulant une renonciation à recours et exonérant le débiteur de sa responsabilité. Ayant été déboutés de leur demande en appel, ils invoquaient, au soutien de leur pourvoi, l’invalidité de la clause stipulant la renonciation à recours de la part de chacune des parties (I) ainsi que de celle exonérant le dépositaire de sa responsabilité, laquelle, selon eux, contrevenait à l’obligation essentielle du dépositaire (II) qui avait, de surcroît, commis une faute lourde (III).
I. Sur la clause réciproque de renonciation à recours
3. Invocation par le déposant de la nullité de la clause de renonciation à recours. Aux termes du contrat conclu à l’origine entre la société APDS et la société CSP, il était prévu dans l’article 4.1 que : « APDS fera son affaire personnelle en matière d’assurances en souscrivant une ou plusieurs polices… couvrant tous dommages matériels aux stocks confiés par APDS à CSP et entreposés dans les locaux de CSP ». Ce contrat a été complété le 14 octobre 2002 par un avenant portant le numéro 2 qui, signé entre la société Sanofi (anciennement APDS) et le dépositaire limitait l’étendue de la clause sus-énoncée en prévoyant que « la société CSP souscrira une assurance (montant forfaitaire annuel pour Sanofi 350 €) qui couvrira tout dommage et/ou détérioration de 1 à 100 000 € pendant le stockage des marchandises chez CSP ».
4. Raisonnement suivi. En application de cette disposition, le déposant et ses assureurs considéraient que pareille clause était entachée de nullité dès lors qu’elle avait pour effet de contredire les dispositions de l’article 1915 du Code civil selon lequel « le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature ». En excluant toute forme de recours, pareille clause faisait obstruction à la réalisation du contrat de dépôt ; dit autrement, elle allait à l’encontre de la définition même du dépôt, de ses éléments caractéristiques et de leurs conséquences ; la clause neutraliserait le caractère contraignant de l’obligation essentielle résultant d’un contrat et permettrait au débiteur de se dispenser de l’exécution de son obligation. Pour pertinent, qu’il soit, pareil raisonnement revient à brider la liberté contractuelle des parties comme la possibilité qu’elles ont de renoncer à tout recours dès lors que cette restriction est compensée par d’autres dispositions permettant aux parties de maintenir l’équilibre du contrat. C’est ce que constate sans ambages la haute juridiction.
5. Reconnaissance par la chambre commerciale de la validité de la clause de renonciation à recours. Reprenant à son compte l’argumentation développée par le dépositaire, la haute juridiction énonce clairement : « Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a exactement retenu que la renonciation à recours résultant des clauses litigieuses était dépourvue d’équivoque dès lors que c’était afin de limiter le champ d’application de l’obligation d’assurer le stock à raison de tous les dommages encourus, mise à la charge du déposant, que les parties étaient convenues que le dépositaire devrait contracter une assurance dans la limite de 100 000 € ». La conclusion s’imposait : d’une part, la clause litigieuse était claire et dépourvue d’ambiguïté ; d’autre part, les clauses contestées n’avaient pas pour effet de priver le déposant de tout recours en cas de faute lourde imputable au dépositaire ; à partir du moment où ce dernier se plaçait en dehors du contrat en commettant une faute lourde33, une action en justice redevenait possible ; enfin (et surtout ?), les parties avaient « couvert » les risques que pouvaient encourir les marchandises du fait de leur détérioration ou de leur perte. La cour le souligne, le dépositaire avait contracté une assurance couvrant tout dommage et/ou détérioration jusqu’à 100 000 € pendant le stockage des marchandises dans ses entrepôts. Ce faisant, l’obligation symétrique du déposant s’en trouvait corrélativement allégée et l’équilibre du contrat respecté. Autant dire que plus rien ne s’opposait à l’admission de la validité de la clause de non-recours. Mais quid de celle de la clause limitative de responsabilité ?
II. Sur la clause exonératoire de responsabilité stipulée au profit du dépositaire
6. Compatibilité ou incompatibilité d’une clause limitative de responsabilité avec l’obligation essentielle du contrat de dépôt. Fidèles à leur argumentaire, le déposant et ses assureurs remettaient en cause la validité d’exonération de responsabilité du dépositaire34. Le contrat de stockage liant les parties déterminait leurs obligations respectives. Or l’obligation de conservation constitue l’obligation essentielle du contrat de dépôt. Les marchandises stockées n’ayant pu être conservées du fait de l’incendie, le dépositaire, débiteur de cette obligation, engageait sa responsabilité. Par voie de conséquence, la clause exonératoire ou limitative de responsabilité portant atteinte à la substance du contrat, contredisait l’obligation essentielle souscrite par le débiteur et devait être réputée non écrite. En vertu de sa responsabilité contractuelle35, le dépositaire devait donc restituer au déposant la somme versée reçue de l’assurance, diminuée de la franchise contractuellement prévue. Avancer une telle prétention, était plausible, certes, mais faisait fi des solutions de droit positif. La jurisprudence36, consacrée désormais par la loi37, ne réfute pas systématiquement les clauses limitatives de responsabilité. C’est même la règle inverse qui prévaut. Entre professionnels, les clauses limitatives de responsabilité sont en principe valables à condition qu’elles ne contredisent pas la portée de l’obligation essentielle. Qu’en était-il en l’espèce ?
7. Conditions de validité des clauses limitatives de responsabilité. La chambre commerciale procède avec une logique à toute épreuve. Pour savoir si la clause limitative ne contredisait pas la portée (nous soulignons) de l’obligation essentielle, elle recherche, à partir des éléments recensés, si la clause ne portait pas atteinte à l’économie générale du contrat ou, pour mieux dire, si elle était équilibrée.
En ce sens, l’arrêt relève en premier lieu que « la clause ouvre au déposant une faculté d’inspection, le coût des prestations facturées s’inscrivant dans le cadre d’une économie générale du contrat qui prend en considération la répartition des risques entre les parties, ceux-ci étant supportés par le dépositaire dans la limite de 100 000,00 € » ; il précise, ensuite, que « la clause litigieuse, inscrite dans le cadre de relations contractuelles habituelles suivies et équilibrées, a prévu une répartition entre les deux parties des risques encourus par les marchandises ». De ce double constat s’infère la conclusion : « ayant, ainsi, fait ressortir que la clause litigieuse ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle du contrat de stockage, la cour d’appel (…) a retenu, à juste titre, que cette clause devait recevoir application ». CQFD.
Restait au déposant, une dernière possibilité, celle d’invoquer la faute lourde du dépositaire, pareille faute paralysant l’efficacité de la clause limitative de responsabilité.
III. Sur L’absence de faute lourde du dépositaire
8. La faute lourde exclusive de l’exonération du débiteur de responsabilité. Les griefs invoqués par Sanofi à l’encontre de la société CSP étaient-ils constitutifs d’une faute lourde imputable au dépositaire ? L’enjeu de la question était important pour le déposant. En effet, la faute lourde du dépositaire fait toujours obstacle à l’application des clauses limitatives ou exonératoires38. Au cas particulier, le dépositaire étant un opérateur économique dans l’exercice de sa mission contractuelle, sa faute lourde devait être, selon l’auteur du pourvoi, caractérisée non seulement au regard des dispositions réglementaires en vigueur mais aussi en tenant compte de l’obligation essentielle pesant sur le cocontractant et des dommages pour son client. Ainsi, le déposant se prévalait-il en premier lieu de deux arrêtés préfectoraux relatifs à l’aménagement des lieux de stockage ainsi qu’aux ouvertures placées au travers des murs séparant les zones incendiées39 que n’aurait pas respectées le dépositaire, facilitant ainsi la propagation de l’incendie d’une cellule de stockage à l’autre. Il faisait valoir ensuite et conséquemment, que, en maintenant en service une installation en pleine connaissance de cause des risques encourus et sans prendre de précautions particulières, il se rendait coupable d’une faute lourde.
9. Absence de caractérisation de la faute lourde. La haute juridiction balaye un à un les différents éléments. « Attendu, en premier lieu », considère-t-elle que « c’est par une appréciation exempte de dénaturation que l’arrêt retient que l’arrêté préfectoral du 19 mars 2008 destiné à la mise en œuvre de mesures de sauvegarde à la suite de l’incendie, faute de précision suffisante, ne permettait pas d’établir si la présence d’ouvertures entre les zones d’entreposage avait, ou non, un caractère réglementaire lors de leur réalisation ».
« Et attendu, en second lieu », poursuivent les magistrats de la chambre commerciale qu’« après avoir constaté que le nombre de produits à fort potentiel calorifique stockés dans le local dans lequel avait été situé le départ de l’incendie était inférieur au seuil de déclaration, et retenu que si les recommandations des auditeurs mettaient en évidence l’opportunité de travaux de modernisation, la société Sanofi et ses assureurs ne démontraient pas pour autant que la société CSP s’était rendue coupable de négligences d’une extrême gravité confinant au dol, dénotant son inaptitude à la mission qui lui avait été confiée, la cour d’appel a exactement retenu que celles-ci n’étaient pas constitutives d’une faute lourde ». C’est à bon escient que les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’une telle faute… et qu’ils ont refusé d’écarter l’application des clauses de non-responsabilité et de renonciation à recours. Où l’on voit que la conjugaison de la rigueur à la logique juridique fonde l’évidence du syllogisme judiciaire.
Geneviève PIGNARRE
III – Contrats relatifs aux litiges
Les contrats relatifs au règlement des litiges et la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
1. Si les contrats spéciaux rassemblent d’abord les contrats portant sur les biens et les services, les contrats portant sur le règlement des litiges ont été au cœur de l’actualité législative, notamment à travers la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et les décrets d’application subséquents. L’intitulé du titre III de la loi indique clairement ses objectifs : « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends ». L’exposé des motifs présente les ambitions du texte : « donner les moyens aux citoyens d’être plus actifs dans la résolution de leurs conflits, c’est favoriser des modes de règlement des conflits reposant sur l’accord de chacun, qui permettent une solution durable, rapide et à moindre coût tout en assurant la sécurité juridique. Cela permettra, en outre, de renforcer le lien social »40. Ainsi, « l’accord de chacun », évoqué par l’exposé des motifs, peut être à l’origine du processus de règlement du litige à travers la convention d’arbitrage (I). À l’inverse, cet accord peut intervenir au terme du processus à travers une transaction ou un accord faisant suite à une médiation ou à une conciliation (II). L’accord peut également gouverner tant la mise en place du processus de règlement du litige, que son déroulement ou son terme à travers la convention de procédure participative (III). La technique contractuelle, et des contrats spéciaux, intervient donc à différents stades du règlement des litiges tel que renouvelé par la loi Justice du XXIe siècle.
I. Le contrat créant le processus de règlement du litige : la convention d’arbitrage
2. En matière d’arbitrage, la loi Justice du XXIe siècle innove à plusieurs égards. D’un point de vue uniquement formel, elle vient redonner de la cohérence au Code civil dans l’usage qu’il fait du mot « arbitrage » (A). De manière plus fondamentale, en apparence au moins, elle vient modifier les règles relatives à la clause compromissoire, en étendant singulièrement son champ de validité (B).
A. La cohérence de l’« arbitrage » dans le Code civil
3. Le premier élément de cohérence vient de la suppression de l’« arbitrage » dans des hypothèses où ce mot était utilisé dans un sens très large, synonyme d’« évaluation », et non dans un sens technique ou juridique. Ainsi, le prix fixé par un expert dans le cadre d’un contrat de vente était « laissé à l’arbitrage d’un tiers » par le Code Napoléon (article 1592). Désormais, ce prix peut « être laissé à l’estimation d’un tiers ». De ce point de vue, la loi n’innove pas sur le fond : il était établi depuis longtemps que « l’arbitrage » de l’article 1592 n’était pas qu’une mesure d’évaluation par un expert41.
4. Le second élément de cohérence porté par la loi Justice du XXIe siècle réside dans l’intitulé du titre XVI du livre troisième du Code civil. Depuis la loi du 5 juillet 1972, ce titre était intitulé « Du compromis » ; il est désormais renommé « De la convention d’arbitrage ». Ce nouvel intitulé permet d’embrasser les deux modes de mise en place de l’arbitrage que sont le compromis et la clause compromissoire. L’intitulé retenu en 1972 était maladroit : à l’intérieur de ce titre, l’article 2061 était relatif à la clause compromissoire. En 1972, l’article en question se contentait d’affirmer le principe de la nullité d’une telle clause42. Mais la loi du 15 mai 2001 a renversé ce principe, rendant d’autant plus trompeur l’intitulé du titre du Code civil. L’article 2061 du Code civil, issu de la loi de 2001, a ainsi admis la licéité des clauses compromissoires43. Le nouvel intitulé du titre XVI lui permet de correspondre à son contenu.
5. Le choix du singulier – « De la convention d’arbitrage » – aurait pu conduire à davantage d’interrogations. On aurait pu envisager le compromis et la clause compromissoire comme deux conventions distinctes et utiliser le pluriel pour les distinguer. L’hésitation a été tranchée par le décret du 13 janvier 2011 qui a réformé le droit de l’arbitrage dans le Code de procédure civile. Le pluriel qui prévalait jusqu’alors à propos des articles 1442 et suivants est devenu un singulier ; « Les conventions d’arbitrage » sont devenues « La convention d’arbitrage ». Le compromis et la clause compromissoire sont les deux formes de cette convention44. Et les règles posées tant par le Code civil que le Code de procédure civile sont applicables tantôt à la convention d’arbitrage qu’importe sa forme45 tantôt à l’une ou l’autre de ses formes46.
B. Le domaine de validité de la clause compromissoire
6. L’article 2061 du Code civil, relatif à la clause compromissoire a été réécrit par la réforme de 2016 (1), mais les limites de l’article 2061 réformé n’ont pas été clairement définies par la loi de 2016 (2)
1. La réécriture de l’article 2061 du Code civil
7. L’article 2061 du Code civil, seule disposition de ce Code relative à la clause compromissoire, dispose désormais que :« La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».
Le premier alinéa semble la réaffirmation d’une banalité en droit des contrats : les parties doivent avoir consenti. C’est le second alinéa qui est le plus porteur de nouveautés.
8. Le premier alinéa constitue une reprise, voire une répétition, du droit positif. La nécessité d’une acceptation, expression du consentement contractuel, n’est pas une nouveauté, y compris lorsque les stipulations invoquées figurent dans des conditions générales annexées au contrat. Le Code de procédure civile admet ainsi depuis 1981 que la convention d’arbitrage « résulte d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale »47. La réaffirmation de la règle dans le Code civil peut toutefois avoir une vertu pédagogique : lorsque la convention d’arbitrage résulte d’une référence effectuée par la convention principale, il est nécessaire de vérifier que chacune des deux parties a effectivement accédé, ou pu accéder, au document en question.
9. Le second alinéa constitue l’apport majeur de la loi du 18 novembre 2016 au droit de l’arbitrage : la validité de la clause compromissoire est singulièrement élargie. Contrairement au compromis qui permet de soumettre à l’arbitrage un conflit déjà né48, la clause compromissoire soumet à l’arbitrage d’éventuels conflits futurs à propos de contrats conclus entre les parties49. Sans connaître les termes du litige qui pourrait les opposer, les parties renoncent à toute possibilité de saisir une juridiction étatique. Cette absence de connaissance préalable du conflit soumis à l’arbitrage a longtemps conduit à une certaine défiance à l’égard de ces clauses. Avant 2001, le principe était la nullité de telles clauses50. En 2001, leur validité a été admise mais limitée aux « contrats conclus dans le cadre d’une activité professionnelle ». La jurisprudence avait alors affirmé le caractère bilatéral de la condition relative à l’activité professionnelle : chacune des deux parties devait avoir agi dans le cadre de son activité professionnelle51. La jurisprudence n’avait pas eu l’occasion de se prononcer sur le régime de la nullité de la clause compromissoire ne satisfaisant pas à la condition d’activité professionnelle. La plus grande partie de la doctrine considérait néanmoins que cette nullité devait être relative dans la mesure où la disposition a pour but de protéger l’une des parties, celle agissant hors de son cadre professionnel52. Ainsi, seule cette partie pourrait soulever la nullité de la clause53. Elle pourrait également renoncer à s’en prévaloir, une fois que la clause est mise en œuvre : en effet, le conflit étant né, les parties auraient la possibilité de compromettre même en dehors de toute activité professionnelle.
10. En apparence, la loi de 2016 opère une révolution en la matière à travers le deuxième alinéa de l’article 2061 : « lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ». Le principe est donc celui de la validité de la clause, quel que soit le cadre dans lequel celle-ci est stipulée. Le critère de l’activité professionnelle n’est plus un critère de validité, mais un critère d’opposabilité54. Si une telle clause est insérée dans un contrat dont l’une des parties au moins n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle, celle-ci pourra s’opposer à l’application de ladite clause.
11. La solution retenue par la loi du 18 novembre 2016 diffère-t-elle véritablement de la solution antérieure ? Dans la mesure où, dans une hypothèse comparable, la nullité n’affectait que la clause en question55 et où la nullité ne pouvait être invoquée que par la partie protégée56, les modifications apportées par la loi du 18 novembre 2016 n’affectent pas fondamentalement la situation des parties. La cause de nullité de la clause compromissoire d’hier est devenue un motif d’inopposabilité de la clause et les conditions de mobilisation des arguments semblent sensiblement identiques. L’appréciation du caractère professionnel du contrat principal, support de la clause compromissoire, a été reformulée ; hier les clauses étaient valables « dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle » ; aujourd’hui elles ne sont pas opposables « lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle ». Outre l’adjonction d’une double négation, stylistiquement peu heureuse, le passage de la « raison » au « cadre », c’est-à-dire du motif au contexte, apparaît dans la continuité de la jurisprudence ; les juridictions prenaient essentiellement en compte l’activité de parties57. Étonnamment, le moment de l’appréciation du motif ou du contexte professionnel ne semble pas avoir évolué : c’est celui de la conclusion du contrat principal. Le passage de la nullité à l’inopposabilité aurait pu conduire à apprécier le caractère professionnel du contrat, non au moment de sa formation, mais au moment où la clause est mise en œuvre. Cela ne semble pas devoir être le cas : l’usage du verbe « contracter » renvoie au moment où le contrat principal est conclu. La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien article 2061 avait répondu à certaines interrogations, mais il en demeure de nombreuses. La question des contrats ayant un double objet, personnel et professionnel, tel le bail à usage mixte, professionnel et d’habitation, pourrait soulever certaines difficultés.
12. Pourrait également se poser la question de la juridiction compétente pour apprécier l’efficacité de la clause. Mais encore une fois, la réponse semble être la même aujourd’hui à propos de l’opposabilité de la clause qu’hier à propos de sa validité. C’est le principe compétence-compétence et l’article 1448 du Code de procédure civile qui apportent des réponses à ces questions. En principe, l’arbitre est seul juge de sa propre compétence : « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable »58. La présence d’une partie agissant hors de son cadre professionnel pouvait hier conduire à considérer la clause manifestement nulle ; aujourd’hui elle pourrait tout à fait permettre de la considérer manifestement inapplicable. Le seul changement identifiable d’un point de vue procédural est la disparition de la possibilité de demander par voie d’action l’annulation de la clause. Mais dans l’immense majorité des cas, la question de la validité se posait par voie d’exception, lorsqu’une juridiction arbitrale ou étatique était saisie. Soit la partie agissant hors de son cadre professionnel soulevait l’argument devant la juridiction arbitrale pour s’opposer à sa compétence, soit elle l’invoquait pour répondre à l’exception d’incompétence dont l’autre partie se prévalait devant la juridiction étatique saisie. Ainsi, l’inopposabilité de la clause pourra être invoquée dans les mêmes conditions que sa nullité par voie d’exception. En fonction de la manière dont l’« inopposabilité » de l’article 2061 est envisagée par la jurisprudence, un point pourrait toutefois évoluer : c’est l’hypothèse de conflits successifs en application d’un même contrat. L’attitude de la partie agissant hors de tout cadre professionnel lors du premier conflit juridictionnel était déterminante pour les conflits successifs avant 2016. Soit l’annulation de la clause avait été obtenue lors du premier conflit et cette clause ne pouvait pas renaître lors de conflits ultérieurs. Soit l’annulation n’avait pas été sollicitée et l’on pouvait considérer qu’une confirmation était intervenue ; l’annulation ne pouvait alors plus être invoquée lors de procédures postérieures. La rédaction du nouvel article 2061 peut laisser penser que la partie agissant hors de son cadre professionnel dispose du droit de s’opposer à l’application de la clause ; ce droit pourrait être mis en œuvre de manière discrétionnaire par ladite partie, de sorte que la partie en cause ne serait pas tenue de s’en prévaloir de manière identique en fonction des conflits en cause59. En dehors du cas particulier d’application d’une même clause à des conflits successifs, les conditions procédurales de mise en œuvre de l’inopposabilité de la clause sont donc très proches de celle de son annulation.
2. Les incertitudes quant aux limites de la réforme
13. Les limites de la réforme de l’article 2061 du Code civil sont incertaines de deux points de vue. D’un point de vue temporel d’abord : la loi du 18 novembre 2016 ne fixe pas les modalités de son application dans le temps et ne règle pas la question de son éventuelle application aux contrats en cours. D’un point de vue matériel ensuite : si le nouvel article 2061 s’applique avec certitude à l’arbitrage interne, quid de l’arbitrage international ?
14. Même si les enjeux sont limités, les changements apportés par la loi du 18 novembre 2016 au droit de l’arbitrage soulèvent la question de leur entrée en vigueur. La loi ne comprend aucune indication relative à l’application dans le temps de la nouvelle rédaction de l’article 2061 du Code civil. La disposition est donc entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 20 novembre 2016. La précédente réforme de cette disposition, résultant de la loi du 15 mai 2001, avait été déclarée applicable immédiatement aux conventions en cours. Les clauses compromissoires stipulées avant l’entrée de vigueur de la loi de 2001, nulles sous l’empire de la loi antérieure, mais valables sous l’empire de la nouvelle, avaient été déclarées valables60. La solution avait été très contestée en doctrine qui avait vu là la « résurrection » d’une clause nulle61. La solution était hétérodoxe en matière contractuelle. Mais la solution était conforme aux règles régissant l’entrée en vigueur des lois de procédure, qui s’appliquent immédiatement aux procédures en cours, sauf à remettre en cause des droits acquis62. Outre les arguments tenant aux lois de procédure et à l’autonomie de la clause compromissoire, il est possible de rappeler que la nullité n’est pas un état de l’acte et que l’annulation n’opère pas de plein droit : elle est une sanction qui doit être prononcée par un juge. Dès lors que l’annulation de la clause n’avait jamais été sollicitée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il est difficile de considérer que le juge a opéré une résurrection de celle-ci. Le raisonnement qui a valu à propos de la loi du 15 mai 2001 vaudra-t-il également pour la loi du 18 novembre 2016 ? La cohérence jurisprudentielle voudrait que la solution ayant prévalu à propos de la loi de 2001 soit également retenue à propos de la loi de 2016.
15. L’étendue de la réforme est également incertaine quant à son application au droit de l’arbitrage international. Si le Code de procédure civile distingue clairement dans deux titres différents l’arbitrage interne de l’arbitrage international, les trois articles du Code civil consacrés à la convention d’arbitrage ne semblent pas les distinguer. Pourtant, la jurisprudence les applique de manière différente en fonction du contexte de l’arbitrage. Les anciennes versions de l’article 2061 du Code civil ont été déclarées inapplicables à l’arbitrage international : leur prohibition de principe antérieure à 2001 ou les limites à leur validité résultant de la loi de 2001 n’ont pas été appliquées en matière d’arbitrage international63. Il ne devrait pas y avoir lieu d’appliquer l’inopposabilité des clauses compromissoires en dehors du cadre professionnel en matière d’arbitrage international.
II. L’accord réglant le litige : la transaction et les transactions spéciales
16. Contrat multimillénaire, la transaction est réglementée par les articles 2044 et suivants du Code civil, dispositions qui n’avaient presque pas été modifiées depuis 1804 et qui étaient largement inspirées des développements de Jean Domat sur la question. La loi du 18 novembre 2016 a opéré des modifications de deux ordres : l’abrogation des articles 2047 et 2053 à 2058 du Code civil ainsi que la modification de l’article 2044 définissant la transaction et de l’article 2052 établissant les effets de la transaction entre les parties.
17. L’abrogation des articles 2047 et 2053 à 2058 a pour but d’expurger le Code civil de dispositions redondantes avec le droit commun des contrats. L’article 2047 précisait qu’il était possible d’inclure dans la transaction « une peine contre celui qui manquera de l’exécuter » ; l’article 1231-5 relatif aux clauses pénales est suffisant. Les articles 2053 et suivants envisageaient différentes causes de nullité du contrat, causes qui n’étaient que la reprise ou l’adaptation du droit commun en la matière : vices du consentement64 ; contenu du contrat65. Par ailleurs, la réécriture de l’article 2052 a conduit à la disparition de second alinéa. Celui-ci prévoyait que les transactions « ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ». L’exclusion de la lésion n’était que la réaffirmation du droit commun des contrats. En revanche, l’exclusion de l’erreur de droit était plus originale car elle dérogeait au droit commun. La jurisprudence avait cependant fortement limité la portée de cette exclusion puisque la première chambre civile était allée jusqu’à admettre l’annulation de transaction dès lors que « l’erreur (…), fût-elle de droit, affecte l’objet de la contestation tel que défini par ladite transaction »66. Ainsi, la disparition dans le Code de la spécificité de l’erreur de droit en matière de transaction se situe dans la continuité de la jurisprudence qui avait cherché à limiter la portée de cette exclusion.
18. Deux véritables modifications interviennent. D’une part, l’exigence de concessions réciproques, depuis longtemps affirmée en jurisprudence67, est intégrée au Code civil. L’article 2044 définit désormais la transaction comme « contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». L’exigence de concessions réciproques ainsi inscrite peut interroger quant aux conséquences de leur défaut. Il est habituellement enseigné qu’une transaction dépourvue de concessions réciproques serait nulle. Mais à lire l’article 2044 réformé, ne pourrait-on pas plutôt comprendre que le contrat terminant une contestation née ou prévenant une contestation à naître, mais ne comprenant pas de concessions réciproques ne peut pas être qualifié de transaction ? Cette disqualification du contrat n’entraînerait pas nécessairement sa nullité, il pourrait être vu comme un contrat innomé mettant fin à une contestation68.
19. Au-delà des conséquences de leur défaut, la définition des concessions réciproques soulevait des difficultés certaines avant la réforme, et en soulèvera encore après. Le plus souvent, on considère que la concession d’une partie consiste en une « renonciation à ses prétentions initiales », « chaque partie à la transaction consent une concession en ce qu’elle se contente d’une situation moins avantageuse que celle à laquelle elle prétendait »69. La Cour de cassation affirme ainsi que « l’existence de concessions (…) doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte » ; ainsi, « le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d’une transaction, rechercher, en se livrant à l’examen des preuves, si ces prétentions étaient justifiées »70. Mais la sévérité de l’appréciation de cette exigence semble varier ; la jurisprudence apparaît particulièrement soucieuse de la protection de certaines parties, notamment des salariés71.
20. Cette exigence de concessions réciproques interroge, surtout lorsque l’on compare la transaction du Code civil avec certaines figures spéciales de transaction. La jurisprudence considère notamment que cette exigence n’est pas applicable à la « transaction » conclue entre un assureur et la victime d’un accident de la circulation en application de la loi du 17 juillet 198572. On considère ainsi que la transaction prévue par ce texte n’est pas une transaction au sens du Code civil. Elle est pourtant bien un contrat par lequel un créancier (la victime) et un débiteur (l’assureur du véhicule) terminent une contestation née, en vertu de laquelle la première pourrait saisir une juridiction pour obtenir une indemnisation du second. De même, les accords auxquels les parties parviennent à la suite d’une conciliation ou d’une médiation, éventuellement constatés ou homologués par un juge, sont des contrats qui viennent terminer une contestation. Leur caractère judiciaire ne leur enlève pas leur caractère contractuel : si l’une des conditions de validité du contrat n’est pas remplie, il est possible d’en solliciter l’annulation73. Alors que l’objet de ces contrats est le même qu’une transaction : mettre fin à une contestation, l’exigence de concessions réciproques n’est jamais formulée ainsi. Lorsque l’accord est soumis à homologation (en cas de médiation), « le juge n’est pas tenu d’homologuer l’accord qui lui est soumis par les parties mais doit vérifier qu’il préserve les droits de chacune d’elles »74. En cas de conciliation par le juge, le contrôle par le juge apparaît plus léger : « le juge s’assure généralement de la réalité de l’accord et du consentement des parties, tout comme il procède à un contrôle minimal de la légalité de l’acte sur son objet et sa portée ».75
21. D’autre part, la loi du 18 novembre 2016 a supprimé de l’article 2052 du Code civil toute référence à « l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Cet article dispose désormais que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». L’article 2052 avait été critiqué de longue date pour sa formulation maladroite : ne s’agissant pas d’une décision de justice, appliquer aux transactions « l’autorité de la chose jugée » apparaissait maladroit. Plus maladroite encore apparaissait la référence à « l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Cette dernière précision qui avait été insérée à l’initiative de François Denis Tronchet durant la discussion du Code devant le Conseil d’État en 1804. On avait déjà remarqué que « l’addition proposée [semblait] inutile ; l’autorité de la chose jugée ne s’est jamais appliquée qu’aux jugements non susceptibles d’appel »76. La formule retenue par le nouvel article 2052 évite toute référence malheureuse. Elle décrit les effets contractuels de la transaction : une fin de non-recevoir dès lors que l’objet de la demande en justice présente le même objet qu’une transaction conclue entre les mêmes parties. La disparition de la référence à l’autorité de la chose jugée pourrait toutefois empêcher le juge de soulever d’office une fin de non-recevoir dans une telle hypothèse. En effet, cette possibilité était offerte par l’article 125, alinéa 2, du Code de procédure civile qui précise que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ». Si cette disparition était avérée77, sa portée pratique serait limitée : les hypothèses dans lesquelles le juge peut avoir connaissance d’une transaction sans qu’elle soit invoquée par les parties sont probablement peu nombreuses.
III. La convention de procédure participative
22. Une autre convention relative au règlement des litiges a été réformée par la loi Justice du XXIe siècle : la convention de procédure participative. Celle-ci peut gouverner tant la mise en place du processus, que son déroulement et sa conclusion. Cette convention avait été introduite dans le Code civil par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 aux articles 2062 et suivants. Les principales innovations introduites par la loi Justice du XXIe siècle résident dans le moment de sa conclusion et dans l’évolution de son objet.
23. En 2010, la convention avait été conçue comme un substitut à une procédure judiciaire puisqu’elle ne pouvait être conclue que pour un différend n’ayant « pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre »78. La loi Justice du XXIe siècle a fait disparaître la condition tenant au moment de la formation de la convention. Celle-ci peut être conclue indifféremment avant ou après la saisine d’une juridiction. Cette première évolution a permis une seconde innovation : l’évolution de l’objet de la convention de procédure participative. Celle-ci n’a plus nécessairement pour objet la résolution d’un litige, elle peut également porter sur la mise en état du litige. Ainsi, le nouvel article 2062, alinéa 1er, du Code civil dispose que « la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige ».
24. Ces évolutions législatives ont conduit à compléter substantiellement le Code de procédure civile. Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 est ainsi venu modifier les articles 1542 et suivants du Code de procédure civile. Ainsi, lorsqu’une convention est conclue alors que la juridiction a déjà été saisie, « le juge ordonne le retrait du rôle lorsque les parties l’informent de la conclusion d’une convention de procédure participative »79. De même, le nouvel article 1546-2 du CPC précise que « devant la cour d’appel, l’information donnée au juge de la conclusion d’une convention de procédure participative entre toutes les parties à l’instance d’appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident » et que « l’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’information donnée au juge de l’extinction de la procédure participative ». Rappelons à cet égard que la convention a nécessairement une durée limitée80.
25. Une autre évolution du Code de procédure civile en matière de convention de procédure participative doit être évoquée : la possibilité de conclure des actes contresignés par avocats dès lors que ceux-ci sont prévus par la convention81. Ceux-ci peuvent avoir pour objet de « 1° Constater les faits qui ne l’auraient pas été dans la convention ; 2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ; 3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ; 4° Recourir à un technicien ; 5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ».
Vincent RIVOLLIER
(À suivre)
IV – Contrats publics
Notes de bas de pages
-
1.
Nombreuses sont les collectivités locales et notamment les communes à avoir souscrit ce type de prêts qui se sont avérés « toxiques ».
-
2.
Mais pas seulement : dans la présente affaire, les prêts étaient aussi des prêts à la consommation et des prêts destinés à restructurer la dette des emprunteurs.
-
3.
TGI Paris, 17 mai 2017, n° 17/01643.
-
4.
L. 26 juill. 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et financières, art. 54.
-
5.
C. consom., art. L. 313-64 : si au départ la portée de cette interdiction était limitée aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, elle a été étendue à l’ensemble des personnes indépendamment du contexte de souscription des prêts, par l’ordonnance du 25 mars 2016 (transposant la directive Crédit immobilier). Par ailleurs, l’ancien texte visait les prêts libellés dans une autre devise que l’euro et remboursables en monnaie nationale alors que le nouveau vise les prêts libellés en devise étrangère et remboursables dans cette devise ou dans la monnaie nationale c’est-à-dire en euros. Observons également que cette disposition ne concerne que les crédits immobiliers, il est vrai principalement en cause en France. Mais a priori, en Roumanie d’autres prêts étaient concernés. Par ailleurs, ces dispositions n’ont pas de caractère rétroactif (v. Dir. 2014/17 du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, art. 23, § 5).
-
6.
Le prêteur qui ne respecte pas cette interdiction encoure la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Il en va de même, dans l’hypothèse où la souscription d’un tel prêt est possible, si le prêteur ne fournit pas l’information précontractuelle prévue. Le prêteur encoure également des sanctions pénales.
-
7.
Ou la Hongrie dans l’affaire Árpád Kásler (CJUE, 30 avr. 2014, n° C-26/13) ; et pour les suites, concl. Wahl N., 16 janv. 2018, n° C-483/16, Sziber. V. aussi CJUE, 3 déc. 2015, n° C-312/14, Banif Plus Bank (sur le terrain de l’application de la directive MIF à de tels prêts, autre voie explorée par les emprunteurs pour tenter d’obtenir leur annulation). V. Storck M., « Les prêts en devises étrangères : opération de crédit, prêt structuré, produit financier ou produit à risque », RD bancaire et fin. 2017, dossier 19.
-
8.
Et, devant la Cour de cassation, celui du manquement du banquier à son obligation de mise en garde.
-
9.
Précédemment : CJUE, 3 déc. 2015, n° C-312/14, Banif Plus Bank – CJUE, 30 avr. 2014, n° C-26/13, Árpád Kásler.
-
10.
68 personnes ont saisi le juge roumain de la contestation (v. concl. Wahl N. dans la présente affaire).
-
11.
Cass. 1re civ., 29 mars 2017, nos 15-27231 et 16-13050 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 144, Samin T. et Torck S. ; JCP E 2017, 1267, note Lasserre Capdeville J. ; JCP N 2017, 1158, note Piedelièvre S. ; JCP G 2017, 532, note Bonneau T. ; Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 297f0, p. 49, note Roussille M. ; RTD com. 2017, p. 409, obs. Legeais D.
-
12.
CJUE, 30 avr. 2014, n° C-26/13, Árpád Kásler, préc.
-
13.
V. C. consom., art. L. 212-1, al. 3.
-
14.
CJUE, 30 avr. 2014, n° C-26/13, Árpád Kásler, préc.
-
15.
V. Kleiner C., « Les prêts libellés en devises octroyés aux particuliers : l’inutile réforme ? », RD bancaire et fin. 2017, dossier 20.
-
16.
CJUE, 30 avr. 2014, n° C-26/13, Árpád Kásler, pt. 49.
-
17.
Cass. 1re civ., 29 mars 2017 (2 arrêts), préc.
-
18.
CA Metz, 6 avr. 2017, n° 15/01666 : Juris-Data n° 2017-007628. L’article L. 313-34 du Code de la consommation paraît cependant de ce point de vue moins restrictif (v. infra).
-
19.
En ce sens v. not. Samin T. et Torck S., note sous Cass. 1re civ. 29 mars 2017, préc.
-
20.
V. Julien J., Droit de la consommation, 2015, LGDJ, n° 211.
-
21.
V. Lagarde X., « Qu’est-ce qu’une clause abusive ? », JCP G 2006, I 110.
-
22.
Dir. n° 93/13, art. 4, § 2 ; C. consom., art. L. 212-1.
-
23.
V. par ex. CA Nancy, 26 janv. 2017, n° 15/02576 : Juris-Data n° 2017-002817 ; JCP G 2017, 324, zoom Henry X.
-
24.
C. consom., art. L. 212-1.
-
25.
V. la décision de la Cour suprême hongroise après l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Kasler (v. concl. Wahl n° C-483/16, Sziber, pt. 19). En France certains auteurs ont proposé d’autoriser le juge à se référer aux usages ou au prix du marché (V. Lachièze C., « Clauses abusives et lésion : la légalisation d’une relation controversée », LPA 2 juill. 2002, p. 4).
-
26.
V. sur ce point, Lokiec P., « Clauses abusives et crédit à la consommation », RD bancaire et fin. 2004, dossier 10036.
-
27.
C. consom., art. L. 313-64 et C. consom., art. R. 313-31.
-
28.
C. consom., art. R. 313-31.
-
29.
C. consom., art. L. 313-16.
-
30.
C. consom., art. R. 313-4 et annexe pt. 3 et 6.
-
31.
Fondement retenu par la Cour de cassation pour sanctionner de tels prêts à l’égard d’emprunteurs profanes : Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-27231, préc.
-
32.
Dir. n° 2014/17, 4 févr. 2014, art. 23.
-
33.
Il s’agit de dépôts salariés – c’est-à-dire rémunérés (V. C. civ., art. 1928, 2°, envisageant le cas « où il a été stipulé un salaire ») ; consenti par un professionnel, le caractère onéreux du dépôt est même présumé.
-
34.
V. infra nos 8 et s.
-
35.
Les clauses qui allègent, voire suppriment la responsabilité du dépositaire sont en principe valables, au même titre, d’ailleurs, que celles qui la renforcent, comme en témoigne l’article 1928, 4o, du Code civil. Il appartiendra au dépositaire de démontrer que cette clause a été connue du déposant et acceptée par lui (V. Malaurie P., Aynès L. et Gautier P.-Y., Contrats spéciaux, 2018-2019, LGDJ-Lextenso-Defrénois, n° 892).
-
36.
Responsabilité contractuelle qui est le corollaire de l’obligation de garde.
-
37.
V. après une longue saga et en dernier lieu, la jurisprudence Faurecia, Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11841 : Bull. civ., IV, n° 115 : attendu que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négocié aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications ; que la cour d’appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ».
-
38.
C. civ., art. 1170, nouveau : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
-
39.
C. civ., art. 1231-3, nouveau (anciennement article 1150 du Code civil).
-
40.
Article 4-1-4-2 de l’arrêté n° 04 DAI 2IC 087 du 1er avr. 2004 ; arrêté du 19 mars 2008 relatif aux installations classées.
-
41.
Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle, déposé au Sénat le 31 juill. 2015, p. 12.
-
42.
V. sur le « faux “arbitre” de l’arbitre 1592 », Moury J., in Droit des ventes et des cessions de droits sociaux à dire de tiers 2011/2012, Dalloz Référence, 1re éd., 2011, spéc. nos 31.31 et s.
-
43.
« La clause compromissoire est nulle s’il n’est disposé autrement par la loi ».
-
44.
Sur les limites posées en 2001 et les conséquences de la loi de 2016 sur celles-ci, v. infra et s.
-
45.
CPC, art. 1442.
-
46.
C. civ., art. 2059 et C. civ., art. 2060 ; CPC, art. 1442, al. 1er ; CPC, art. 1443 ; CPC, art. 1444 ; CPC, art. 1446 ; CPC, art. 1447, al. 1er ; CPC, art. 1448 ; CPC, art. 1449.
-
47.
CPC, art. 1442, al. 3 ; CPC, art. 1445 ; CPC, art. 1446 à propos du compromis ; C. civ., art. 2061 et CPC, art. 1442, al. 2 ; CPC, art. 1447, al. 2 à propos de la clause compromissoire.
-
48.
CPC, art. 1443, réformé par le décret du 13 janv. 2011 (mais la version antérieure de l’article, résultant du décret du 12 mai 1981, disposait en substance la même règle).
-
49.
CPC, art. 1442, al. 3.
-
50.
CPC, art. 1442, al. 2.
-
51.
Cette nullité, conséquence de l’arrêt Prunier (Cass. civ., 10 juill. 1843, Cie l’Alliance c/ Prunier : S. 1843, 1, p. 561 concl. Hello C. G., note Devilleneuve L.-M.), avait été inscrite en 1972 dans le Code civil (ancien art. 2061). Depuis 1925, une large exception existe pour tous les litiges pour lesquels les juridictions commerciales sont compétentes (v. l’actuel article C. com., art. L. 721-3).
-
52.
Par ex. Cass. 1re civ., 29 févr. 2012, n° 11-12782 : Bull. civ. I, n° 40.
-
53.
V. par exemple Racine J.-B., Droit de l’arbitrage, 1re éd., 2016, PUF, Thémis droit, n° 187 ; Jarrosson C. et Racine J.-B., « Les dispositions relatives à l’arbitrage dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », Rev. arb. 2016, p. 1007-1027, spéc. n° 20 ; Moreau B. et a., Rép. procédure civile Dalloz, V° « Arbitrage en droit interne », spéc. n° 133.
-
54.
Ou bien les deux, si aucune n’a agi dans un cadre professionnel.
-
55.
Ou, mieux, d’efficacité. Sur la critique de la notion d’opposabilité retenue par le législateur à travers le nouvel article 2061 du Code civil, v. Jarrosson C. et Racine J.-B., « Les dispositions relatives à l’arbitrage dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », préc., spéc. n° 16.
-
56.
C’est l’une des facettes de l’autonomie de la clause d’arbitrage, v. CPC, art. 1247.
-
57.
Dès lors que cette nullité est bien relative.
-
58.
V. par ex. Cass. 1re civ., 29 févr. 2012, préc.
-
59.
CPC, art. 1448, al. 1er.
-
60.
Jarrosson C. et Racine J.-B., « Les dispositions relatives à l’arbitrage dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », préc., spéc. n° 20.
-
61.
Cass. 1re civ., 22 nov. 2005, n° 04-12655 : Bull. civ. I, n° 423.
-
62.
Bureau D., note sous Cass. 1re civ., 22 nov. 2005, n° 04-12655 : Rev. arb. 2005, p. 1011 et s., spéc. p. 1013 ; v. dans le même sens Le Bars T. et Callé P., « L’actuel article 2061 du Code civil serait rétroactif », note sous Cass. 1re civ., 22 nov. 2005, n° 04-12655 : D. 2006, p. 277.
-
63.
Loquin É., « L’application dans le temps du nouvel article 2061 du Code civil », note sous Cass. 1re civ., 22 nov. 2005, n° 04-12655 : RTD com. 2006, p. 302 et s.
-
64.
Par ex. Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-21430 : Bull. civ. I, n° 2.
-
65.
C. civ., art. 2053 ; C. civ., art. 2056.
-
66.
C. civ., art. 2054 ; C. civ., art. 2055 ; C. civ., art. 2057.
-
67.
Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 06-19643 : Bull. civ. I, n° 151. V. dans le même sens Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n° 09-14144 : Bull. civ. I, n° 138.
-
68.
Par ex. Cass. soc., 17 mars 1982, n° 80-40455 : Bull. civ. V, n° 180 – Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-12819 : Bull. civ. I, n° 130 – Cass. com., 27 nov. 2012, n° 11-17185 : Bull. civ. IV, n° 213. V. d’une manière plus générale Jarrosson C., « Les concessions réciproques dans la transaction », D. 1997, p. 267 et s.
-
69.
Mayer L., « La transaction, un contrat spécial ? », RTD civ. 2014, p. 523 et s., spéc. n° 14.
-
70.
Mayer L., « La transaction, un contrat spécial ? », préc., spéc. n° 11.
-
71.
Cass. soc., 27 mars 1996, n° 92-40448 : Bull. civ. V, n° 124.
-
72.
Mayer L., « La transaction, un contrat spécial ? », préc., spéc. n° 13.
-
73.
Cass. 2e civ., 16 nov. 2006, n° 05-18631 : Bull. civ. II, n° 320.
-
74.
V. par ex. Cass. 3e civ., 10 juill. 1991, n° 90-11847 : Bull. civ. III, n° 208.
-
75.
Cass. soc., 18 juill. 2001, n° 99-45534 et 99-45535 : Bull. civ. V, n° 279.
-
76.
Douchy-Oudot M. et Joly-Hurard J., Rép. procédure civile Dalloz, v. « Médiation et conciliation », spéc. n° 146.
-
77.
Fenet P.-A., Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. XV, p. 94, intervention de Berlier (sic).
-
78.
V. considérant que le juge conservera le pouvoir le soulever d’office cette fin de non-recevoir, Clay T., « L’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des différends et la transaction dans la loi Justice du XXIe siècle », JCP G 2016, 1295, spéc. n° 46.
-
79.
C. civ., art. 2062.
-
80.
CPC, art. 1546-1 nouveau.
-
81.
C. civ., art. 2062, al. 2.
-
82.
CPC, art. 1546-3 nouveau.