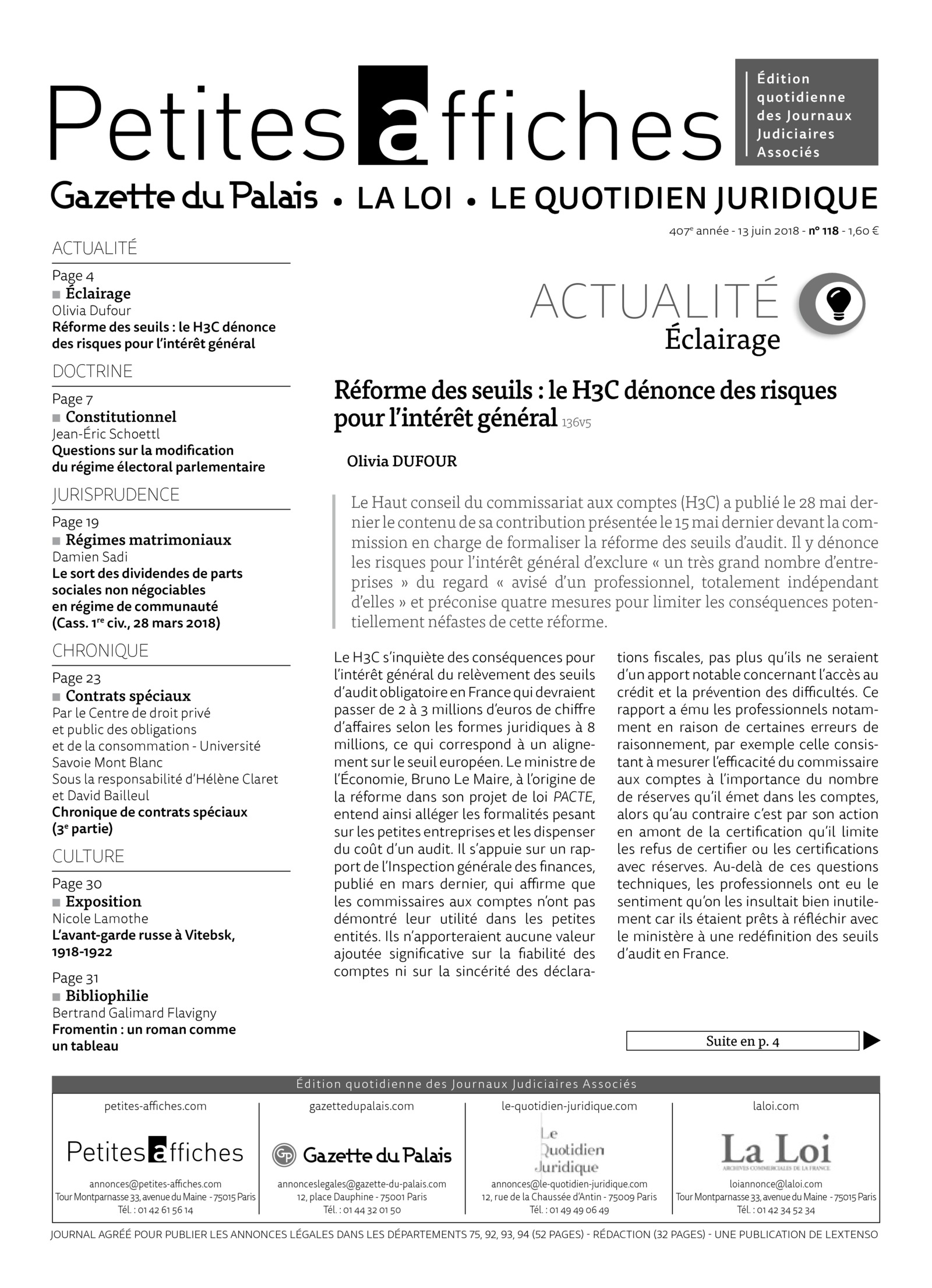Chronique de contrats spéciaux (3e partie)
I – Contrats relatifs au transfert de propriété d’un bien : vente immobilière
II – Contrats relatifs à la mise à disposition d’un bien
A – Bail
B – Prêt – Crédit aux consommateurs
C – Dépôt
III – Contrats relatifs aux litiges
IV – Contrats publics
Quelques (im)précisions quant aux illégalités susceptibles de conduire le juge à annuler un contrat administratif
CE, 15 nov. 2017, nos 409428 et 409799, Cne d’Aix-en Provence, Sté d’économie mixte d’équipement du Pays d’Aix. L’office du juge administratif du contrat n’a eu de cesse d’évoluer. Et après les grands arrêts qui ont marqué la dernière décennie, c’est désormais le temps des réglages et des mises au point, qui se réalisent au fil d’une jurisprudence empirique.
Le représentant de l’État n’a pas été épargné par ces mutations. Investi du contrôle de légalité des actes administratifs locaux, il était traditionnellement compétent pour dénoncer un contrat qui lui semblait irrégulier, sans avoir en principe à démontrer un intérêt à agir1. Ce déféré préfectoral, même dirigé contre un contrat, était qualifié de recours pour excès de pouvoir2, la qualification étant justifiée par l’objet d’un tel recours, qui tendait à l’annulation de l’acte en question. Dans une première étape, le Conseil d’État a d’abord rénové l’action en déféré contre un contrat, en précisant qu’« eu égard à son objet », un tel recours formé relève désormais du contentieux de pleine juridiction3. Les solutions limitées qu’offre le contentieux objectif de la légalité peuvent ainsi être dépassées. Ensuite, dans le but de concilier cette évolution avec la demande de suspension dont le préfet peut assortir son déféré si l’un des moyens invoqués lui paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué4, le Conseil d’État a estimé qu’il appartient au juge de prendre en considération « la nature de l’illégalité commise » pour se prononcer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution contractuelle. Une grande liberté d’appréciation est donc octroyée au juge, pour justifier – ou non – une décision de suspension5. Enfin, le déféré préfectoral, dans une dernière étape, a été aménagé à travers le prisme de jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne6. Dans le cadre du recours en contestation de validité du contrat, la présomption d’intérêt à agir du représentant de l’État a été réaffirmée, et il a été jugé par ailleurs que ce dernier pourrait invoquer tout moyen à l’appui de son recours contre le contrat.
Le processus d’unification du contentieux contractuel semble ainsi achevé. Le passage du déféré préfectoral de l’excès de pouvoir au plein contentieux, en matière contractuelle, devrait désormais permettre d’éviter que la qualité du requérant n’influence les pouvoirs du juge. Mais dans la mesure où les moyens soulevés par le préfet demeurent de simples moyens de légalité, la requalification peut paraître artificielle, comme en atteste cet arrêt du 15 novembre 2017.
Par une délibération du 2 mai 2016, le conseil municipal d’Aix-en-Provence décidait d’abandonner le service public du stationnement payant hors voirie. Le 9 avril suivant, la commune et la SEMEPA (société d’économie mixte d’équipement du Pays d’Aix) s’accordaient donc pour résilier les deux conventions de délégation de service public conclues entre elles en 1986 et 2003 en vue, notamment, de l’exploitation des parcs de stationnement souterrain. La convention prévoyant la résiliation s’accompagnait en outre d’une promesse de vente des huit parcs de stationnement du centre-ville à la SEM, et fixait les conditions de la prise de possession par anticipation de ces biens par la société. Estimant la convention irrégulière, le préfet des Bouches-du-Rhône saisit le tribunal administratif de Marseille, en assortissant sa demande d’une suspension sur déféré. Par une ordonnance du 18 janvier 2017 confirmée en appel, les juges marseillais ont fait droit à la demande de suspension, en raison de l’incompétence de la commune pour conclure la convention, et de la méconnaissance du principe d’inaliénabilité du domaine public.
Le Conseil d’État réfute pourtant cette analyse, et, concernant la demande de suspension présentée par le préfet, s’en tient à deux des illégalités dénoncées par lui. En premier lieu, ce que les cocontractants ont présenté comme la « résiliation partielle » de la convention de 1986 doit être regardé, selon la haute juridiction, comme une modification du contrat de concession initial. À ce titre, les parties auraient dû, au vu du changement de nature globale du contrat, respecter les obligations de publicité et mise en concurrence imposées par les textes. En second lieu, le montage contractuel, aux dires de la municipalité, avait pour seul objectif de faire échec au transfert de compétence imminent de la gestion des parcs de stationnement souterrain vers l’intercommunalité. Difficile alors de ne pas opposer à la commune l’illicéité de l’objet de la convention conclue avec la SEMAPA.
Estimant que ces deux moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la convention, et que les illégalités relevées pourraient à elles seules conduire le juge du contrat à annuler la convention, la haute juridiction confirme la suspension de l’exécution contractuelle prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Cette décision apporte donc des précisions quant à la nature des chefs d’illégalité pouvant conduire le juge à annuler un contrat administratif. Mais, manquant de justesse dans ses formulations, le Conseil d’État entretient également la confusion quant à la réalité d’une unification du contentieux contractuel.
I. Violation de la règle de droit et détournement de pouvoir : des moyens « classiques » d’annulation
Réformés par la jurisprudence Commune de Béziers de 20097, les pouvoirs dont dispose le juge du contrat dans le cadre d’un recours en contestation de validité ont été largement inventoriés et décryptés. En pratique, le juge doit choisir, parmi la gamme de sanctions qui s’offrent à lui, celle qu’il estime la plus adéquate en fonction de « l’importance et des conséquences des vices entachant la validité du contrat », et ne prononcer l’annulation qu’en dernier ressort. C’est pourtant bien de cela dont il est question en l’espèce. Et si les moyens susceptibles de conduire à l’annulation ne surprennent guère, tant ils relèvent de l’évidence, il n’en reste pas moins qu’ils s’inscrivent habituellement dans une logique propre au recours pour excès de pouvoir.
En premier lieu, le juge administratif dénonce l’irrégularité de la convention de 2016 passée entre la ville et « sa » SEM, qui a pour objet « la modification du contrat de concession initial ». Dans la mesure où, par la conclusion de ce nouvel accord, la ville a entendu retirer de la concession les parcs de stationnement souterrains, tout en maintenant ce mode de gestion pour le stationnement sur voirie, le juge assimile la convention à un avenant au contrat initial, et en tire toutes les conséquences. En effet, suivant les règles particulières gouvernant la modification des contrats de concession, dès lors que cette dernière change « la nature globale du contrat » initial, elle introduit des conditions qui justifient notamment la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de dévolution concurrentielle8. Ce critère, dont les modalités d’appréciation ont été précisées, pose les limites de la modification contractuelle9. C’est ainsi que par une analyse objective, portant notamment sur l’équilibre financier de la nouvelle concession, le juge conclut à la méconnaissance des nouvelles règles relatives aux contrats de concession. En définitive, cette illégalité peut être assimilée ici à une violation directe de la règle de droit. Et celle-ci, dans ce cas particulier, paraît difficilement pouvoir être couverte par une mesure de régularisation : non seulement, parce qu’en permettant de contourner les règles de mise en concurrence, elle heurte directement le principe de liberté d’accès à la commande publique, mais surtout, parce qu’interprétée à la lumière des développements suivants, elle traduit une intention manifeste de la ville de se soustraire à ses obligations légales, laissant penser à un détournement de procédure manifeste.
En second lieu en effet, le préfet soulève un autre moyen qui, bien que portant sur un élément subjectif et donc rarement retenu par le juge, met à jour une irrégularité flagrante. La commune, à la suite d’une importante communication, a fait savoir que l’objet de la convention de 2016 devait lui permettre de « se soustraire à l’obligation de céder gratuitement ses parkings » à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, « ce que la loi imposait »10. Les velléités de résistance de la ville au transfert de compétence vers l’intercommunalité, clairement révélées, ont assurément simplifié l’administration de la preuve par le préfet. C’est donc très logiquement que le juge considère que la nouvelle convention a un objet illicite, et doit être regardée « comme entachée d’un détournement de pouvoir ». Cette fois encore, la régularisation n’est pas pensable : sans besoin de rechercher plus avant les intentions véritables qui ont guidé la personne publique, sa volonté de frauder la loi est manifeste. Et même dans l’hypothèse où la municipalité aurait été animée par une volonté, louable, de satisfaire au mieux les besoins de la population locale, l’argument ne tient pas dans le contexte décrit. C’est ce qui ressort – implicitement – de la décision du Conseil d’État, qui conclut à l’existence d’un nouveau doute sérieux sur la légalité de la convention.
II. La confusion entretenue autour de l’unification du contentieux des contrats administratifs
En plein contentieux contractuel, le juge doit désormais se livrer à une véritable gymnastique juridique, et prendre en considération les exigences de stabilité des relations contractuelles, de légalité, ou encore celles inhérentes à l’intérêt général. L’entreprise s’avère des plus complexe. Néanmoins, pour stabiliser l’état du droit après les grandes (r)évolutions de la matière et assurer une certaine sécurité juridique, il convient que la haute juridiction fixe une ligne directrice et ne s’en départisse plus, au moins pour ce qui est du bon usage des « nouvelles » formulations. Dans le cas contraire, la confusion va demeurer latente.
Le moins que l’on puisse dire au regard de l’espèce qui donne lieu à commentaire, c’est que cette dernière ne pèche pas par excès de clarté. Sans doute, il ne s’agit là que d’un référé de cassation qui, au surplus, ne fait que confirmer la suspension d’une exécution contractuelle. Certes… Mais toutes les occasions devraient être saisies, dès à présent, pour préciser les concepts et clarifier les notions avec la plus grande rigueur.
Ainsi, à la suite des grands arrêts rendus en matière contractuelle, les questions liées aux moyens invocables – pour ne citer qu’elles – restent encore largement en suspens. Quels sont, parmi ces moyens, ceux qui, précisément, conduiront à l’annulation du contrat ? Aux termes de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne, l’annulation pourra être prononcée par le juge si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité. Dans la décision du 15 novembre dernier, le juge ne fait pourtant référence qu’à l’illicéité de l’objet, qu’il assimile par ailleurs à un détournement de pouvoir, formulation tenant plus au contexte d’annulation de l’acte unilatéral qu’à celui du contrat. Mélange des genres, hybridation des motifs, il est difficile de s’y retrouver.
Il est certain qu’à chaque catégorie de tiers correspondra sa catégorie de moyens invocables. Aussi, ceux dont se prévaut en l’espèce le préfet ne doivent pas surprendre. Même requalifié de recours de plein contentieux, « le déféré préfectoral contre un contrat administratif est exclusivement destiné à faire prévaloir la légalité (…) : il reste un recours purement objectif »11. Mais cela n’aurait pas dû empêcher le juge administratif de se dégager de cette tradition du contrôle objectif de la légalité, afin de ne pas fragiliser l’unité du plein contentieux.
Pour ce faire, il aurait pu légitimement se rapprocher du régime des contrats de droit privé, ou de la législation de nombreux droits étrangers, en relevant ici l’illicéité de la cause du contrat12. Mais outre le fait que l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a supprimé la notion de cause, cette solution aurait compliqué un peu plus l’état du droit dans le sens où, même si l’emploi de la notion aurait été pertinent en l’espèce, il n’est pas habituel en droit administratif13. En revanche, il aurait été plus opportun que le Conseil d’État reprenne la formulation employée dans la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne, en visant notamment l’illicéité, non de la cause ou de l’objet, mais du contenu du contrat. Ne s’étant pas prononcé sur ce point, il reviendra très prochainement aux juges du fond d’opérer la requalification des moyens de légalité interne soulevés par le préfet, afin de les adapter à la matière contractuelle.
Il reste que la haute juridiction ne pourra pas rester indéfiniment là où elle s’est placée avec cet arrêt : au milieu du gué…
Marie COURRÈGES
Quelques précisions sur le régime de responsabilité découlant de la faute de l’Administration ayant causé l’annulation d’un marché.
CE, 6 oct. 2017, Sté Cegelec Perpignan. Parmi les questions fréquentes du contentieux de la commande publique se trouve celle de la responsabilité découlant de la faute de l’Administration ayant causé l’annulation d’un marché vis-à-vis de son titulaire. Dans un arrêt du 6 octobre 201714, le Conseil d’État y apporte quelques précisions lorsque l’annulation est prononcée dans le cadre d’un référé contractuel. En l’espèce, le centre hospitalier de Narbonne avait lancé en 2011 une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la construction d’un centre de gérontologie, dont le lot « CVC – plomberies – paillasses humides » avait été attribué à la société Cegelec, pour un montant de 2 849 735,72 € HT. La société Spie Sud-Oest, concurrent évincé, avait alors saisi le juge du référé contractuel du tribunal administratif de Montpellier. Ce dernier, constatant le non-respect d’une clause de standstill ayant privé la requérante de son droit d’exercice d’un recours précontractuel en temps utile, ainsi que plusieurs irrégularités relatives aux critères de sélection des offres, constitutives de manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, annula le marché par une ordonnance du 7 juillet 2011. Le centre hospitalier de Narbonne recommença la procédure en lançant un nouvel appel d’offres auquel la société Cegelec Sud-Ouest se porta candidate, mais cette fois sans être retenue. Elle avait alors demandé au centre hospitalier de l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de l’annulation par le juge du référé contractuel du marché dont elle était titulaire. Le tribunal administratif de Montpellier fit droit à sa demande par jugement du 10 décembre 2013, condamnant le centre hospitalier de Narbonne à lui verser la somme de 132 616 € avec intérêts au titre du manque à gagner correspondant à la somme qu’elle aurait dû percevoir pour l’exécution normale du contrat. Puis saisie à son tour, la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 12 octobre 2015, ramena l’indemnisation de la société aux seuls frais de présentation de son offre, pour un montant de 12 470 €, ce qui motiva le recours en cassation introduit devant le Conseil d’État. Confirmant l’arrêt d’appel, le Conseil d’État opère une extension du principe d’indemnisation du manque à gagner en cas d’annulation en référé, et pose sous un nouvel angle la question de l’indemnisation de ce chef de préjudice en matière de passation des contrats de commande publique.
I. L’extension du principe d’indemnisation du manque à gagner au cas d’annulation en référé
Le principe de réparation intégrale du préjudice a conduit la jurisprudence administrative à admettre que soit indemnisé le manque à gagner du cocontractant de l’Administration résultant de l’annulation du contrat pour une faute de cette dernière. Le régime est systématisé par un arrêt du 19 avril 1974, qui expose de manière particulièrement claire la manière dont s’articulent dans ce cas de figure les règles de l’enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle15. Il est ainsi jugé que l’entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut obtenir le remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Et dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’Administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute, et ainsi obtenir le paiement du bénéfice dont il aurait été privé par la nullité du contrat. Pour cela, la faute du service doit avoir causé un dommage réel, ce qui n’est pas le cas si la somme perçue au titre des dépenses utiles, sur le terrain quasi contractuel, recouvre l’intégralité de la réparation du préjudice à laquelle il peut prétendre au titre de la responsabilité quasi-délictuelle. Autrement dit, « il appartient dès lors au juge, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réparation des dommages imputés à la faute de service, de déterminer en premier lieu le montant des sommes dues à l’entrepreneur au titre de ses dépenses utiles et que c’est seulement dans l’hypothèse où l’indemnité ainsi calculée serait inférieure au prix du contrat qu’il y a lieu de rechercher si le préjudice qui en résulte doit être supporté en totalité ou en partie, dans la limite de ce prix, par la collectivité dont la faute est à l’origine de la nullité du marché »16. Cette construction est complétée par un arrêt Société Decaux du 10 avril 200817, lequel envisage la faute du cocontractant susceptible de limiter en partie ou totalement son droit à réparation. Il est ainsi jugé que « si le cocontractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l’illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice ». C’est enfin dans le cadre plus général du régime de responsabilité administrative que ces principes sont mis en œuvre, le juge rappelant ainsi la nécessité de faire état d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre celui-ci et la faute de l’Administration.
Après avoir rappelé ce régime dans un considérant synthétique très clair, le Conseil d’État, dans son arrêt du 6 octobre 2017, en fait une application sans restriction au cas d’une annulation du contrat par voie de référé contractuel. En l’espèce, c’est l’absence de lien de causalité direct qui est retenue pour motiver le rejet de la demande d’indemnisation du manque à gagner. Du point de vue du mécanisme de la responsabilité extracontractuelle, la solution n’est pas sans logique. Il était en effet établi que les différents manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence avaient eu une incidence déterminante sur l’attribution du marché à la société Cegelec, de sorte que celle-ci ne pouvait se prévaloir d’une perte de chance sérieuse d’obtenir le marché dans des conditions normales. Ici, la chance « sérieuse » s’entend plus précisément comme « certaine », pour être la cause directe du préjudice, ce que la cour administrative d’appel a d’ailleurs traduit par le fait que l’entreprise Cegelec ne pouvait « se prévaloir d’aucun droit à la conclusion du contrat ». Le raisonnement devient toutefois moins limpide en adoptant un point de vue plus large, et sans doute plus en adéquation avec l’esprit de l’indemnisation du préjudice subi dans une telle hypothèse. Soulignons en effet qu’il s’agit ici de compenser l’annulation d’un marché vis-à-vis de l’entreprise qui en était titulaire et dont la candidature a ensuite été rejetée dans le cadre de la nouvelle procédure de passation. Or réduire l’appréciation du caractère direct du lien de causalité à l’existence de chance certaine d’obtenir le marché revient à admettre que dans les conditions où le lien de causalité serait suffisamment établi, l’entreprise devrait normalement se voir réattribuer le marché annulé, sans donc qu’il soit question d’action en responsabilité. Et il paraît évident, dans ce dernier cas, que le fait de ne pas participer à la nouvelle procédure de passation du marché annulé pourrait aisément être opposé à toute demande d’indemnisation du préjudice causé par l’annulation18.
Il semble dès lors plus pertinent de considérer dans une telle hypothèse que l’exonération de responsabilité quasi-délictuelle de l’Administration résulte nécessairement de la faute de son cocontractant. Sans doute la faute exonératoire doit-elle être suffisamment importante pour avoir cet effet, ainsi que le rappelle le Conseil d’État dans son arrêt Société Decaux19. Il doit s’agir d’une irrégularité assez évidente pour qu’aucune des parties au contrat ne puisse l’ignorer, ce qui sera toujours le cas, en principe, des erreurs susceptibles de justifier une annulation par voie de référé contractuel. Comme le prévoient en effet les articles L. 551-18 et L. 551-20 du Code de justice administrative, le juge du référé a, selon les cas, le pouvoir ou l’obligation d’annuler le contrat pour les manquements les plus graves aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ce qui vaut notamment pour le non-respect d’une clause de standstill. En définitive, et non sans paradoxe, plus la faute de l’Administration sera grossière, moins elle sera susceptible de l’obliger à la réparer. Les litiges où la responsabilité extracontractuelle sera effectivement retenue sur ce fondement devraient donc demeurer marginaux, pour ne pas dire hypothétiques20. Pour autant, le principe même d’un droit du titulaire du marché annulé à l’indemnisation de son manque à gagner, lorsque cette annulation résulte d’un référé contractuel, ne va pas de soi, dès lors notamment que ledit marché n’a reçu aucun commencement d’exécution avant d’être annulé par le juge, ce qui était le cas en l’occurrence, argument que ne manquait d’ailleurs pas de soulever la requérante, et qui avait été souligné par la cour administrative d’appel.
II. La question de l’indemnisation du manque à gagner au stade de la conclusion du contrat
L’enjeu de cette question n’échappe à aucun observateur. Le risque qui pèse sur l’Administration dont le marché a été annulé par sa faute est de devoir indemniser son cocontractant, en plus du financement d’un nouveau marché si celui-ci est finalement conclu avec une autre entreprise. En pratique, la personne publique éclairée et soucieuse de ses deniers devra donc s’efforcer, dans le cadre de la nouvelle procédure de passation, de reprendre la même entreprise après avoir purgé le vice ayant entaché d’illégalité la procédure initiale. Cette possibilité ne reste toutefois ouverte qu’à condition que l’irrégularité commise n’ait pas été un élément déterminant du choix opéré par la collectivité. Dans le cas contraire, elle s’expose aussi à une action indemnitaire de concurrents injustement évincés, selon le même régime de responsabilité21. Il en résulte un effet d’étau, pesant sur le choix de la collectivité, sur lequel il n’est pas incongru de s’interroger, au-delà même du cadre du référé contractuel. Il est peu contestable en effet que les conditions actuelles de passation des contrats de commande publique sont autrement plus complexes qu’elles ne l’étaient en 1974, date à laquelle fut admis le principe d’indemnisation du manque à gagner résultant de l’annulation du contrat, ce qui accroît d’autant plus l’insécurité juridique pesant sur l’Administration, en particulier lorsqu’il s’agit de petites collectivités territoriales, qui le plus souvent ne disposent pas des compétences techniques suffisantes pour y faire face. Il peut en résulter corrélativement un effet d’aubaine de la part d’entreprises rompues à cet exercice, dont certaines se sont dotées de cellules juridiques dédiées. Il est entendu qu’il ne s’agit pas pour autant de reconnaître une forme d’impunité des acheteurs publics, dont on imagine mal sur quel fondement juridique elle pourrait reposer. Il peut être envisagé en revanche de limiter le risque en caractérisant davantage la faute administrative et le préjudice subi par le titulaire du marché.
Une limitation de la responsabilité administrative pourrait ainsi d’abord résulter de l’exigence que la faute ayant entaché d’irrégularité la passation du contrat soit suffisamment grave pour ouvrir droit à une indemnisation. À contre-courant de l’évolution de la jurisprudence qui tend à réduire toujours davantage le champ d’application de la faute lourde, il s’agirait donc d’admettre que la passation des contrats de commande publique, en raison de la complexité de son régime, constitue une activité justifiant que toute erreur dans la procédure ne soit pas nécessairement traduite comme une faute de nature à engager la responsabilité de l’Administration. Une telle solution, si elle mérite d’être débattue, paraît toutefois trop radicale. Au-delà d’une entorse au principe selon lequel tout acte administratif illégal est constitutif de faute, elle conduirait le cas échéant à exclure l’indemnisation de tous chefs de préjudice, dont celui correspondant aux frais engagés pour se porter candidat au marché, et l’iniquité changerait alors de camp. Au surplus, admettre que la responsabilité de la personne publique ne puisse être engagée qu’en cas d’erreur grossière dans la procédure de passation reviendrait en pratique à anéantir toute chance de réparation du préjudice causé au titulaire du marché annulé ; dès lors en effet que l’irrégularité est évidente, ce dernier se verra normalement opposer son concours fautif à l’attribution du contrat dans de telles conditions. Il semble alors plus pertinent de s’intéresser au stade de la procédure contractuelle auquel l’annulation est prononcée, afin de mieux déterminer le caractère réel et certain du préjudice causé.
La jurisprudence paraît s’en tenir à un principe simple. Dès lors que le contrat a été signé, son existence suffit à établir la réalité du préjudice de perte de profits attendus de son exécution, quand bien même il n’aurait pas encore commencé à être exécuté au moment où le juge en prononce la nullité. Or il est évident que le préjudice subi n’a pas la même intensité selon que l’annulation intervient avant un début d’exécution, comme c’était le cas dans l’arrêt commenté, ou plusieurs mois après. L’application uniforme du principe d’indemnisation s’avère ainsi particulièrement favorable au cocontractant de l’Administration. Il reste que le critère de l’inexécution ne peut par lui-même affecter le droit d’indemnisation du manque à gagner, lequel est fondé sur la seule existence du contrat. La durée de la période susceptible de s’écouler avant le début de l’exécution, et la durée totale d’exécution du contrat sont elles-mêmes très variables d’une hypothèse à l’autre. Il est possible en revanche de distinguer plus objectivement une période où la réalité et la certitude du préjudice ne sont pas suffisamment consolidées pour ouvrir droit à une indemnisation, qui correspond au délai de purge des recours en annulation susceptibles d’être exercés par les tiers au contrat. Ce laps de temps, pendant lequel l’existence du contrat peut être remise en cause, suffit selon nous à altérer la certitude d’une perte de bénéfices liée à l’engagement22, le préjudice susceptible d’en résulter devant ainsi simplement s’analyser comme la perte d’une chance de conclure le contrat. Sans doute l’instruction d’un recours peut-elle être parfois assez longue, y compris dans le cadre du référé-contractuel où il n’est pas rare que le juge rende sa décision plusieurs mois après la saisine. Mais l’inconvénient supporté par l’entreprise titulaire du marché, dont la situation ne serait donc pas immédiatement stabilisée par la signature de celui-ci, semble à la hauteur du risque qui pèse sur la collectivité. Au demeurant, l’entreprise a toujours elle-même la possibilité de mesurer le risque lié à l’existence d’un recours dès l’introduction de celui-ci, donc en principe dans un bref délai à compter de la signature du contrat. Le souci d’une meilleure protection des finances locales, en matière de commande publique, pourrait justifier cet aménagement.
David BAILLEUL
Notes de bas de pages
-
1.
V. CGCT, art. L. 2131-2 pour la liste limitative des actes devant être transmis au préfet et donc susceptibles d’être déférés au tribunal administratif. Pour rappel, le juge administratif s’est expressément affranchi de cette contrainte textuelle, en généralisant la solution à l’ensemble des contrats administratifs : CE, 14 mars 1997, n° 143800, Département des Alpes-Maritimes : Lebon, p. 79 ; RFDA 1997, p. 660.
-
2.
CE, 26 juill. 1991, n° 117717, Cne de Sainte-Marie (Réunion) : Lebon, p. 302.
-
3.
CE, 23 déc. 2011, n° 348647, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration : RFDA 2012, p. 683, note Delvolvé P. ; Dalloz actualité, mars 2012, comm. Claeys A.
-
4.
V. CJA, art. R. 554-1.
-
5.
CE, 9 mai 2012, n° 355665, Syndicat départemental des ordures ménagères de l’Aude : Contrats et Marchés publics 2012, comm. Pietri J.-P.
-
6.
CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne : GAJA, n° 116 ; RFDA 2014, p. 425, concl. Dacosta B. et p. 428, note Delvolvé P. ; RDP 2014, Janicot L. et Lafaix J.-F.
-
7.
CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Cne de Béziers : RFDA 2010, p. 506, concl. Glaser E., note Pouyaud D. ; RJEP 2010, comm. 30, Gourdou J. et Terneyre P. ; AJDA 2010, p. 142, chr. Lieber S. et Botteghi D.
-
8.
Hoepffner H., « La modification de contrats », RDFA 2016, p. 280.
-
9.
V. Ord. n° 2016-65, 29 janv. 2016, art. 55 relative aux contrats de concession, complété par les articles 36 et 37 de son décret d’application du 1er févr. 2016.
-
10.
V. CGCT, art. L. 5218-2.
-
11.
Delvolvé P., « Le déféré préfectoral contre les contrats administratifs : du recours pour excès de pouvoir au recours de plein contentieux », RFDA 2012, p. 683.
-
12.
La cause, en droit privé, permet en effet de contrôler la licéité du contrat, l’ancien article 1133 du Code civil précisant en outre que « la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ».
-
13.
Par exemple. CE, 15 févr. 2008, n° 279045, Cne de la Londe-les-Maures. Le Conseil d’État rappelle dans cet arrêt qu’« une convention peut être déclarée nulle lorsqu’elle est dépourvue de cause ou qu’elle est fondée sur une cause qui, en raison de l’objet de cette convention ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite ».
-
14.
CE, 6 oct. 2017, n° 395268, Sté Cegelec Perpignan : AJDA 2017, p. 1919.
-
15.
CE, 19 avr. 1974, Sté Entreprise Louis Segrette : Lebon, p. 1052.
-
16.
CE, 19 avr. 1974, Sté Entreprise Louis Segrette : préc.
-
17.
CE, sect., 10 avr. 2008, n° 244950, Sté Decaux et département des Alpes-Maritimes : Lebon, p. 151 concl. Dacosta B. ; AJDA 2008, p. 1092, chron. Boucher J. et Bourgeois-Machureau B. ; RDI 2008, p. 385, note Noguellou R.
-
18.
V. cependant CE, 12 mars 1999, n° 171293, Entreprise Porte : Lebon T., p. 1016.
-
19.
CE, sect., 10 avr. 2008, n° 244950, Sté Decaux et département des Alpes-Maritimes, préc.
-
20.
V. cependant Roussel S. et Nicolas C., chron. AJDA 2017, p. 2189.
-
21.
C’est d’ailleurs à propos des concurrents évincés que le régime a été construit par la jurisprudence : v. Roussel S. et Nicolas C., préc.
-
22.
V. CE, 23 sept. 1983, n° 32164, Min. de l’Intérieur c/ Dridi : Lebon T., p. 861 : préjudice jugé inexistant dès lors que la faute commise n’a pas porté atteinte à un droit définitivement acquis.