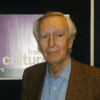En votant une proposition de loi ramenant l’âge légal de la retraite à 62 ans, l’Assemblée ouvrirait une crise institutionnelle majeure !

Les propositions de loi n° 1164 et n° 1165 présentées par Bertrand Pancher et, pour la première, par de nombreux députés, visent implicitement ou explicitement à abroger le report de l’âge légal de la retraite à 64 ans. Elles ont été déposées alors qu’était à peine sèche l’encre de la décision du Conseil constitutionnel du 14 avril et que venait d’être publiée la loi sur les retraites. Cette initiative du groupe LIOT pose une question cruciale au regard de l’article 40 de la Constitution. Alors même que l’irrecevabilité financière d’une telle initiative parlementaire est flagrante, le débat se concentre sur des questions de procédure et de compétence. Les procédures parlementaires relatives à la mise en œuvre de l’article 40 s’appliquaient jusqu’ici de manière satisfaisante parce qu’une logique de dédoublement fonctionnel entre le politique et une fonction de nature juridictionnelle prévalait. L’abandon de cette logique d’autocontrôle, pour des raisons d’opportunité politique, pourrait aboutir à restreindre l’autonomie décisionnelle du Parlement.
Va-t-on bientôt assister à une nouvelle régression de l’autonomie décisionnelle confiée aux instances internes au Parlement ? Tel est le risque de voir rendue une décision politique à l’occasion de l’examen, prévu à l’Assemblée nationale le 8 juin prochain, de la proposition de loi n° 1164 émanant du groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), qui tend à ramener à 62 ans l’âge légal de départ à la retraite, porté à 64 ans par l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale. Le contrôle obligatoire et systématique de la recevabilité financière de la proposition de loi, exigé par le Conseil constitutionnel avant le débat parlementaire, devrait pourtant aboutir, si l’article 40 de la Constitution est respecté, au constat de l’irrecevabilité de cette proposition. Si tel n’était pas le cas, c’est à une crise du fonctionnement parlementaire que l’on aboutirait.
L’élection à la présidence de la commission des finances d’un député du groupe La France insoumise (LFI), politiquement hostile au contrôle qu’il doit juridictionnellement exercer, met en cause une construction procédurale, progressivement mais clairement élaborée depuis 1958. Elle consiste à confier aux seules instances parlementaires le contrôle de la recevabilité financière des initiatives parlementaires et à faire du Conseil constitutionnel un simple juge d’appel de ce contrôle. Ce système ne pourra plus fonctionner si sont rendues des décisions contraires à la lettre de la Constitution. Les instances des assemblées chargées du contrôle, en l’espèce obligatoirement confiées par le règlement à un député de l’opposition, s’avéreraient en effet incapables d’assumer la différence fonctionnelle entre un mandat politique et une mission institutionnelle. Peut-on se servir de l’attribution institutionnelle d’une compétence à l’opposition pour en dévoyer l’exercice ?
Définissant la fonction des assemblées pour le contrôle de la régularité des élections de leurs membres, Marcel Waline, dans un célèbre article à la Revue du droit public de 1928 (p. 441), voit dans la « vérification des pouvoirs » l’exercice d’une pleine fonction juridictionnelle. Pourquoi juridictionnelle ? Parce qu’il s’agit d’appliquer des règles juridiques et de répondre définitivement à une question qui ne peut être tranchée qu’en droit, sans intervention d’aucune considération politique. En s’éloignant du respect de cette logique pour rendre des décisions politiques, l’Assemblée nationale a invalidé, en 1956, 11 députés poujadistes et proclamé leurs adversaires élus sans appliquer la même rigueur aux mêmes faits. En 1958, ce contrôle lui a été ôté pour être confié au Conseil constitutionnel. La conclusion est aisée : si l’Assemblée, par la voie des autorités désignées à cet effet, applique une règle pourtant claire de manière aléatoire, discrétionnaire, en fonction de considérations politiques, la compétence institutionnelle qui lui est confiée par la Constitution devra lui être retirée à plus ou moins brève échéance.
L’article 40 de la Constitution de 1958 interdit toute initiative parlementaire « coûteuse », c’est-à-dire créant ou augmentant « une charge publique » (soulignons « une ») ou diminuant « les ressources publiques » (soulignons « les »). Comme pour bien des mécanismes introduits pour rationaliser l’activité parlementaire en 1958, le dispositif est l’aboutissement de règles antérieures trop ponctuelles pour atteindre cet objectif. Il trouve son origine dans la résolution « Berthelot », adoptée par la Chambre des députés en 1900, puis dans l’article 17 de la Constitution du 27 octobre 1946, qui avait interdit, lors des discussions budgétaires, les créations ou les augmentations de dépenses, et enfin dans la loi dite des « maxima », du 31 décembre 1948, qui consistait à fixer des plafonds avant de débattre des dépenses. Cette dernière fut appliquée à partir de 1949 aux dépenses de l’État, même hors discussion budgétaire, puis aux recettes l’année suivante, puis aux dépenses de sécurité sociale l’année suivante, et enfin aux finances locales en 1955. Cet ensemble fut repris par un décret du 19 juin 1956. Les initiatives coûteuses ou réductrices de recettes devaient être compensées par des recettes équivalentes. Mais l’application de ces principes fut hésitante et limitée.
En 1958, le dispositif est triplement renforcé : il ne permet plus les compensations de dépenses (augmentation et diminution corrélatives), crée une interdiction spécifique aux recettes et rend indiscutable l’application de cette prohibition à tous les textes. L’article 40 est ainsi l’aboutissement d’un long mais irréversible processus.
L’objet de l’irrecevabilité financière de l’article 40 est simple et simplement décrit, en 1958, par Gilbert Devaux devant la commission constitutionnelle du Conseil d’État (Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, Documentation française, 1991, tome III, p. 139) : « le texte que vous avez là empêche les opérations compensées, à tout le moins dans le domaine des dépenses… Par conséquent, il atteint vraiment l’initiative parlementaire des dépenses. Par contre il laisse, c’est admissible, la possibilité d’une proposition compensée en matière de ressources ».
L’emploi du singulier, qui concerne toute dépense, crée une interdiction drastique et parfaitement voulue : il n’est possible de compenser la création ou l’aggravation d’une « charge » publique ni par la diminution proposée d’une autre dépense publique, ni par une recette nouvelle qui financerait cette augmentation. L’emploi du pluriel s’agissant des recettes – principalement fiscales – vise à protéger leur niveau global, c’est-à-dire à permettre des compensations entre recettes. La restriction des initiatives parlementaires est substantielle. À dessein.
En dépit de multiples tentatives de réforme ou de suppression, l’article 40 est l’un des rares articles de la Constitution inchangés depuis 1958. Il interdit le débat – et plus encore le vote – de toute initiative parlementaire coûteuse, c’est-à-dire de toute initiative créant ou aggravant une charge publique, ou diminuant les ressources publiques. La jurisprudence est constante : la diminution d’une ressource publique est permise à condition qu’elle soit « gagée » par une augmentation correspondante, le gage devant s’appliquer à l’entité qui subit la perte de ressources (Cons. const., 2 juin 1976, n° 76-64). Il s’agit souvent de droits additionnels aux droits sur les tabacs s’agissant des impôts d’État, car l’article L. 131-8 du Code de la sécurité sociale affecte ces droits à la sécurité sociale. Le niveau des recettes est ainsi protégé. En revanche, et contrairement à ce qu’on lit fréquemment, toute dépense supplémentaire, même gagée par une recette ou une économie, est prohibée sauf lorsqu’il s’agit d’une pure charge de gestion.
Ne souffre pas débat le fait que les dépenses des régimes de sécurité sociale relèvent de la catégorie des charges publiques au sens de l’article 40. Depuis l’origine, « l’expression “charge publique” doit être entendue comme englobant outre les charges de l’État toutes celles antérieurement visées par l’article 10 du décret du 19 juin 1956 » (texte qui vise en particulier les « régimes d’assistance ou de sécurité sociale »). Le Conseil constitutionnel se prononce en ce sens dès le 20 janvier 1961 (Cons. const., 20 janv. 1961, n° 61-11 DC) et cette évidence n’a jamais été contestée, surtout pas depuis qu’en 1996 ont été instituées les lois de financement de la sécurité sociale (article 47-1 de la Constitution et loi organique du 22 juillet 1996). Cette « décision de principe conforme à la volonté du constituant n’a jamais été remise en cause », indique Jacques Barrot dans l’un des nombreux rapports que les présidents des commissions des finances ont consacré à la recevabilité financière, tout en relevant que les régimes complémentaires financés uniquement par cotisations échappent au champ de l’article 40 (Doc AN 1273, Xe législature, p. 20). Incombent en effet aux présidents des commissions des finances de chaque assemblée le contrôle systématique de la recevabilité financière des amendements et celui, il est vrai plus aléatoire, des propositions de loi.
Le Conseil constitutionnel exige un contrôle de la recevabilité financière des initiatives lors de leur dépôt en des termes particulièrement explicites. Dans sa décision du 14 juin 1978 (Cons. cons., 14 juin 1978, n° 78-94 DC), il juge qu’il résulte des termes mêmes de l’article 40 « qu’il établit une irrecevabilité de caractère absolu et fait donc obstacle à ce que la procédure législative s’engage à l’égard de propositions de loi irrecevables (…) le respect de l’article 40 de la Constitution exige qu’il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des propositions de loi (…) antérieurement à l’annonce par le Président de leur dépôt et donc avant qu’elles ne puissent être imprimées, distribuées et renvoyées en commission (…) il appartient à chaque assemblée parlementaire de déterminer les modalités d’exercice de ce premier contrôle et, notamment, l’autorité chargée de l’exercer ».
L’exigence d’un contrôle interne de la recevabilité financière (rappelée par exemple dans les décisions n° 2009-581 DC et n° 2009-582 DC du 25 juin 2009) est mise en œuvre par l’article 89 du règlement de l’Assemblée (voir infra). Les autorités chargées du contrôle sont distinctes pour les amendements et pour les propositions de loi (PPL).
Pour les amendements, le contrôle est systématique. Il est effectué par le président de la commission des finances. Le règlement de l’Assemblée ménage la compétence des autres présidents de commission, mais ceux-ci ont pour habitude de renvoyer aux décisions du président de la commission des finances même s’ils demeurent libres du renvoi et de leurs décisions. Le règlement accorde également une place au président de l’Assemblée, mais celui-ci s’en remet toujours au président de la commission des finances. La présidente de l’Assemblée a pourtant exercé cette compétence une première fois, le 11 juillet 2022, puis à nouveau le 27 octobre 2022. Symptomatique des dysfonctionnements survenus depuis juin 2022, cette intervention de Yaël Braun-Pivet en matière de recevabilité financière était motivée par l’incohérence de décisions antérieures sur un amendement relatif à la réintégration des personnels soignants radiés pour refus de se vacciner contre le Covid-19. À cette exception près, c’est toujours, depuis 1958, le président de la commission des finances qui décide. Il ne s’agit pas d’une consultation « éventuelle » mais systématique pour les amendements qui peuvent présenter une incidence financière. Il ne s’agit pas d’un avis mais d’une décision.
Pour les propositions de loi, l’exigence du contrôle au dépôt est formelle et ne fait pas appel aux mêmes autorités. Elles sont renvoyées à une délégation du Bureau qui les apprécie, mais admet, sans respecter ni la lettre ni l’objet de l’article 40, les charges gagées. Le gage des charges (pourtant irrecevable), ainsi que celui des pertes de recettes, est le plus souvent (comme ici) la majoration des droits sur les tabacs ou la création d’une taxation additionnelle. L’une et l’autre des PPL créent une charge nouvelle qui n’échappe pas à l’irrecevabilité de l’article 40 par le gage.
Le règlement a longtemps retenu que l’irrecevabilité devait être « évidente ». Même si ce terme a disparu en 2009, le contrôle demeure superficiel : les charges peuvent être à ce stade compensées, nonobstant la lettre de l’article 40 de la Constitution. En pratique, le contrôle est destiné à mettre l’accent sur l’irrecevabilité financière davantage qu’à faire obstacle au dépôt d’une proposition. Cette procédure « souple », « bienveillante », « libérale » (comme on l’a qualifiée) peut être justifiée par deux raisons : d’une part, les chances de voir débattre d’une PPL sont statistiquement très faibles au regard du nombre de propositions de loi déposées, même depuis 2009 où l’ordre du jour est partagé ; d’autre part, un texte peut toujours, au stade de l’examen, être expurgé d’une irrecevabilité, comme le Conseil constitutionnel l’a jugé dans une décision du 13 janvier 1994 (Cons. const., 13 janv. 1994, n° 93-329 DC) à propos d’une PPL qui tendait à déplafonner l’aide apportée par les collectivités territoriales aux établissements d’enseignement privés. Dans ce cas, seul un amendement gouvernemental peut rétablir la mesure coûteuse supprimée par la commission.
Après le précédent du 11 juillet 2022, qui a vu la Présidence prendre la main sur la recevabilité financière d’amendements déclarés irrecevables, puis recevables, le traitement de la proposition de loi du groupe LIOT au regard de l’article 40 de la Constitution pose un problème inédit. Ce problème tient non à l’existence de l’irrecevabilité financière, évidente, mais à l’autorité en charge de la constater ou, plus exactement, à la réticence idéologique du titulaire actuel de la fonction à assumer le caractère juridictionnel de ce constat. S’affranchir de l’obligation, pour les organes du Parlement, de veiller eux-mêmes à l’application de la Constitution méconnaît la logique de la Ve République.
Indéniablement, la décision appartient au président de la commission des finances, lequel a été saisi par la présidente de la commission des affaires sociales du texte de la PPL. La délégation du Bureau avait constaté, en examinant les gages, l’existence de la charge publique nouvelle, ainsi que pour la deuxième des PPL, la diminution des recettes, du fait de la perte de cotisations et d’impositions affectées assises sur les salaires. Mais la délégation du Bureau n’a pas relevé l’irrecevabilité financière, alors qu’elle est avérée dans les deux cas.
À la différence de ce qu’il en est pour les amendements, la présidente de l’Assemblée ne peut prendre la main sur la recevabilité financière d’une proposition de loi : ce n’est pas elle qui, aux termes de l’article 89 du règlement de l’Assemblée nationale, renvoie les PPL au président de la commission des finances. Elle les renvoie au Bureau de l’Assemblée qui statue. La compétence du président de la commission des finances sur une PPL validée par la délégation du Bureau est donc, au stade de l’examen en commission, incontournable, sauf à ce qu’il se désiste ou à ce qu’il soit empêché.
Pour autant, une décision rendue par le président de la commission des finances en méconnaissance de l’article 40 serait-elle sans appel ? Nous ne le pensons pas. Le Bureau de l’Assemblée pourrait en effet décider de se saisir du texte adopté par la commission des affaires sociales. Une compétence extensive du Bureau peut découler de l’article 14 du règlement selon lequel il détient « tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée ». Elle fut par exemple à l’œuvre, non sans critique, pour refuser la création d’une commission d’enquête sur les sondages de l’Élysée, le 26 novembre 2009. Mais cette compétence serait ici plus constructive encore puisque, par le biais de la délégation du Bureau, il a déjà été statué sur le texte initial. Pratiquant, quant à elle, un strict dédoublement fonctionnel, la présidente Yaël Braun-Pivet a pour l’instant écarté cette possibilité.
Le gouvernement peut également soulever en séance la question de la recevabilité. Les précédents sont fréquents. Il s’est par exemple opposé, en raison de leur irrecevabilité financière, à des propositions de loi :
-
créant des allocations d’attente pour les demandeurs d’emploi de plus de 60 ans le 12 décembre 1996 au Sénat ;
-
améliorant les pensions de retraite des plus de 60 ans le 8 décembre 1998 à l’Assemblée (doc n° 1251 XIe législature, 1998) ;
-
visant à abaisser l’âge de la scolarisation obligatoire (10 novembre 2011 au Sénat), etc.
Un député pourrait soutenir une motion de rejet dont l’objet « est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (article 91 du règlement).
Les auteurs de la proposition de loi peuvent, quant à eux, trouver un avantage à ce que le débat se poursuive en commission sans aboutir, de manière à ce que le débat s’engage sur le texte de la PLL et non sur celui issu des travaux de la commission, ce qui est le cas lorsque « la commission ne s’est pas prononcée sur l’ensemble des articles du texte avant le début de l’examen en séance » (Cons. const., 24 oct. 2012, n° 2021-655 DC).
Si la majorité de la Commission supprimait l’article 1er de la PPL (qui abroge les 64 ans), la substance de cet article 1er ne pourrait être réintroduite en séance que par voie d’amendements. Il est probable que le président de la commission des finances persisterait à ne pas les déclarer irrecevables. La présidente de l’Assemblée pourrait alors opposer l’irrecevabilité financière à ces amendements en vertu de l’article 89, alinéa 3, du règlement.
Si le texte franchissait ces barrages, des amendements de suppression seraient alors débattus en séance. À les supposer rejetés, le gouvernement pourrait demander une deuxième délibération. À supposer ces nouvelles étapes surmontées, le texte sera transmis au Sénat. La base du droit applicable au regard de la recevabilité sera alors, certes, le texte transmis par l’Assemblée, mais l’irrecevabilité initiale ne sera pas purgée. À supposer que le Sénat, cohérent avec ses votes lors du débat sur la réforme des retraites, rejette ou modifie le texte, la proposition de loi sera en navette. La Première ministre pourra refuser d’inscrire à nouveau le texte à l’ordre du jour et il faudra qu’un groupe utilise à nouveau l’ordre du jour réservé pour tenter une nouvelle adoption. La commission mixte paritaire (CMP) pourrait ne pas être convoquée et la navette se poursuivrait. Autre scénario possible : compte tenu des divergences entre les deux assemblées, la Première ministre (ou les présidents des deux assemblées par une démarche conjointe) convoquerait la CMP. Compte tenu de sa composition, la CMP produirait un texte ne comprenant pas l’abrogation des 64 ans. Et, au cours de la dernière lecture devant l’Assemblée, les amendements au texte de la CMP seraient à la discrétion du gouvernement. Troisième scénario possible : la CMP échoue et la navette reprend avec les mêmes aléas d’attente d’inscription à l’ordre du jour.
Si la loi était adoptée malgré tous ces obstacles et contenait une disposition impérative d’abaissement de l’âge légal de départ en retraite, la question serait inévitablement tranchée (en cas de saisine) par le Conseil constitutionnel, dès lors qu’est respectée l’exigence d’une contestation préalable (Cons. const., 20 juill. 1977, n° 77-82 DC et les décisions Cons. const., 25 juin 2009, n° 2009-581 DC et Cons. const., 25 juin 2009, n° 2009-582 DC, précitées).
Que veulent les auteurs de la proposition de loi (dont un signataire éminent sait tout de l’article 40 et ne peut donc nourrir aucun doute sur l’irrecevabilité financière de cette proposition) sinon maintenir la pression contre une loi promulguée ? Cela ne s’est jamais produit depuis 1958, comme en témoigne, par exemple, l’extinction de la contestation contre la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe.
Même si la question peut paraître technique, l’examen d’un dispositif abrogatif mais irrecevable porterait une nouvelle atteinte à la souveraineté du législateur en décrédibilisant son aptitude à l’autocontrôle. Bien entendu, il serait facile de faire porter au gouvernement la responsabilité de l’échec de la PPL. Il serait également aisé, politiquement, de dénoncer une censure du Conseil constitutionnel, alors même que celui-ci, juridiquement, ne pourrait s’éloigner ni du texte de la Constitution, ni du constat de la carence des autorités, investies grâce au règlement d’une mission qu’elles refusent d’assumer… Quoi qu’il en soit la pratique consistant à admettre, au stade de leur dépôt, des PPL comportant des dépenses paraît fragilisée.
Quel regard le citoyen pourra-t-il porter sur des autorités parlementaires, qui, comme sous les IIIe et IVe Républiques, s’affranchiraient du respect de la Constitution, respect qui pourtant leur incombe ?
Référence : AJU009b2