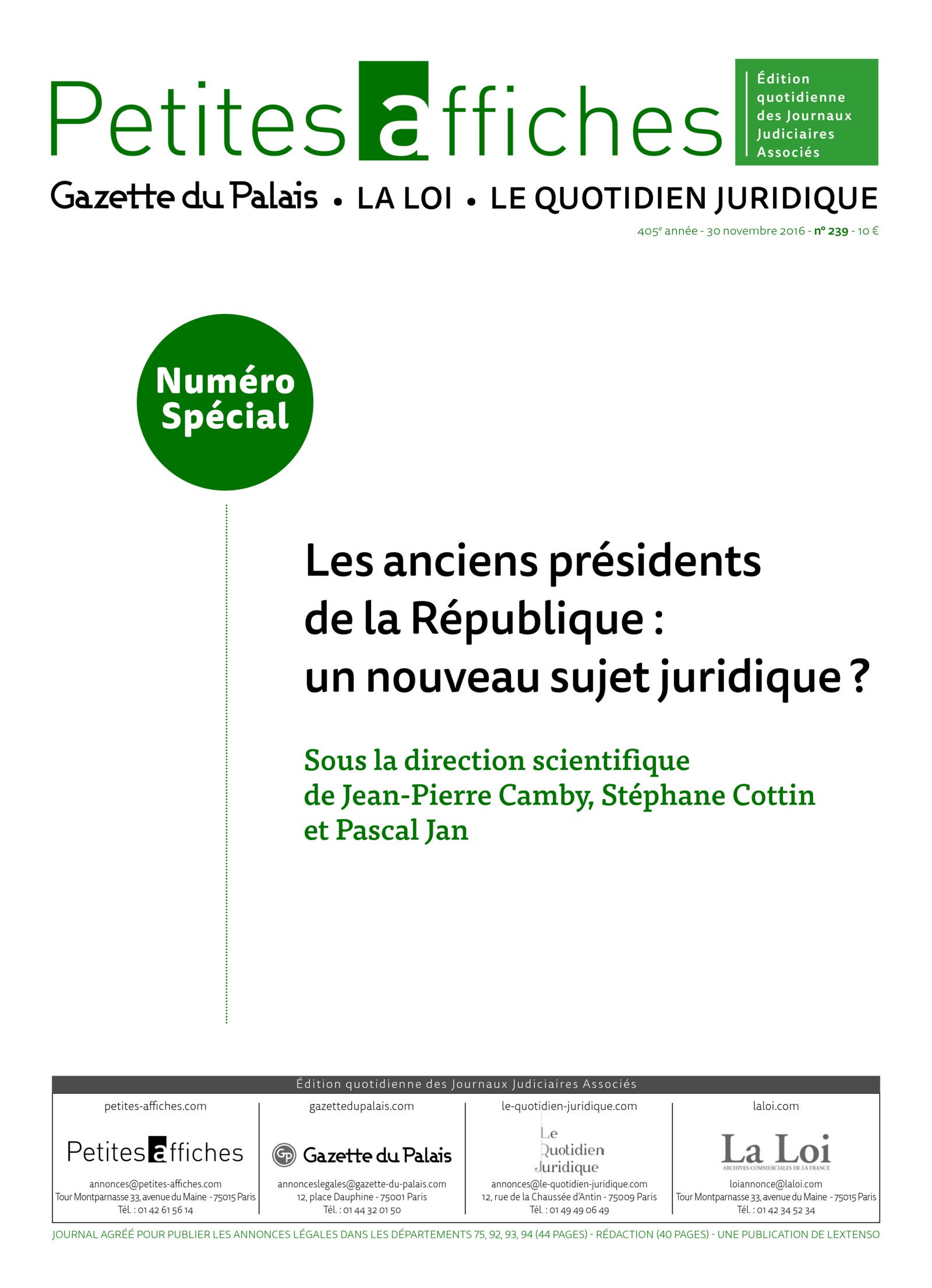Présidence arbitrale ou « présidence gouvernante », aux sources d’une vieille querelle républicaine
Le débat sur l’exercice de la fonction présidentielle est récurrent en France. Sous la IIIe et la IVe République, s’est imposée la conception d’un président arbitre impartial, écarté des tâches gouvernementales et dont la désignation du président du Conseil restait la principale prérogative. Pourtant, une autre conception de la magistrature suprême, celle d’une « présidence gouvernante », aurait pu, alors, prévaloir à travers une évolution de la pratique ou des textes constitutionnels. Si cela n’a pas été le cas, cette conception a largement inspiré la restauration de la fonction présidentielle après 1958.
« Leur rêve : un président ressemblant à René Coty ! Leur vision : un président cantonné à la politique étrangère et à la défense, un président otage des partis. Je suis pour un président qui exerce pleinement sa fonction au service du pays »1. Telle a été la réaction du président du Sénat, le gaulliste Gérard Larcher, aux propositions du rapport Refaire la démocratie du groupe de travail co-présidé par le président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone, et l’historien Michel Winock, qui préconise de « redéfinir le rôle du chef de l’État en accentuant et en modernisant son rôle d’arbitre, de réorienter le président de la République vers les enjeux du long-terme et d’en faire, avant tout, le garant des valeurs de la Nation »2.
L’exercice de la fonction présidentielle reste un sujet majeur du débat politique, même si les Français s’affirment majoritairement attachés à la présidence forte façonnée par la Ve République. Le chef de l’État doit-il gouverner ou seulement présider ? Ce débat est ancien. Il prend largement sa source aux débuts de la IIIe République quand la figure républicaine d’un chef de l’État en charge du pouvoir exécutif, Premier consul ou président de la IIe République, a cédé la place à un président « aussi proche que possible d’un monarque parlementaire »3. Sous les IIIe et IVe Républiques en effet, s’est imposée la figure d’un président « arbitre suprême et dont tout le monde reconnaî(t) la haute impartialité »4, tenant la balance égale entre tous les partis, « un surveillant et un conseiller »5 qui « n’a été choisi, ni comme représentant d’un groupe, ni comme défenseur d’une doctrine particulière », selon la définition donnée par Raymond Poincaré, titulaire de la fonction entre 1913 et 1920. Il ne pouvait, donc, y avoir de « politique de l’Élysée », comme l’annonçait Armand Fallières au soir de son élection en 19066. Les lois constitutionnelles de 1875, adoptées par des députés républicains et orléanistes qui avaient fait leurs premières armes, sous le Second Empire, en combattant le « pouvoir personnel », établissaient, en effet, un président doté de prérogatives importantes dans les textes, mais toutes soumises à la règle du contreseing ministériel, irresponsable politiquement et élu par les seuls parlementaires. La présidence fondatrice de Jules Grévy de 1879 à 1887 a, ensuite, définitivement consacré une conception purement arbitrale de la magistrature suprême, dont la IIIe et la IVe République ne s’écarteront pas.
Pourtant, depuis les travaux constituants de l’Assemblée nationale de 1871, une autre voie semblait possible. Le projet constitutionnel Thiers-Dufaure sur l’organisation des pouvoirs publics présenté le 19 mai 1873, qui n’a pas été discuté du fait de la démission de Thiers quelques jours après, dessinait une autre figure de l’institution présidentielle. Celle d’un président directement en charge du pouvoir exécutif, élu pour cinq ans et rééligible par un congrès présidentiel formé des parlementaires mais aussi par des représentants des conseils généraux, afin de lui assurer une « véritable indépendance »7 et ne pas en faire le simple « délégué » des assemblées. Sa responsabilité politique serait « réelle » en ce qui concerne les « actes de gouvernement » et ce président serait admis à intervenir lui-même, le cas échéant, dans l’enceinte des assemblées, en sus de ses ministres. Surtout, pour la première fois dans une constitution républicaine, le chef d’État pourrait prendre l’initiative de demander au Sénat l’autorisation de dissoudre la chambre populaire. C’est donc bien la conception d’une « présidence gouvernante »8 que retenait ce projet constitutionnel « mort-né ». Cheminant plus ou moins souterrainement, à contre-courant de la doxa de la présidence arbitrale, cette conception a inspiré, dans la pratique et leurs projets, tous les réformateurs de la IIIe et de la IVe République soucieux de restaurer la fonction et l’autorité présidentielles dans une République parlementaire, avant de s’imposer aux premiers temps de la Ve République.
I – La présidence arbitrale consacrée sous la IIIe et la IVe République
A – Le « moment » Grévy, fondateur de la présidence arbitrale
« On sait toute l’importance au début de tout régime des premières décisions : elles déterminent l’avenir des institutions qui prennent alors, comme un vêtement, un pli qui ne s’effacera plus »9. La présidence de Jules Grévy entre 1879 et 1887 a été le « moment » fondateur de la conception arbitrale de la présidence de la République sous la IIIe et la IVe République. Président de la chambre des députés, Jules Grévy est élu à la magistrature suprême, le 30 janvier 1879. Il inaugure la longue liste des présidents d’assemblée portés à l’Élysée, onze en tout sur les dix-sept présidents de la République élus entre 1879 et 1953. Habitués à exercer une autorité morale et impartiale, à dire le droit sans prendre position sur le fond du débat, ces présidents d’assemblée apparaissent, en effet, comme les plus aptes à incarner la fonction présidentielle imaginée par les constituants de 1875 ou de 1946. À travers leur élection, c’est bien le Parlement en personne qui entre à l’Élysée et surtout pas un homme de gouvernement ou un chef de parti porteur d’un programme d’action bien déterminé.
De façon singulière, le premier véritable républicain à exercer la magistrature suprême était un de ceux qui, en 1848, s’étaient le plus vigoureusement opposés à l’instauration d’un président de la République, préconisant, dans le célèbre amendement Grévy, la désignation par l’Assemblée d’un simple chef du pouvoir exécutif révocable par elle à tout moment. En 1879, « ne pouvant supprimer lui-même, [Jules Grévy] va désarmer l’institution »10. Il annonce, son message inaugural aux assemblées du 6 février 1879, qu’il se soumettra toujours à la « volonté nationale » exprimée par les seules assemblées, ne mettant jamais en œuvre le droit de dissolution. C’est la « constitution Grévy »11, cet usage respecté par tous ses successeurs, l’acte de naissance de ce « parlementarisme absolu », décrit par Carré de Malberg, marqué par un déséquilibre structurel entre les assemblées et le pouvoir exécutif. Le chef de l’État ne peut plus en appeler au peuple souverain pour surmonter les situations de blocage provoquées par le jeu des partis. Il en est lui-même l’otage.
Ayant renoncé à toute lecture dualiste des institutions de 1875, Jules Grévy va, cependant, fixer un champ très large à l’arbitrage présidentiel pour ce qui est de la prérogative majeure restant au chef de l’État, celle de la désignation du président du Conseil. En se refusant à appeler Gambetta en 1879, alors que ce dernier est, à ce moment, le chef naturel du parti républicain, en laissant ses proches mener une guérilla permanente contre Jules Ferry12, président du Conseil de 1883 à 1885, en préférant, souvent, nommer des personnalités de second plan à la tête de ministères de concentration républicaine, Grévy a contribué activement à empêcher l’affirmation en France d’un véritable leadership ministériel de la majorité sur le modèle parlementaire britannique.
Enfin, c’est sous la présidence Grévy, à l’occasion de la crise présidentielle de novembre 1887, que se met en place une révocabilité indirecte par les chambres d’un chef de l’État, pourtant irresponsable politiquement. Éclaboussé par le scandale des décorations, sans que sa probité puisse être mise en cause, Jules Grévy refuse de démissionner, malgré les pressions émanant de tous les partis. En faisant tomber le gouvernement en place et en organisant une « grève des ministères », les principaux chefs politiques refusant de former un nouveau gouvernement, les députés contraignent Grévy à se retirer in fine. Ce précédent de 1887 devait être utilisé à nouveau en 1924 contre le président Millerand.
B – L’exercice courant de la présidence arbitrale
Sous la IIIe et la IVe République, le président ne gouverne pas, il préside. Dans un vieux pays marqué par son passé monarchique, le chef de l’État incarne et personnifie la République. Il préside aux solennités nationales. Ainsi que le souligne le président Loubet, « le président doit se renfermer dans son irresponsabilité constitutionnelle en ce qui concerne les mesures gouvernementales et s’abstenir de tout acte personnel »13. Ainsi, de nombreuses prérogatives gouvernementales attribuées au chef de l’État par les lois constitutionnelles de 1875 : l’initiative législative concurremment avec les chambres, le pouvoir de nomination à tous les emplois civils et militaires, l’exercice du pouvoir réglementaire notamment, prérogatives toutes soumises à la règle du contreseing, ont été très rapidement aspirées et exercées en pratique par le cabinet responsable devant les chambres. La Constitution de 1946 fera, d’ailleurs, passer ces prérogatives, nominalement, au président du Conseil. Même pour ce qui est des Affaires étrangères, dans lequel les présidents Grévy, Loubet ou Poincaré en particulier, ont pu jouer un rôle important, ils ne pourront le faire qu’en plein accord avec le président du Conseil et toujours en lien étroit avec le ministère des Affaires étrangères, lesquels répondent devant les assemblées des mesures prises en la matière. Le président ne gouverne pas et n’exerce donc que les droits que Bagehot reconnaît au souverain d’une monarchie parlementaire : le droit de savoir, d’encourager et d’avertir. Ce que Louis Barthou, président du Conseil en 1913 et plusieurs fois ministre, qualifie de « conseils agissants »14. Ce rôle fluctue, d’ailleurs, selon la personnalité, l’expérience politique et l’habileté des locataires de l’Élysée.
Le président de la République est d’abord, et surtout, le régulateur du jeu constitutionnel. Face aux turbulences de la vie politique, à l’instabilité gouvernementale, élu pour sept ans, il est celui qui demeure. Il est l’arbitre impartial de la vie parlementaire, un arbitre que son mode d’élection par les parlementaires et la neutralisation du droit de dissolution ne permettent pas d’être un arbitre véritablement au-dessus des partis.
Inauguré par Grévy, l’arbitrage actif du chef de l’État pour la désignation du président du Conseil sous la IIIe République ou du président du Conseil pressenti soumis au vote d’investiture de l’Assemblée nationale sous la IVe République reste sa prérogative la plus importante. À l’inverse du monarque britannique auquel le choix du Premier ministre est imposé par les effets de la loi électorale et du bipartisme de gouvernement, le président français bénéficie d’une réelle liberté pour désigner ou écarter tel ou tel postulant à la présidence du Conseil du fait du multipartisme français et de l’instabilité ministérielle inhérente au régime. Amené à interpréter le sens des crises ministérielles et à discerner leurs solutions potentielles : replâtrage du cabinet, nouvelle majorité ou ministère de concentration, le président de la République est bien le grand mécanicien du régime parce que « c’est un fait bien connu que les parlements modernes recèlent non pas une mais deux ou trois majorités éventuelles »15 entre lesquelles il appartient au président de choisir.
Le choix de Grévy de ne pas appeler Gambetta en 1879, ceux de Loubet en 1899, en pleine crise dreyfusiste, de nommer Waldeck-Rousseau ou de René Coty de préférer Guy Mollet à Pierre Mendès France en 1956 auront des conséquences majeures sur l’évolution du régime. Plusieurs présidents de la République ont été, ainsi, des virtuoses de l’arbitrage, Félix Faure levant l’hypothèque radicale en 1895 pour assurer la stabilité ministérielle jusqu’à la fin de la législature ou Vincent Auriol inventant littéralement Antoine Pinay en 1952. Sous la IVe République, après avoir failli être supprimée en 1946, la fonction présidentielle a, en effet, retrouvé un rôle arbitral particulièrement actif grâce à Vincent Auriol16. Élu après 13 tours d’élections en 1953, René Coty exercera sa fonction de manière plus discrète17, mais déterminante dans la résolution de la crise de mai 1958.
II – La « présidence gouvernante » occultée sous la IIIe et la IVe République
A – L’expérience Millerand, mise en œuvre avortée de la « présidence gouvernante »
Soucieux à son entrée en fonction de « ne laisser ni méconnaître, ni prescrire les droits que la Constitution [lui] confère »18 et se concevant comme un président actif davantage que comme un simple arbitre19, Jean Casimir-Perier ne restera à l’Élysée que six mois, constamment en butte à l’hostilité des ministres eux-mêmes et d’une partie des milieux parlementaires. C’est donc principalement la pratique présidentielle d’Alexandre Millerand aux débuts des années 1920 qui constitue une expérience concrète de « présidence gouvernante » dans le cadre institutionnel fixé par les lois constitutionnelles de 1875.
À la suite à la démission précipitée de Paul Deschanel le 21 septembre 1920, Alexandre Millerand, président du Conseil, est porté à l’Élysée par une confortable majorité en toute connaissance de cause20. Depuis son discours du Ba-Ta-Clan pendant la campagne électorale de 1919, chacun sait, en effet, Millerand partisan d’une restauration de la fonction présidentielle, y compris par le biais d’une révision constitutionnelle. Avant l’élection, il a d’ailleurs pris soin de publier un communiqué précisant ses conceptions : « Le président de la République, s’il ne doit pas être l’homme d’un parti, doit être l’homme d’une politique arrêtée et appliquée en étroite collaboration avec ses ministres »21.
La révision constitutionnelle s’avérant impossible en l’état, Millerand va « s’efforcer d’user des pouvoirs présidentiels tels que les déterminait la Constitution de la manière la plus efficace »22. Au lendemain de son élection, il impose ainsi une nouvelle pratique présidentielle, reconduisant intégralement les ministres du gouvernement qu’il présidait, appelant à leur tête son ami Georges Leygues, prenant l’habitude d’étudier quotidiennement les dossiers avec les ministres, voire parfois les hauts fonctionnaires, en priorité les dossiers des Affaires étrangères, de la Guerre et de la Marine ou convoquant les préfets à l’Élysée. Il est même sollicité pour arbitrer, en conseil des ministres, les différends entre les ministres23. En rupture avec tradition de neutralité présidentielle suivie depuis Grévy, Millerand prend également l’habitude dans les discours prononcés au cours des voyages présidentiels, comme dans ses entretiens publiés dans la presse, d’exprimer ses idées personnelles sur la politique du pays sans en avertir préalablement le Gouvernement et son chef.
Plusieurs points d’orgue émaillent cette présidence active. En janvier 1922, les prises de position et les mises en garde officielles de Millerand au moment de la conférence internationale de Cannes conduisent le président du Conseil, Aristide Briand, excédé, à démissionner. Toutefois, dans la République parlementaire, Millerand n’a pu agir ainsi que parce que ses positions étaient partagées par la majorité des deux assemblées. À l’automne 1923, à quelques mois des élections législatives, le chef de l’État prononce un discours retentissant à Évreux, le 14 octobre, en faveur de la politique gouvernementale et pour réaffirmer la nécessité d’une révision constitutionnelle. Le 26 mars 1924, alors que le ministère Poincaré a chuté à la chambre, Millerand indique que les grandes lignes de la politique gouvernementale ne doivent pas changer et qu’il ne saurait appeler au pouvoir un cabinet susceptible de les infléchir, reconduisant à son poste le président du Conseil. Les gauches s’élèvent à la chambre contre ce qu’elles considèrent comme une atteinte intolérable à la primauté absolue de la délibération parlementaire24.
Après sa victoire aux élections législatives du 11 mai 1924, le cartel des gauches renoue avec la technique de la « grève des ministères » pour contraindre Millerand à se retirer au motif qu’il avait « contrairement à l’esprit de la Constitution soutenu une politique personnelle »25. Millerand démissionne le 11 juin et son successeur, le président du Sénat Gaston Doumergue, réaffirme son attachement à la conception traditionnelle d’un « arbitre impartial et indiscuté » qui se situe « au-dessus des partis »26. Cette crise présidentielle de 1924 marque bien, comme le souligne alors Gaston Jèze, « l’échec définitif des tentatives (de “présidence gouvernante” …). En France, “le président préside mais ne gouverne pas”. Telle est l’interprétation donnée, une fois de plus, par la pratique »27.
B – La nécessité d’une révision constitutionnelle pour imposer la « présidence gouvernante »
L’échec de l’expérience Millerand l’a confirmé, établir une « présidence gouvernante » nécessitait bien une réforme constitutionnelle portant notamment sur le mode d’élection du chef de l’État, l’exercice effectif du droit de dissolution ou la responsabilité présidentielle, suivant les grandes lignes du projet constitutionnel Thiers-Dufaure. De Jean Casimir-Perier après son départ de la présidence28 au général de Gaulle sous la IVe République, en passant par les propositions du républicain conservateur Charles Benoist29, le projet de Constitution libérale de 1906 établi par l’Action Libérale Populaire (ALP)30 de Jacques Piou et Albert de Mun ou le révisionnisme d’Alexandre Millerand31, tous les réformateurs soucieux de restaurer la fonction présidentielle, voire de faire du président « réellement le chef du pouvoir exécutif »32, ont préconisé des réformes similaires.
Pour atteindre leur objectif, ces réformateurs proposaient d’abord, sur le modèle initialement prévu par le projet Thiers-Dufaure, de faire élire le chef de l’État par un collège associant parlementaires et représentants des collectivités locales. Il s’agissait de faire du président « l’expression de la France »33 ou « le premier représentant de la France »34 et non plus le simple « syndic des parlementaires »35. C’est la formule qui sera d’ailleurs retenue en 1958. Ces réformateurs entendaient, aussi, pour rééquilibrer les pouvoirs, donner au président de la République la plénitude du droit de dissolution en supprimant l’avis conforme du Sénat prévu par les textes constitutionnels de 1875. La dissolution interviendrait ainsi, véritablement, pour faire trancher par le peuple souverain un conflit entre le pouvoir exécutif et les assemblées. Ils entendaient confier ce droit de dissolution au chef de l’État, sans lui imposer de n’exercer cette prérogative qu’à la demande expresse du cabinet36. C’est bien au président de la République, et à lui seul, que la Constitution de la Ve République a confié l’exercice du droit de dissolution.
Le principe d’une responsabilité politique du chef de l’État a longtemps été inscrit dans la doctrine constitutionnelle républicaine. Le projet constitutionnel Thiers-Dufaure prévoyait cette responsabilité, une « responsabilité réelle »37, pour les « actes de gouvernement »38 du président de la République. Le député thieriste Ernest Duvergier de Hauranne a précisé les modalités concrètes que pourrait prendre la mise en œuvre de cette responsabilité présidentielle, à travers un vote conjoint des deux chambres. En cas de conflit avec la seule chambre populaire, mais soutenu par le Sénat, le président pourrait se maintenir, voire, si le conflit devait s’aggraver, prononcer, sous réserve de l’accord du Sénat, la dissolution de la chambre39. Casimir-Perier reprendra cette idée40, trente ans plus tard, en soulignant que c’est en inscrivant dans la Constitution le principe de l’irresponsabilité présidentielle que l’on a réduit le président à l’impuissance : « Supprimer la responsabilité, c’est nécessairement supprimer l’action »41. Benoist ou Millerand n’écriront pas sur cette question, mais la pratique gaullienne a renoué avec cette idée de responsabilité efficiente du chef de l’État, par le biais de mécanismes contestés par les républicains au XIXe siècle : l’élection présidentielle au suffrage universel et le référendum.
« Présidence gouvernante », présidence arbitrale, le débat est toujours prégnant. Le rapport de force entre les deux conceptions s’est inversé depuis 1958. Mais rien n’est jamais définitivement acquis dans un pays qui a déjà vécu sous l’empire d’une dizaine de constitutions successives.
Notes de bas de pages
-
1.
Entretien au Journal du Dimanche, 4 oct. 2015.
-
2.
Bartolone C. et Winock M., Refaire la démocratie, 2016, Thierry Marchaise, p. 111.
-
3.
Morabito M., Le chef de l’État en France, 2e éd., 1996, Montchrestien, Clefs, p. 92.
-
4.
Poincaré R., « Chronique de la quinzaine », Revue des Deux Mondes, 15 juin 1920, p. 931.
-
5.
Poincaré R., « Chronique de la quinzaine », Revue des Deux Mondes, 15 mars 1920, p. 471.
-
6.
Cité par Tardieu A., La profession parlementaire, 1937, Flammarion, p. 220.
-
7.
Exposé des motifs du projet sur l’organisation des pouvoirs publics, JO, 20 mai 1873, p. 3208. Les extraits cités infra sont tirés de ce texte.
-
8.
Girard L., « Une Constitution mort-née : le projet de loi sur les pouvoirs publics de mai 1873 », in « Études européennes », Mélanges offerts à V.-L. Tapie, 1973, Publications de la Sorbonne, p. 544.
-
9.
Rémond R., La République souveraine, la vie politique en France 1879-1939, 2002, Fayard, p. 90.
-
10.
Prélot M., Précis de droit constitutionnel, Dalloz, p. 232.
-
11.
Ibid.
-
12.
Gatulle J., Du rôle effectif du chef de l’État sous la Troisième République, thèse de droit soutenue le 12 mai 1959 à l’université de Paris, p. 206.
-
13.
Lettre du 27 févr. 1904 au Pape Pie X, citée par Gatulle J., préc. cit., p. 81.
-
14.
Barthou L., Le politique, 1923, Hachette, p. 121.
-
15.
Burdeau G., Le régime parlementaire dans les Constitutions européennes, 1933, Editions internationales, p. 322.
-
16.
V. les riches développements sur ce point du maître ouvrage de Roussellier N., La force de gouverner, Le pouvoir exécutif en France XIXe-XXe siècles, 2015, Gallimard, p. 278 et s.
-
17.
de Baecque F., René Coty, tel qu’en lui-même, 1990, STH, p. 185.
-
18.
Journal Officiel des débats parlementaires, séance du 3 juill. 1894, p. 1153.
-
19.
V. l’intro. d’Elina Lemaire à Casimir-Perier J., préc. cit., p. 26.
-
20.
V. Hauriou M., Précis de Droit constitutionnel, 1923, Sirey, p. 394.
-
21.
Communiqué du 20 sept. 1920, repris dans RDP 1920, p. 575.
-
22.
Millerand A., Souvenirs inédits, Fonds Millerand aux Archives nationales, 470AP, carton 1, p. 102.
-
23.
Sur ces points, v. Jèze G., « Chronique constitutionnelle de France », RDP 1920, p. 585 et s.
-
24.
V. Jèze G., « Chronique constitutionnelle de France », RDP 1924, p. 246.
-
25.
Texte de la motion commune adoptée par les députés du cartel le 1er juin 1924, repris dans Bonnefous E., Histoire politique de la Troisième République, t. IV, « Cartel des gauches et union nationale (1924-1929) », p. 9.
-
26.
Messages aux chambres du 17 juin 1924, cité par Jèze G in « Chronique constitutionnelle de France », RDP 1924, p. 473.
-
27.
Jèze G., « Chronique constitutionnelle de France », RDP 1924, p. 248.
-
28.
V. à cet effet ses textes récemment retrouvés et publiés : Casimir-Perier J., Notes sur la Constitution de 1875, intro. par Lemaire E., 2015, Dalloz.
-
29.
Benoist C., Un programme, 1902, Plon et La réforme parlementaire, 1914, Plon, p. 45 not.
-
30.
Janet-Vendroux E., thèse inédite sur Jacques Piou et l’Action libérale populaire (1901-1914), dirigée par Le Béguec G. et soutenue à l’université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, le 29 juin 2012, p. 699 et s.
-
31.
Millerand A., Discours prononcé à Ba-Ta-Clan le 7 novembre 1919, Imprimerie Le Papier, 1919 ou « En attendant une Constitution », La Revue de Paris, 1930, p. 721 et s.
-
32.
Casimir-Perier J., Notes sur la Constitution de 1875, op. cit., p. 86.
-
33.
Ibid.
-
34.
Millerand A., Discours de Ba-Ta-Clan, op. cit., p. 10.
-
35.
Ibid.
-
36.
Conformément à la pratique britannique ou aux propositions d’autres réformateurs constitutionnels des années 1930 tel André Tardieu.
-
37.
JO du 20 mai 1873, Exposé des motifs du texte, p. 3208.
-
38.
Ibid, art. 14 du projet, p. 3209.
-
39.
Duvergier de Hauranne E., La République conservatrice, 1873, Germer-Baillière, p. 274.
-
40.
Casimir-Perier J., op. cit., p. 82.
-
41.
Ibid, p. 70.