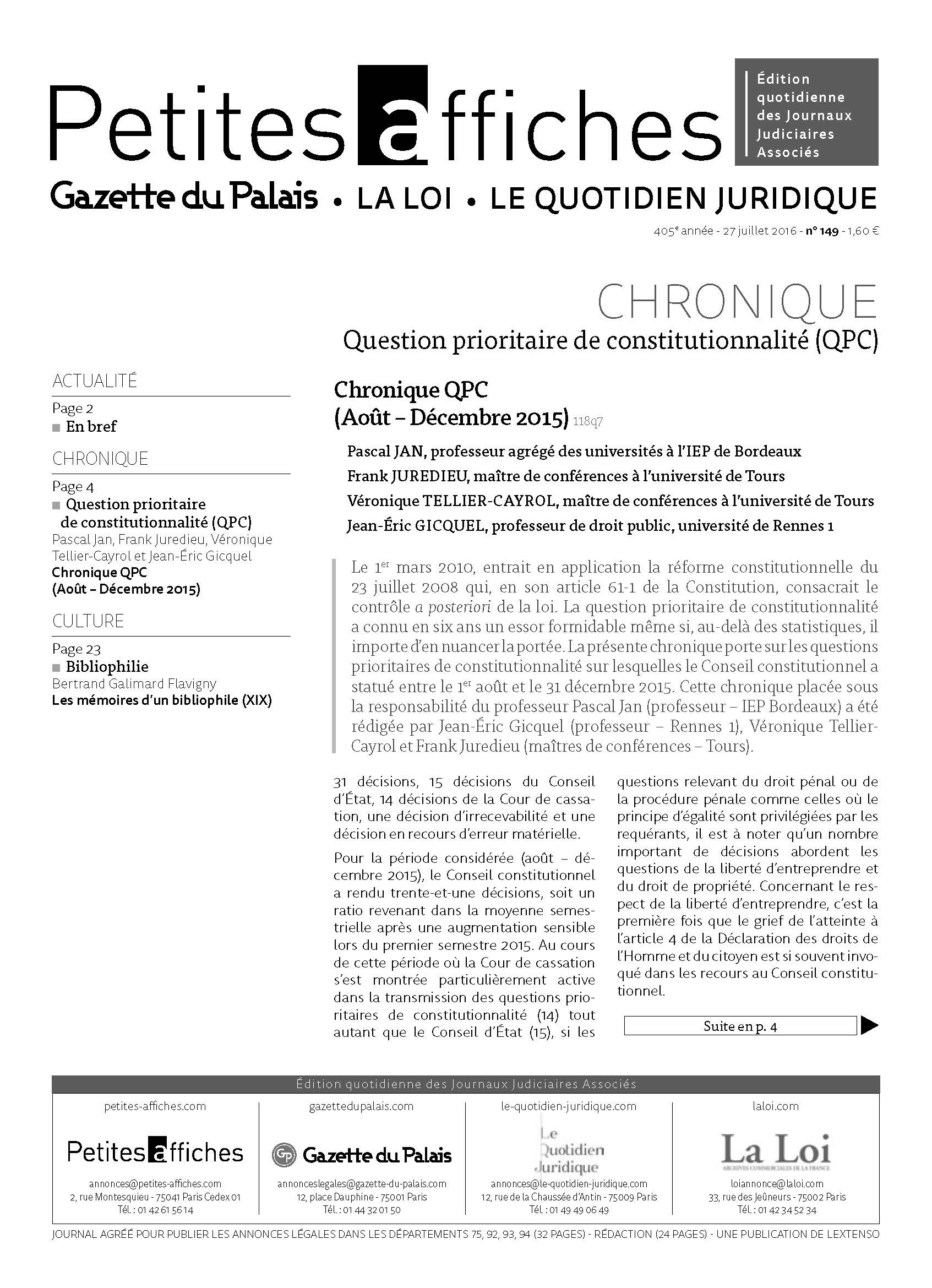Chronique QPC (Août – Décembre 2015)
Le 1er mars 2010, entrait en application la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui, en son article 61-1 de la Constitution, consacrait le contrôle a posteriori de la loi. La question prioritaire de constitutionnalité a connu en six ans un essor formidable même si, au-delà des statistiques, il importe d’en nuancer la portée. La présente chronique porte sur les questions prioritaires de constitutionnalité sur lesquelles le Conseil constitutionnel a statué entre le 1er août et le 31 décembre 2015. Cette chronique placée sous la responsabilité du professeur Pascal Jan (professeur – IEP Bordeaux) a été rédigée par Jean-Éric Gicquel (professeur – Rennes 1), Véronique Tellier-Cayrol et Frank Juredieu (maîtres de conférences – Tours).
Cons. const., 7 oct. 2015, no 2015-488 QPC, M. Jean-Pierre E.
Cons. const., 7 oct. 2015, no 2015-486 QPC, M. Gil L.
Cons. const., 14 oct. 2015, no 2014-489, Sté Grands Moulins de Strasbourg SA et a.
Cons. const., 31 juill. 2015, no 2015-477 QPC, M. Jismy R.
Cons. const., 16 oct. 2015, no 2015-492 QPC, Asso. Communauté rwandaise de France
Cons. const., 8 janv. 2016, no 2015-512 QPC, M. Vincent R.
Cons. const., 4 déc. 2015, no 2015-506 QPC, M. Gilbert A.
Cons. const., 20 nov. 2015, no 2015-499 QPC, M. Hassan B.
Cons. const., 25 sept. 2015, no 2015-485 QPC, M. Johny M.
Cons. const., 14 oct. 2015, no 2015-490 QPC, M. Omar K.
Cons. const., 22 déc. 2015, no 2016-527 QPC, M. Cédric D.
Cons. const., 19 févr. 2016, nos 2016-535 QPC et 2016-536 QPC, Ligue des droits de l’Homme
31 décisions, 15 décisions du Conseil d’État, 14 décisions de la Cour de cassation, une décision d’irrecevabilité et une décision en recours d’erreur matérielle.
Pour la période considérée (août – décembre 2015), le Conseil constitutionnel a rendu trente-et-une décisions, soit un ratio revenant dans la moyenne semestrielle après une augmentation sensible lors du premier semestre 2015. Au cours de cette période où la Cour de cassation s’est montrée particulièrement active dans la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité (14) tout autant que le Conseil d’État (15), si les questions relevant du droit pénal ou de la procédure pénale comme celles où le principe d’égalité sont privilégiées par les requérants, il est à noter qu’un nombre important de décisions abordent les questions de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété. Concernant le respect de la liberté d’entreprendre, c’est la première fois que le grief de l’atteinte à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen est si souvent invoqué dans les recours au Conseil constitutionnel. Ce fait est à mettre en relation avec la prolifération des dispositions législatives de ces dernières années à objet économique et financier. Elle se traduit, en terme contentieux, par un nombre d’affaires initié majoritairement pour la période concernée par des personnes morales, ce qui fait de la QPC un instrument désormais autant actionné par les entreprises et les associations que par les personnes physiques. En effet, au cours de ce second semestre 2015, sur les vingt-neuf décisions émanant des juridictions suprêmes, près de la moitié ont pour requérantes des personnes morales. Outre la liberté d’entreprendre, la recherche du respect des principes d’égalité et d’égalité devant les charges publiques motivent ces saisines, ce qui ne constitue nullement cette fois-ci une nouveauté. Sur le respect de ces derniers principes, le Conseil constitutionnel est toujours autant sollicité. Le Conseil constitutionnel n’a pas eu à connaître de transmission automatique fondée sur l’article 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 qui dispose : « Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel ». En revanche, il a de nouveau été saisi directement par un particulier, en méconnaissance de la législation organique sur l’organisation des questions prioritaires de constitutionnalité et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. La clarté de la réponse apportée par la QPC n° 491 dans des termes semblables à la QPC n° 440 est de nature à limiter la multiplication de ces requêtes. Par ailleurs, faisant preuve de détermination, le requérant dont la requête a été déclaré irrecevable s’est également vu infliger une décision de rejet cinglante d’une demande de recours en erreur matérielle : « Considérant que, par sa décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015 susvisée, le Conseil constitutionnel a rejeté comme irrecevable la demande de M. Pierre G. relative à l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité en relevant que le Conseil d’État avait rendu une ordonnance de non admission sur le pourvoi de M. G. à l’occasion duquel il contestait le refus de la cour administrative d’appel de Bordeaux de transmettre cette question et que l’instance à l’occasion de laquelle la question avait été posée était éteinte / 2. Considérant, d’une part, que la mention, dans la décision dont la rectification est demandée, de la date de l’enregistrement, le 17 juillet 2015, de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le requérant au Conseil constitutionnel n’est pas entachée d’erreur matérielle ; que, d’autre part, en contestant les motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel a jugé ses conclusions irrecevables, le requérant ne demande pas la rectification d’une erreur matérielle ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être rejetée ».
Sur le sens des décisions QPC, outre les décisions d’irrecevabilité et de rejet d’une demande de correction d’une erreur matérielle à l’instant évoquées, il y a lieu de constater que les décisions d’invalidations se situent dans la moyenne constatée depuis le début de la mise en place des QPC. En effet, on dénombre trois décisions de non-conformité partielle, sept décisions de non-conformité totale, quatre décisions de conformité sous réserve, le reste des décisions étant de pure conformité. Le nombre de censure totale est exceptionnellement élevé par rapport à la moyenne semestrielle établie depuis 2010. Le non-respect de l’article 16 de la Déclaration de 1789 est principalement concerné, ce qui renforce les contraintes qui pèsent sur le législateur afin qu’il respecte au plus près les exigences liées au droit des recours et donc aux droits des personnes de contester les décisions négatives à leur encontre.
I – Le procès constitutionnel
Le mandat du président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, s’achève donc sur un resserrement des contraintes qui pèsent sur la loi. Mais s’agissant du procès proprement dit, la période étudiée ne comporte guère d’innovations majeures. En premier lieu, notons que saisi d’une QPC contestant l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le Conseil constitutionnel a statué dans un délai record de onze jours, prouvant non seulement sa capacité à réagir rapidement à une situation exceptionnelle pour sécuriser non seulement les opérations de prévention de désordre public mais également pour répondre aux attentes des citoyens désireux de sécurisation juridique en période troublée1. En second lieu, si les abstentions de conseillers sont toujours d’actualité mais demeurent en nombre très acceptable, de nouveau se pose la question de la composition du Conseil constitutionnel. La prochaine chronique reviendra sur ce point, avec la nomination comme président du Conseil constitutionnel de Laurent Fabius qui pourrait bien commencer son mandat avec comme problème celui de répondre aux exigences de l’impartialité du procès constitutionnel. Quoi qu’il en soit, on réitérera ici notre interrogation : sans qu’il soit opportun de contraindre les autorités de nomination des membres du Conseil constitutionnel, l’opportunité de désigner en dehors de tout quorum des anciens parlementaires ou ministres qui prennent une part active à la législation et qui se trouvent parmi les premiers à s’abstenir de siéger doit-elle prendre fin ?
Sur sa méthode de juger, le Conseil a de nouveau actionné son droit de soulever d’office un grief d’inconstitutionnalité, conformément à ce que lui reconnaît l’article 7 du règlement de procédure du 4 février 2010 au terme duquel « les griefs susceptibles d’être relevés d’office sont communiqués aux parties et autorités mentionnées à l’article 1er pour qu’elles puissent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti ». Dans la décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015, une association contestait la constitutionnalité d’une disposition législative relative à la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A. Elle arguait de l’inconstitutionnalité du dispositif législatif au motif de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre. Sur ce point, le Conseil constitutionnel lui donne partiellement raison. Mais la décision est intéressante surtout en ce que le juge relève d’office le moyen tiré de la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence. Étonnant car l’on sait que le Conseil considère que « la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit »2. Il ne s’agit donc pas en l’espèce d’une violation directe d’un droit comme c’est le cas traditionnellement le cas lorsque le Conseil use de son pouvoir de l’article 7 du règlement de procédure. Étonnant également, car la décision conclut à la pleine constitutionnalité de la disposition au regard de l’article 34 de la Constitution. Il faut voir dans cette espèce peut-être le début d’une évolution de la politique jurisprudentielle du Conseil afin d’étendre plus fréquemment son contrôle à ce type de grief. Une fois encore, au-delà de la solution retenue par le juge on ne peut que s’interroger sur l’opportunité du Conseil de soulever de tels griefs non censurés et donnant lieu à aucune interprétation alors que dans le même temps il se refuse de relever d’autorité des dispositions d’un article de loi qui n’ont pas été expressément contestées devant lui et qu’il continue à circonscrire restrictivement et de façon régulière le champ des QPC transmises3. Sur ce dernier point, la pédagogie du Conseil à l’égard des juridictions suprêmes n’a toujours pas produit les effets escomptés.
S’agissant du champ des droits et libertés garantis par la Constitution au sens de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel refuse toujours de se prononcer sur la portée constitutionnelle du principe de précaution mentionné à l’article 5 de la Charte de l’environnement4. Dans sa saisine du 17 juin 2015, le Conseil d’État indique pourtant que « le moyen tiré (…) notamment de qu’elles portent à la liberté d’entreprendre une atteinte non justifiée par le principe de précaution énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement, soulève une question relative à la portée de cette disposition constitutionnelle, s’agissant de mesures de suspensions comme celle qui est en cause ; que cette question doit être regardée comme nouvelle ». Le Conseil s’est retranché derrière l’objectif de la QPC qui portait principalement sur l’atteinte à la liberté d’entreprendre et non au principe de précaution invoqué à l’appui de la violation alléguée.
Il convient de noter qu’aucune allusion n’est faite au principe de précaution dans la décision. Les observations que l’on formule s’appuient sur les détails du commentaire de la décision. Alors que l’information est en soi pertinente car s’appuyant sur la décision de transmission du Conseil d’État, il conviendrait à l’avenir dans un souci de plus grande transparence du procès constitutionnel que les décisions QPC reproduisent la motivation de la transmission des QPC par les juridictions suprêmes qui ne saurait se retrouver exclusivement dans les commentaires officiels du Conseil constitutionnel. Le laconisme jurisprudentiel dans l’écriture de la décision se retrouve s’agissant du respect de certains principes, comme celui du respect de la dignité de la personne humaine5 ou encore de la justiciabilité de l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 19466, même si ce faisant il confirme leur appartenance à la catégorie des droits et libertés que la Constitution garantit au sens de l’article 61-1 de la Constitution, ce dont on ne doutait guère. De toutes ces observations, il résulte l’impérieuse nécessité pour le Conseil d’améliorer la rédaction de ces décisions. C’est une question de clarté, de transparence et gage de respectabilité et d’autorité de ses décisions.
Pascal Jan
II – La jurisprudence
A – QPC transmises par la Cour de cassation
1 – Droit de la famille
Indemnité exceptionnelle accordée à l’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé
Cons. const., 7 oct. 2015, n° 2015-488 QPC, M. Jean-Pierre E. Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation7 renvoyait une QPC relative à l’indemnité de l’ancien article 280-1 du Code civil, abrogé par la loi du 26 mai 2004. Cet article préfigure l’objectivation du divorce pour faute qui sera retenue par la réforme de 2004. Certes, dans l’esprit du législateur de 1975, le divorce pour faute est perçu comme une sanction à l’encontre de l’époux coupable, lequel ne peut obtenir de prestation compensatoire en vertu de l’alinéa premier de l’article 280-1 dans sa version antérieure à 2004. Néanmoins, la culpabilité de l’époux aux torts duquel le divorce est prononcé n’exclut pas toute compensation à son égard : l’alinéa 2 dispose qu’« à titre exceptionnel » une indemnité peut être versée « si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l’autre époux, il apparaît manifestement contraire à l’équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ». La Cour de cassation a fixé le régime de cette compensation dans une décision du 26 avril 19908 en précisant que l’indemnité fixée sous forme de rente n’était pas révisable.
Dans l’affaire qui a donné lieu à la QPC, l’époux non-fautif avait été condamné en 1994 à payer l’indemnité de l’ancien article 280-1 sous forme d’une rente mensuelle. Près de vingt ans après cette condamnation, désormais âgé de 70 ans et éprouvant les plus grandes difficultés à verser la rente, celui-ci demande sa révision. Les juges du fond, reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation, rejettent la demande au motif que cette rente obéit à un régime distinct de celui de la prestation compensatoire et n’est donc pas révisable. La QPC portait ainsi sur l’interprétation faite sur ce texte par la Cour de cassation et, plus précisément, sur les rapports existant entre l’indemnité de l’article 280-1 et la prestation compensatoire. Le requérant soutenait que « la différence de traitement résultant de ce qu’une indemnité exceptionnelle ne peut, contrairement à une prestation compensatoire, être révisée, méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi ».
L’injustice de la situation a sans doute pesé dans la décision de renvoi de la QPC. N’est-il pas en effet surprenant que le débiteur d’une prestation compensatoire bénéficie d’un sort plus favorable que le débiteur de l’indemnité exceptionnelle qui a pourtant obtenu le divorce aux torts exclusifs de son conjoint ? Alors que la prestation compensatoire versée à l’époux non fautif est révisable, la rente versée à l’époux fautif ne l’est pas ! Comme l’a souligné le requérant lors de l’audience, l’équité, pivot de l’article 280-1, devient ici source d’iniquité. Pour autant, et à l’aune de sa jurisprudence habituelle sur le principe d’égalité, le Conseil constitutionnel pouvait difficilement déclarer cet article contraire à la Constitution.
D’une part, la différence de traitement entre le débiteur d’une prestation compensatoire et le débiteur de cette indemnité exceptionnelle s’explique par une différence de situation. Le Conseil relève que, dans le cas de la prestation compensatoire, l’époux créancier est une personne qui ne s’est pas vue condamnée aux torts exclusifs au contraire du créancier de l’indemnité de l’article 280-1 du Code civil (cons. 8). D’autre part, « la différence de traitement ainsi instituée entre le débiteur de l’indemnité exceptionnelle et celui de la prestation compensatoire, en ce qui concerne la possibilité de révision de l’une et de l’autre lorsqu’elles sont fixées sous forme de rente, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (cons. 9). Là encore, l’affirmation n’est guère discutable dès lors que l’on se réfère aux critères de fixation des deux indemnités. L’article 271 du Code civil, relatif à la prestation compensatoire, impose non seulement d’apprécier la situation patrimoniale des époux à la date du divorce mais encore dans un avenir proche en tenant compte du patrimoine et des droits « prévisibles » des époux : la dimension prospective de la prestation explique le droit à révision de la rente viagère. L’indemnité exceptionnelle de l’article 280-1 obéit à des critères opposés, tournés vers le passé : les deux modes d’évaluation – la durée de la vie commune et la collaboration apportée à l’autre époux durant le mariage – sont connus et définitifs au jour du divorce et enferment logiquement l’indemnité de l’article 280-1 dans une même intangibilité. Si les évolutions législatives postérieures à la réforme de 1975 ont accentué la différence de traitement entre les débiteurs des deux compensations, le Conseil constitutionnel souligne qu’elles n’ont pas eu pour effet de priver cette différence de rapport direct avec l’objet de la loi qui l’a initialement établi « au regard de la nature distincte de ces deux créances consécutives au divorce » (cons. 11).
La différence de nature entre les deux indemnités constitue la clé de voûte de la décision du Conseil constitutionnel et mérite à ce titre quelques explications. La prestation compensatoire est selon l’article 270, « destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ». La finalité de l’indemnité est, en d’autres termes, de rétablir, dans une logique de distribution, un équilibre matériel rompu par le divorce9. Le rôle de l’article 280-1 du Code civil est tout autre puisque l’indemnité exceptionnelle a pour objet un retour au statu quo ante dans l’hypothèse où l’un des époux a bénéficié du travail non rémunéré de son conjoint. Autrement dit, la survenance d’un divorce rend le déplacement de valeur non causé et oblige l’époux bénéficiaire à restituer le gain obtenu. Ce double mouvement économique rappelle la notion d’enrichissement sans cause mais d’autres mécanismes voisins ont été proposés pour justifier l’indemnité de l’article 280-1, comme la gestion d’affaires10 ou encore le travail à salaire différé11. La qualification de quasi-contrat innomé12 exprime le mieux, à notre sens, la nature originale de l’indemnité qui participe de chacune des institutions citées tout en obéissant à des caractéristiques propres. L’ancien article 280-1 est à ce titre une illustration de la justice commutative, là où la prestation compensatoire relève « d’une philosophie de la justice distributive »13 et par conséquent des engagements qui résultent de l’autorité seule de la loi de l’article 1370 du Code civil. Cette différence de source, l’une légale, l’autre quasi-contractuelle, justifie la différence de régime critiquée par l’auteur de la QPC. Aussi injuste soit-elle, la décision du Conseil constitutionnel illustre cette réflexion tirée de la Comédie humaine : « Un homme peut avoir raison en équité, tort en justice, sans que le juge soit accusable »14.
Franck Juredieu
2 – Droit des affaires
Cession forcée des droits sociaux d’un dirigeant dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire
Cons. const., 7 oct. 2015, n° 2015-486 QPC, M. Gil L. Parmi les matières du droit des affaires, les procédures collectives constituent l’une des terres d’élection des QPC. Il est vrai que le livre VI du Code de commerce « heurte frontalement de nombreux intérêts »15 en sacrifiant tantôt les droits des créanciers, tantôt les droits des dirigeants ou encore ceux des propriétaires sur l’autel de la sauvegarde de l’entreprise. Paradoxalement, cet objectif primordial de redressement et les spécificités économiques qui en découlent sont aussi la cause principale de l’infortune des QPC devant le juge. À l’exception notable de la jurisprudence sur les saisines d’office16, les transmissions par la Cour de cassation tout comme les censures du Conseil constitutionnel demeurent relativement rares17. La décision du 14 octobre 2015 relative à l’article L. 631-19-1 du Code de commerce ne déroge pas à ce constat : le Conseil constitutionnel y fait prévaloir l’intérêt supérieur de la poursuite de l’activité de l’entreprise sur la préservation du droit de propriété des dirigeants.
La question contestait plus précisément l’alinéa 2 de cet article qui autorise le juge à ordonner la cession forcée des actions et parts sociales des dirigeants de la société mise en redressement judiciaire. Avant même l’introduction de cette QPC, certains auteurs s’étaient émus de la sévérité de cette mesure, assimilable selon eux à une expropriation des dirigeants18. L’argumentation de la QPC s’inspire de cette doctrine autorisée tout en l’adaptant à la typologie constitutionnelle des atteintes au droit de propriété, laquelle, rappelons-le, distingue les privations de propriétés soumises à l’article 17 de la Déclaration de 1789 des « simples » atteintes portées au droit de propriété régies par l’article 2 de cette même Déclaration. Le requérant affirme ainsi que la cession forcée de l’article L. 631-19-1 du Code de commerce institue « une privation de propriété injustifiée et disproportionnée ».
Cette QPC aurait pu être l’occasion de connaître la position du Conseil sur la nature juridique des cessions forcées : constituent-elles une expropriation au sens de l’article 17 de la Déclaration ? Assurément la mesure ne répond pas, au sens strict, à une nécessité publique19. Pas davantage l’existence d’une « juste et préalable indemnité » ne se vérifie puisque le transfert de propriété trouve sa contrepartie dans « le paiement d’un prix » pour reprendre les termes de l’article L. 631-19-1 du Code de commerce20. La présence d’un rapport d’obligation, d’une structure contractuelle typique d’une vente s’accorde mal avec l’origine judiciaire du transfert. Ne faut-il pas y voir une opération hybride, à mi-chemin entre la vente et l’expropriation ? Le Conseil constitutionnel évite soigneusement d’entrer dans ces considérations. Il écarte la privation de propriété au motif que le dirigeant qui détient des parts dans la société mise en redressement peut renoncer à l’exercice de ses fonctions et conserve ainsi la possibilité d’éviter la cession forcée de ces parts, titres ou valeurs.
Le raisonnement du Conseil constitutionnel, qui consiste à souligner la part de liberté dont dispose le dirigeant pour échapper à la cession forcée, nous semble plus habile que pleinement convaincant. Certes, la Cour de cassation a toujours admis que le dispositif ne s’appliquait pas au dirigeant démissionnaire lors de la période d’observation21. Est-ce à dire que l’existence de cette « porte de sortie » exclut la privation de propriété ? La mesure oblige tout de même les associés à choisir entre leur qualité de dirigeant et celle de propriétaire et il nous semble difficile de dire que le fait pour le dirigeant de conserver ses fonctions révèle corrélativement une volonté de sa part d’abandonner ses titres ou valeurs ! La cession se fait bien contre le gré du cédant à la suite d’une décision du tribunal. Dans une décision du 28 juillet 199822, le Conseil constitutionnel, confronté à une autre alternative – celle pour un créancier de devoir choisir entre l’abandon des poursuites contre son débiteur et l’acquisition forcée d’un bien –, avait retenu un raisonnement très différent ; il avait souligné le caractère contraignant du dispositif législatif en cause, l’atteinte à la liberté du consentement et en définitive la dénaturation du droit de propriété23. La décision du 7 octobre 2015 montre une nouvelle fois, après la décision sur la cession judiciaire de biens en exécution de la prestation compensatoire24, les réticences du Conseil constitutionnel à voir dans les transferts forcés des privations de propriété.
La seconde partie de la motivation, relative au respect de l’article 2 de la Déclaration de 1789, suit un déroulement classique. Pour établir la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété, le Conseil apprécie les conditions entourant la cession forcée de l’article L. 631-19-1 du Code de commerce.
Il relève ainsi l’existence d’une règle procédurale restreignant les possibilités de saisines du juge puisque la cession forcée ne peut être décidée qu’à la demande du ministère public. Cette garantie a été renforcée par la Cour de cassation afin que le dirigeant puisse utilement préparer sa défense. La requête du parquet doit en effet être présentée par écrit et dans le délai prescrit par l’article R. 631-34-1 du Code de commerce25.
Le Conseil constate également la double limitation du domaine de l’article L. 631-19-1. D’une part, la mesure ne s’applique qu’aux dirigeants de droit et de fait. La Cour de cassation s’en est toujours tenue à ce cadre strict : les associés, fussent-ils majoritaires, ne peuvent subir une cession forcée de leurs droits26. D’autre part, la mesure concerne uniquement la procédure de redressement judiciaire. Ce ne fut pas toujours le cas : jusqu’à l’ordonnance du 18 décembre 2008, la société mise en sauvegarde pouvait également bénéficier de cette cession forcée mais la mesure paraissait peu compatible avec le fait que la sauvegarde repose sur une initiative volontaire du dirigeant.
Surtout, le Conseil constitutionnel rappelle que la mise en œuvre du dispositif est subordonnée à la condition que « le redressement de l’entreprise le requiert ». Le but de la mesure n’est pas, en d’autres termes, de sanctionner le dirigeant mais de s’assurer de la réussite du redressement de la société. La généralité de la formule du Code de commerce permet d’accroître l’utilité du dispositif. L’intérêt premier de la mesure, celui auquel on pense immédiatement, est d’éviter que le dirigeant, une fois le plan adopté, n’empêche son exécution par un vote contraire de l’assemblée générale. Pourtant, la nécessité de la cession forcée dans ce cas peut se discuter : le tribunal ne dispose-t-il pas d’une autre option, moins attentatoire au droit de propriété, celle de nommer un mandataire chargé d’exercer le droit de vote du dirigeant27 ? En vérité, la cession forcée est surtout un moyen pour le tribunal d’assurer le transfert de contrôle de la personne morale, en permettant par exemple à un tiers d’entrer dans le capital de la société28. L’éviction du dirigeant apparaîtra alors comme une condition de réussite de la restructuration29.
Compte tenu de l’intérêt que présente l’article L. 631-19-1 du Code de commerce, la décision de conformité n’est pas une surprise. Elle l’est d’autant moins que la décision récente n° 2015-715 DC du 5 août 2015 avait déjà jugé conforme à la Constitution la cession forcée des parts des associés ou actionnaires opposés au plan de redressement. Cette mesure, prévue à l’article 238 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et codifiée à l’article L. 631-19-2 du Code de commerce, prévoit de nombreuses conditions à la cession forcée telles que, par exemple, l’importance de l’entreprise (au moins 150 salariés) ou le fait que la cessation d’activité soit de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou au bassin d’emploi. Cet arsenal de garanties tranche avec l’encadrement, relativement lâche en comparaison, de l’article L. 631-19-1. Mais ces conditions différentes s’expliquent par la différence de portée des deux mesures : là où l’une vise le seul associé dirigeant, l’autre concerne tous les associés et porte donc une atteinte beaucoup plus forte au droit de propriété.
La QPC soulevait un autre motif d’inconstitutionnalité. L’article L. 631-19-1 exclut du champ d’application les débiteurs exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire. Prenant appui sur cette différence de traitement, le requérant invoquait une atteinte au principe d’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel retient au contraire « qu’en excluant du champ d’application des mécanismes prévus les débiteurs exerçant de telles activités, le législateur a entendu tenir compte des règles particulières qui s’imposent, à titre personnel, aux dirigeants de ces entreprises qui doivent notamment faire l’objet, en fonction de l’activité libérale exercée, d’un agrément, d’une inscription ou d’une titularisation ». L’argument nous semble probant : même si la cession des parts n’est pas théoriquement impossible, elle se trouve compliquée par les règles professionnelles régissant les activités libérales. Par ailleurs, l’intuitu personae qui caractérise l’activité de ces personnes rend l’intérêt de leur remplacement plus incertain pour le redressement de l’entreprise30. L’exclusion de ces professionnels du domaine de l’article L. 631-19-1 du Code de commerce est toutefois loin de faire l’unanimité31.
Franck Juredieu
Saisine d’office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence
Cons. const., 14 oct. 2015, n° 2014-489, Société Grands Moulins de Strasbourg SA et a. Encore une décision sur les saisines d’office ! Le Conseil constitutionnel avait à se prononcer sur les dispositions de l’article L. 462-5 du Code de commerce relatives aux règles de saisine de l’Autorité de la concurrence. La décision portait également sur les sanctions pécuniaires pouvant être prononcées en cas de pratique anticoncurrentielle au titre de l’article L. 464-2 du Code de commerce.
En ce qui concerne les modalités de saisine de l’Autorité de la concurrence, le juge constitutionnel avait déjà retenu la conformité de l’actuel article L. 462-5 du Code de commerce dans une décision QPC du 12 octobre 2012 (n° 2012-280). La présente décision porte sur la rédaction de l’article en vigueur jusqu’à sa modification par l’ordonnance du 13 novembre 2008, à une époque où l’Autorité s’appelait encore « Conseil de la concurrence ». Si les deux versions prévoient que l’Autorité peut se saisir d’office de certaines pratiques anticoncurrentielles, le texte actuel ajoute un préalable nécessaire à l’auto-saisine consistant en une proposition du rapporteur général. Relevant l’importance que cette garantie légale avait joué dans la décision du 12 octobre 2012, les sociétés requérantes soulevaient que les dispositions contestées n’assurent pas une séparation des poursuites et des sanctions de ces pratiques, « qu’il en résulterait une atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à une autorité administrative indépendante exerçant des pouvoirs de sanction ». Le Conseil n’a pas suivi cette analyse.
Tout d’abord, dans les mêmes termes que sa décision du 12 octobre 2012, le juge constitutionnel rappelle que l’Autorité de la concurrence doit respecter les principes d’indépendance et d’impartialité de l’article 16 de la Déclaration de 1789, quand bien même elle ne présenterait pas une nature juridictionnelle. La décision fait prévaloir, à juste titre, l’étendue réelle des pouvoirs de l’Autorité sur la qualification formelle de juridiction. Si l’Autorité de la concurrence ne rend pas de jugements mais des décisions administratives, elle dispose néanmoins de vastes pouvoirs de sanction qui sont exercés dans le cadre d’une procédure classique. Celle-ci débute par une enquête et une instruction pour s’achever par une décision de sorte « qu’elle réunit sous sa fonction les pouvoirs reconnus habituellement à une juridiction »32. Il convient donc de s’assurer d’une séparation des fonctions de poursuite et d’instruction d’une part et du pouvoir de sanction d’autre part.
Selon le juge constitutionnel, « la décision par laquelle le Conseil exerce sa mission de contrôle du bon fonctionnement des marchés n’a ni pour objet ni pour effet d’imputer une pratique à une entreprise déterminée ; que dès lors, elle ne conduit pas à préjuger la réalité des pratiques susceptible de donner lieu au prononcé de sanctions ». Indéniablement, la mission du Conseil de la concurrence n’est pas tant de trancher un litige que de veiller au bon fonctionnement des marchés. Sa mission de régulation est à la fois la raison d’être de l’auto-saisine et l’une des justifications de sa conformité aux droits fondamentaux. Au-delà de ces considérations générales, les saisines d’office antérieures à 2008, ne se réfèrent nominativement à aucune entreprise ou pratiques en cause et ne font, à ce stade de la procédure, grief à personne33. C’est une différence importante avec l’actuel article L. 462-5 du Code de commerce qui vise non seulement des pratiques anticoncurrentielles mais encore « des manquements aux engagements pris en application de l’article L. 430-7-1 ». Ce nouvel objet rend plus prégnant le risque de pré-jugement et explique que l’ordonnance de 2008 ait ajouté la règle selon laquelle la saisine d’office devait être proposée par le rapporteur général.
Le Conseil constitutionnel énonce ensuite les différentes règles procédurales garantissant une séparation fonctionnelle entre l’instruction et le jugement. Ainsi, l’instruction de l’affaire est assurée sous la seule direction du rapporteur général. Le collège du Conseil de la concurrence est, pour sa part, compétent pour se prononcer sur les griefs notifiés par le rapporteur général et le cas échéant infliger des sanctions. Par ailleurs, l’article L. 463-7 du Code de commerce prévoit que lorsque le Conseil statue sur les pratiques dont il a été saisi, le rapporteur général et le rapporteur n’assistent pas au délibéré. Pour ces raisons, la saisine d’office ne porte pas atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.
S’agissant des sanctions pécuniaires des pratiques anticoncurrentielles, la question portait sur l’évaluation de l’amende prévue à l’article L. 464-2 du Code de commerce selon lequel le montant maximum est « de 10 % du chiffre d’affaires mondial le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». L’amende peut donc être très élevée car d’une part le chiffre d’affaires retenu n’est pas uniquement celui de l’entreprise mais aussi celui du groupe auquel l’entreprise appartient, d’autre part la règle permet de retenir « tout chiffre d’affaires depuis celui réalisé au moment où les pratiques anticoncurrentielles ont été commises jusqu’à celui de l’exercice précédant la condamnation »34. Le dispositif français apparaît, de ce point de vue, plus sévère que le droit européen puisque le Règlement (CE) n° 1/2003 se réfère au chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédent par l’entreprise ou l’association d’entreprise participant à l’infraction.
En l’espèce, la société-mère n’avait acquis sa filiale responsable des pratiques qu’après la cessation des pratiques anticoncurrentielles. En d’autres termes, son chiffre d’affaires avait servi de référence alors qu’elle était demeurée étrangère aux manquements constatés. La société requérante considérait donc que le lien entre l’infraction et la sanction faisait défaut et invoquait une atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et de personnalité des peines.
Sans entrer dans le détail de la décision, le Conseil constitutionnel s’est fondé sur le rôle dissuasif des dispositions en cause pour déclarer le texte conforme à la Constitution. L’assiette retenue par le législateur permet d’intégrer les gains illicites procurés par les infractions après leur cessation. Elle permet également de prévenir les stratégies visant à réduire, par des restructurations, le chiffre d’affaires des entreprises incriminées. On pense notamment à la pratique consistant pour l’entreprise incriminée à transférer son activité durant la période d’enquête pour ne maintenir une existence que sous la forme de holding. En outre, l’article L. 464-2 du Code de commerce se limite à instaurer un plafond et laisse à l’Autorité, sous le contrôle du juge, le soin de « proportionner la sanction à la gravité des faits, à l’importance du dommage causé à l’économie ou à la situation de l’entreprise sanctionnée ». Cette possibilité de modulation préserve sans doute le principe d’individualisation des peines. Mais ne pèche-t-elle pas par manque de transparence ? La souplesse des critères retenus par la loi et le large pouvoir de l’Autorité qui en découle le laissent penser35. C’est là toutefois une autre question à laquelle le Conseil constitutionnel n’avait pas à répondre.
Franck Juredieu
3 – Droit pénal spécial
Incrimination de la création de nouveaux gallodromes
Cons. const., 31 juill.2015, n° 2015-477 QPC, M. Jismy R. Depuis une loi du 8 juillet 1964, la construction de tout nouveau gallodrome est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende36. La conformité de cette incrimination était contestée au regard du principe d’égalité devant la loi, dans la mesure où n’est pas sanctionnée la création de nouveaux lieux accueillant les courses de taureaux.
Le raisonnement du Conseil (cons. 4) relève du postulat. Il considère d’abord que ces pratiques « sont distinctes par leur nature », sans s’en expliquer. Certes, la corrida est un combat entre un taureau et un homme ; les coqs, eux, se combattent entre eux. Est-ce suffisant ? Dans les observations présentées au nom du Premier ministre, était invoquée une différence entre les traditions, liée à la taille des lieux. Alors que la construction d’arènes suppose un terrain conséquent, la création d’espace de combats coqueleux se contente d’endroits plus modestes, souvent situés dans les arrières salles des estaminets du Nord de la France. L’interdiction de créer de nouveaux gallodromes se justifierait donc par le souci de lutter contre la prolifération de ces enceintes peu visibles. C’est quelque peu ergoter et oublier que l’organisation de cette tradition coqueleuse est soumise à certaines autorisations et contrôles vétérinaires et fait l’objet de publicité dans la presse locale. Le Conseil a ensuite eu recours à une interprétation téléologique, recherchant dans les travaux préparatoires de la loi de 1964 l’intention du législateur dans cette différence de traitement entre les taureaux et les coqs : le Parlement a entendu « encadrer plus strictement l’exclusion de responsabilité pénale pour les combats de coqs afin d’accompagner et de favoriser l’extinction de ces pratiques » ; ainsi, « le législateur a traité différemment des situations différentes ». Enfin, fort de ces constats, il conclut à l’absence d’atteinte au principe d’égalité.
La question des combats de coqs est sensible37 (l’audience constitutionnelle n’est d’ailleurs pas retransmise) ; la décision – tout comme celle rendue en matière de corridas – aurait mérité d’être plus explicite.
En premier lieu, le contrôle de constitutionnalité apparaît bien faible : puisque le législateur a décrété que les situations étaient différentes, il n’y a pas d’atteinte au principe d’égalité ! La loi « serait, à la fois, l’origine de la différence et, curieusement, sa justification par cela seul que le législateur a introduit des distinctions en rapport avec l’objet du texte »38.
En second lieu, la référence aux travaux parlementaires semble partielle, voire partiale. L’examen des travaux préparatoires peut au contraire permettre de démontrer que le but de la loi de 1964 était de rétablir une égalité de traitement entre les deux traditions. Ainsi, le rapporteur de la commission des lois notait que cette loi était justifiée par le souci de « combler quelques lacunes de la loi de 1963 en étendant aux combats de coqs la dérogation dont bénéficient, sous certaines conditions, les courses de taureaux ». Il précisait que, « en refusant aux habitant du Nord ce qu’elle accorde à ceux du Sud de la France, la loi crée une inégalité d’autant plus choquante que celle-ci affecte deux catégories comparables de citoyens » et que « c’est à cette inégalité que se propose de mettre fin la proposition de loi qui vous est aujourd’hui soumise »39.
Pour tenter de comprendre cette distinction de nature relevée par le Conseil, peut-être eût-il été plus pertinent de se tourner vers les débats ayant abouti à la loi de 1963 qui avait maintenu l’exception d’irresponsabilité pour les courses de taureaux (instaurée en 1951) tout en excluant l’impunité pour les combats de coqs : la différence relevée tenait à ce que la course de taureaux est un spectacle là où les combats de coqs sont principalement un motif de paris40. Où l’on voit que, au gré des pages du Journal officiel, la référence à l’intention du législateur peut justifier tout et son contraire.
Après l’absence de rupture d’égalité entre les régions de tradition taurine et les autres41, l’absence de rupture d’égalité entre la création possible de nouvelles arènes et la création prohibée de nouveaux gallodromes semble confirmer la « déliquescence du principe constitutionnel d’égalité »42.
Véronique Tellier-Cayrol
Associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité
Cons. const., 16 oct. 2015, n° 2015-492 QPC, Asso. Communauté rwandaise de France ; Cons. const., 8 janv. 2016, n° 2015-512 QPC, M. Vincent R. L’article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Mais en vertu de l’article 48-2 de cette même loi, seules les associations qui se proposent de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la résistance et des déportés peuvent se constituer partie civile pour apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Ainsi, en raison de leurs statuts, une association de défense de la mémoire des Harkis, la Ligue des droits de l’Homme et du citoyen (LDH), la Ligue internationale contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (LICRA), ou encore SOS Racisme sont irrecevables à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
L’association Communauté rwandaise de France contestait cette irrecevabilité en pointant cette dissymétrie entre la règle de fond, laquelle pose une incrimination générale, et la règle de procédure qui limite la constitution de partie civile ; elle estime que l’application combinée de ces deux dispositions porte atteinte au principe d’égalité.
Le Conseil constitutionnel lui donne raison : l’incrimination d’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ne distingue pas entre ces crimes (« le législateur n’a pas prévu une répression pénale différente pour l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, selon que ces crimes ont été commis ou non pendant la Seconde Guerre mondiale »). La gravité de tels crimes ne permet pas d’accepter de degrés, de hiérarchie dans l’horreur. Dès lors, aucune raison ne justifie que seules les associations défendant les intérêts des victimes de la Seconde Guerre mondiale soient autorisées à agir. La décision rend plus que douteuse la constitutionnalité de l’article 2-5 du Code de procédure pénale selon lequel « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne (…) l’apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi ».
Le législateur a désormais jusqu’au 1er octobre 2016 pour décider soit de supprimer purement et simplement la constitution de partie civile des associations de défense des résistants ou des déportés en matière d’apologie de crime de guerre ou de crime contre l’humanité (l’action civile restant évidemment possible pour toute victime directe et personnelle de faits d’apologie), soit d’ouvrir cette faculté à toutes les associations ayant pour objet de défendre l’honneur et les intérêts moraux des victimes de tels crimes.
Quelle branche de l’option choisir ? Pour différentes raisons, la répression de l’infraction d’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité est difficile à mettre en œuvre (en témoigne la récente décision de la chambre criminelle du 15 décembre 2015 ayant cassé sans renvoi la condamnation du député-maire Gilles Bourdouleix pour ses propos – considérés comme non publics – contre des gens du voyage « Comme quoi Hitler n’en a peut-être pas tué assez »). Alors, même si la propension du législateur à accorder à certaines associations le droit de se constituer partie civile est fortement contestable43, il peut être utile, dans ce domaine spécifique, de leur reconnaître, sans distinction entre elles, cette faculté. La méthode paraît simple : il suffit d’ajouter « et l’apologie de tels crimes » à la fin de l’article 2-3 du Code de procédure pénale, lequel indique que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre (…) peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ».
Délit de contestation de l’existence de certains crimes contre l’humanité. Cette déclaration d’inconstitutionnalité doit être rapprochée de la décision QPC du 8 janvier 2016 relative à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 qui incrimine la contestation des crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne s’agit plus ici de sanctionner des propos apologétiques mais des propos négationnistes. Le problème est quelque peu différent puisqu’il confronte des dispositions de droit pénal spécial : d’une part, les articles 211-1 et 212-1 du Code pénal qui répriment tous les crimes contre l’humanité ; d’autre part, l’article 24 bis de la loi de 1881, introduit par la loi Gayssot du 13 juillet 1990, qui ne sanctionne la négation que de certains d’entre eux. Le délit de révisionnisme est, en effet, circonscrit à la contestation des seuls crimes commis pour le compte des puissances européennes de l’Axe avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale.
La Cour européenne, dans son arrêt Garaudy c/ France du 24 juin 2003, a estimé que cette loi ne portait pas atteinte à la liberté d’expression, qu’il « ne fait aucun doute que contester la réalité des faits historiques clairement établis, tels que l’Holocauste, ne relève en aucune manière d’un travail de recherche historique s’apparentant à une quête de la vérité », qu’il s’agit de « réhabiliter le régime national-socialiste et, par voie de conséquence, d’accuser de falsification de l’Histoire les victimes elles-mêmes ». Elle précise que le négationnisme remet en cause « les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et sont de nature à troubler gravement l’ordre public ».
Certes le législateur avait tenté d’étendre l’incrimination au génocide arménien, mais il avait essuyé la censure du Conseil, lequel considérait qu’en réprimant « la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression »44.
Plusieurs QPC ont été soulevées relativement à l’article 24 bis mais la Cour de cassation avait, jusqu’à la décision de transmission du 6 octobre 2015, toujours refusé de les transmettre pour des raisons procédurales ou pour absence de caractère sérieux parce qu’étaient invoquées une atteinte au principe de la légalité ou une atteinte à la liberté d’expression45.
L’angle d’attaque était ici plus habile puisque le grief portait notamment sur l’atteinte au principe d’égalité. Vincent R. avait été condamné à un an d’emprisonnement ferme pour avoir diffusé sur internet une vidéo mettant en cause l’existence des chambres à gaz. La protection de la loi pénale étant refusée pour les victimes de crimes contre l’humanité autres que ceux visés par l’article 24 bis, le requérant soutenait qu’il y avait là une atteinte au principe constitutionnel d’égalité au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la négation des autres crimes contre l’humanité n’étant pas sanctionnée… ce qui revenait indirectement à défendre les victimes de ces autres crimes contre l’humanité.
Le Conseil n’allait pas se contredire : « la négation des crimes contre l’humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle-même une portée raciste et antisémite ; que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre l’humanité commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a traité différemment des agissements de nature différente » (cons. 10). L’objet de la loi Gayssot est de renforcer la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie : la différence entre la négation de la Shoah et la négation d’autres génocides paraît justifiée car derrière la négation du génocide du peuple juif, il y a un discours antisémite et antidémocratique qu’on ne trouve pas derrière les autres discours négationnistes46. Cette décision du Conseil est en adéquation avec la position de la Cour européenne : dans un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, Perinçek c/ Suisse du 15 octobre 2015, la Cour opère la même distinction entre la négation de l’Holocauste et la négation d’autres génocides. M. Perinçek, universitaire turc, avait qualifié, lors de manifestations publiques en Suisse, le génocide arménien de « mensonge international ». Dans cette très longue décision, la Cour se fonde sur des facteurs géographique, historique et temporel et rappelle que sa jurisprudence justifie la pénalisation de la négation de l’Holocauste parce que, au vu du contexte historique, cette négation traduit invariablement une idéologie antidémocratique et antisémite.
Ainsi, la négation du génocide rwandais de 1994 ou celle du génocide arménien de 1915 échappent à toute répression. Ce qui, au moins pour ce dernier, peut paraître paradoxal puisque le législateur reconnaît le génocide arménien sans pour autant le protéger contre la négation47.
L’extension du délit de négationnisme aux autres crimes contre l’humanité fait débat. De nombreux auteurs y sont opposés, soit en estimant que l’article 1382 du Code civil peut utilement être invoqué, soit même en considérant que l’article 24 bis devrait être abrogé. À l’inverse, d’autres auteurs sont favorables à l’extension du délit : à partir du moment où l’existence d’un crime contre l’humanité est contestée, on ne peut pas admettre une différence de traitement ; toutes les contestations doivent alors faire l’objet d’un traitement similaire. Dès lors, ils se prononcent en faveur de la création d’un unique délit de contestation de l’existence des crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis aux articles 211-1 et 212-1 du Code pénal48. « Le législateur n’empiète pas sur la chasse gardée des historiens, lesquels pas plus que les autres ne sont au-dessus des lois (…). L’Assemblée nationale n’écrit pas une histoire dont les pages les plus noires ont d’ores et déjà été écrites à l’encre de la barbarie, en dehors de son enceinte ; le législateur se contente de prohiber et de sanctionner sa négation. (…) il ne s’agit pas de porter atteinte à la liberté d’opinion, mais simplement de réprimer les délits commis par ceux qui nient la vérité que l’histoire nous a léguée et insultent les victimes des tragédies qui ont ensanglanté notre passé »49.
Ces deux décisions montrent une nouvelle fois qu’un toilettage de la loi de 1881 est nécessaire, toilettage qui ne peut se faire sans une réelle vue d’ensemble et de la loi, et des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale.
Véronique Tellier-Cayrol
4 – Procédure pénale
Respect du secret professionnel et des droits de la défense lors d’une saisie de pièces à l’occasion d’une perquisition
Cons. const., 4 déc. 2015, n° 2015-506 QPC, M. Gilbert A. Dans le cadre d’une perquisition, que ce soit dans le cadre de l’enquête de flagrance (art. 56 et 57), de l’enquête préliminaire (art. 96) ou dans le cadre d’une instruction préparatoire (art. 81), l’officier de police judiciaire ou le juge d’instruction a « l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ». Des dispositions spécifiques encadrent les perquisitions réalisées au cabinet d’un avocat, dans les locaux d’une entreprise de presse, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, mais aucune mesure spécifique n’est prévue en cas de perquisition au sein d’une juridiction.
À la suite de la mise en examen de Gilbert A.50 pour recel de violation du secret professionnel et trafic d’influence passif, deux juges d’instruction avaient saisi, lors d’une perquisition réalisée à la Cour de cassation, un rapport et un projet d’arrêt rédigés par un conseiller-rapporteur à la chambre criminelle concernant un pourvoi en cassation. Rien n’interdit en effet de perquisitionner dans les bureaux de personnes tenues au secret professionnel et de prendre connaissance d’informations couvertes par ce secret dès lors que ces opérations sont justifiées par les besoins de la manifestation de la vérité.
Le requérant soulevait un grief unique tiré de la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence : l’absence de garanties procédurales spécifiques portait atteinte au principe d’indépendance des juges. La chambre criminelle retient le caractère sérieux de la question, « en ce que les textes précités, relatifs aux pouvoirs du juge d’instruction au cours d’une information, ou d’un officier de police judiciaire, quel que soit le cadre de l’enquête, ne comportent, en matière de perquisitions et de saisies de documents dans une juridiction, aucune disposition qui garantisse leur conformité aux principes d’indépendance et d’impartialité du juge, auxquels participe le secret du délibéré ». Le secret du délibéré est en effet destiné à garantir l’indépendance et l’impartialité, ce que confirme la présente décision. Après avoir cité l’article 16 de la Déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel juge « qu’est garanti par cette disposition le principe d’indépendance, qui est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles et dont découle le principe du secret du délibéré » (cons. 13).
Il ajoute que, « s’il est loisible au législateur de permettre la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d’indépendance peut être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée » (cons. 15). Or aucune disposition n’indique à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi. Le Conseil indique alors qu’en « adoptant les dispositions contestées, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d’indépendance des juridictions ».
Le Conseil constitutionnel, et avec lui le Conseil d’État et la Cour de cassation, avaient déjà considéré que le rapport est un élément consubstantiel de la délibération qui, pour cette raison, obéit à la règle du secret51. La Cour européenne des droits de l’Homme, quant à elle, dans son arrêt Reinhardt et Sliman-Kaïd c/ France du 31 mars 1998, a sanctionné le défaut de communication aux requérants du rapport du conseiller rapporteur. Pour mettre la pratique de la Cour de cassation en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne, le rapport est aujourd’hui scindé en deux parties. La première partie peut être consultée par les parties et par l’avocat général, mais elle ne comporte qu’un simple exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués par les parties. La seconde partie, qu’on appelle « la note », précise la position personnelle du rapporteur et comporte le projet d’arrêt. Elle est couverte par le secret du délibéré et n’est communiquée ni aux parties, ni à l’avocat général. La Cour européenne a pu juger cette nouvelle pratique conforme à l’article 6 de la Convention52.
Appliquée aux faits ayant donné lieu à cette décision du 4 décembre, la règle confirme bien que la « note » et le projet d’arrêt saisis étaient bien couverts par le secret du délibéré. Mais la saisie de tels documents n’est pas interdite. Le Conseil constitutionnel reproche simplement le manque de garanties qu’aurait dû prévoir le législateur lorsqu’il s’agit d’aller perquisitionner chez un magistrat.
L’abrogation est reportée au 1er octobre 2016, et est assortie d’une réserve transitoire : « les dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du Code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, la saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré » (cons. 19). Le Conseil prend ensuite le soin d’indiquer que « la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles méconnaîtrait l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » (cons. 20). Victoire à la Pyrrhus pour Gilbert A. ? Pas tout à fait puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’annuler, dans une décision du 22 mars 201653, la saisie des documents réalisée dans le bureau de Gilbert A. considérant que « cette appréhension n’était pas indispensable à la recherche de la preuve d’un trafic d’influence » et que « les juges d’instruction avaient porté une atteinte non nécessaire au secret du délibéré ».
Véronique Tellier-Cayrol
Absence de nullité de la procédure en cas de méconnaissance de l’obligation d’enregistrement sonore des débats de cours d’assises
Cons. const., 20 nov. 2015, n° 2015-499 QPC, M. Hassan B. Issu de la loi du 20 juin 2014 réformant notamment la procédure de révision, l’article 308, alinéa 2, du Code de procédure pénale impose l’enregistrement sonore des débats de cours d’assises. Cet enregistrement a pour objectif de faciliter la preuve du fait nouveau ou de l’élément inconnu nécessaire à la révision d’un procès criminel. Le dernier alinéa de l’article 308 indique cependant que cette obligation n’était pas prescrite « à peine de nullité de la procédure ». C’est cette absence de sanction qui fait l’objet de la QPC transmise par la Cour de cassation le 9 septembre 2015 : « Les dispositions du dernier alinéa de l’article 308 du Code de procédure pénale en ce qu’elles prévoient que l’enregistrement sonore devant la cour d’assises n’est pas prescrit à peine de nullité, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit à un recours effectif ainsi qu’au principe d’égalité devant la justice, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ? ».
Le Conseil constitutionnel s’est d’abord interrogé sur la nature juridique de cette obligation. Entre un droit de l’accusé (position de l’avocat du requérant) ou une simple mesure d’administration (position du Gouvernement), le Conseil a tranché : « le législateur a conféré aux parties un droit à l’enregistrement sonore des débats de la cour d’assises » (cons. 4). Partant, l’absence de recours en cas d’inobservation de cette formalité constitue bien une atteinte aux exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 (cons. 5). L’abrogation du dernier alinéa de l’article 308 est différée au 1er septembre 2016 et, en attendant, « les arrêts de cours d’assises rendus jusqu’à cette date (…) ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».
Où l’on voit donc que le législateur de 2014 n’a pas encore toujours le réflexe de constitutionnalité au moment de l’adoption des lois. Certes, on peut nuancer la critique : l’alinéa contesté (« les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ») est issu de la loi du 2 février 1981 laquelle n’avait instauré qu’une faculté d’enregistrement à la disposition du président de la cour d’assises (faculté dont on pouvait d’ailleurs douter de la constitutionnalité au regard du principe d’égalité). En rendant cet enregistrement obligatoire, il aurait dû néanmoins s’interroger sur la sanction de son non-respect.
Véronique Tellier-Cayrol
5 – Droit pénitentiaire
Acte d’engagement des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les établissements pénitentiaires
Cons. const., 25 sept. 2015, n° 2015-485 QPC, M. Johny M. Retour à la case prison. Dans sa décision du 14 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du Code de procédure pénale (« les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail »). Dans sa décision du 25 avril 2014, il avait censuré l’article 728 du même code, décision à l’effet assez limité puisque la disposition abrogée concernait la version antérieure à celle issue de la loi pénitentiaire de 2009. Le travail en prison revient donc une troisième fois devant le Conseil.
Détenu au sein de l’établissement de Poitiers-Vivonne, M. Johny M. a formé devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de déclassement de l’emploi d’opérateur qu’il occupait et à cette occasion, a posé une QPC relative à l’article 33 de la loi pénitentiaire et à l’article 717-3 du Code de procédure pénale. L’article 33 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit que la participation des détenus aux activités professionnelles organisées dans les prisons « donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire ». Cet acte « énonce les droits et obligations professionnels » du détenu, « ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération ». Les griefs invoqués portaient sur la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence et se fondaient sur les alinéas 5 à 8 du Préambule de la Constitution de 1946, lequel prévoit un certain nombre de garanties protégeant tout travailleur. Peine perdue ! Reprenant l’insertion déjà présente dans sa décision du 14 juin 2013, le Conseil rappelle qu’ « il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits » mais ajoute que « le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence (…) doit être écarté » (cons. 11).
Malgré les très nombreuses critiques contre la décision de 2013, le Conseil a donc récidivé dans sa volonté de ne pas condamner l’incompétence négative du législateur, malgré le dépôt, la veille de la décision, d’une pétition signée par plus de 375 enseignants-chercheurs condamnant l’inertie du législateur et réclamant la fin « d’un régime juridique aussi incertain qu’attentatoire aux droits sociaux fondamentaux des personnes incarcérées ». La décision du 25 septembre 2015 suscite déjà des protestations virulentes et parfois volontairement provoquantes, allant jusqu’à sous-entendre qu’elle s’explique par des raisons plus ancillaires que juridiques : « Que craignaient les huit membres de l’institution qui ont rendu la décision ? De déplaire ? Que risquaient-ils ? Rien. Quoique désignés par des élus, ils sont au sommet des postes non électifs. Auraient-ils eu peur d’être privés d’un supplément de décoration ? »54. On peut pourtant penser que la décision n’a sans doute pas été adoptée à l’unanimité. En effet, Nicole Maestracci, désormais membre du Conseil constitutionnel depuis février 2013, avait préconisé, lorsqu’elle était présidente de la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale, d’introduire « un contrat de travail, qui tienne compte de manière réaliste de la situation de détention, mais ouvre la voie à la sécurisation du parcours professionnel pour les détenus, à l’intérieur de la prison, puis à l’extérieur, au moment de leur sortie »55. Cette décision fait une nouvelle fois regretter, avec d’autres56, l’absence de publication des opinions dissidentes.
Véronique Tellier-Cayrol
B – Les QPC transmises par le Conseil d’État
Instauration de l’état d’urgence
Cons. const., 14 oct. 2015, n° 2015-490 QPC, M. Omar K. ; Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2016-527 QPC, M. Cédric D. ; Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC et n° 2016-536 QPC, Ligue des droits de l’Homme. Dans l’absolu, il aurait été souhaitable de commenter d’autres décisions. Leur existence a malheureusement été provoquée par la réapparition du terrorisme sur notre sol. Une démocratie doit être, pour reprendre un concept allemand, aussi apte à se défendre (Wehrhafte Demokratie). Entre l’assurance tranquille des uns57 et les cris d’orfraie des autres dénonçant immédiatement le péril totalitaire, il est bien trop tôt pour trancher la question de savoir si notre démocratie a trouvé, avec l’instauration de l’état d’urgence aux modalités substantiellement renforcées par la loi du 20 novembre 2015, les moyens adéquats et proportionnés58 permettant de combattre efficacement ce fléau tout en préservant ses valeurs.
En tout cas, l’adoption de dispositions législatives d’exception, adoptées expéditivement (48 heures pour la loi du 20 novembre 2015) va de pair avec une intervention juridictionnelle fondée à se prononcer sur leur conformité aux principes garantis par la Constitution d’un État de droit. Tout est alors question d’un équilibre subtil à trouver entre l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public « sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré 59» et les inéluctables restrictions apportées à nos droits et libertés. Tel est l’objet de ces différentes décisions QPC dont certaines vont au-delà du cadre temporel de la chronique. On saisira aisément les raisons de cette présentation globale.
Recourons d’abord une focale large avant d’entrer dans les modalités techniques. Deux points retiendront ici tout particulièrement notre attention.
En premier lieu, l’instauration de la QPC a permis au Conseil constitutionnel d’être remis en selle si l’on s’autorise cette expression familière. Celui-ci était jusqu’ici un acteur mineur à l’égard de l’état d’urgence. S’il avait eu la possibilité d’affirmer en 1985 que la Constitution n’a pas « exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier (…) les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public ; qu’ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas eu pour effet d’abroger la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, qui, d’ailleurs, a été modifiée sous son empire60 », il resta cantonné au rang de spectateur lors du précédent recours à l’état d’urgence en 2005. Seul le Conseil d’État tira, à ce moment, son épingle du jeu en examinant des demandes tendant à la suspension du décret le déclarant61 puis en jugeant que ce régime était conforme aux stipulations de l’article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales62. En revanche, ce même Conseil d’État n’avait pu que constater que « les mesures dont l’application est autorisée par le décret n° 2005-1387 ont pour fondement une loi dont il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier la constitutionnalité »63.
Tout ceci appartient au passé désormais. Certes, il eût été préférable que le juge constitutionnel soit saisi a priori (ce qui ne fut ni le cas de la loi du 13 novembre 2014 établissant un dispositif d’interdiction de sortie du territoire, ni celle du 20 novembre 2015) afin d’empêcher immédiatement qu’une disposition inconstitutionnelle puisse provoquer le moindre effet juridique ; certes, il fut pour le moins malencontreux pour le Premier ministre d’affirmer qu’il « est toujours risqué de saisir le Conseil constitutionnel »64. Mais tout ceci doit être apprécié à l’aune de la possibilité qu’ont les justiciables de faire valoir leurs droits dans une logique a posteriori. Sans tomber dans l’angélisme65, la QPC n’a pas seulement restauré la primauté de la Constitution au sein de la hiérarchie des normes (du moins en droit interne), elle a aussi replacé le Conseil constitutionnel en tant que gardien des droits et libertés fondamentaux. En 2005, l’attention s’était focalisée exclusivement sur le Conseil d’État. Ce n’est maintenant plus le cas. Libre ensuite à certains d’estimer que le juge constitutionnel reste trop pusillanime pour être crédible (parce qu’il continuerait comme Jean Rivero le constatait en 1981 de « filtrer le moustique et laisser passer le chameau »66) et qu’il ne prend pas en compte les (inévitables ?) excès des forces de police dans son raisonnement67. Il n’en reste pas moins que l’intervention du juge constitutionnel a au moins le mérite d’exister et qu’il est difficile d’affirmer que la raison d’État l’a emporté systématiquement sur la défense des droits et libertés (voir infra).
En second lieu, les présentes décisions auxquelles il convient de rajouter celle rendue, dans le cadre du contrôle par voie d’action, le 23 juillet 2015, sur la loi relative au renseignement68, s’inscrivent dans un mouvement, tracé depuis 1999, confinant l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution de 1958 (C.), à l’isolement voire à une relative marginalisation. Pour le dire vite, le juge administratif est devenu le juge naturel pour les justiciables confrontés aux mesures sécuritaires votées depuis plus d’un an. Rien d’étonnant alors de voir le premier président de la Cour de cassation s’en émouvoir régulièrement et notamment69 lors de l’audience solennelle de rentrée 2016 : « Les pouvoirs publics sont-ils parfois portés à prendre leurs distances avec l’autorité judiciaire ? Si oui, pourquoi ? Quelles défaillances ou quels risques l’autorité judiciaire présente-t-elle qui justifieraient que l’État préfère l’éviter lorsqu’il s’agit de la défense de ses intérêts supérieurs ? Le premier président de la Cour de cassation se doit de poser loyalement cette question dans les circonstances dramatiques que notre pays traverse avec un accompagnement législatif qui ne s’est pas tourné spontanément vers l’autorité judiciaire lorsque l’on a mis en place le contrôle de l’application aussi bien de la loi sur le renseignement que de celle sur l’état d’urgence, textes qui intéressent pourtant au premier chef la garantie des droits fondamentaux.
Qu’on me comprenne bien. Mon propos n’est pas critique ni revendicatif. Il est seulement interrogatif. Pourquoi l’autorité judiciaire est-elle ainsi évitée ? Elle est la première appelée à rechercher en elle-même les réponses à cette question fondamentale.
Gouvernement, Parlement, Conseil constitutionnel ont convergé pour ne pas désigner le juge judiciaire dans ces lois récentes. Au-delà de la problématique technique autour des notions de prévention et de répression, dont tous les juristes connaissent la labilité, pourquoi ce choix ? »70.
De telles questions sont parfaitement légitimes. La discussion est bien connue et a déjà été abordée dans de précédentes chroniques (principalement n° 1, 4 et 8). D’une part, il faut parmi les libertés constitutionnellement garanties, distinguer « la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile privé, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 » de « la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l’autorité judiciaire »71 étant précisé que cette liberté individuelle est limitée à la seule sûreté (i.e. l’interdiction de la détention, rétention, arrestation, hospitalisation sans consentement arbitraires). D’autre part, il est acté depuis des décades72 que les opérations de prévention des atteintes à l’ordre public (indépendamment donc de la commission de toute infraction) relèvent du contrôle du juge administratif, le juge judicaire restant compétent à l’égard des opérations de répression (i.e. en relation avec une infraction déterminée)73. Cette double politique jurisprudentielle, menée conjointement par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État (dont les relations ont toujours été plus tissées et entremêlées que celles entretenues avec la Cour de cassation) a fini inexorablement par réduire, telle une peau de chagrin, les possibilités d’interventions contentieuses des juges judiciaires. On s’en convaincra, une nouvelle fois, avec le présent commentaire.
Avec une focale plus resserrée, intéressons-nous au régime de l’interdiction administrative de sortie du territoire déterminé par la loi du 13 novembre 201474 et surtout celui des assignations à résidence75 ; des perquisitions administratives76 et des restrictions imposées à la liberté de réunion77 établis par la loi du 3 avril 1955 modifiée par celle du 20 novembre 2015. Tous ces mécanismes ont été déclarés conformes à la Constitution, seul le dispositif permettant à l’autorité administrative, lors d’une perquisition, de copier les données informatiques accessibles n’a pas réussi à franchir l’obstacle78 – voir infra.
Que retenir ?
Primo, le Conseil a pris systématiquement le soin dans ses décisions relatives à l’état d’urgence d’indiquer, dans un considérant de principe, que « la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence ; qu’il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ». On est ici face à la version améliorée de la formulation de 1985 selon laquelle la Constitution n’a pas « exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier (…) les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public ». Ceci relativisait un des intérêts de la révision (finalement abandonnée par le président de la République en mars 2016) visant à figer l’état d’urgence dans le marbre constitutionnel79 puisque le législateur reste de son côté libre de façonner à tout moment un nouveau régime d’exception (tel un état d’urgence « renforcé »). Beaucoup de bruit pour rien.
Secundo, le juge judiciaire occupe ici, comme on l’a vu plus haut, une place minorée dans la protection des droits et libertés.
C’est en ce sens 1°) qu’une décision d’interdiction administrative de sortie du territoire, restreignant la liberté d’aller et venir, relève – en empêchant un citoyen de se rendre à l’étranger s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette de participer à des opérations terroristes ou sur un théâtre d’opération de groupements terroristes – d’un objectif de prévention des atteintes à l’ordre public. Elle ne peut donc être examinée par le juge judiciaire et ce même si l’intéressé doit remettre sa carte nationale d’identité et son passeport80.
Pareillement, le juge constitutionnel admet 2°) que des perquisitions administratives (de loin les mesures les plus utilisées mais dont la plus-value par rapport aux perquisitions judiciaires semble faible81), y compris lorsqu’elles ont lieu dans un domicile, n’affectent pas la liberté individuelle au sens de l’article 66 C et « n’ont pas à être placées sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire »82. Afin d’éviter son dessaisissement complet, il a cependant été prévu par l’article 11 de loi du 3 avril 1955 modifiée (et ce grâce au Sénat davantage attentionné à l’égard de l’autorité judiciaire que l’Assemblée nationale) que le procureur de la République est informé sans délai de la décision ordonnant la perquisition ; que celle-ci est conduite en présence d’un officier de police judiciaire fondé, lorsqu’une infraction est constatée, à procéder à toute saisie utile.
Malgré ces précautions, on mesure la distance avec l’époque où, ce même Conseil constitutionnel affirmait que « si les nécessités de l’action fiscale peuvent exiger que des agents du fisc soient autorisés à opérer des investigations dans des lieux privés, de telles investigations ne peuvent être conduites que dans le respect de l’article 66 de la Constitution qui confie à l’autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects, et notamment celui de l’inviolabilité du domicile83 ». On sait qu’un bloc de compétences a été réservé, en application d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, à la juridiction administrative84. Mais il n’est pas pour autant superflu de rappeler que, selon un principe de même valeur, l’autorité judiciaire est garante de la propriété85 (à laquelle portent atteinte les perquisitions) et que le législateur est fondé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à « unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé »86. Manifestement, la volonté de trouver un équilibre acceptable pour les deux ordres juridictionnels a bel et bien quitté le Parlement et le Conseil constitutionnel.
Enfin, 3°) la loi du 20 novembre 2015 permet au ministre de l’Intérieur d’astreindre une personne à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé dans la limite de douze heures par tranche de vingt-quatre heures. Selon le Conseil, cette durée maximale « ne saurait être allongée sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, dès lors soumise aux exigences de l’article 66 de la Constitution »87. Autrement dit, la mesure est restrictive de liberté jusqu’à douze heures et devient privative (justifiant alors l’intervention du juge judiciaire) seulement à la treizième heure. Mais pourquoi le curseur a-t-il été placé par le Conseil à douze heures et non à huit ? Aucune explication n’est ici apportée et on peut s’interroger sur l’attitude du Conseil si la version initiale présentée par le Gouvernement dans son projet de loi (une durée maximale d’assignation de huit heures – présentée, à ce moment, comme la plus conforme à la jurisprudence constitutionnelle) lui avait été soumise.
En complément, il est à rappeler que, concernant la possibilité pour un individu en ivresse manifeste sur la voie publique d’être placé en cellule de dégrisement, le Conseil n’avait pas exigé l’intervention obligatoire de l’autorité judiciaire eu égard à ce que « la privation de liberté ne peut se poursuivre après que la personne a recouvré la raison ; que la condition ainsi posée par le législateur a pour objet et pour effet de limiter cette privation de liberté à quelques heures au maximum »88 On est donc passé d’une notion des plus subjectives (« quelques heures au maximum ») à une limite fixée selon une méthode se réclamant quelque peu du jugement de Salomon89.
Tertio, les mesures ont été, à une exception près, déclarées conformes à la Constitution. C’est, pour partie, le résultat du travail concordant effectué par le Gouvernement, par le Conseil d’État lors de la phase consultative (art. 39 de la Constitution de 1958) et du Parlement multipliant les précautions juridiques afin d’éviter tout risque d’invalidation contentieuse. Mais n’a-t-on pas parfois été trop loin en risquant, au final, de prescrire des mécanismes seulement virtuels ? Tel est le cas principalement de la modalité prévue par l’article 4-1 aux termes de laquelle une personne assignée à résidence qui a été préalablement condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d’emprisonnement et a fini l’exécution de sa peine depuis moins de huit ans, peut être placée sous surveillance électronique mobile. Mais, pour cela, la loi exige que cet individu, « dont le passé pénal atteste d’une dangerosité particulière », selon les propres mots du Premier ministre90, exprime son accord qui devra, au surplus, être recueilli par écrit…
Une seule disposition a été finalement déclarée contraire à la Constitution. Lors d’une perquisition administrative, les services de police sont en droit d’accéder à des données stockées sur un téléphone, une tablette et un ordinateur ainsi qu’à celles accessibles à partir de ces terminaux (messagerie et « nuage »). Seulement, le législateur avait aussi prévu la possibilité de copier ces données sur tout support (parce que leur volume est trop important pour être traitées pendant la perquisition et/ou leur accès est verrouillé). Cette copie, s’apparentant techniquement à un véritable clonage – c’est-à-dire un double strictement identique – a été, à juste titre, considérée comme une saisie puisque les services de police n’ont plus besoin du support originel pour la poursuite de leurs investigations. Or, on l’a vu, ce n’est que lorsqu’une infraction est constatée qu’un officier de police judiciaire peut procéder à toute saisie utile91.
Le Conseil a ici estimé, d’abord, que cette saisie déguisée n’avait pas été autorisée par un juge (mais par lequel ? Le Conseil reste prudent sur ce point) et, ensuite, que toutes les données, sans aucune distinction possible, se retrouvent en possession des services de police et dont y compris celles relevant de la vie privée de leur possesseur ; les circonstances étant même aggravées si la perquisition se déroule chez un tiers de la personne constituant une menace. Une incompétence négative du législateur a été ici identifiée puisque celui-ci « n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée »92.
Pour autant, le Conseil constitutionnel ne s’est pas pour autant contenté de délivrer un satisfecit général à l’égard des autres dispositions. Ont, en outre, été fixées de nombreuses réserves d’interprétation, constituant un véritable vade-mecum pour le juge administratif chargé de veiller, d’une manière générale, à ce que chaque mesure prise soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit. C’est à cette condition que le Conseil a pu considérer que la conciliation entre le respect des droits et libertés et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre publique n’était pas, dans chaque hypothèse, manifestement déséquilibrée.
1°) Concernant les restrictions imposées aux réunions publiques (qui ne peuvent avoir pour « effet de régir les conditions dans lesquelles sont interdites les manifestations sur la voie publique »)93, le Conseil exige que le juge administratif s’assure que la mesure de fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion ainsi que sa durée soient justifiées et proportionnées aux nécessités de la préservation de l’ordre public ayant motivé cette fermeture. Il est de même à l’égard d’une mesure d’interdiction de réunion. Quant aux mesures présentant un caractère individuel, elles devront être motivées94.
2°) Pour les perquisitions administratives, le Conseil a réduit la latitude pour l’Administration de recourir à la perquisition nocturne en raison de son caractère plus traumatisant pour les occupants des lieux. Point de possibilité d’y recourir en toute opportunité puisqu’une telle perquisition devra être « justifiée par l’urgence ou l’impossibilité de l’effectuer le jour »95. Il appartiendra au juge administratif, dans un contentieux limité à l’engagement de la responsabilité de l’Administration, de s’en assurer.
3°) Eu égard aux effets temporels d’une assignation à résidence, d’une mesure de fermeture provisoire d’une salle de spectacle, débit de boissons et lieu de réunion et d’une mesure d’interdiction de réunion, ceux-ci cessent de produire effet à la date de cessation de l’état d’urgence dont la durée générale, rappelle le Conseil, ne « saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence »96. Il a été précisé, à titre de garantie, qu’en cas de nouvelle prorogation (tel a été le cas avec les lois du 19 février 2016 et du 20 mai 2016), les mesures restrictives énoncées plus haut devront, si elles nécessitent d’être prolongées, faire l’objet d’un renouvellement express (Ibid).
Pour conclure, il est certain que l’instauration d’un état d’urgence ne peut être une fin en soi. Dans cette lutte contre le terrorisme qui impliquera « du sang, du labeur, des larmes et de la sueur » (W. Churchill), des dispositions pérennes devront être bâties. Une première contribution a été apportée par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. D’autres interviendront plus tard. Mais il faudra prendre garde à ne pas transformer notre État de droit en un État de sécurité.
Jean-Éric Gicquel
Notes de bas de pages
-
1.
Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC.
-
2.
Cons. const., 18 juin 2012, n° 2012-254 QPC, Fédération de l’énergie et des mines – Force ouvrière FNEM FO (Régimes spéciaux de sécurité sociale).
-
3.
Cons. const., 11 déc. 2015, n° 2015-508 QPC.
-
4.
Cons. const., 17 sept. 2015, n° 2015-480 QPC.
-
5.
Cons. const., 25 sept. 2015, n° 2015-485 QPC.
-
6.
Cons. const., 27 nov. 2015, n° 2015-500 QPC.
-
7.
Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 15-40021.
-
8.
Cass. 2e civ., 26 avr. 1990, n° 88-10337.
-
9.
De Poulpiquet J., « Les prestations compensatoires après le divorce », JCP 1977, I, 2856, n° 10.
-
10.
Cathélineau A., « L’indemnité exceptionnelle de l’article 280-1 al. 2 du Code civil », D. 1998, p. 194.
-
11.
Carbonnier J., Droit civil, vol. 1, 2004, PUF, quadrige, n° 613.
-
12.
Douchy M., La notion de quasi-contrat en droit positif français, 1997, Economica, nos 110 et s.
-
13.
Sériaux A., « La nature juridique de la prestation compensatoire ou les mystères de Paris », RTD civ. 1997, n° 7, p. 53.
-
14.
De Balzac H., « Scènes de vie parisienne, L’interdiction », in Œuvres complètes, 2015, Arvansa Editions, p. 4779.
-
15.
Pérochon F., Entreprises en difficultés, 10e éd., 2014, LGDJ, n° 37.
-
16.
V. Juredieu F., « L’instance dans les procédures collectives. À propos des décisions du Conseil constitutionnel sur les saisines d’office », in Mélanges Rossetto J., 2016, LGDJ, p. 303.
-
17.
Pour un bilan, voir Favario T., « Le livre VI du Code de commerce en son miroir constitutionnel », RPC 2015, n° 4, étude n° 12.
-
18.
Pérochon F., ibid., n° 1076 ; Le Corre M., Droit et pratique des procédures collectives, 2015, Dalloz Action, n° 511-51 évoquant une « forme d’expropriation des titres d’associés pour cause entrepreneuriale » ou encore Roussel Galle P., obs. sous Cass. com., 9 févr. 2010, n° 09-10800 : Rev. sociétés 2010, p. 194.
-
19.
Voir Cheynet de Beaupré A., « L’expropriation pour cause d’utilité privée », JCP G 2005, I, 144.
-
20.
Ibid., n° 26.
-
21.
Cass. com., 19 févr. 2008, n° 06-18446 : JCP E 2008, 2062, spéc. n° 17, obs. Pétel P.
-
22.
Cons. const., 28 juill. 1998, n° 98-403 DC.
-
23.
Cons. const., 28 juill. 1998, n° 98-403 DC.
-
24.
Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-151 QPC.
-
25.
Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-15305 : BJE juill. 2013, n° 110b3, p. 244, obs. Favario T.
-
26.
Cass. com., 9 févr. 2010, n° 09-10800.
-
27.
V. Pérochon F., ouv. préc., n° 1137. On a toutefois assez justement relevé que « cette mesure est nécessairement limitée dans le temps, et à son expiration, on risque de voir renaître les difficultés. Dès lors, la cession forcée de ses titres ou d’une fraction de ceux-ci, pour lui faire perdre son influence, peut constituer une mesure utile » (Roussel Galle P., « La cession forcée des titres du dirigeant et le ministère public », Rev. sociétés 2013, p. 521).
-
28.
Voir Roussel Galle P., « Associés, dirigeants et plans de continuation dans la société en difficulté », BJS déc. 2009, p. 1109.
-
29.
Voir Cerati-Gauthier A., « Constitutionnalité des dispositions autorisant la cession forcée des titres du dirigeant en redressement judiciaire », JCP E 2015, 1562, spéc. n° 47.
-
30.
Hyest J.-J., Rapport commissions des lois, Sénat, n° 335, 2004/2005, t. 1, p. 331 cité par Roussel Galle P., « Associés, dirigeants et plans de continuation dans la société en difficulté », BJS déc. 2009, p. 1109.
-
31.
Monsèrié-Bon M.-H., « Lettre d’actualité des Procédures collectives », nov. 2015, n° 18, repère n° 278 ; BJE nov. 2015, n° 112u5, p. 362, Favario T.
-
32.
Menuret J.-J., « La saisine d’office du Conseil de la concurrence au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme », Contrats, conc. consom. janv. 2002, chron. n° 1, n° 7. V. aussi en ce sens Mainguy D. et Depincé M., Droit de la concurrence, 2e éd., 2015, Lexisnexis, n° 50.
-
33.
Menuret J.-J., op. cit., n° 20.
-
34.
Commentaire de la décision n° 2015-489, p. 16 ; site internet du Conseil constitutionnel.
-
35.
Consciente des faiblesses de cet encadrement, l’Autorité de la concurrence a publié le 16 mai 2011 un communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires. Voir Roskis D. et Dorémus C., « sanction des pratiques anticoncurrentielles : vers plus de prévisibilité et de transparence ? » : Contrats, conc. consom. 2011, étude n° 11.
-
36.
C. pén., art. 521-1, al. 8.
-
37.
Sur son histoire, v. Perrot X., « L’athlète des gallodromes. Le coq de combat animal domestique et de compétition », Revue semestrielle de droit animalier, 2/2012, p. 319.
-
38.
De Lamy B., « Le coq, le taureau et le Conseil constitutionnel : fable sur la nature », RSC 2015, p. 718.
-
39.
JOAN 18 juin 1964, 2e séance, p. 2040.
-
40.
JOAN 10 oct. 1963, p. 5127.
-
41.
Cons. const., 21 sept. 2012, n° 2012-271 QPC, Association Comité radicalement anti-corrida.
-
42.
Roblot-Troizier A., « Chronique de jurisprudence, Droit administratif et droit constitutionnel », RFDA 2013, p. 141. V. Deumier P., « La tradition tauromachique, source sentimentale du droit (ou l’importance d’être constant) », RTDC 2007, p. 57.
-
43.
CPP, art. 2-1 à 2-23. V. Guinchard S., « Les moralisateurs au prétoire », in Mélanges Foyer 1997, p. 477 ; Larguier J., « L’action publique menacée », D. 1958, p. 29 ; Volff J., « La privatisation rampante de l’action publique », Procédure janv. 2005, étude n° 1.
-
44.
Cons. const., 28 févr. 2012, n° 2012-647 DC.
-
45.
Cass. crim., 7 mai 2010, n° 09-80744 ; Cass. crim., 5 déc. 2012, n° 12-86382 ; Cass. crim., 6 mai 2014, n° 14-90010.
-
46.
Troper M., « Droit et négationnisme : la loi Gayssot et la Constitution », Annales Histoire, Sciences sociales 1999, n° 6, p. 1239.
-
47.
V. Francillon J., RSC 1998, p. 577.
-
48.
V. sur cette question : Droin N., Les limitations à la liberté d’expression dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Disparition, permanence et résurgence du délit d’opinion, thèse, 2010, LGDJ-Fondation Varenne ; Francillon J., « Pénalisation des discours négationnistes et liberté d’expression », in Mélanges Bontems C., 2013, L’Harmattan, p. 219.
-
49.
Rome F., « Retour sur les lois mémorielles », D. 2007, p. 489. Contra : Mathieu B., Le Pourhiet A.-M. et a., « Observations relatives à la loi visant à réprimer la contestation des génocides reconnus par la loi », Constitutions 2012, p. 393.
-
50.
Pourquoi cette anonymisation de façade ? L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdisant l’enregistrement des audiences n’est applicable qu’aux juridictions administratives et judiciaires ; l’article 9 du règlement intérieur du 4 février 2010 autorise la diffusion de l’audience sur le site internet du Conseil constitutionnel. Devant le Conseil, le procès est fait à une disposition législative, non contre une personne. Pourquoi, si anonymisation il doit y avoir, ne pas alors l’étendre aux noms des personnes morales ?
-
51.
V. D. 1999, p. 253, obs. Jan P.
-
52.
CEDH, 26 juin 2003, n° 45019/98, Pascolini c/ France.
-
53.
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83207.
-
54.
Boucher P., « Ronronner », D. 2015, p. 2085. Adde : Céré J.-P., « Le Conseil constitutionnel et le travail en prison : une occasion manquée ? », D. 2015, p. 2083 ; Auvergnon P., « Travail en prison : le combat continue ! », Dr. soc. 2016, p. 64.
-
55.
Citée par Rambaud G., Le travail en prison. Enquête sur le business carcéral, 2010, Autrement, Mutations, p. 63, note 1. V. Jacquot S. et Raimbourg D. qui proposent la création d’une agence nationales des personnes placées sous main de justice et la création d’un contrat de travail de droit administratif : Prison : le choix de la raison, 2015, Economica, spéc. p. 65.
-
56.
V. en faveur de la publication des opinions séparées (dissidentes ou concordantes), entre autres : Mastor W., « Point de vue scientifique sur les opinions séparées des juges constitutionnels », D. 2010, p. 714 ; Bourdoiseau J., « Le secret de la délibération », Procédures 2011, dossier n° 6.
-
57.
« les mesures qui ont été arrêtées (…) ont permis d’atteindre des résultats significatifs » (CE, ord., 27 janv. 2016, n° 396220, Ligue des droits de l’homme et autres).
-
58.
V. à cet égard, les recensements exhaustifs effectués périodiquement par la commission des lois de l’Assemblée nationale et le comité de suivi de la commission des lois du Sénat.
-
59.
Cons. const., 25 janv. 1985, n° 85-187 DC : Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie, Rec. 13.
-
60.
Ibid.
-
61.
CE, 14 nov. 2005, n° 286835, Rolin.
-
62.
CE, ass., 24 mars 2006, n° 286834, Rolin et Boivert : Rec. p. 171.
-
63.
CE, 14 nov. 2005, n° 286835, Rolin.
-
64.
Valls M., JO Sénat, 20 nov. 2015, p. 11148.
-
65.
Il est certain que dans l’attente de l’intervention du juge constitutionnel (qui doit être saisi par renvoi de la part du Conseil d’État ou de la Cour de cassation), le justiciable peut subir une série variable de préjudices. Il est aussi possible que la décision finale revête pour lui seulement des effets platoniques. Ainsi, M. Cédric D., assigné à résidence par arrêté le 25 novembre et ce jusqu’au 12 décembre 2015, a pris connaissance seulement le 22 décembre 2015 de la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2016-527 QPC, M. Cédric D.). Une fois cela posé, il faut bien admettre l’existence d’une tardiveté intrinsèque de l’action juridictionnelle. Comment pourrait-il en être autrement puisque le juge ne peut agir qu’après l’acte litigieux ayant porté potentiellement atteinte aux droits du justiciable ? Cette situation n’est pas du reste propre au régime d’exception (Contra : Beaud O. et Guérin-Bargues C., « L’état d’urgence de novembre 2015 : une mise en perspective historique et critique », Jus Politicum, n° 15, passim).
-
66.
Rivero J., « À propos de la loi Sécurité et liberté : filtrer le moustique et laisser passer le chameau. À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 1981 », AJDA juin 1981, p. 275.
-
67.
En réalité, le débat n’a pas lieu d’être puisque le Conseil statue en QPC dans une logique abstraite sans avoir connaissance des pièces du dossier.
-
68.
Cons. const., 23 juill. 2015, n° 2015-713 DC, Loi relative au renseignement.
-
69.
Voir aussi son audition sur le projet de la loi constitutionnelle relatif à la constitutionnalisation de l’état d’urgence (Rapport Bas, Sénat, Doc. Parl. n° 447, enregistré à la présidence du Sénat le 9 mars 2016, p. 147-154) et l’entretien donné au magazine Le Point du 6 avril 2016 (Site internet de la Cour de cassation). Sans remettre en cause l’équilibre général, le Sénat a entendu, lors du processus de révision constitutionnelle avorté, expressément indiquer qu’en période d’état d’urgence, « il ne peut être dérogé à la compétence que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l’article 66 » (Texte adopté, Doc. Parl. n° 113, 22 mars 2016).
-
70.
Louvel B., Audience solennelle de rentrée, 14 janv. 2016, site internet de la Cour de cassation.
-
71.
Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, Perben 2 : Rec. 66.
-
72.
CE, sect., 11 mai 1951, Consorts Baud : Rec. 265.
-
73.
Indépendamment des difficultés dans certaines situations factuelles de distinguer ce qui relève de la prévention et de la répression, il est à souligner que des opérations de police administrative peuvent relever in fine de l’autorité judiciaire. C’est en sens que l’article 78-2 du Code de procédure pénale indique que l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée notamment par des officiers de police judiciaire « pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ». Le Conseil constitutionnel a toutefois, par une réserve d’interprétation, précisé que « l’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle » (Cons. const., 5 août 1993, n° 93-323 DC, Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité : Rec. 213).
-
74.
Cons. const., 14 oct. 2015, n° 2015-490 QPC, M. Omar K.
-
75.
Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2016-527 QPC, M. Cédric D.
-
76.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, Ligue des droits de l’Homme.
-
77.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC, Ligue des droits de l’Homme.
-
78.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC.
-
79.
« L’inscription dans la Constitution de ces conditions donne la garantie la plus haute que, sous le choc de circonstances, la loi ordinaire ne pourra pas étendre les conditions d’ouverture de l’état d’urgence ». Exposé des motifs, projet de loi constitutionnelle, Doc. AN, n° 3381. Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2015, p. 4. « Le régime de l’état d’urgence [est] à l’abri des “emballements” causés par les circonstances, ou des combinaisons d’une majorité de rencontre ». (Rapp. AN, Raimbourg, Doc. Parl. n° 3451, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2016, p. 11).
-
80.
Cons. const., 14 oct. 2015, n° 2015-490 QPC, M. Omar K.
-
81.
V. en ce sens le rapport Mercier, Sénat, Doc. Parl. n° 368, enregistré à la présidence du Sénat le 3 février 2016, p. 39.
-
82.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, cons. 4.
-
83.
Cons. const., 29 déc. 1983, n° 83-164 DC, Loi de finances pour 1984 : Rec. 67.
-
84.
« À l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ». Cons. const., 23 janv. 1987, n° 86-224 DC, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence : Rec. 8.
-
85.
Cons. const., 25 juill. 1989, n° 89-256 DC, Loi portant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’agglomérations nouvelles : Rec. 53.
-
86.
Cons. const., 23 janv. 1987, n° 86-224 DC, Ibid. C’est dans une logique approchante que la contestation d’une décision de placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière faisait, avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, intervenir, d’abord, le juge administratif (dans un délai de 48 heures) puis le juge judiciaire afin d’autoriser la prolongation de la rétention au-delà d’une durée de cinq jours. Désormais, le juge judiciaire sera le seul à se prononcer sur la décision de placement en rétention et des conditions de son exécution. Toutefois, le juge administratif reste toujours compétent pour statuer sur la légalité de la mesure d’éloignement.
-
87.
Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2016-527, cons. 6.
-
88.
Cons. const., 8 juin 2012, n° 2012-253 QPC, M. Mickaël D. : Rec. 289, voir chron. n° 4.
-
89.
En écho : « Mais en commission hier, Guillaume Larrivé a très bien résumé l’ensemble du débat : huit heures, c’est peut-être un peu court, mais vingt-quatre heures, c’est peut-être un peu long. Voilà une conversation intéressante, même si je ne suis pas sûr qu’elle soit à la hauteur du sujet ». Urvoas J.-J., JOAN, 19 nov. 2015, p. 9606.
-
90.
Valls M., JOAN, 19 nov. 2015, p. 9607.
-
91.
L. n° 2015-1501, 20 nov. 2015, prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, art. 11.
-
92.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC, cons. 14.
-
93.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC, cons. 5.
-
94.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC, cons. 9.
-
95.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, cons. 10.
-
96.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC, cons. 9.