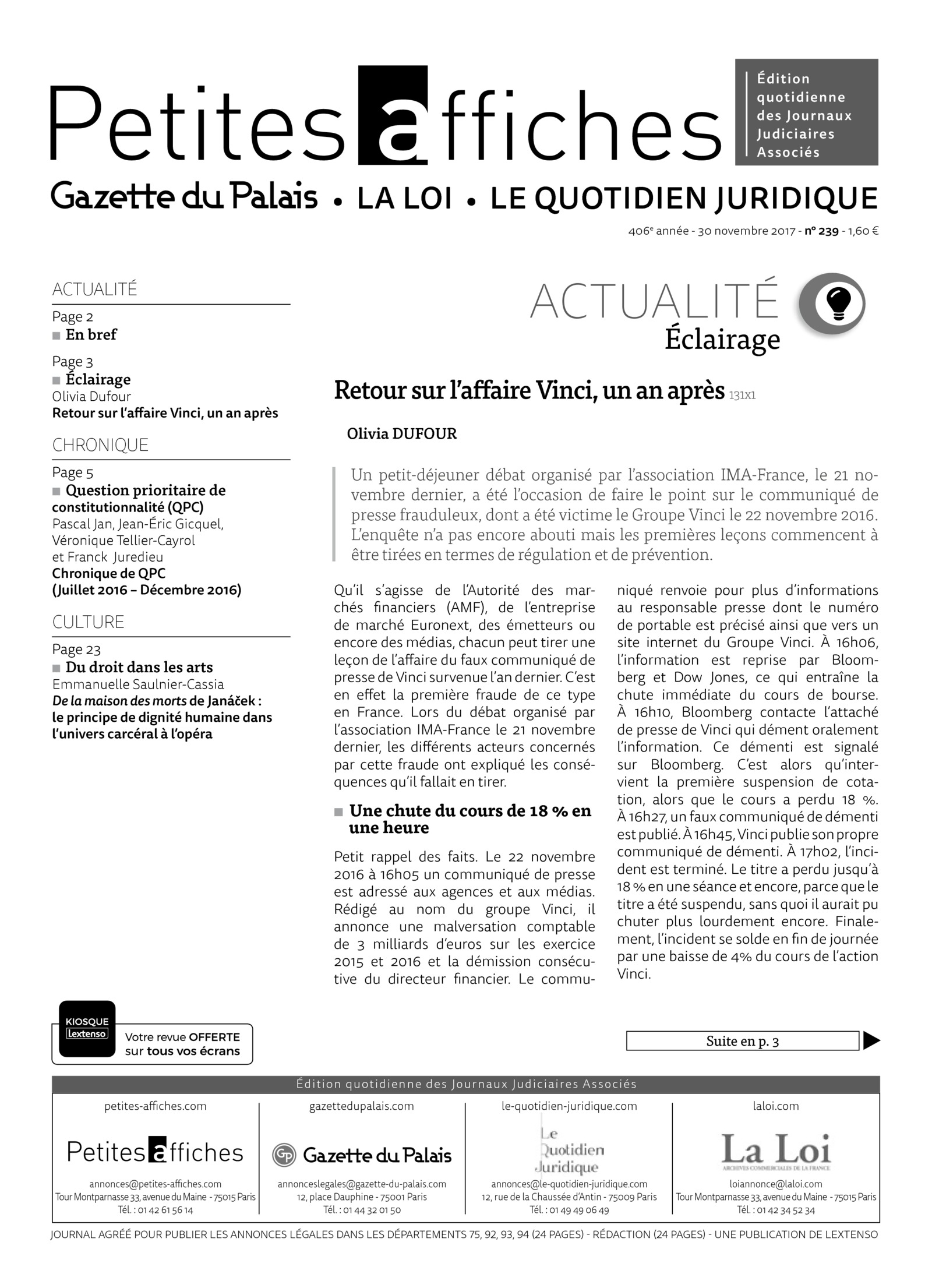Chronique de QPC (Juillet 2016 – Décembre 2016)
La présente étude porte sur les questions prioritaires de constitutionnalité traitées par le Conseil constitutionnel entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016. Cette chronique placée sous la responsabilité du professeur Pascal Jan (professeur – IEP Bordeaux) a été rédigée par Jean-Éric Gicquel (professeur – Rennes 1), Véronique Tellier-Cayrol et Franck Juredieu (maîtres de conférences – Tours).
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a rendu 45 décisions QPC, soit près d’un quart de décisions supplémentaires par rapport au précédent semestre. Si ce semestre est l’un des plus productifs depuis 2010, la répartition entre le Conseil d’État et la Cour de cassation n’a en revanche rien d’inédite puisque 21 transmissions ont été assurées par la juridiction administrative contre 24 pour la juridiction judiciaire. Les requérants, comme on a pu le relever dans les dernières chroniques, sont autant les personnes morales que les personnes physiques – 25/20), ce qui confirme une nouvelle fois l’absence de monopole des lobbies et entreprises dans le déclenchement du contrôle de constitutionnalité a posteriori. Cela tient en partie aux nombreux recours individuels portant, une nouvelle fois, sur des sujets impliquant l’application de dispositions pénales. Les personnes morales invoquent, elles, de préférence les règles et principes en lien avec la fiscalité et particulièrement le principe d’égalité sans oublier la liberté d’entreprendre et le droit de propriété. Pour la période étudiée, on peut par ailleurs noter que parmi ces personnes morales, un certain nombre de questions prioritaires de constitutionnalité intéresse les collectivités territoriales qui contestent des dispositions législatives attentatoires, selon elles, à la libre administration des collectivités territoriale et à l’autonomie financière. Dans un contexte de restriction budgétaire et d’enserrement des budgets locaux, il n’est pas étonnant que les collectivités cherchent à contrecarrer par les voies juridiques les dispositifs approuvés par le Parlement qui affectent leur capacité financière.
Au cours de la période étudiée, le juge constitutionnel a prononcé deux non-lieux à statuer, rendu 23 décisions de conformité, 7 de conformité assorties d’une réserve, 10 décisions de non-conformité totale et 3 de non-conformité partielle. Le ratio conformité/non-conformité ne cesse de s’améliorer depuis trois semestres, particulièrement sur les lois les plus récentes ce qui démontre combien le gouvernement et les parlementaires intègrent la contrainte constitutionnelle dans les dispositions législatives. Les parlementaires remplissent un rôle indéniable de vigie constitutionnelle, ce dont on ne peut que se réjouir. Comme par le passé, le Conseil constitutionnel a été saisi de textes importants. De nouveau, il a été conduit à examiner les dispositifs de contrainte sur les personnes (perquisitions, assignation) dans le cadre de l’état d’urgence. Plusieurs fois amené à trancher un contentieux relatif au financement des collectivités territoriales, le Conseil a eu à examiner des questions nouvelles, notamment de droit civil. C’est à propos de l’une d’elles que le Conseil constitutionnel a ainsi reconnu un droit constitutionnel au divorce, droit inhérent à la liberté personnelle au même titre que la liberté de mariage : « Selon l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». Selon son article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Il résulte de ces dispositions une liberté pour chacun de se marier ainsi qu’une liberté de mettre fin aux liens du mariage, composantes de la liberté personnelle. Il est cependant loisible au législateur d’apporter à la liberté de mettre fin aux liens du mariage des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (n° 2016-557 QPC). De même, le Conseil constitutionnel a, pour la première fois, reconnu explicitement le « droit de se taire » : « Selon l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire » (n° 2016-594 QPC). Enfin on relèvera que le juge constitutionnel admet pour la première fois au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution (art. 61-1 C), le principe d’interdiction de toute tutelle d’une collectivité sur une autre qui n’est qu’une extension du principe de la libre administration des collectivités territoriales.
Si le nombre de décisions QPC du Conseil constitutionnel se situe dans la moyenne haute observée depuis trois ans, le nombre de dispositions censurées est proportionnellement moins important que ces derniers trimestres comme il a pu être observé ci-dessus. Les moyens les plus sollicités par les requérants restent le principe d’égalité devant la loi et le principe des droits de la défense et du recours juridictionnel effectif. On observera toutefois que le nombre de moyens par question prioritaire est en régression, ce qui laisse entendre que les requérants ciblent mieux leurs reproches et se rendent compte que « faire feu de tout bois » n’est guère efficace. Enfin, si les transmissions des QPC par les juges ordinaires aboutissent assez largement à des décisions de conformité simple ou avec réserve, il y a autant de décisions de non-conformité totale ou partielle rendues sur la saisine des deux juridictions suprêmes.
I – Le procès constitutionnel
Le début de la présidence de Laurent Fabius a été marquée par quelques nouveautés dans la rédaction des décisions avec l’abandon du traditionnel « considérant » emprunté à la juridiction administrative. Sur ce plan, la période étudiée ne comporte aucune avancée ou nouvelle orientation. De façon générale, le Conseil constitutionnel n’a eu à trancher aucune question particulière au stade de son office. Au contraire, il a confirmé sa jurisprudence antérieure tant sur la recevabilité des interventions (n° 2016-555 QPC), la restriction du champ des QPC qui, notons-le, devient quasi-systématique, le déport des membres du Conseil constitutionnel ou encore sa faculté à soulever d’office des conclusions qu’elles aboutissent (n° 2016-554 QPC) ou non (n° 2016-551 QPC) à une censure des dispositions législatives visées.
Le Conseil constitutionnel a été confronté pour rendre un certain nombre de décisions à l’absence de quorum. On rappellera à ce propos qu’aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1067, du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel « les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal ». En l’occurrence, les décisions rendues les 29 et 30 septembre 2016 l’ont été par six conseillers constitutionnels. Pour les deux décisions rendues le 29 septembre (nos 2016-570 et 2016-573 QPC), l’explication tient à l’abstention de siéger de Jean-Jacques Hyest. En revanche, pour les deux décisions du 30 septembre (nos 2016-571 et 2016-572 QPC), la curiosité tient au fait qu’au cours d’une même séance, M. Pinault s’est abstenu pour juger de la constitutionnalité du cumul des poursuites pénales pour le délit de diffusion de fausses informations avec des poursuites devant la commission des sanctions de l’AMF pour manquement à la bonne information du public et n’a pas siégé pour juger de la constitutionnalité de l’exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés d’un groupe fiscalement intégré sans que pour cette dernière décision, le commentaire ne précise le refus explicite du conseiller constitutionnel de siéger.
Il conviendrait sur cette question somme toute mineure qu’à l’avenir le Conseil constitutionnel fasse état et identifie explicitement dans le dispositif de la décision de l’abstention volontaire d’un conseiller constitutionnel. Il en va de la transparence des décisions du Conseil, laquelle ne saurait se contenter d’une mention en introduction du commentaire officiel de la décision sur le site du Conseil constitutionnel. Enfin, parmi le lot de décisions étudiées, on relèvera une décision rectifiant une erreur matérielle conformément à l’article 13 du règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité qui énonce que « si le Conseil constitutionnel constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, il peut la rectifier d’office, après avoir provoqué les explications des parties et des autorités mentionnées à l’article 1er » (n° 2016-565 QPC).
S’agissant du champ des droits et libertés garantis par la Constitution au sens de l’article 61-1 de la Constitution et des dispositions législatives susceptibles d’être examinées, l’on sait que Conseil constitutionnel s’interdit de contrôler une disposition législative qui n’est que la transposition d’une directive (n° 2015-520 QPC). Seule une atteinte à une règle ou à un principe inhérent à l’identité constitutionnelle qui n’est pas neutralisée par une disposition constitutionnelle contraire est susceptible d’être invoquée devant le juge constitutionnel. Mais saisi de dispositions législatives relatives au mandat d’arrêt européen, le Conseil se doit de déterminer si elles ne sont que la transposition d’un acte de l’Union ou, au contraire, s’inscrivent dans la marge d’appréciation laissée au législateur national. Dans une affaire n° 2016-602 QPC, le Conseil constitutionnel a ainsi examiné la recevabilité d’un moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative prise pour l’application de l’article 12 de décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen. Il en a conclu qu’en l’espèce les dispositions critiquées (voies de recours) découlaient de la liberté autorisée du législateur. Qu’en conséquence, la question de leur conformité à la Constitution pouvait être utilement soutenue.
Pascal Jan
II – La jurisprudence
A – QPC transmise par la Cour de cassation
1 – Droit de la famille
Prononcé du divorce subordonné à la constitution d’une garantie par l’époux débiteur d’une prestation compensatoire en capital
Cons. const., 29 juill. 2016, n° 2016-557 QPC, M. Bruno B. Cette décision apporte une contribution importante au droit de la famille puisqu’elle consacre une nouvelle liberté constitutionnelle, celle de mettre fin au mariage.
La QPC portait sur l’article 276, 1°, du Code civil qui permet au juge, lorsque la prestation compensatoire en capital s’exécute sous la forme d’un versement d’une somme d’argent, de décider que le prononcé du divorce sera subordonné à la constitution de garanties. L’auteur de la QPC soutenait que cette disposition fait obstacle au divorce lorsque le débiteur de la prestation se trouve dans l’incapacité de constituer la garantie exigée par le juge. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté du mariage : faute de fournir la garantie exigée par le juge, l’époux ne pourrait obtenir le divorce et par conséquent se remarier en application de l’article 147 du Code civil.
L’argumentation développée par le requérant n’est pas totalement nouvelle. Sous l’angle du contrôle de conventionalité, la Cour de cassation avait déjà eu à se prononcer, en 20071, sur la compatibilité de cette disposition2 avec le droit de contracter mariage. Elle avait considéré, avec la concision qu’on lui connaît, que cet article n’instaurait pas un empêchement au remariage dans la mesure où son application ne fait que différer provisoirement certains effets de la décision de divorce afin de garantir le versement du capital au créancier de la prestation. Effectivement, l’empêchement au mariage n’est que relatif puisque l’obstacle du divorce peut être levé en exécutant la prestation compensatoire.
La décision du 29 juillet 2016 intègre l’essentiel de cette motivation adaptée aux exigences constitutionnelles. Le Conseil souligne que le but de la disposition est la protection du conjoint créancier de la prestation compensatoire et qu’ainsi le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général (§ 7). Il relève par ailleurs, en écho là encore à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les dispositions contestées n’ont d’autre effet que de retarder le prononcé du divorce (§ 7). Le Conseil constitutionnel déclare donc l’article 276, 1°, conforme à la Constitution. L’intérêt de la décision est ailleurs, dans le fondement retenu par le juge constitutionnel : alors que le requérant visait la seule liberté matrimoniale, le Conseil relève, en application des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, l’existence d’une « liberté pour chacun de se marier ainsi qu’une liberté de mettre fin aux liens du mariage, composantes de la liberté personnelle ».
L’affirmation est remarquable, surtout si l’on se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui s’est, jusqu’à maintenant, opposée à la reconnaissance d’un tel droit (CEDH, 18 déc. 1986, n° 9697/82, Johnston et a. c/ Irlande). Elle n’est pas pour autant surprenante.
La reconnaissance d’une liberté de mettre fin aux liens du mariage s’explique tout d’abord par le fait que la liberté matrimoniale, invoquée par le requérant, s’accordait mal avec la question posée. La prestation compensatoire, ce dont atteste sa nature alimentaire, est un prolongement du devoir de secours créé par le mariage de sorte que l’article 276, loin de s’opposer à la liberté matrimoniale, en marque l’aboutissement en garantissant l’exécution de la prestation compensatoire3. À proprement parler, le principe en cause dans cette affaire n’était pas tant la liberté de se marier que celle de se remarier. Or cette liberté est indissociable de l’affirmation d’un premier droit, celui de mettre fin au mariage4. C’est donc à raison que le Conseil constitutionnel a placé la question du droit de divorcer au centre de sa décision.
Au-delà de la réponse apportée à la QPC, la reconnaissance de la liberté de mettre fin au mariage trouve son origine à la fois dans l’ancienneté du droit du divorce et dans son évolution, parallèle à celle de la société. Le divorce, faut-il le rappeler, a été rétabli en 1884 avec la loi Naquet et n’a plus quitté le Code civil. Avec la grande réforme de 1975, le législateur a posé les bases du divorce moderne, indissociable de l’idée de liberté. Les causes de rupture ont été élargies ; les considérations morales, sans disparaître complètement, ont cédé en importance. Particulièrement, avec l’introduction du divorce pour rupture de la vie commune, le législateur a admis que la rupture du mariage pouvait intervenir indépendamment de toute faute et sans l’accord des deux époux. La loi du 26 mai 2004 s’inscrit dans la continuité de cette réforme. Une plus grande place est laissée à la liberté des époux souhaitant divorcer, que ce soit par la multiplication des passerelles entre les causes de divorce ou par une tendance à la contractualisation du divorce, phénomène qui trouvera sa pleine mesure avec le nouveau divorce par consentement mutuel effectif depuis le 1er janvier 20175. Surtout, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, amélioration technique du divorce pour rupture de la vie commune6, crée un droit à la rupture pour l’époux demandeur7 : désormais, avec la suppression de la clause de dureté, le défendeur ne peut plus s’opposer à la dissolution du mariage. Ce droit n’est cependant pas absolu et ne saurait être assimilé à une répudiation8. Son exercice n’est pas laissé à la discrétion du demandeur puisqu’il fait l’objet d’un contrôle du juge sur la durée de séparation du couple. En outre, le législateur, par le mécanisme de la demande reconventionnelle, offre au défendeur la possibilité de répliquer à la demande initiale. La liberté de mettre fin au mariage apparaît ainsi inséparable du principe d’égalité9.
On retrouve, dans la décision du Conseil constitutionnel, cette approche du divorce. Le Conseil constitutionnel ne consacre pas un « droit au divorce » mais une liberté de mettre fin au mariage, ce qui semble écarter toute idée d’un droit subjectif, unilatéral, à la rupture des liens matrimoniaux. Par ailleurs, le juge constitutionnel, comme toujours, encadre l’exercice de ce principe, en rappelant qu’« il est loisible au législateur d’apporter à la liberté de mettre fin aux liens du mariage des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (§ 5). Il est certain néanmoins que si le législateur souhaitait restreindre le droit du divorce, il devrait désormais s’interroger sur la conformité de cette modification avec le droit constitutionnel10.
Franck Juredieu
2 – Droit des successions
Extinction des créances pour défaut de déclaration dans les délais en cas d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net
Cons. const., 5 oct. 2016, n° 2016-574/575/576/577/578 QPC, société BNP PARIBAS SA. Cette décision QPC porte sur les modalités d’application de l’« ACAN », l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. Le dispositif, créé par la loi du 23 juin 2006, a remplacé l’ancienne acceptation sous bénéfice d’inventaire. La finalité du dispositif est la même – permettre à l’héritier de limiter son obligation aux dettes – mais son régime a été rénové afin de rendre l’acceptation plus attractive pour l’héritier et plus sûre pour les créanciers11. L’une des principales innovations du dispositif réside dans l’obligation, pour les créanciers de la succession, de déclarer leurs créances. L’article 792 alinéa 2, qui faisait l’objet de la QPC, dispose à ce titre que « faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité de l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci ».
Compte tenu de la jurisprudence antérieure rendue par la Cour de cassation, la transmission de cette QPC est assez inattendue. Dans une décision du 22 mai 2013, la haute juridiction avait refusé de renvoyer la QPC portant sur l’ancien article L. 621-46 du Code de commerce, lequel prévoyait pourtant la même sanction que l’article 788 en cas de défaut de déclaration de créance à la procédure collective. Dans les cinq arrêts de renvoi12, la très laconique motivation de la Cour de cassation (« la question posée présente un caractère sérieux en ce qu’elle invoque une atteinte au droit de propriété ») tranche avec l’argumentation beaucoup plus dense de l’arrêt du 22 mai 2013. Peu importe, serait-on tenté de penser : la question de la conformité de la sanction du défaut de déclaration des créances méritait sans doute d’être examinée par le Conseil constitutionnel compte tenu des effets radicaux qu’elle produit.
Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La référence à ces deux articles montre qu’aux yeux du Conseil constitutionnel, le droit de créance s’analyse en un droit de propriété. L’affirmation n’est pas inédite13 mais a le mérite de rappeler que ce droit n’est pas uniquement un lien personnel mais aussi un élément du patrimoine, une valeur appropriable14. L’intérêt de la qualification est d’assurer une plus grande protection au créancier, encore que sur ce point, la décision commentée n’en apporte pas la preuve éclatante !
De manière tout à fait classique, le Conseil constitutionnel cherche tout d’abord à savoir si la disposition en cause relève du régime des privations de propriété (art. 17) ou des atteintes aux conditions d’exercice du droit de propriété (art. 2). De prime abord, la première qualification paraît s’imposer : l’extinction de créance ne constitue-t-elle pas une perte définitive et opposable à tous du droit de créance ? Le Conseil constitutionnel considère néanmoins que « dans la mesure où la créance n’est éteinte que si le créancier a omis de la déclarer dans le délai prévu par le législateur pour qu’il accomplisse des diligences, les dispositions contestées n’entraînent pas de privation de propriété » (§ 6). La motivation reprend un argument déjà développé par le passé15 : lorsque le propriétaire a le pouvoir de s’opposer à la perte de son droit, l’article 17 de la Déclaration de 1789 n’est pas en cause. En l’espèce, le créancier avait effectivement la possibilité d’éviter l’extinction de son droit en déclarant sa créance dans les délais fixés par la loi.
Une notion permet d’éclairer la motivation du Conseil constitutionnel, celle d’incombance16 qui désigne une « exigence de diligence ou de probité imposée pour conserver le bénéfice d’un droit »17. Ces obligations d’un genre particulier tendent à se multiplier, signe que le législateur cherche à moraliser et à responsabiliser davantage le créancier. Pour ne citer que deux exemples, l’article L. 332-1 du Code de la consommation impose au créancier de conclure un cautionnement proportionné, sous peine d’être déchu de son droit contre la caution ; l’article L. 742-10 du même code prévoit que le défaut de déclaration à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation entraîne l’extinction du droit des créanciers. À n’en pas douter, la décision commentée s’étend, sur cette question, à ces différents cas d’incombances. Comme pour l’article 788, le créancier étant responsable de la perte de son droit de créance, il ne peut invoquer une privation de propriété : seule une violation de l’article 2 de la Déclaration de 1789 est envisageable.
Sur ce point, le Conseil constitutionnel considère que l’article 788 du Code civil ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété (§ 7). Il relève que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général puisqu’il a cherché à assurer, au travers de cette disposition, l’efficacité de l’acceptation de la succession et ainsi à faciliter la transmission des patrimoines. Le Conseil constitutionnel aurait pu également mettre en avant l’intérêt que présente l’article 788 pour les créanciers eux-mêmes. La procédure de déclaration des créances participe de l’organisation du paiement : elle offre davantage de prévisibilité aux créanciers, ceux-ci étant payés dans l’ordre de leur déclaration18. L’intérêt protégé n’est donc pas uniquement celui de l’héritier et il est dommage que le Conseil n’ait pas intégré dans sa décision l’ensemble des objectifs suivis par le législateur.
Pour justifier la conformité de la disposition, le Conseil considère par ailleurs que des garanties sont offertes aux créanciers puisque ceux-ci disposent d’un délai de quinze mois pour déclarer leurs créances et que l’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de signaler l’existence d’une créance au passif est, au titre de l’article 800 du Code civil, déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net. On peut penser effectivement que le délai relativement long de déclaration protège suffisamment les créanciers, même non-professionnels. À titre de comparaison, la déclaration des créances à la procédure de rétablissement personnel obéit à un délai beaucoup plus court, deux mois à compter là encore de la publication au BODACC. Même si les créanciers à cette procédure disposent d’autres garanties, notamment la possibilité de demander un relevé de forclusion, il serait intéressant de connaître la position du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de l’article L. 742-10 du Code de la consommation. Cette disposition fera peut-être l’objet d’une prochaine QPC.
Franck Juredieu
3 – Droit des procédures collectives et droit pénal
Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d’interdiction
Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-570 QPC, M. Pierre M. et Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-573 QPC, M. Lakhdar Y. En trois mois (juillet-septembre 2016), pas moins de cinq décisions QPC ont été rendues relativement à des questions de cumul de poursuites et de sanctions. Depuis la fameuse décision du 18 mars 2015, et après les décisions Wildenstein et Cahuzac du 24 juin 201619, le Conseil constitutionnel a ainsi eu l’occasion de parfaire sa jurisprudence en la matière.
Deux décisions concernent le droit des procédures collectives, décisions pour lesquelles Jean-Jacques Hyest s’est déporté, ayant été le rapporteur au Sénat du projet de loi devenu la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
En vertu des articles L. 653-3, L. 653-4, et L. 653-5 du Code de commerce, le juge de la procédure collective (juge civil ou commercial) peut prononcer, contre les personnes visées à l’article L. 653-1, la faillite personnelle – laquelle emporte interdiction de gérer (C. com., art. L. 653-2) – ou seulement l’interdiction de gérer (C. com., art. L. 653-8) pour des faits liés à une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
Le juge pénal, peut, quant à lui, condamner, pour des faits identiques, les mêmes personnes pour banqueroute à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (C. com., art. L. 654-3) ou sept ans et 100 000 € d’amende (C. com., art. L. 654-4). Au titre des peines complémentaires de l’article L. 654-5, il peut prononcer soit la faillite personnelle, soit l’interdiction de gérer de l’article L. 653-8 « à moins qu’une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l’occasion des mêmes faits » (C. com., art. L. 654-6).
Face à cette combinaison de mesures et de juges, les requérants se fondaient sur deux griefs. D’une part, ils invoquaient une atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 au motif qu’une même personne peut être condamnée à la faillite personnelle ou à une interdiction de gérer par le juge civil et par le juge pénal. Ils invoquaient d’autre part une atteinte au principe d’égalité devant la loi. Seul ce dernier principe a conduit à une abrogation.
Le principe de nécessité et de proportionnalité des peines. Avant d’apprécier la conformité de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen aux dispositions du Code de commerce en cause, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur une question discutée, celle de la nature juridique de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer. Si les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et peines, comme le rappelle le juge constitutionnel, « ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales » (n° 2016-570 QPC, § 3) encore fallait-il vérifier que les sanctions prévues en matière de redressement et de liquidation judiciaire répondissent au caractère d’une punition. D’aucuns ont considéré que la nature juridique de ces sanctions dépendait de la juridiction prononçant la sanction : elles auraient une nature professionnelle en cas de saisine du juge civil ou commercial mais seraient constitutives d’une peine lorsque le juge pénal prononcerait une faillite personnelle20. Dans la mesure toutefois où la sanction est identique dans les deux cas, il apparaît discutable de faire dépendre la nature juridique de ces mesures de la seule qualité du juge. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2006, les a qualifiées de « mesures d’intérêt public »21 et en a déduit que la rétroactivité in mitius ne s’appliquait pas. Destinées à écarter le débiteur fautif de la vie des affaires, ces mesures revêtent, autrement dit, une finalité préventive. Toutefois, d’autres arrêts ont semblé suivre un raisonnement différent. Ainsi, dans un arrêt du 1er décembre 200922, la Cour de cassation a reconnu que le principe de proportionnalité s’appliquait aux mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer. N’était-ce pas, par là même, leur reconnaître un caractère de punition ?
Face à ces incertitudes – lesquelles sont sans doute le reflet de la double nature des mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer -, la décision du Conseil constitutionnel a le mérite de la clarté. En se fondant sur la généralité de la mesure d’interdiction de gérer et sur les conséquences attachées à la faillite personnelle, le juge constitutionnel considère que « le législateur a entendu, en instituant de telles mesures, assurer la répression, par le juge civil ou commercial, des manquements dans la tenue d’une comptabilité » (n° 2016-570 QPC, § 5 ; n° 2016-573 QPC, § 10). La qualification de punition doit être approuvée, particulièrement pour la faillite personnelle dans la mesure où cette sanction, particulièrement grave, entraîne d’autres effets que l’interdiction de gérer23. Ainsi, l’article L. 643-11 III 1° prévoit que les créanciers peuvent agir en recouvrement de leur créance contre le débiteur en faillite personnelle et ce, malgré la clôture de la liquidation. Il ne fait guère de doute que cette dérogation à la règle de la paralysie du droit d’action des créanciers marque la volonté du législateur de punir le failli.
Les deux décisions portent ensuite sur l’application du principe de nécessité des délits et des peines aux sanctions prononcées par le juge civil ou commercial et le juge pénal. Pour rappel et selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel24 reprise dans les deux décisions, le principe de nécessité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente. Le cumul de sanctions semblait a priori difficile à admettre dans les deux QPC commentées car, comme le reconnaît le Conseil constitutionnel, « les sanctions de faillite personnelle et d’interdiction de gérer (…) sont identiques à celles encourues devant la juridiction pénale pour les mêmes manquements constitutifs du délit de banqueroute » (n° 2016-570 QPC, § 7 ; n° 2016-573 QPC, § 12). Le Conseil rejette pourtant l’argumentation des requérants au motif que le juge pénal peut par ailleurs condamner l’auteur de la banqueroute à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende ainsi qu’à plusieurs peines complémentaires d’interdictions. En d’autres termes, pour le Conseil constitutionnel, même s’il existe un « tronc commun » de sanctions, les faits sont susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente puisque le juge pénal dispose de peines plus nombreuses et plus graves que le juge civil.
Même si l’on comprend bien le raisonnement du Conseil constitutionnel – privilégier une approche globale des mesures plutôt qu’une confrontation individuelle des différentes sanctions – et sa finalité – limiter les remises en cause de cumuls de sanctions –, il est difficile, toutefois, de ne pas trouver cette motivation quelque peu elliptique. Le Conseil indique que les sanctions de faillite personnelle et d’interdiction de gérer sont identiques, et que le juge pénal dispose d’autres sanctions de nature différente. Mais il revient au lecteur d’en tirer la conclusion en se référant alors au principe de proportionnalité dégagé dans d’autres décisions constitutionnelles : le cumul de sanctions semble possible dans la limite du maximum légal encouru. Cette décision a néanmoins une portée très limitée eu égard à la deuxième QPC.
Franck Juredieu
Le principe d’égalité devant la loi. En plus de l’atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, la QPC posée dans la deuxième affaire (n° 2016-573 QPC) soulevait, avec succès cette fois, une violation du principe d’égalité devant la loi.
L’article L. 654-6 du Code de commerce interdit au juge pénal de prononcer à l’encontre de la personne reconnue coupable de banqueroute, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer lorsqu’une juridiction civile ou commerciale l’a déjà prononcée à l’occasion des mêmes faits, ce qui constitue une rare illustration d’une autorité de la chose jugée au civil sur le pénal. La réciproque n’est pas prévue et le juge de la procédure collective n’est pas tenu par la décision de la juridiction répressive.
Comme le note le Conseil constitutionnel, « une personne en redressement ou liquidation judiciaire devant le juge civil ou commercial et poursuivie pour banqueroute devant le juge pénal peut ainsi faire l’objet deux fois d’une mesure de faillite personnelle ou deux fois d’une mesure d’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du Code de commerce si le juge pénal se prononce avant la décision définitive du juge civil ou commercial. À l’inverse, la même personne ne peut faire l’objet qu’une seule fois de telles mesures si le juge civil ou commercial a définitivement statué au moment où le juge pénal se prononce » (§ 16). Cette différence de traitement, qui repose sur la plus ou moins grande rapidité d’intervention du juge civil ou commercial, n’est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général25.
Sans surprise, le Conseil abroge donc l’article L. 654-6 du Code de commerce. Mais il précise « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ». L’abrogation de cet article L. 654-6 du Code de commerce fait-elle revivre l’article L. 654-6 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2008 ? Une telle résurrection de l’ancienne disposition a été proposée par un auteur26 : « la décision ne laisse pas vacant un numéro d’article du Code de commerce. Si l’article L. 654-6 est chassé de l’ordre juridique dans la version qu’il devait à l’ordonnance de 2008, il laisse place à ce même article tel qu’il existait avant ladite réforme », c’est-à-dire dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005. Or l’ancienne version est identique à celle abrogée, l’ordonnance de 2008 ayant simplement ajouté « à l’occasion des mêmes faits ». L’abrogation est donc « illusoire » ; « la même différence de traitement demeure ! », et l’auteur préconise « une autre QPC, visant cette fois l’article L. 654-6 dans sa version telle qu’elle résulte de la loi de 2005 ».
Une telle analyse est discutable. On sait que la résurrection d’une loi abrogée est impossible. Le Conseil d’État l’a affirmé dans un avis du 10 janvier 2008, puis dans un arrêt du 28 septembre 2009, indiquant que l’abrogation ne fait pas revivre le texte abrogé antérieurement. Mais l’hypothèse dans la décision analysée est quelque peu différente puisque l’ordonnance de 2008 n’a fait que compléter l’article L. 654-6 du Code de commerce ; elle n’a pas vraiment supprimé l’ancienne version mais y a rajouté des précisions. Pour autant, il semble possible de considérer qu’une loi modificative abroge l’ancienne version : celle-ci n’est plus en vigueur. Ainsi, soit la censure porte sur l’ajout et seule cette partie du texte sera abrogée ; soit le texte nouveau est abrogé et cette abrogation ne peut faire revivre l’ancienne disposition. L’abrogation d’un texte ne peut entraîner la résurgence d’une version antérieure.
Tenu par la disposition litigieuse invoquée par le justiciable (l’article L. 654-6 du Code de commerce « résultant de l’ordonnance du 18 décembre 2008 »), le Conseil constitutionnel n’avait pas d’autre choix que de s’en tenir à cette version du texte. Mais le commentaire officiel du Conseil ne reprend pas cette précision, indiquant que « le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 654-6 du Code de commerce contraire au principe d’égalité devant la loi. L’abrogation de cet article, qui prend effet à compter de la date de la publication de la décision, prive le juge pénal de la possibilité de prononcer, contre une personne coupable de banqueroute, une mesure de faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 » (p. 24). Le site Legifrance ne fait d’ailleurs plus apparaître cette disposition.
Le juge répressif n’est pas pour autant démuni : outre l’emprisonnement et l’amende, il reste encore au juge pénal la possibilité de prononcer l’interdiction professionnelle de l’article L. 654-5, 2°, du Code de commerce. Si le juge civil ou commercial inflige une mesure analogue, le principe de proportionnalité impose alors que la durée totale de ces mesures ne dépasse pas quinze ans27.
Véronique Tellier-Cayrol
4 – Procédure pénale
Transaction pénale par officier de police judiciaire
Cons. const., 23 sept. 2016, n° 2016-569 QPC, Syndicat de la magistrature et autre. La loi du 15 août 2014 a inséré une nouvelle alternative aux poursuites : la transaction pénale prévue à l’article 41-1-1 du Code de procédure pénale. De nombreux commentaires ont déjà été faits, tant sur cette nouvelle procédure que sur la décision du Conseil28 ; quelques remarques suffiront dans le cadre de cette chronique.
Le Conseil a, d’une part, émis une réserve d’interprétation. Rappelons que cette mesure permet à l’officier de police judiciaire de transiger avec l’auteur de l’infraction, avant l’exercice de toute action publique et sa bonne exécution entraîne l’extinction d’une telle action. Le Conseil rappelle que « pour que les droits de la défense soient assurés dans le cadre d’une procédure de transaction ayant pour objet l’extinction de l’action publique, la procédure de transaction doit reposer sur l’accord libre et non équivoque, avec l’assistance éventuelle de son avocat, de la personne à laquelle la transaction est proposée » (§ 8). Il indique alors que « les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, autoriser qu’une transaction soit conclue sans que la personne suspectée d’avoir commis une infraction ait été informée de son droit à être assistée de son avocat avant d’accepter la proposition qui lui est faite, y compris si celle-ci intervient pendant qu’elle est placée en garde à vue » (§ 9). On peut s’étonner de cette dernière précision. En effet, le décret du 13 octobre 2015 a clairement écarté la possibilité d’une transaction lorsque la personne est placée en garde à vue, en raison de la pression psychologique que peut créer cette mesure de contrainte. L’accord à la transaction d’une personne privée momentanément de sa liberté d’aller et venir peut ne pas paraître tout à fait « libre ».
Le Conseil a, d’autre part, limité le champ de cette transaction. Le vol, infraction entrant initialement dans le champ d’application de cette mesure, devait faire l’objet d’un seuil fixé par décret, ce qui fut fait par le décret du 13 octobre 2015, lequel a fixé la valeur du bien volé à 300 €. Sans surprise, le Conseil a relevé la compétence négative du législateur : « en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de délimiter le champ d’application d’une procédure ayant pour objet l’extinction de l’action publique, le législateur a méconnu sa compétence dans des conditions affectant l’égalité devant la procédure pénale » (§ 17). Ne pouvant censurer le décret, il a abrogé le 4° de l’article 41-1-1 ; autrement dit, il a fait sortir le vol des infractions susceptibles de faire l’objet d’une transaction.
La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a rétabli le 4° de l’article 41-1-1 du Code de procédure pénale en reprenant – cette fois expressément – la limite de 300 €.
Véronique Tellier-Cayrol
Absence de nullité en cas d’audition réalisée sous serment au cours d’une garde à vue
Cons. const., 4 nov. 2016, n° 2016-594 QPC, Mme Sylvie T. Il y a quelque paradoxe à faire prêter serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité » à une personne qui a le droit de se taire. Déjà Beccaria le relevait : « C’est encore une contradiction entre les lois et les sentiments naturels, que d’exiger d’un accusé le serment de dire la vérité, lorsqu’il a le plus grand intérêt à la taire : comme si l’homme pouvait jurer de bonne foi qu’il va contribuer à sa propre destruction ! »29.
C’est pourtant ce qui est arrivé à l’auteur de la QPC ayant donné lieu à la décision du 4 novembre 2016. Dans cette affaire, Mme T. avait été placée en garde à vue en exécution d’une commission rogatoire. Elle a alors été entendue après avoir prêté serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ». À l’occasion d’une requête en nullité dirigée contre les procès-verbaux de sa garde à vue, elle soulève une QPC portant sur « la conformité de l’article 153 du Code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux droits de la défense qui incluent notamment le droit à un procès équitable, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ».
L’article 153 du Code de procédure pénale prévoit que « l’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l’article 154 ». Mais – et le problème se situe bien là –, il ajoute que « le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure ».
C’est cette dernière phrase qui est estimée contraire à la Constitution par la requérante en ce qu’elle méconnaît le droit de se taire et celui de ne pas participer à sa propre incrimination.
Le représentant du gouvernement n’y voyait pas matière à censure. Cette absence de sanction d’un serment en garde à vue est, selon lui, compensée en quelque sorte par la notification obligatoire du droit de se taire. Soit le mis en cause est informé de son droit de se taire et s’il prête serment, il le fait en connaissance de cause ; soit le mis en cause n’est pas informé de son droit de se taire et, qu’il prête serment ou non, la procédure pourra être annulée pour absence de notification.
Le Conseil n’a pas été sensible à ce raisonnement et relève que « faire ainsi prêter serment à une personne entendue en garde à vue de « dire toute la vérité, rien que la vérité » peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l’information qu’elle a reçue concernant ce droit » (§ 8).
La décision ne surprend pas. Déjà, la Cour européenne, dans sa décision Brusco c/ France30, avait condamné une telle prestation de serment d’une personne placée en garde à vue, oxymore contraire aux droits de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence. Dans cette affaire, la procédure était comparable : le requérant, placé en garde à vue en exécution d’une commission rogatoire, avait également prêté serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ». La Cour européenne a estimé « que le fait d’avoir dû prêter serment avant de déposer a constitué (…) une forme de pression, et que le risque de poursuites pénales pour témoignage mensonger a assurément rendu la prestation de serment plus contraignante » (§ 52), d’où « l’atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tel que garanti par l’article 6, § 1, et 3 de la Convention » (§ 55).
Et déjà, sur le terrain des sanctions cette fois, le Conseil constitutionnel avait sanctionné l’absence de nullité du défaut d’enregistrement sonore des débats de cour d’assises : dès lors que l’obligation d’enregistrement est prévue, le non-respect de cette obligation doit être sanctionné31. Ici, dès lors que l’impossibilité de prêter serment en garde à vue est prévue, son non-respect doit de même être sanctionné.
La dernière phrase de l’article 153 du Code de procédure pénale est ainsi abrogée avec effet immédiat. Il est précisé dans le commentaire de la décision que « cette censure ne saurait signifier l’illégalité des auditions d’une personne entendue d’abord comme témoin puis placées en garde à vue en raison de l’apparition de raisons plausibles de la soupçonner. Dans une telle hypothèse, cette personne a valablement été invitée à prêter serment tant qu’elle était considérée comme témoin puis s’est vue notifier, dès que son statut a changé, son droit au silence. Par ailleurs (…) en l’absence d’intervention nouvelle du législateur sur cette question, il appartiendra désormais au juge judiciaire de déterminer au cas par cas, (…) les conséquences à tirer d’une telle irrégularité ». Logiquement, au regard du régime des nullités en garde à vue, la prestation de serment en garde à vue constitue désormais une cause de nullité substantielle faisant nécessairement grief.
Il est dès lors surprenant qu’une proposition de loi, déposée le 15 novembre 2016, ait prévu dans son article 12 que la personne soupçonnée, « avant de commencer sa déposition, (…) prête serment « de dire toute la vérité et rien que la vérité ». Elle est informée de ce que toute déclaration mensongère de sa part, présentant un caractère déterminant, donne lieu, à son encontre, à des poursuites pour déclaration mensongère en application de l’article 434-13 du Code pénal ». Cette proposition a heureusement été écartée. Outre les vices d’inconventionnalité et d’inconstitutionnalité, elle soulevait plusieurs difficultés pratiques. En premier lieu, magistrats et représentants de la police judiciaire ont souligné le risque que cette prestation de serment entraîne un recours effectif plus élevé au droit au silence. En deuxième lieu, les mensonges peuvent avoir une utilité : d’une part pour les enquêteurs – ils peuvent constituer de nouvelles pistes –, d’autre part pour les magistrats en permettant de vérifier la crédibilité du suspect. En dernier lieu, la disposition proposée peut poser problème en cas de procès opposant essentiellement la parole du suspect à la parole de la victime : la prestation de serment du suspect peut décrédibiliser celle de la victime. Cette disposition a donc été supprimée par la commission des lois lors de son examen en janvier 2017.
Véronique Tellier-Cayrol
Communication des réquisitions du ministère public devant la chambre de l’instruction
Cons. const., 16 sept. 2016, n° 2016-566 QPC , Mme Marie-Lou B. et a. Après ses décisions du 9 septembre 201132 et du 23 novembre 201233, le Conseil constitutionnel continue d’améliorer le sort de la partie qui fait le choix de se défendre seule, sans avocat. Étaient ici en cause les alinéas 3 et 4 de l’article 197 du Code de procédure pénale, lesquelles ne permettent pas à la partie non représentée d’obtenir communication du réquisitoire du ministère public.
La chambre criminelle, dans un arrêt du 19 novembre 201434, avait déjà écarté cette impossible communication du réquisitoire à la partie non représentée en se fondant sur l’article préliminaire du Code de procédure pénale et sur l’article 6 de la Convention européenne : le respect des principes du contradictoire et de l’équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l’instruction de statuer sur l’appel d’une ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction sans que la partie qui a choisi de se défendre sans avocat ait été mise en mesure d’obtenir la délivrance, si elle en fait la demande, d’une copie du réquisitoire définitif du procureur de la République.
Fort logiquement, le Conseil constitutionnel reprend le raisonnement tenu dans ses deux décisions précitées. « Dès lors qu’est reconnue aux parties la liberté d’être assistées par un avocat ou de se défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de l’instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère public jointes au dossier de la procédure »35.
Il constate ensuite que la différence de traitement instituée par l’article 197 du Code de procédure pénale ne trouve pas de justification « dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l’ordre public ou l’objectif de recherche des auteurs d’infraction, auxquels concourt le secret de l’instruction ».
L’alignement du statut des parties se défendant seules avec celui des parties assistées d’un avocat ne saurait donc être automatique, comme l’explique d’ailleurs très clairement le commentaire officiel sous la décision QPC du 23 novembre 2012 : « (…) un raisonnement au cas par cas s’impose. Il convient d’apprécier dans chaque hypothèse si la différence de traitement mise en place est justifiée par les circonstances dans lesquelles la disposition intervient. Le principe dégagé par le Conseil constitutionnel ne saurait aboutir à censurer de manière mécanique la disposition contestée, puisqu’une différence de traitement entre les parties privées selon qu’elles sont ou non assistées par un avocat peut être justifiée par une différence de situation ou par le motif d’intérêt général poursuivi, en particulier la préservation du secret de l’instruction. Les garanties inhérentes au statut de l’avocat (le secret professionnel qui n’est que l’une des facettes de la déontologie des avocats) peuvent ainsi justifier qu’il bénéficie – en particulier au regard du secret de l’instruction – d’informations qui ne peuvent être transmises qu’aux avocats des parties ».
Dans un arrêt Menet c/ France du 30 novembre 2005, la Cour européenne des droits de l’Homme tenait le même discours à propos de l’absence de communication du dossier aux parties choisissant de se défendre seules36 : « en droit français, les accusés et les parties civiles, en tant que personnes privées, ne sont pas soumises au secret professionnel, à la différence des avocats. Or le fait que l’accès au dossier de l’instruction est réservé aux avocats (…) découle précisément de la nécessité de préserver le caractère secret de l’instruction » (§ 49). Comme le faisait remarquer le gouvernement français devant la Cour européenne, la partie décide, en parfaite connaissance de cause, de ne pas user de la faculté d’être représentée par un avocat, choisi par elle ou commis d’office, qui aurait eu accès au dossier d’instruction (§ 42). Elle ne peut, ensuite, se plaindre des conséquences procédurales de son choix.
C’est également ce qui a motivé le refus de transmission d’une QPC par la Cour de cassation dans une décision du 17 janvier 2012, QPC qui contestait le même article 197 du Code de procédure pénale mais en ce qu’il prévoit que seuls les avocats des parties ont accès aux pièces du dossier devant la chambre de l’instruction. La Cour de cassation a refusé de transmettre, en relevant que « ni l’exercice des droits de la défense ni les principes d’égalité et du contradictoire commandent qu’il soit ainsi porté une atteinte générale et permanente au secret de l’enquête et de l’instruction dont le respect est garanti par la communication du dossier aux seuls avocats, en raison du secret professionnel auquel ils sont astreints »37.
Pour autant, l’argument fondé sur la préservation du secret de l’instruction peut ne pas paraître suffisant à justifier une mise à l’écart de la partie non assistée d’un avocat. Certes, seul l’avocat est tenu au secret professionnel mais l’article 114-1 du Code de procédure pénale ne prévoit-il pas que le fait, pour une partie, de diffuser une reproduction des pièces ou actes d’une instruction auprès d’un tiers est puni de 10 000 € d’amende ? De manière générale, « le droit à l’assistance d’un défenseur et celui d’accéder au dossier pénal étant deux droits distincts offerts aux parties, la mise en œuvre du second ne devrait pas être conditionnée par l’exercice préalable du premier »38.
Les récentes interventions législatives conduisent à le confirmer. L’article 7 de la directive n° 2012/13/UE, du 22 mai 2012, relative à l’information dans le cadre des procédures pénales impose ainsi le droit d’accès aux pièces essentielles du dossier à n’importe quel stade de la procédure, par la personne arrêtée ou son avocat. La loi du 27 mai 2014, transposant ladite directive, a dû modifier l’article 114 du Code de procédure pénale (« les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier ») mais avait oublié l’article 197 du Code de procédure pénale.
La présente censure du Conseil constitutionnel permet de réparer cet oubli. La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique est venue modifier l’article 197 : désormais, « les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions ».
Véronique Tellier-Cayrol
B – QPC transmise par le Conseil d’État
Droit administratif (ordre public)
Cons. const., 21 oct. 2016, n° 2016-590 QPC, La Quadrature du Net et a. La loi du 24 juillet 2015 a étendu significativement les prérogatives des services de renseignement (principalement la DGSE et la DGSI39) en leur accordant le droit de recourir à un nombre conséquent de techniques de renseignement. Il s’agit, en plus des possibilités reconnues jusqu’ici d’effectuer des interceptions de sécurité (soit des écoutes téléphoniques) et d’accéder aux données de connexion (le big data ou métadonnées concernant, non pas le contenu, mais le contenant d’une conservation : destinataire, durée, fréquence, etc.), de pouvoir géolocaliser des individus, sonoriser des lieux et véhicules ou encore capter à distance des conversations, des images et données informatiques. Pour dire rapidement les choses, il a été décidé d’accorder à ces services les moyens mis à la disposition de l’autorité judiciaire par les lois du 9 mars 2004 et du 14 mars 2011 et d’en rajouter de nouveaux40. Ne soyons pas naïfs. En mettant de côté les impératifs de lutte contre le terrorisme – qui, certes, ne rendent pas tout acceptable ; les États démocratiques pouvant « saper, voire détruire, la démocratie au motif de la défendre (…) ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l’espionnage et le terrorisme, n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée »41, la plupart de ces techniques très intrusives étaient déjà empiriquement et clandestinement utilisées par les services de renseignement. C’est avant la triste année 2015 que la nécessité vit le jour de combler une telle lacune, afin notamment d’éviter des condamnations de la part de la CEDH42 et de conférer aux pratiques existantes une assise juridique43. La loi du 24 juillet 2015 a ainsi été adoptée et le Conseil constitutionnel, saisi entre autres pour la première fois depuis 1958 par le président de la République, a déclaré la plupart des dispositions conformes à la Constitution44.
Mais, on le sait, le débat devant le Conseil n’est pas définitivement clos depuis la mise en place de la QPC. En effet, une disposition législative qui n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision peut faire l’objet d’une contestation a posteriori. C’est dans ce cadre que des associations – dont notamment La Quadrature du Net – spécialisées dans les droits des internautes et des fournisseurs d’accès à internet ont obtenu que les Sages se penchent, cette fois-ci, sur l’article L. 811-5 du Code de la sécurité intérieure. Celui-ci reprend à l’identique une disposition déjà prévue par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications. Il énonce que « les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne » ne sont ni soumises aux Code de la sécurité intérieure pour les interceptions de communications électroniques dites administratives (autorisées par le Premier ministre après l’avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement – CNCTR) ni aux dispositions du Code de procédure pénale pour les interceptions de communications électroniques dites judiciaires (décidées par le juge d’instruction).
Concrètement, tandis que la surveillance des communications électroniques était soumise à un cadre juridique rigoureux, celle relative aux communications hertziennes (soit celles permettant de relier deux sites par un réseau non câblé) continuait d’échapper à tout contrôle au nom de la défense des intérêts nationaux.
De prime abord, une telle surveillance était censée peser peu sur les droits et libertés. Lors de la discussion législative, le rapporteur du projet de loi devant le Sénat s’était voulu rassurant en affirmant que « les capteurs hertziens des armées permettent de recueillir des signaux techniques et des communications électromagnétiques émis depuis l’étranger, par exemple ceux engendrés par des mouvements de troupes, d’aéronefs ou de navires dans une zone donnée. Ces interceptions hertziennes qui résultent du balayage de l’ensemble des gammes de fréquences du spectre électromagnétique, ne concernent pas des identifiants rattachables au territoire national45 ». En résumé, ce régime dérogatoire établi dès 1991 et maintenu en 2015 était justifié par le fait que la surveillance était aléatoire et ne visait donc pas une personne spécifique.
Reste que dans les années 1990, les interceptions de communications ne pouvaient être, en tout état de cause, effectuées que sur le seul réseau filaire (soit entre deux postes téléphoniques fixes). Aussi, les potentialités de surveillance par le réseau hertzien étaient-elles forcément limitées, les communications relayées par radio ou par satellite étant concrètement les seules concernées.
Or, de nos jours, nombreuses de nos communications modernes transitent par le réseau hertzien : notamment celles entre un téléphone portable et l’antenne relais ; un téléphone sans fil et sa base ; un ordinateur portable et une clé 3G/4G ou un spot Wi-Fi. On mesure alors les risques potentiels d’atteintes aux droits et libertés (respect de la vie privée et du secret des correspondances) et de tentations de contournement du cadre légal.
Le Conseil constitutionnel a déclaré logiquement l’article contesté non conforme à la Constitution. Plusieurs raisons justifiaient cette position : a) une telle surveillance n’exclut pas totalement le fait que « que puissent être interceptées des communications ou recueillies des données individualisables » – ce qui réduit à néant la justification de la dérogation jusqu’ici avancée – ; b) l’appui sur la seule « défense des intérêts nationaux » s’avère trop large et enfin c) à l’instar de ce qui avait été décidé en juillet 2015 à propos du régime de surveillance des communications avec l’étranger, le cadre juridique – fixant notamment les conditions de fond et de procédure – brille par son caractère lacunaire.
Soit. On peut tout de même s’interroger sur les comportements des différents acteurs (Conseil d’État en amont, gouvernement, parlementaires et in fine Conseil constitutionnel) à l’égard d’une mesure législative dont l’inconstitutionnalité apparaît finalement flagrante à la lecture de la présente décision. Certes, ce trou noir législatif n’est désormais plus (du moins au plus tard au 31 décembre 201746) mais qu’on ait pu transiter par lui afin de contourner la Commission nationale des interceptions de sécurité (remplacée, par la loi du 24 juillet 2015, par la CNCTR) était un secret de Polichinelle. L’affaire des « fadettes » (les factures téléphoniques détaillées) de journalistes du Monde enquêtant sur l’affaire Bettencourt obtenues de la manière illégale par la DCRI (à qui a succédé en 2014 la DGSI) via l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 en témoigne47 et n’est sans doute que la pointe émergée de l’iceberg48.
Autrement dit, on peut être en droit de reprocher au Conseil de ne pas s’être donné les moyens de soulever d’office l’inconstitutionnalité de l’article L. 811-5 du Code de la sécurité intérieure dès l’été 2015. En effet, eu égard à un tel texte, voué aux gémonies par de nombreux acteurs de la société civile et dont les conséquences sur les droits et libertés sont lourdes en raison du recours autorisé à des techniques intrusives, un examen attentif, approfondi et exhaustif était escompté. Pouvait-on ici prendre le risque de s’en remettre, pour la suite, à la seule ingéniosité juridique des justiciables et à la bienveillance du Conseil d’État chargé de filtrer les QPC49 ?
Plusieurs éléments peuvent toutefois être mis à sa décharge. On passera rapidement sur le fait qu’il est la seule juridiction à être astreinte à statuer dans un délai préfixé (un mois dans le cadre du contrôle a priori ; trois mois pour l’examen a posteriori). Dès lors que le flux devient tendu (et précisément il le fut entre la mi-juillet et la mi-août 2015 où furent concomitamment rendues cinq décisions QPC et huit décisions DC, dont trois d’entre elles portaient sur des textes à la fois majeurs et volumineux, lois NoTRE, Macron et sur le renseignement), cela rejaillit sur sa capacité à soulever d’office des moyens sur le fond50. En réalité, seuls des aspects procéduraux continuent de retenir son attention parce que, eux, ne peuvent être évoqués dans le cadre d’une QPC. Le renforcement de son service juridique en 2016, avec l’adjonction d’un administrateur du Sénat, est une première réponse à la question de l’inadéquation progressive des moyens du Conseil à l’égard de l’accroissement de ses tâches depuis 2010.
Une seconde remarque découle de ce qui vient d’être évoqué. On peut ici se laisser imaginer que les Sages n’avaient peut-être pas tous une vision précise de ce qu’est une transmission empruntant la voie hertzienne et de son utilisation au quotidien. Tout ceci, sauf à être un initié, est loin de tomber sous le sens. À défaut de pouvoir tabler sur l’omniscience des membres du Conseil et de son service juridique, il n’est pas rare, lorsque la loi aborde des domaines techniquement complexes et que les saisines des parlementaires sont expéditives au point de les rendre indigentes, que la lecture d’une de ces « portes étroites » (selon la classique expression du Doyen Vedel), c’est-à-dire « le texte de la contribution déposée (…) par des acteurs de la société civile lors du contrôle a priori de la loi »51 apporte un éclairage important aux Sages ce que certains ont parfaitement reconnu52. Or, en l’espèce, les requérants avaient amplement communiqué sur l’argumentation étoffée, préparée avec le concours d’avocats, adressée directement au Conseil à propos de la loi sur le renseignement53. Mais voilà, cette « porte étroite » avait passé, elle aussi, sous silence la question de la transmission par voie hertzienne…
Peut-être faut-il voir dans tout cela des raisons de ne pas accabler injustement la rue de Montpensier de ne pas avoir, en empruntant le vocabulaire propre à ce type de législation, détecté préventivement les éléments susceptibles d’être en lien avec une menace pesant sur les droits et libertés.
Jean-Éric GICQUEL
Cons. const., n° 2016-600 QPC, 2 déc. 2016, M. Raïme A. Le contentieux lié à l’état d’urgence revient devant le Conseil constitutionnel54 et plus particulièrement celui relatif à la saisie des données informatiques lors d’une perquisition. Précédemment, avait été jugée inconstitutionnelle la modalité selon laquelle l’autorité administrative pouvait copier toutes les données informatiques auxquelles il était possible d’accéder au cours de la perquisition. En réalité, il était alors procédé à une saisie sans support légal55. De nouvelles modalités législatives (issue de la loi du 21 juillet 2016) ont donc été agencées. À l’exception d’une règle concernant la durée de conservation des données56, elles ont été jugées conformes au respect de la vie privée, au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété.
L’article 11 de la loi du 3 avril 1955 modifiée dispose que « si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition ». À l’instar de ce que prévoit déjà l’article 56 du Code de procédure pénale, deux modalités techniques de saisie, réalisées en présence de l’officier de police judiciaire, sont donc, à ce stade envisageable : la copie immédiate des données ou la saisie du support (ordinateur portable, tablette, disque dur, téléphone portable, clef USB, carte SIM etc.) permettant une copie différée57. On notera que la perquisition peut parfois être justifiée par le seul « comportement numérique » de l’intéressé. Ainsi, à titre d’illustration, « il résulte de l’instruction que la perquisition administrative du domicile de M. A, (…) a été ordonnée par le préfet du Nord au motif que l’intéressé avait téléchargé l’application “AMAQ”. Il est constant que cette application, d’une part, est destinée à relayer des informations issues de la propagande de l’organisation dite État islamique et que, d’autre part, ce sont essentiellement des personnes ayant une certaine pratique des sites internet proches de la mouvance islamiste qui sont à même de réaliser ce téléchargement… »58.
Une nouvelle fois, le contournement de l’autorité judiciaire59 est organisé puisque l’administration est autorisée à effectuer une saisie hors de toute infraction. Elle est décidée « si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée ». Autrement dit, on est face à une menace (ce qui est assez vague et subjectif mais c’est de toute de façon ce qui a justifié, au départ, la perquisition) ne conduisant pas à la constatation d’une infraction pénale en lien avec le terrorisme définie par les articles 421-1 et suivants du Code pénal. Il est à rappeler que l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 prévoit que, si une infraction est constatée lors la perquisition, l’officier de police judiciaire « procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République ». Dans le cas des données informatiques, cette disposition risque d’avoir une utilité relative puisqu’il faudra généralement, sauf dans le cas où la consultation immédiate des supports (du moins s’ils ne sont pas cryptés) lors de la perquisition permettrait la révélation d’une infraction (telles l’apologie du terrorisme et la consultation habituelle de sites à caractère terroriste), recourir à leur exploitation ce qui implique donc une saisie… administrative.
Le juge judiciaire écarté dans le cadre de cette saisie administrative, le législateur impose ici une autorisation préalable du juge administratif des référés pour l’exploitation des données. En revanche, la saisie, elle, ne nécessite pas d’autorisation juridictionnelle. Le Conseil n’apparaît pas ici des plus rigoureux par rapport à ce qu’il avait décidé auparavant. En effet, dans sa décision du 19 février 2016, il avait jugé que le législateur n’avait pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée en raison du fait que les règles prévues « permettent à l’autorité administrative de copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été possible d’accéder au cours de la perquisition ; que cette mesure est assimilable à une saisie ; que ni cette saisie ni l’exploitation des données ainsi collectées ne sont autorisées par un juge… » (c’est nous qui soulignons) ». Une interprétation littérale de ce considérant indiquait donc que la saisie devait aussi être préalablement autorisée et ce même si des doutes persistaient sur son caractère réaliste sur le terrain. Quelques mois plus tard, le doute est levé. L’autorisation du juge est seulement requise pour l’exploitation des données, le commentaire « officiel » de la présente décision confirmant bien que « le Conseil constitutionnel a implicitement considéré qu’aucune exigence constitutionnelle n’imposait de prévoir une autorisation du juge préalable à la saisie des données elle-même » (p. 8). Faut-il en déduire que lorsque le Conseil a fait état, dans sa décision du 19 février 2016, que la saisie n’était pas autorisée par un juge, on était face à un obiter dictum ? Sans doute.
Jean-Éric GICQUEL
Droit des collectivités territoriales
Cons. const., n° 2016-565 QPC, 16 sept. 2016, Assemblée des départements de France et Cons. const., n° 2016-588 QPC, 21 oct. 2016, Communauté des communes des sources du lac d’Annecy. Disposant d’un fondement constitutionnel explicite (art. 34 et 72C), reconnue logiquement comme norme de valeur constitutionnelle par le Conseil dès 197960, pouvant être invoquée dans le cadre d’une QPC61, la libre administration des collectivités territoriales est régulièrement invoquée par les saisissants (dans le cadre du contrôle a priori) et par les justiciables (dans l’examen a posteriori). Pourtant, les probabilités d’obtenir gain de cause devant les Sages s’avèrent réduites. Dans les deux présentes décisions, c’est par un match nul que la partie contentieuse se conclut même si, sur le plan substantiel, les partisans de la libre administration n’y trouveront pas leur compte.
Certes, le Conseil, dans la décision du 21 octobre 2016, Communauté des communes des sources du lac d’Annecy, a trouvé à redire sur une modalité de la coopération intercommunale, une politique publique, qui après une précédente invalidation62, est devenue un terrain fertile pour les QPC. Plus concrètement, l’article L. 2113-2 du Code général des collectivités territoriales permet la création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes contiguës. Si ces communes appartenaient initialement à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) distincts, il appartient au conseil municipal de la commune nouvelle de choisir l’EPCI-FP auquel elle souhaite être rattachée. Seulement, ce souhait peut être refusé par le préfet (CGCT, art. L. 2113-5 – objet de la QPC). Dans cette hypothèse, la Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) est saisie du projet préfectoral de rattachement. La commune nouvelle devient membre de l’EPCI-FP qu’elle avait initialement retenue à la condition que ladite commission se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans le cas contraire, la commune nouvelle est membre de l’EPCI-FP choisi par le préfet. Qu’une commune puisse être contrainte de la sorte ne méconnaît pas pour autant sa libre administration. Le Conseil constitutionnel, dans une version corrigée de sa jurisprudence dite SRU (solidarité et renouvellement urbains63) estime que le législateur peut « assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations ou les soumettre à des interdictions, (…) à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d’intérêt général ». Ici, il a jugé que le souhait initial de la commune nouvelle peut « porter atteinte à la cohérence ou à la pertinence des périmètres intercommunaux existants » et que le législateur, en conférant un droit d’opposition au préfet, a poursuivi un but d’intérêt général.
Seulement, les Sages semblent être séduits par la démocratie locale participative en insistant sur les bienfaits de la plus large consultation des communes ou des EPCI afin de mieux les associer à la décision finale. Ainsi, examinant en 2014 (dans la décision Commune de Thonon-les-Bains) les modalités de rattachement d’office d’une commune n’appartenant à aucun EPCI-FP ou créant, au sein du périmètre d’un tel établissement, une enclave ou une discontinuité territoriale, il avait constaté une atteinte manifestement disproportionnée à la libre administration principalement au motif que les conseils municipaux des communes intéressées et, plus particulièrement, celui dont le rattachement est envisagé n’étaient pas consultés et ce à aucun moment de la procédure. On retrouve ici cette approche puisque, « compte tenu des conséquences qui résultent du rattachement de la commune nouvelle à un (EPCI-FP) », le Conseil estime que des consultations auraient dû être prévues par le législateur à savoir celles de 1) l’organe délibérant de l’EPCI-FP auquel le rattachement est envisagé ; 2) des organes délibérants des EPCI-FP dont la commune nouvelle est susceptible de se retirer et 3) des conseils municipaux des communes membres de ces EPCI-FP. En sus, est reproché au législateur de ne pas aménager, au profit des établissements et des communes, un droit de saisie de la CDCI Autant de lacunes portant à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée.
Reste que cette décision, à l’objet techniquement circonscrit, retiendra moins l’attention que celle du 16 septembre 2016, Assemblée des départements de France. Ici, les enjeux juridiques étaient nettement plus consistants puisque le Conseil devait se prononcer sur le point de savoir si la suppression, par la loi du 7 août 2015 (dite NoTRE), de la clause de compétence générale reconnue, jusqu’ici, au département méconnaissait la libre administration des collectivités territoriales.
Quiconque s’intéresse à la vie locale, sait que les collectivités territoriales, dès lors qu’elles ont à la fois l’imagination et les ressources financières en correspondance, peuvent conduire, en s’appuyant sur la clause générale de compétences, des actions publiques dans les secteurs extrêmement diversifiés. Logiquement, ce véritable couteau suisse juridique est soumis à des limites et on pensera principalement au fait que ces mesures doivent correspondre à un besoin de la population locale64.
Le législateur a été ici des plus hésitants. Après avoir été initialement supprimée par la loi du 16 décembre 2010, la clause générale pour les départements et régions a été rétablie par la loi du 27 janvier 2014 avant d’être (définitivement ?) remisée par la loi dite NoTRE de 2015. À l’occasion de ce va-et-vient, le Conseil eut l’occasion de juger que ladite clause « ne saurait avoir donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une telle compétence »65.
Dans la présente décision, il s’agissait, pour le Conseil, de s’assurer que le département (et le raisonnement peut être, mutatis mutandis, étendu à la région) est mis dans la possibilité d’exercer des « attributions effectives ». On sait que l’on est ici face, aux côtés de l’existence d’un conseil élu, l’autonomie financière et la liberté contractuelle, à une des composantes de la liberté d’administration. L’argumentation du juge tient en deux temps : primo, l’article 72 C « n’implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi ». Ceci signifie donc que le principe même de la clause générale ne dispose pas de fondement constitutionnel. Secundo, il est nécessaire que le législateur, sur le fondement de l’article 34 C, confère effectivement des compétences à la collectivité que ce soit de manière exclusive, partagée ou susceptible d’être déléguée par d’autres collectivités. À la lueur des attributions conférées au département (principalement consistantes en matière d’action sociale), le Conseil a jugé que ladite collectivité disposait bien « d’attributions effectives » et que, ce faisant, la libre administration des collectivités n’était pas méconnue. Au regard des compétences législatives de la région (en matière de formation, d’interventionnisme économique et d’enseignement), il est à penser qu’il en est de même pour cette catégorie de collectivités.
Jean-Éric GICQUEL
Droit fiscal
Cons. const., n° 2016-554 QPC, 22 juill. 2016, M. Gilbert B. et Cons. const., n° 2016-591 QPC, 21 oct. 2016, M. Helen S. Le Conseil constitutionnel est-il prêt à tout accepter au nom de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales66 ? Visiblement non puisque, coup sur coup, deux dispositions législatives ont été déclarées non conformes à la Constitution.
Dans les deux cas, le raisonnement a le mérite de la simplicité. Le législateur est fondé à établir des règles visant à lutter contre les pratiques sources de fraudes et d’évasions fiscales (premier temps) mais à condition de respecter les droits et libertés garantis par la Constitution (second temps).
Dans la décision M. Gilbert B., des sanctions à l’égard des contribuables omettant de déclarer leurs comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et ce afin « de faciliter l’accès de l’administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus ou de biens à l’étranger » peuvent être instituées. En rappelant que le Conseil juge depuis 1981 que la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur67, nul besoin d’être un spécialiste de droit fiscal pour saisir l’intérêt d’une telle modalité. Dans la décision M. Helen S., le législateur entendait, en créant un registre public des trusts, exiger de ces derniers davantage de transparence. Pour aller à l’essentiel, le trust est un mécanisme de droit anglo-saxon, n’ayant pas d’équivalent en droit civil et qui est décrit comme « l’ensemble des relations juridiques résultant de la décision (révocable ou irrévocable) d’une personne créant le trust (le constituant ou « settlor ») de confier des biens à un tiers (le gestionnaire ou « trustee ») qui les contrôle (de manière encadrée ou discrétionnaire) dans l’intérêt d’un bénéficiaire (ou dans un but déterminé, par exemple caritatif) avant d’en transférer éventuellement la propriété à un attributaire (une même personne pouvant être constituant, bénéficiaire et/ou attributaire) »68. Le droit fiscal français reconnaît de son côté l’existence du trust69 puisque le domicile fiscal du constituant ou du bénéficiaire peut être en France. Ceci permet son imposition notamment aux droits de mutation à titre gratuit ainsi qu’à l’ISF. Reste que qualifiée de pratique « fraudogène70 », faisant souvent intervenir comme territoires les îles Caïmans, régulièrement utilisé dans le marché de l’art, « cet outil patrimonial anglo-saxon a donné lieu à des phénomènes massifs d’évasion fiscale »71. Aussi, le Conseil constitutionnel reconnaît-il qu’afin d’« éviter leur utilisation à des fins d’évasion fiscale et de blanchiment des capitaux », le législateur est en droit de les assujettir à des obligations de transparence.
Encore faut-il, dans les deux cas, ne pas porter, de manière excessive, à d’autres droits et libertés constitutionnels. Ce fut pourtant le cas.
Dans la première hypothèse, l’absence de déclaration annuelle d’un compte bancaire à l’étranger entraînait, et ce même si les sommes présentes figuraient bien sur la déclaration fiscale du contribuable, la condamnation à une amende se déclinant sur un versant forfaitaire (1 500 € par compte non déclaré et 10 000 € si le compte a été établi dans un État ou un territoire n’ayant pas signé de convention de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales avec la France) et proportionnel (5 % du solde créditeur si le solde créditeur du compte est supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année). Concernant ce dernier, il a été jugé que le législateur avait instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits (une absence de déclaration) qu’il entendait réprimer.
Dans la seconde espèce, l’article 1649 AB du Code général des impôts prévoyait, d’une part, la création d’un registre public des trusts au sein duquel sont recensés « les trusts déclarés, le nom de l’administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust » et, d’autre part, renvoyait les modalités de consultation à un décret en Conseil d’État.
Ici, le Conseil a reproché au législateur de ne pas avoir suffisamment encadré les modalités de consultation du registre partant du constat que la connaissance des noms du constituant, du (ou des) bénéficiaire(s) et de l’administrateur d’un trust fournit « des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine ». Aux yeux du Conseil, cela constitue alors une atteinte au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration de 178972.
Il s’agit sans doute d’une victoire à la Pyrrhus pour les partisans de l’opacité, puisque la nouvelle rédaction de l’article 1649AB (insérée par l’article 10 de l’ordonnance du 1er décembre 2016) maintient l’existence d’un registre qui n’est certes plus public mais dont l’accès est ouvert à un ensemble d’autorités (tels notamment la cellule de renseignement financier nationale, les autorités judiciaires, les douanes et l’administration fiscale) qui sont, principalement ou exclusivement, chargées de traquer la fraude et l’évasion fiscales…
Jean-Éric GICQUEL
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-12419 : Bull. civ. I, n° 106 ; RTD civ. 2007, p. 320, obs. Hauser J.
-
2.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-596, du 30 juin 2000.
-
3.
Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 08-10576 : RTD civ. 2009, p. 513, obs. Hauser J.
-
4.
V. le commentaire officiel de la décision.
-
5.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016.
-
6.
Bénabent A., La réforme du droit du divorce. Article par article, 2004, Defrénois, p. 9.
-
7.
Massip J., Le nouveau droit du divorce, 2005, Defrénois, p. 4 ; Courbe P., Le divorce, 4e éd., 2004, Dalloz, p. 10.
-
8.
Le terme est parfois utilisé pour décrire le divorce pour altération définitive du lien conjugal. V. par ex. : Labbé X., « L’ordre public patrimonial à deux visages », JCP G 2009, 201 ; Koumdadji A., La sécularisation de la répudiation, 2015, Édition du Cerf, Patrimoine.
-
9.
Koumdadji A., op. cit., p. 197.
-
10.
RTD civ. 2016, p. 926, obs. Hauser J.
-
11.
Brémond V., « La nouvelle acceptation à concurrence de l’actif net », JCP N 2006, 1331.
-
12.
Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 16-40217.
-
13.
Cons. const., 10 juin 2010, n° 2010-607 DC ; L. n° 2010-658, 15 juin 2010, relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité.
-
14.
Sur cette question : Mazeaud V., « Droit réel, propriété et créance dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RTD civ. 2014, p. 29.
-
15.
Cons. const., 7 oct. 2015, n° 2015-486 : LPA 27 juill. 2016, n° 118q7, p. 4.
-
16.
Le terme de « charge » lui est parfois préféré : Forest G., Essai sur la notion d’obligation en droit privé, 2012, Dalloz, nos 473 et s.
-
17.
Luxembourg F., La déchéance des droits, contribution à l’étude des sanctions civiles, thèse, 2008, Panthéon-Assas Paris II, n° 256.
-
18.
C. civ., art. 796, al. 3.
-
19.
Cons. const., 18 mars 2015, nos 2014-543/454 QPC et 2015-462 QPC (Cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour manquement d’initié) ; Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC et Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC (Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale) : LPA 28 févr. 2017, n° 124r1 p. 5, chron. Tellier-Cayrol V.
-
20.
RTD com. 2004, p. 606, obs. Mascala C.
-
21.
Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-19088 : Bull. civ. IV, n° 123 ; D. 2006, AJ, p. 1449, obs. Lienhard A.
-
22.
Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-17187 : Bull. civ. IV, n° 155.
-
23.
V. le commentaire officiel de la décision.
-
24.
Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC.
-
25.
Sur les difficultés de ce cumul de compétences : Mascala C., « Le nouveau régime des sanctions de sauvegarde des entreprises », RTD com. 2006, p. 209 ; Lasserre Capdeville J., « Les apports en droit pénal de l’ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté », AJ pénal 2009, p. 351.
-
26.
BJS déc. 2016, n° 115u0, p. 738, obs. Saintourens B.
-
27.
C. com., art. L. 653-11 ; Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-570 QPC .
-
28.
Sur cette transaction : Jeanne N., « Réflexions sur la transaction pénale par officier de police judiciaire », RSC 2016, p. 1 ; Perrier J.-B., « Réflexions et perspectives sur la transaction en matière pénale », AJ pénal 2015, p. 474 ; « La transaction pénale de l’article 41-1-1 du Code de procédure pénale. Bonne idée ou outil dangereux ? », D. 2014, p. 2182 et du même auteur sur cette décision QPC : « La transaction pénale et les progrès du Conseil constitutionnel », D. 2016 p. 2545 ; RFDC 2017/1, n° 109, p. 237 et s.
-
29.
Beccaria C., Des délits et des peines (1764), 2002, Éd. du Boucher, p. 35, § XI.
-
30.
CEDH, 5° sect., 14 oct. 2010, n° 1466/07, Brusco c/ France : RSC 2011, p. 211, note Roets D.
-
31.
Cons. const., 20 nov. 2015, n° 2015-499 QPC (Absence de nullité de la procédure en cas de méconnaissance de l’obligation d’enregistrement sonore des débats de cours d’assises) : LPA 27 juill. 2016, n° 118q7, p. 17, chron. Tellier-Cayrol V.
-
32.
Cons. const., 9 sept. 2011, n° 2011-160 (Communication du réquisitoire définitif aux parties).
-
33.
Cons. const., 23 nov. 2012, n° 2012-284 QPC (Droit des parties non assistées par un avocat et expertise pénale) : LPA 9 sept. 2013, p. 6, chron. Tellier-Cayrol V.
-
34.
Cass. crim., 19 nov. 2014, n° 13-87965 : Bull. crim., n° 245.
-
35.
§ 9 de la décision Cons. const., 16 sept. 2016, n° 2016-566 QPC ; Cons. const., 9 sept. 2011, n° 2011-160, cons. 5 ; Cons. const., 23 nov. 2012, n° 2012-284 QPC, cons. 4.
-
36.
V. CPP, art. 114, dans sa version antérieure à la L. n° 2014-535, 27 mai 2014.
-
37.
Cass. crim., 17 janv. 2012, n° 11-90111, D.
-
38.
Ribeyre C., « La communication du dossier d’instruction aux parties privées », JCP G 2006, 152.
-
39.
Plus précisément, la liste des services de renseignement est déterminée par l’article R. 811-1 du Code de la sécurité intérieure, pour les services dits du « premier cercle », et par le décret n° 2015-1639, du 11 décembre 2015, pour services dits du « second cercle ». Ces derniers ne disposent pas ipso facto de recourir à toutes les techniques de renseignement reconnue aux services du premier cercle.
-
40.
On pensera tout particulièrement à la communication en temps réel des données de connexion d’une personne « susceptible d’être en lien avec une menace » (CSI, art. L. 851-2) et à la possibilité de mettre en place un dispositif basé sur un algorithme apte « à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste » (CSI, art. L. 851-3).
-
41.
CEDH, 6 sept. 1978, Klass c/ Allemagne.
-
42.
Celle-ci énonce qu’elle doit être convaincue « de l’existence de garanties adéquates et effectives contre les abus car un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale risque de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre » (CEDH, 4 déc. 2015, n° 47143/06, Zakharov c/ Russie).
-
43.
V. en ce sens : MM. Urvoas et Verchère, « Mission d’information sur l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement », Rapp. AN n° 1022, 14 mai 2013.
-
44.
Cons. const., 23 juill. 2015, n° 2015-713 DC, et Cons. const., 26 nov. 2015, n° 2015-722 DC. Cette dernière décision est relative à la loi n° 2015-1556, du 30 novembre 2016, relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales rendue nécessaire par l’invalidation prononcée par le juge constitutionnel en juillet 2015 du fait du manque d’encadrement légal.
-
45.
Rapp. Sénat n° 460, 20 mai 2015, p. 110
-
46.
Dans l’attente de l’ajout législatif, le Conseil par une réserve directive adressée à la CNCTR couplée à une réserve d’interprétation transitoire a indiqué, primo, que les dispositions de l’article L. 811-5 du CSI « ne sauraient être interprétées comme pouvant servir de fondement à des mesures d’interception de correspondances, de recueil de données de connexion ou de captation de données informatiques soumises à l’autorisation » et que secundo, « les dispositions de l’article L. 811-5 du Code de la sécurité intérieure ne sauraient être mises en œuvre sans que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement soit régulièrement informée sur le champ et la nature des mesures prises en application de cet article ».
-
47.
V. not. : Lhomme F., « L’interprétation de la loi sur les écoutes au cœur du dossier », Le Monde, 18 oct. 2011
-
48.
Comme le rappelle la CNCTR, dans sa délibération n° 2/2016, du 10 novembre 2016, « la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) avait pris position à plusieurs reprises sur la portée des dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (…). Elle estimait que ces dispositions devaient être interprétées strictement et ne pouvaient notamment servir de fondement à la mise en œuvre d’interceptions de communications individualisables. Elle a en outre mis en doute leur utilité et suggéré qu’elles ne soient pas reprises par la loi du 24 juillet 2015. Elle n’a pas été suivie par le législateur sur ce dernier point ».
-
49.
Dans sa décision de renvoi (CE, 22 juill. 2016, n° 394922, Quadrature du Net et a.), le Conseil d’État a été des plus conciliants à l’égard de l’intérêt à agir douteux des associations, en jugeant qu’il « n’est pas tenu, lorsqu’à l’appui d’une requête est soulevée devant lui une question prioritaire de constitutionnalité, sur laquelle il lui incombe de se prononcer dans un délai de trois mois, de statuer au préalable sur la recevabilité de cette requête ».
-
50.
Voir, dans d’autres circonstances, l’aveu de Pierre Mazeaud : « (…) ayant dû rendre huit décisions sur des textes de nature et de portée très diverses au cours du seul mois de juillet 2005, le Conseil ne pouvait sérieusement exercer son contrôle d’office » (c’est nous qui soulignons) : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/20051001erevan.pdf, p. 9.
-
51.
de Béchillon D., « Réflexions sur le statut des “portes étroites” devant le Conseil constitutionnel », Le Club des juristes janv. 2017. Le Conseil constitutionnel a décidé, en février 2017, de rendre désormais publique la liste de ces « contributions extérieures ».
-
52.
Dutheillet de Lamothe O., AFDC 13 juin 2012, http://www.droitconstitutionnel.org/afdc/CRCA130612.html : « (…) les juges n’ont plus le temps de lire les mémoires et autres documents officiels, mais ces portes étroites qui ne sont pas visées officiellement, sont distribuées à tous les membres du Conseil constitutionnel et sont un moyen d’enrichissement très important de la réflexion, comme le disait déjà le doyen Vedel. Ces portes étroites nous ont beaucoup plus apporté que les mémoires. Le contrôle a priori du Conseil constitutionnel vit dans un climat d’une grande pauvreté intellectuelle. Les recours sont souvent de faible qualité, à peine contrôlés par le Groupe politique qui les dépose, en décalage complet avec les exceptions d’irrecevabilité qui sont souvent de très grande qualité. C’est un vrai bonheur pour un rapporteur et pour les juges d’avoir une porte étroite dans une affaire ».
-
53.
V. le mémoire : https://www.laquadrature.net/files/amicus_loi_renseignement_fdn_ffdn_lqdn.pdf.
-
54.
V. la chronique : LPA 27 juill. 2016, n° 118q7, p. 4.
-
55.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-536 QPC, Ligue des droits de l’Homme.
-
56.
Les données copiées relatives « à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée » pouvaient être détenues ad vitam aeternam par l’administration. Par conséquent, il a été jugé que le législateur n’a « pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public » (§ 16).
-
57.
Pour les modalités opérationnelles : Sontag-Koenig S., « Les perquisitions 2.0 : quand l’informatique se saisit de l’immatériel », AJ pénal 2016, p. 238
-
58.
CE, 9 févr. 2017, n° 407650.
-
59.
En réaction à ce phénomène de fond, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans les décisions nos 16-82176 et 16-84794, du 13 décembre 2016, a donné un sens extensif à l’article 111-5 du Code pénal en jugeant que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu’il en va ainsi lorsque de la régularité de ces actes dépend celle de la procédure ». Autrement dit, la juridiction pénale est compétente pour apprécier la légalité des ordres de perquisition si une infraction pénale a été constituée.
-
60.
Cons. const., 23 mai 1979, n° 79-104 DC, Nouvelle-Calédonie : Rec. Cons. const., p. 27
-
61.
Cons. const., 2 juill. 2010, n° 2010-12 QPC, Commune de Dunkerque : Rec. Cons. const., p. 134.
-
62.
Cons. const., 25 avr. 2014, n° 2014-391 QPC, Commune de Thonon-les-Bains : Rec. Cons. const., p. 257 ; LPA 15 déc. 2014, p. 6.
-
63.
Cons. const., 7 déc. 2000, n° 2000-436 DC : Rec. Cons. const., p. 176.
-
64.
Voir par exemple l’annulation d’une délibération accordant une subvention pour la restauration du village de Colombey-les-Deux-Églises (situé dans le département de la Haute-Marne) par le conseil général de l’Oise au motif qu’une telle opération « ne saurait être regardée comme relevant d’un intérêt départemental pour le département de l’Oise » (CE, 16 juin 1997, n° 170069, Département de l’Oise : Lebon, p. 236.
-
65.
Cons. const., 9 déc. 2010, n° 2010-618 DC : Rec. Cons. const., p. 367
-
66.
LPA 5 juin 2012, p. 9.
-
67.
Cons. const., 20 janv. 1981, n° 80-127 DC : Rec. Cons. const., p. 15.
-
68.
Éd. Francis Lefebvre, Documentation pratique fiscale, série ENR, division IX, n° 18010.
-
69.
En application de l’article 792-0 bis du Code général des impôts : « On entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».
-
70.
Rapp. Sénat n° 673, 17 juill. 2012, p. 143.
-
71.
Ibid.
-
72.
Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC : Rec. Cons. const., p. 100.