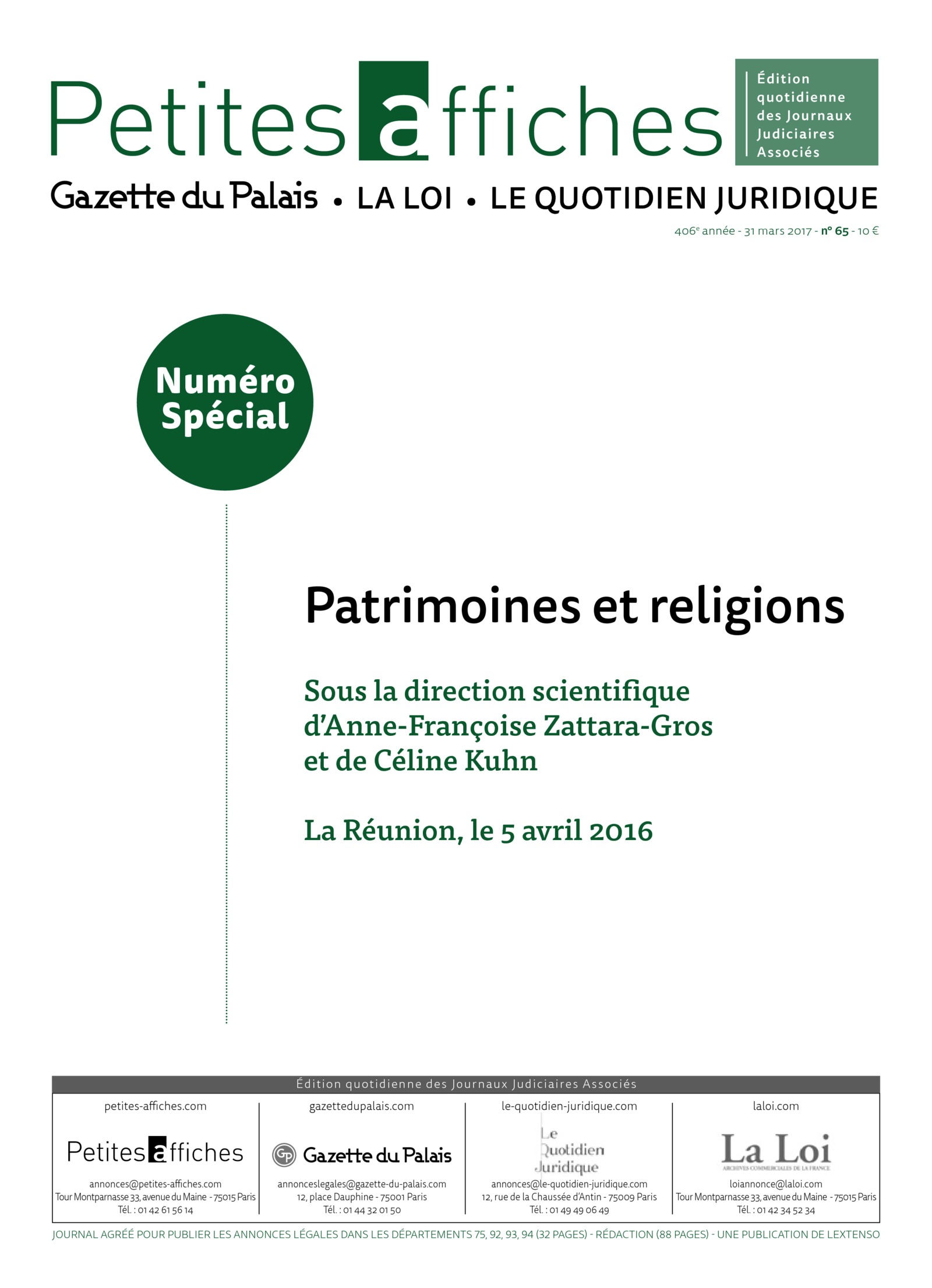Le financement du patrimoine religieux par les personnes publiques
Le principe de laïcité est souvent compris comme interdisant aux personnes publiques de prendre en charge des dépenses liées aux cultes. Une telle analyse va à l’encontre de l’esprit de la loi du 9 décembre 1905 qui établit un compromis et autorise les personnes publiques, dans certaines limites, à accompagner l’exercice des cultes, notamment à travers la prise en charge de financements patrimoniaux.
« Islam des caves ». Cette expression résume à elle seule la façon dont la problématique du patrimoine religieux est bien souvent perçue. Elle témoigne d’une réalité difficile, celle du culte musulman, qui en France ne se pratique pas toujours dans des conditions adaptées. Elle rend également compte, dans une certaine mesure, de l’existence de fantasmes, d’inquiétudes liés à l’affirmation d’une religion souvent méconnue. Cette expression, en définitive, met en évidence toute la sensibilité de la question du financement des édifices religieux. Elle invite tous les acteurs à se mobiliser pour sortir l’islam des caves, sans pour autant qu’il y ait consensus quant aux modalités, notamment financières, d’une telle émancipation. Souvent, le risque de voir des pays musulmans rigoristes financer la création de nouvelles mosquées et y imposer leur conception de l’islam inquiète, mais en retour, l’implication des pouvoirs publics aux côtés des fidèles musulmans pour la création de nouvelles mosquées suscite des réactions parfois vives. C’est donc dans ce contexte souvent troublé que la question du financement public du patrimoine religieux est aujourd’hui posée1.
Affirmons-le sans ambages : réduire les interrogations relatives à l’implication des collectivités en matière de financement des édifices de culte au seul culte musulman est une grossière erreur. Depuis l’adoption de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, tous les cultes ont été confrontés à la problématique patrimoniale et, pour tous, les actions engagées par les personnes publiques l’ont été dans le respect d’un cadre général non discriminatoire. Toutefois, certaines religions rencontrent aujourd’hui des difficultés particulières. En effet, on observe en matière de financement public des cultes une forme de discrimination à rebours : le cadre uniforme et égalitaire avantage les cultes qui étaient bien représentés et organisés en 1905 et désavantage les cultes qui se sont développés ensuite. Ainsi il est impossible d’appréhender le régime juridique du financement du patrimoine religieux sans prendre en compte la diversité des situations des différents cultes.
La nécessité de se préoccuper de cette réalité cultuelle contrastée est d’autant plus importante que la définition même d’un culte suppose notamment d’identifier des lieux de cultes et donc l’existence d’un patrimoine religieux. Tant la définition de Léon Duguit affirmant que « le culte est l’accomplissement de certains rites, de certaines pratiques qui, aux yeux des croyants, les mettent en communication avec une puissance surnaturelle »2, que celle proposée par le Conseil d’État qui présente le culte comme « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques »3, mettent en évidence, au-delà d’une croyance nécessairement subjective, la nécessité d’accomplir des actes concrets et objectifs, des rites, qui supposent le plus souvent l’existence de lieux ou d’objets dédiés. Ainsi existe-t-il un lien entre l’existence d’un patrimoine cultuel et l’identification d’un culte.
Il faut cependant relever que toutes les religions ne sont pas égales face à la détention d’un tel patrimoine. Comme le rapporte le sénateur Hervé Maurey4, « selon différents recensements, la France compterait près de 100 000 édifices religieux dont 90 000 catholiques. Si la religion catholique dispose, pour des raisons historiques évidentes, de nombreux lieux de culte, les communautés musulmanes, bouddhistes, orthodoxes et protestantes évangéliques sont aujourd’hui en recherche de lieux de culte, soit à construire lorsqu’elles en ont les moyens, soit par la location de salles ». Le décalage entre la religion catholique et les autres cultes – notamment le culte musulman qui est désormais le second en France – est donc manifeste. Le sénateur ajoute que l’asymétrie entre la religion catholique et les autres religions se prolonge sur le terrain de la propriété : « 90 % des édifices du culte catholique sont la propriété des communes, alors que ce chiffre ne représente que 12 % pour le culte protestant, 3 % pour le culte juif, et 0 % pour le culte bouddhiste et le culte musulman ». En outre, tenant l’importance du patrimoine catholique, c’est cette religion qui formule la majorité des demandes de financement, notamment pour des dépenses d’entretien ou de rénovation. Les représentants du culte musulman, eux, formulent des demandes de plus en plus nombreuses, le plus souvent pour l’édification de nouveaux lieux de culte, mais elles restent minoritaires5. Enfin, on constate une réalité que, malheureusement, chacun connaît : les populations acceptent aisément la création de nouveaux lieux de culte catholiques et manifestent davantage d’opposition à la création de lieux de culte musulmans.
Ces inégalités entre les différents cultes du point de vue de l’importance de leur patrimoine religieux s’expliquent notamment par des inégalités sociales entre les différentes communautés. Les communautés catholique et juive sont ainsi composées de citoyens de toutes classes sociales qui peuvent assurer un financement privé suffisant pour bon nombre de lieux de culte. La situation du culte musulman est plus délicate. La communauté musulmane française est composée de citoyens qui, dans une plus grande proportion, rencontrent des difficultés économiques et sociales importantes rendant le financement privé des mosquées plus complexe, bien que non résiduel6.
Face à la difficulté de financer des lieux de cultes sur fonds privés, les différentes religions se tournent fréquemment vers les collectivités publiques. Ces demandes n’apparaissent néanmoins pas toujours légitimes dans un pays où le principe de laïcité a valeur constitutionnelle et où dès 1905 a été instaurée une séparation entre les Églises et l’État. Il n’est pas rare, par conséquent, que le principe de laïcité soit interprété de façon restrictive, comme un obstacle à toute intervention des pouvoirs publics au bénéfice des cultes.
Force est toutefois de constater que le principe de laïcité ne fait l’objet d’aucune définition textuelle reconnue par tous7 et qu’il est encore aujourd’hui difficile de dire s’il s’oppose catégoriquement à une intervention des collectivités publiques en faveur des cultes. Cette question est d’autant plus complexe qu’elle ne semble pas devoir toujours recevoir la même réponse. S’il paraît clair, en dehors du cadre concordataire, que les collectivités ne peuvent pas, en vertu du principe de laïcité, prendre en charge les salaires d’un clergé, les limites de leurs possibilités d’intervention en matière patrimoniale sont plus floues, le plus souvent parce que le patrimoine religieux constitue aussi, dans de nombreux cas, un patrimoine culturel pouvant être revendiqué par n’importe quel citoyen. En outre, il est également soutenu que le principe de laïcité oblige les collectivités publiques à garantir la liberté de culte. Une telle acception du principe suppose la mise en place d’actions positives – notamment des actions financières – en faveur des cultes8.
Aussi, face à cette difficulté de dire si le principe de laïcité autorise ou non le financement par des collectivités publiques du patrimoine religieux, il apparaît plus pertinent de renverser la perspective pour tenter de cerner ce que les règles de financement public du patrimoine religieux disent du principe de laïcité. On constate alors que l’affirmation ambivalente du principe d’interdiction du financement public du patrimoine religieux (I) permet la mise en place de nombreux aménagements (II) qui amènent à privilégier une définition compréhensive et constructive du principe de laïcité.
I – L’ambivalence du principe d’interdiction du financement public du patrimoine religieux
Nul besoin d’être un spécialiste du droit public et du principe de laïcité pour avoir connaissance de l’existence d’une règle juridique d’interdiction du financement des édifices de culte par les personnes publiques. Les profanes savent bien, de façon plus ou moins précise, que les personnes publiques ont des marges de manœuvre limitées dès lors qu’elles envisagent de financer des activités ou des biens en lien avec l’exercice d’un culte. Ceci témoigne de la notoriété de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui énonce avec clarté que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Cette disposition est ordinairement comprise comme une interdiction faite aux communes, départements et régions d’inscrire au sein de leurs budgets des dépenses qui seraient relatives aux cultes. Serait ainsi prohibé tout financement public des lieux de culte. Une telle interdiction serait par ailleurs corroborée par l’article 19 de la loi de 1905 qui, tel un miroir, énonce que les associations cultuelles instituées par cette loi pour assurer l’exercice du culte ne peuvent « sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements et des communes ». Le dispositif est donc double : interdiction de donner pour les personnes publiques et interdiction de recevoir pour les associations cultuelles.
L’articulation de ces énoncés met en évidence un véritable principe d’interdiction du financement public des édifices religieux (A). Pour autant, au-delà de l’apparente simplicité des formules, il faut bien convenir du caractère très relatif de l’affirmation d’un tel principe, tant sa portée peut être remise en cause (B).
A – La clarté apparente du principe d’interdiction du financement public du patrimoine religieux
La conviction de l’existence d’un principe d’interdiction du financement public des édifices religieux prend appui sur une interprétation restrictive des dispositions peu équivoques de la loi de 1905. Toutefois, force est de reconnaître que celle-ci procède surtout de la prise en compte d’une jurisprudence administrative qui, pendant longtemps, a mis en œuvre une conception stricte du principe de laïcité. Il existe ainsi un certain de nombre de décisions manifestant une réelle opposition de l’ordre juridictionnel administratif à l’intervention financière directe ou indirecte des personnes publiques au bénéfice des cultes. Dans un arrêt Commune de Saint-Louis – Association « Siva Soupramanien de Saint-Louis »9, le Conseil d’État a ainsi jugé qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de la loi de 1905 que « des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles ».
Plus particulièrement, s’agissant du financement du patrimoine cultuel, les juridictions administratives ont estimé que les personnes publiques ne peuvent pas contribuer financièrement, directement ou indirectement, totalement ou partiellement à construction d’un édifice cultuel ou à l’acquisition de biens dans une vocation cultuelle. Sont ainsi interdits le financement de la construction d’un nouveau lieu de culte10, l’achat de mobilier à vocation cultuelle11, ou encore la cession d’un bien appartenant à une personne publique à une association cultuelle à une valeur inférieure à celle du marché12.
De la même façon, des dépenses destinées à financer le fonctionnement courant des édifices de culte sont interdites. L’application d’une telle règle n’est pas toujours évidente dès lors que certaines dépenses de fonctionnement peuvent parfois être prises en charge par la personne publique lorsqu’il s’agit d’assurer la préservation du patrimoine dont elle peut être propriétaire. Toutefois, la cour administrative d’appel de Nancy13 est venue rappeler l’importance de cette interdiction en jugeant, à propos de dépenses d’électricité relative à une église, que « quel qu’en soit le montant, les personnes publiques ne peuvent engager d’autres dépenses que celles qui sont nécessaires à l’entretien et la conservation des édifices du culte dont elles ont la propriété ». Peu importe alors la modicité du montant de la dépense restant à la charge du culte.
Il en va encore ainsi des avantages pouvant être accordés à certains cultes dans le cadre de la mise à disposition des locaux appartenant à une personne publique14. Dans une décision du 19 juillet 2011, Commune de Montpellier15, le Conseil d’État a jugé qu’une commune pouvait mettre à la disposition d’une association cultuelle des locaux lui appartenant afin que cette dernière y organise des cérémonies religieuses. Il est toutefois exigé que les conditions financières de la mise à disposition « excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ». Tel sera le cas lorsque le loyer demandé sera bien en dessous de la valeur locative réelle du bien16.
Enfin, sont également prohibés les financements publics dirigés vers des célébrations religieuses, quand bien même elles seraient d’intérêt local en constituant un outil de promotion du tourisme et du territoire. En la matière, le Conseil d’État a clairement rappelé à propos des « ostensions septennales »17 que celles-ci « ont le caractère de cérémonies cultuelles ». Dès lors, une subvention qui a un objet se rapportant directement aux ostensions est illégale. Tel n’aurait pas été le cas si la subvention avait eu un objet tourné vers la dimension culturelle et touristique de l’événement18.
Le principe d’interdiction du financement public des édifices cultuels est donc affirmé sans ambages par la loi de 1905 et repris par les juridictions administratives. Toutefois, l’examen plus poussé des textes législatifs et de la jurisprudence conduit à relativiser l’autorité dudit principe qui souffre de nombreux aménagements ou dérogations.
B – La portée relative du principe d’interdiction du financement public du patrimoine religieux
Le principe d’interdiction du financement public des lieux de cultes est souvent opposé aux revendications des nouvelles religions qui souhaitent être accompagnées dans la construction de nouveaux lieux de cultes plus dignes et plus adaptés à la pratique des fidèles. Cette opposition prend appui sur une conception rigoriste du principe qui, en définitive, conduit à occulter totalement son caractère relatif. En effet, la démarche du législateur de 1905 n’a pas consisté à établir avec brutalité une séparation entre l’État et les Églises. Tout au contraire, cette loi est le produit d’une démarche pragmatique qui, dès l’origine, a écarté une interprétation maximaliste du principe d’interdiction du financement public des édifices de culte. Aujourd’hui, le principe connaît de nombreuses limites (1) qui sont celles de la loi de 1905 et qui sont de nature à amenuiser sa portée juridique (2).
1 – Les limites multiples du principe
Le principe d’interdiction du financement public des édifices de culte connaît des limites de plusieurs ordres.
Géographiques, d’abord. Il ne peut échapper à l’observateur que la loi de 1905 ne s’applique pas sur l’ensemble du territoire national, excluant de fait en ces lieux particuliers l’application du principe d’interdiction du financement public des édifices de culte. Si le cas de l’Alsace-Moselle régie par le Concordat est bien connu, il ne faut pas oublier la situation singulière des outre-mer19. Ainsi la loi de 1905 ne fut pas directement applicable sur ces territoires et il a fallu attendre l’intervention du décret du 6 février 1911 portant séparation des Églises et de l’État en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion pour que le principe de non-financement public des lieux de culte s’y applique20. Cette application tardive de la loi de 1905 s’est accompagnée de quelques ajustements21 afin de tenir compte de la spécificité des contextes locaux mais sans pour autant altérer la portée initiale du texte. Pour d’autres territoires ultramarins22, le cadre juridique de la loi de 1905 a été écarté au profit de textes spécifiques tels que les décrets Mandel des 16 janvier et 6 décembre 193923. Ces textes, combinés à l’exclusion de l’application de la loi de 1901 relative aux associations, ont maintenu dans ces territoires le régime des missions hérité de l’ère coloniale. Il apparaissait naturel, à l’époque, de maintenir dans les colonies un processus d’évangélisation conçu comme un outil commode et efficace de diffusion des valeurs occidentales24. En Guyane, les décrets Mandel se superposent à l’ordonnance royale du 27 août 1828, toujours en vigueur, qui autorise les collectivités publiques, notamment le département et les communes, à être propriétaires des édifices du culte25. En outre, les cultes peuvent constituer des associations depuis que la loi de 1901 est entrée en vigueur sur le territoire guyanais. En conséquence, en Guyane, rien ne s’oppose à ce qu’une personne publique finance un édifice cultuel pour autant qu’il existe un motif d’intérêt général et non discriminatoire. À Mayotte, le processus de départementalisation ne s’est pas encore traduit par une application de la loi de 1905. Le culte musulman, majoritaire, prend appui sur des associations cultuelles tandis que le culte catholique est organisé autour d’une mission. Ces structures assument une partie du financement des édifices de culte mais sont soutenues par les interventions possibles du département et des communes. Une situation semblable se retrouve en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les biens cultuels y sont gérés par des missions religieuses qui définissent avec les collectivités publiques des modalités particulières26 de concours financier.
Le principe d’interdiction du financement public des édifices de culte connaît ensuite des limites matérielles tenant à son champ d’application. Ainsi, sur les portions du territoire régies par la loi de 1905, les biens religieux ne sont pas tous soumis aux mêmes règles selon qu’ils ont été construits avant ou après l’entrée en vigueur du texte. La plupart des édifices de cultes construits avant 1905, essentiellement catholiques, sont donc aujourd’hui la propriété des communes et sont intégrés à leur domaine public. En revanche, les lieux de culte acquis ou construits après 1905 l’ont été par des personnes privées prenant la forme d’associations cultuelles ou d’associations loi 1901. Cette situation s’explique aisément. Dès 1789, le statut public des cultes a conduit à une appropriation des biens cultuels par les personnes publiques. La promulgation du Concordat par la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) confortera cette situation en distinguant le régime des biens édifiés sur un terrain communal et intégrés au domaine public communal de celui des biens édifiés sur des terrains appartenant à des établissements publics du culte. En 1905, les premiers ainsi que les biens pris en charge par l’État et les départements en 1789 restent propriété de ces personnes publiques alors que les seconds sont confiés aux associations cultuelles créées pour se substituer aux établissements publics du culte. Si les protestants et les juifs ont accepté de prendre en charge les biens relatifs à leurs cultes à travers des associations cultuelles, les catholiques ont, pour une large part, refusé cette démarche. Le législateur est alors intervenu pour mettre en place un régime juridique laissant aux personnes publiques la propriété des édifices cultuels et garantissant leur affectation au culte. Finalement, à partir de 1920, les catholiques s’organisent autour des associations diocésaines dont l’action se limite aux frais et à l’entretien du culte catholique, laissant aux personnes publiques le soin d’assumer la charge des édifices dont elles sont propriétaires.
2 – La valeur simplement législative du principe
Le dernier élément permettant de relativiser la portée du principe d’interdiction du financement public des édifices de culte tient à la valeur juridique dudit principe. À propos de son application en Polynésie, le Conseil d’État a ainsi jugé que « le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l’État et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes »27. La portée de cette décision a pu être nuancée dans la mesure où, comme il a été précisé précédemment, la loi de 1905 n’est pas applicable en Polynésie. Ainsi, une telle solution s’expliquerait essentiellement au regard de « l’esprit des statuts spéciaux »28. Pour autant, l’énoncé du Conseil d’État a bien une dimension générale et se prononce sur l’étendue du principe constitutionnel de laïcité.
Les doutes que cette décision n’a pas pu dissiper sont aujourd’hui temporairement levés par le Conseil constitutionnel. Les interrogations récurrentes à propos du principe de laïcité ont en effet amené le juge constitutionnel à se prononcer sur sa valeur et sur ses implications. À l’occasion de la décision n° 2012-297-QPC dans le cadre de laquelle il était amené à apprécier la constitutionnalité du régime cultuel alsacien-mosellan au regard du principe de laïcité, le Conseil constitutionnel a jugé que ledit principe, tel que reconnu par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er de la Constitution, « figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ». Le Conseil ajoute qu’il résulte de ce principe « la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ». Il poursuit en indiquant « que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte ». L’énoncé des implications du principe de laïcité se borne ainsi à reconnaître une valeur constitutionnelle au principe de non-salariat des cultes mais il n’est jamais fait explicitement référence à un principe de non-subventionnement reprenant les dispositions de l’article 2 de la loi de 1905. Tenant le caractère très sensible de cette problématique, il est difficile de penser qu’il s’agissait là d’un simple oubli, et ce d’autant plus que les requérants avaient expressément invoqué la violation d’un principe de non-subventionnement des cultes. Il y a donc tout lieu de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu refuser de reconnaître une valeur constitutionnelle à cette déclinaison du principe.
Certes, cette exclusion n’est pas des plus convaincantes tant il est difficile de percevoir, en droit, les différences qui justifieraient de traiter distinctement les principes de non-salariat et de non-subventionnement. Toutefois, elle répond à des difficultés matérielles sérieuses dès lors que la constitutionnalisation du principe de non-subventionnement des cultes aurait pu fragiliser une série de dispositifs dérogatoires autorisant le financement public des cultes (v. infra II). Le risque de voir l’équilibre subtil entre neutralité de l’État et financement public des cultes a amené des observateurs avisés29 à appeler à la prudence et à la mesure en la matière. Cet appel a manifestement été entendu mais le caractère peu convaincant du raisonnement juridique pourrait conduire à de nouvelles saisines du Conseil constitutionnel30 qui pourrait sans difficulté préciser sa jurisprudence et reconnaître la valeur constitutionnelle du principe de non-subventionnement des cultes. Est-ce à dire que toutes les dérogations existantes seraient remises en cause ? Rien n’est moins sûr tant le Conseil constitutionnel s’accommode fort bien, généralement, des nombreuses exceptions aux différents principes de valeur constitutionnelle qu’il a pu identifier.
Au-delà des idées reçues, le principe d’interdiction du financement public des lieux de cultes, bien que juridiquement reconnu, est marqué par de nombreuses limites tracées au gré des besoins des cultes et des contextes sociaux. Il n’a à ce jour qu’une simple valeur législative, ce qui autorise le gouvernement ou le Parlement à l’aménager ou à y déroger largement, pour répondre aux besoins des cultes.
II – Les aménagements contingents du principe d’interdiction du financement public du patrimoine religieux
Si chacun sait qu’il existe un principe d’interdiction du financement public du patrimoine religieux, chacun sait également qu’il existe de nombreuses situations dans lesquelles les personnes publiques sont amenées à venir au soutien des cultes qui ont parfois besoin de construire des lieux de cultes décents lorsqu’ils n’existent pas ou qui peinent à les entretenir. Chaque commune de France métropolitaine ou d’outre-mer a déjà été concernée par la nécessité de reconstruire un clocher ou une toiture d’Église après des intempéries, d’assurer le bon déroulement d’une manifestation religieuse, notamment grâce à des deniers publics. L’existence de ces faits témoigne de la possibilité pour les personnes publiques, même dans les territoires où la loi de 1905 s’applique pleinement, d’intervenir financièrement au profit des cultes. Force est toutefois de constater que la connaissance de ces hypothèses d’intervention publique ne suffit pas à appréhender précisément la latitude d’action des personnes publiques. Il existe, à cet égard, une certaine confusion souvent invoquée par les élus locaux qui ne savent pas précisément ce qu’ils peuvent décider en matière cultuelle. Cette confusion tient à la diversité des dérogations permettant de subventionner directement les cultes (A) ainsi qu’aux multiples possibilités de les soutenir indirectement dans le cadre de la construction/acquisition ou de l’entretien de leur patrimoine (B).
A – Les multiples dérogations directes au principe d’interdiction du financement public du patrimoine religieux
L’affirmation du principe de laïcité et de neutralité de l’État n’a jamais impliqué un retrait total de la puissance publique en matière cultuelle. En effet, la nécessité constitutionnelle de garantir le libre exercice des cultes a conduit le législateur (1) et le juge administratif (2) à développer des outils pouvant être qualifiés de positifs31 afin de garantir aux citoyens la possibilité d’exercer leurs cultes dans de bonnes conditions.
1 – La persistance de dérogations législatives
Le législateur a très tôt perçu la nécessité de ne pas appliquer le principe d’interdiction du financement public du patrimoine religieux de façon rigoriste. La loi de 1905 elle-même comprend des dispositions qui limitent la portée dudit principe. Tel est notamment l’objet de l’article 2, alinéa 2, qui dispose que « pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». De la même façon, le treizième alinéa de l’article 13 de la loi prévoit que « l’État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ». La possibilité d’intervention financière des personnes publiques au profit des cultes est donc explicitement reconnue et organisée par le texte de 1905.
Par la suite, face à des problématiques ponctuelles, le législateur a été amené à adopter des textes de circonstance. Ainsi, en 1920, une loi spéciale a été votée afin de permettre l’octroi d’une subvention exceptionnelle pour construction de la mosquée de Paris. Puis, en 1942, l’article 19 de la loi de 1905 a été amendé de sorte que, si les associations cultuelles ne peuvent recevoir, sous quelque forme que ce soit, des subventions de l’État, des départements et des communes, « ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques ».
2 – L’élargissement des dérogations jurisprudentielles
À l’occasion de l’arrêt Commune de Saint-Louis – Association « Siva Soupramanien de Saint-Louis »32, le Conseil d’État avait jugé que les dispositions de l’article 2 de la loi de 1905 interdisaient aux collectivités publiques d’accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles. La particularité de cette décision tenait moins à l’affirmation claire du principe de prohibition du financement public des cultes qu’à la nature de l’association bénéficiaire de la subvention, qui avait un objet mixte : cultuel et culturel.
Cette décision a conduit à opposer de façon quelque peu artificielle les associations strictement cultuelles et les associations à objet mixte (cultuel et culturel). Ces dernières sont en effet identifiées, dans une certaine mesure, à des associations strictement cultuelles ne pouvant percevoir aucune subvention libre, à la différence des associations strictement culturelles pouvant recevoir un soutien financier des personnes publiques33. Elles sont également distinguées des associations cultuelles stricto sensu qui peuvent prétendre à certains soutiens financiers dans le cadre de titre IV de la loi de 1905. Se sont alors multipliées les associations strictement culturelles dont tout le monde savait qu’elles avaient vocation à prendre en charge, indirectement, des dépenses liées aux cultes34.
Le caractère ubuesque de la situation n’a pas échappé au Conseil d’État qui, à l’occasion des décisions du 19 juillet 201135, a redéfini les modalités d’intervention financière des personnes publiques au profit des cultes.
Dans l’affaire Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône36, la ville de Lyon était opposée à ladite fédération à propos du financement d’un ascenseur destiné aux personnes à mobilité réduite au sein de la basilique de Fourvière, normalement accessible par un escalier. Il fallait donc déterminer si le bien (un ascenseur) pour lequel la subvention a été octroyée présentait une dimension cultuelle excluant tout financement public alors même qu’il avait été implanté sur le parvis, c’est-à-dire à l’extérieur de l’édifice religieux, et qu’il ne constituait pas le seul moyen d’accès possible pour les fidèles. La haute juridiction administrative a saisi l’occasion de cette espèce pour énoncer un considérant de principe qui désormais constitue la grille de lecture permettant d’apprécier la légalité d’un financement public ayant un objet potentiellement cultuel. Ainsi, après avoir rappelé que la loi du 9 décembre 1905 autorise seulement les collectivités publiques à financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Églises et de l’État, à accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels, mais qu’elle leur interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte, le Conseil d’État tempère ce principe de prohibition. Il énonce en effet que les dispositions de la loi de 1905 « ne font pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d’entretien ou de conservation d’un édifice servant à l’exercice d’un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l’édifice, soit en accordant une subvention lorsque l’édifice n’est pas sa propriété, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’un aménagement en rapport avec cet édifice ». Une telle possibilité n’est ouverte que si certaines conditions sont réunies. Tout d’abord, l’équipement ou l’aménagement doit présenter un intérêt public local, « lié notamment à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire », et ne doit pas être destiné à l’exercice du culte. Le Conseil d’État envisage donc clairement qu’un édifice cultuel puisse présenter un intérêt pour la population toute entière, notamment du point de vue touristique ou culturel. Ensuite, le juge administratif exige, « lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n’est pas versée à une association cultuelle et qu’elle est exclusivement affectée au financement du projet ». Il s’agit, à travers cette condition, de s’assurer que, face à des associations à l’objet cultuel et culturel, c’est essentiellement la dimension culturelle qui justifiera le financement. En tout état de cause, l’existence d’une mixité entre le cultuel et le culturel ne doit plus être un obstacle à l’intervention financière des collectivités publiques : « la circonstance qu’un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale ». Ce faisant, le Conseil d’État a implicitement remis en cause la jurisprudence Commune de Saint-Louis en autorisant l’octroi de subvention à des associations ayant un objet à la fois cultuel et culturel, dès lors que l’objet de ces subventions présente un aspect culturel se rattachant à un intérêt public local.
La référence à la mixité peut également s’appliquer aux aménagements n’ayant pas vocation à bénéficier à un grand nombre de touristes. Dans l’arrêt Commune de Trélazé37, il était question de l’achat et de la rénovation d’un orgue devant être implanté dans l’église communale. Le Conseil d’État y propose une combinaison constructive de la loi du 2 janvier 1905 autorisant les collectivités publiques à financer des travaux d’entretien et de réparation sans pour autant financer les cultes et la loi du 2 janvier 1907 garantissant un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte. Ainsi, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une commune acquière un orgue, « afin notamment de développer l’enseignement artistique et d’organiser des manifestations culturelles dans un but d’intérêt public communal », et « convienne avec l’affectataire d’un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n’est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l’exercice du culte ». Afin d’organiser ce financement, une contrepartie de l’affectataire doit être exigée en raison du bénéfice qu’il tirera de la présence de l’orgue, et les modalités de répartition des plages d’utilisation de l’orgue entre la commune et l’affectataire doivent être précisées au sein d’une convention.
Ces décisions ont permis une simplification du régime applicable aux associations mixtes mais de nombreuses difficultés demeurent. En effet, la ligne de partage entre les actions à objet culturel et les actions à vocation cultuelle, entre ce qui relève ou non d’un intérêt public local, est souvent des plus « ténue »38 et les difficultés rencontrées par les élus locaux ne sont que déplacées. Les suites données à ces décisions du 19 juillet 2011 illustrent la nécessité, pour le juge administratif, de préciser davantage les contours de sa jurisprudence et le positionnement de cette ligne de partage, au terme d’une démarche pointilliste39 dont il est familier.
À titre d’exemple, devant se prononcer sur la décision du conseil de la communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole de financer l’achèvement de l’église Saint-Pierre de Firminy Vert, conçue par Le Corbusier, au motif de l’affectation des « deux tiers du futur ouvrage, correspondant à la base inachevée de l’édifice, à des activités culturelles, seul le tiers restant devant être affecté à l’exercice du culte », le Conseil d’État a jugé40 que le financement décidé par la communauté d’agglomération était légal dès lors qu’il n’excédait pas le montant des crédits nécessaires aux travaux afférents à la seule partie à vocation culturelle de l’édifice, non destinée à l’activité cultuelle.
Dans un nouvel arrêt Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône41, les principes affirmés en 2011 ont été confirmés dans le cadre d’une espèce relative cette fois au subventionnement de la 19e Rencontre internationale pour la paix. Des financements publics ont ainsi été autorisés par le Conseil d’État qui a relevé notamment que cette manifestation « a donné lieu à un ensemble de tables rondes et de conférences consacrées, dans l’esprit des rencontres d’Assise du 27 octobre 1986, au courage d’un humanisme de paix et a réuni plusieurs centaines d’invités et plusieurs milliers de participants » qui n’étaient pas tous là pour des raisons religieuses.
À l’inverse, dans la décision Grande confrérie de Saint Martial précitée42, le Conseil d’État relève que « les ostensions septennales ont le caractère de cérémonies cultuelles » et que « les subventions litigieuses (…) se rapportaient directement aux ostensions ». Certes, à la lecture de l’arrêt, il semble que la décision du juge résulte pour l’essentiel d’une absence de défense pertinente de la part des bénéficiaires de la subvention mais il n’en reste pas moins que la dimension touristique évidente de l’événement n’a pas été suffisante pour conduire la juridiction à reconnaître la légalité de la subvention contestée.
Quoi qu’il en soit, le cadre jurisprudentiel applicable aux financements directs des cultes a été assoupli et facilite le financement public du patrimoine religieux. La référence à la mixité des ouvrages ou aménagements est une façon de contribuer au financement du patrimoine religieux dès lors que le culte n’en est pas le bénéficiaire exclusif et qu’il est possible d’identifier un intérêt public local. Il est donc plus aisé pour les collectivités publiques d’intervenir dans le cadre cultuel, et ce d’autant plus que des outils permettant des interventions indirectes existent également.
B – Les diverses possibilités de contournement du principe d’interdiction du financement public du patrimoine religieux
En plus des outils permettant des interventions financières directes des collectivités publiques dont les cultes peuvent tirer bénéfice, il existe des outils juridiques permettant de faciliter largement la constitution ou la gestion du patrimoine religieux. Ces outils qui autorisent les collectivités publiques à soutenir les cultes permettent à ces derniers de dégager des marges de manœuvre pour la gestion de leur patrimoine.
En plus des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les personnes qui souhaitent réaliser des donations, legs et dons aux associations cultuelles, facilitant ainsi leur financement aux dépens des finances publiques, l’article L. 2252-4 du Code général des collectivités territoriales dispose qu’« une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ». Les départements disposent de la même faculté43. Il s’agit d’un soutien non négligeable qui facilite grandement l’accès des associations cultuelles au prêt bancaire44.
Depuis 200645, les collectivités peuvent également proposer aux cultes la conclusion d’un bail emphytéotique administratif en vue de la réalisation d’un édifice religieux. L’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales énonce en effet qu’« un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du Code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ». Un tel bail peut bien entendu être conclu en vue de l’occupation d’une dépendance du domaine privé de la commune, mais il peut aussi porter sur une dépendance du domaine public46. Cet outil a parfois présenté des difficultés de mise en œuvre, notamment au regard du risque de requalification des baux emphytéotiques en marché ou concession de travaux imposant le recours à une procédure de publicité et de mise en concurrence. L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux concessions a complété l’article L. 1311-2 CGCT afin d’écarter ce risque. L’alinéa 3 dispose désormais qu’« un tel bail ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante soumise à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ». Est ainsi clairement rappelée la délimitation entre les contrats de la commande publique et les contrats d’occupation domaniale auxquels se rapporte le BEA. Par ailleurs, le Conseil d’État a eu l’occasion, dans le cadre d’une décision du 19 juillet 201147, de préciser quelques aspects de ces BEA dont il était soutenu qu’ils méconnaissaient le principe d’interdiction du financement public des édifices religieux découlant de l’article 2 de la loi de 1905. Il a ainsi jugé qu’en créant la possibilité pour les collectivités de conclure des BEA au bénéfice des associations cultuelles, « le législateur a permis aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d’un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d’une part, le versement, par l’emphytéote, d’une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n’exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d’autre part, l’incorporation dans leur patrimoine, à l’expiration du bail, de l’édifice construit, dont elles n’auront pas supporté les charges de conception, de construction, d’entretien ou de conservation ». Ce faisant, poursuit la haute juridiction administrative, le législateur a dérogé aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905. Aussi le BEA constitue-t-il aujourd’hui un outil efficace et pertinent48 au service de constitution du patrimoine religieux même si des questions subsistent, notamment à propos du nécessaire retour, en fin de bail, des bâtiments construits au sein du patrimoine des personnes publiques et des conséquences financières de l’augmentation du patrimoine public49.
Enfin, les collectivités peuvent accompagner les cultes qui manquent de patrimoine à travers la mise à disposition de locaux. Cette mise à disposition peut être temporaire pour permettre l’exercice du culte (salle de prière). Une telle possibilité, consacrée par l’arrêt Commune de Montpellier50, constitue bien une aide indirecte aux cultes en les déchargeant de la nécessité de construire leurs propres locaux. De la même façon, cette mise à disposition peut parfois permettre l’exercice ponctuel d’une pratique cultuelle telle que les abattages rituels. Le Conseil d’État a affirmé51 que les dispositions de la loi de 1905 « ne font pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, construise ou acquière un équipement ou autorise l’utilisation d’un équipement existant afin de permettre l’exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes, à condition qu’il y ait un intérêt public local tenant à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique ». Autorisée dans son principe, une telle mise à disposition doit en outre respecter un certain nombre d’exigences. Le droit d’utiliser l’équipement doit être concédé dans des conditions non discriminatoires. Ainsi les tarifs, notamment, doivent assurer la garantie du principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité. Enfin, toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte doit être proscrite.
En définitive, il résulte de l’examen des dérogations textuelles et jurisprudentielles à la loi de 1905 en matière de financement public du patrimoine religieux que le principe de laïcité bénéficie d’une définition très ouverte et compréhensive, davantage tournée vers l’accompagnement du fait religieux que vers son cantonnement. Cela témoigne d’une certaine façon, comme le propose Jacques Fialaire, de la mise en œuvre de la théorie des « accommodements raisonnables »52 dont le droit français est peu coutumier et qui peine à trouver sa place dans le cadre d’un débat toujours très vif dès lors qu’il pose la question du sacré en République.
Notes de bas de pages
-
1.
C’est notamment pour tenter d’apporter une aide précieuse aux élus locaux face à diverses revendications que le Sénat a publié un rapport relatif au financement des lieux de culte par les collectivités territoriales : Maurey H., « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte », Rapp. Sénat n° 345, 17 mars 2015, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales.
-
2.
Duguit L., Traité de droit constitutionnel, t. VI, 1925, Paris, Boccard, p. 459.
-
3.
CE, ass., 24 oct. 1997, n° 187122, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom.
-
4.
Maurey H., « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte », Rapp. préc., p. 12.
-
5.
Ibid., p. 13.
-
6.
Ibid., p. 28.
-
7.
« Un siècle de laïcité », Rapp. Conseil d’État, 2004, La Documentation française, p. 246.
-
8.
En ce sens, v. : CEDH, 29 juin 2007, n° 15472/02, Folgero et a. c/ Norvège.
-
9.
CE, sect., 9 oct. 1992, n° 94455, Cne de Saint-Louis c/ association « Siva Soupramanien de Saint-Louis ».
-
10.
CE, 1er juill. 1910, Ville d’Amiens : S. 1910, III, 145, note Hauriou M. – CE, ass., 19 juill. 2011, n° 320796.
-
11.
CE, 11 juill. 1913, Cne de Dury : Lebon, p. 830.
-
12.
TA Orléans, 16 mars 2004, n° 0103376, Fédération Indre-et-Loire de la libre pensée.
-
13.
CAA Nancy, 3 juin 2003, n° 99NC01589.
-
14.
Ramel A., « Mise à disposition de locaux pour les cultes », La Gazette, Seban & associés, 22 nov. 2010, p. 70.
-
15.
CE, ass., 19 juill. 2011, n° 313518, Cne de Montpellier.
-
16.
CE, 18 nov. 1994, n° 90866, Cne de Mouhers.
-
17.
Selon l’UNESCO, ces manifestations font partie du patrimoine culturel et immatériel de l’humanité. Elles sont présentées ainsi : « Les ostensions septennales limousines consistent en de grandioses cérémonies et processions organisées tous les sept ans en vue de l’exposition et de la vénération de reliques de saints catholiques conservées dans des églises du Limousin. Largement soutenues par les villes et villages locaux, les festivités attirent un grand nombre de personnes qui se rassemblent pour voir les reliquaires défiler dans les villes accompagnées de drapeaux, de bannières, de décorations et de personnages historiques costumés. Les ostensions septennales appartiennent à toute la population du Limousin et les habitants — qu’ils soient chrétiens ou non — se considèrent comme les détenteurs de la tradition ».
-
18.
CE, 15 févr. 2013, n° 347049, Grande confrérie de Saint Martial.
-
19.
Circ. min. Intérieur n° NOR/IOC/D/11/21265C, 25 août 2011, relative à la réglementation des cultes en outre-mer.
-
20.
Ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
-
21.
Les modalités de constitution des associations cultuelles ne sont pas les mêmes par exemple.
-
22.
Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises.
-
23.
D.-L., 6 déc. 1939, « Institution aux colonies de conseils d’administration de missions religieuses ».
-
24.
Cerf M. et Horwitz M., Dictionnaire de la Laïcité, 2011, Armand Colin.
-
25.
Voir l’article 33 de la loi du 13 avril 1900, portant fixation du régime général des dépenses et des recettes de l’exercice 1900.
-
26.
Maurey H., « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte », Rapp. préc., p. 62.
-
27.
CE, 25 mars 2005, n° 265560, Min. de l’Outre-Mer c/ gouvernement de la Polynésie française.
-
28.
Fialaire J., « Les rapports entre les collectivités territoriales et les cultes », AJDA 2012, p. 2305.
-
29.
Mathieu B., de Béchillon D. et Mélin-Soucramanien F., « Faut-il actualiser le préambule de la Constitution ? », Constitutions 2012, p. 247-259.
-
30.
Forey E., « Le Conseil constitutionnel au secours du droit local des cultes », AJDA 2013, p. 1108.
-
31.
Touzeil-Divina M., « Laïcité latitudinaire », D. 2011, p. 2375.
-
32.
CE, sect., 9 oct. 1992, n° 94455, Cne de Saint-Louis c/ association « Siva Soupramanien de Saint-Louis ».
-
33.
Woehrling J.-M., « L’interdiction pour l’État de reconnaître et de financer un culte. Quelle valeur juridique aujourd’hui ? », RDP 2006, p. 1633.
-
34.
Comte-Perrier M., « Loi de 1905 et aides des collectivités publiques aux cultes (suite) », RFDA 2013, p. 342.
-
35.
CE, ass., 19 juill. 2011, n° 308544, Cne de Trélazé ; CE, ass., 19 juill. 2011, n° 308817, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et M. ; CE, ass., 19 juill. 2011, n° 309161, Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole ; CE, ass., 19 juill. 2011, n° 313518, Cne de Montpellier ; CE, ass., 19 juill. 2011, n° 320796, Mme V. : AJDA 2011, p. 1460, obs. de Montecler M.-C. ; AJDA 2011, p. 1667, chron. Domino X. et Bretonneau A. ; AJCT 2011, p. 515, obs. Perrier M. ; RFDA 2011, p. 967, concl. Geffray E.
-
36.
CE, 19 juill. 2011, n° 308817, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et M.
-
37.
CE, ass., 19 juill. 2011, n° 308544, Commune de Trélazé.
-
38.
Fialaire J., « Les rapports entre les collectivités territoriales et les cultes », art. préc.
-
39.
Voire byzantine comme l’affirme Jacques Fialaire.
-
40.
CE, 3 oct. 2011, n° 326460, Communauté d’agglomération Saint-Étienne métropole.
-
41.
CE, 4 mai 2012, n° 336462, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône.
-
42.
CE, 15 févr. 2013, n° 347049.
-
43.
CGCT, art. L. 3231-5.
-
44.
« Un siècle de laïcité », Rapp. Conseil d’État, 2004, La Documentation française, p. 286.
-
45.
Ord. n° 2006-460, 21 avr. 2006, relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques.
-
46.
L’alinéa 2 de l’article L. 1311-2 du CGCT précise en effet qu’un tel bail peut être conclu « même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie ».
-
47.
CE, ass., 19 juill. 2011, n° 320796, Mme V.
-
48.
« Un siècle de laïcité », Rapp. Conseil d’État, 2004, La Documentation française, p. 391.
-
49.
Maurey H., « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte », Rapp. préc., p. 85.
-
50.
CE, ass., 19 juill. 2011, n° 313518, Cne de Montpellier.
-
51.
CE, ass., 19 juill. 2011, n° 309161, Communauté urbaine du Mans – Le Mans métropole.
-
52.
Fialaire J., art. préc.