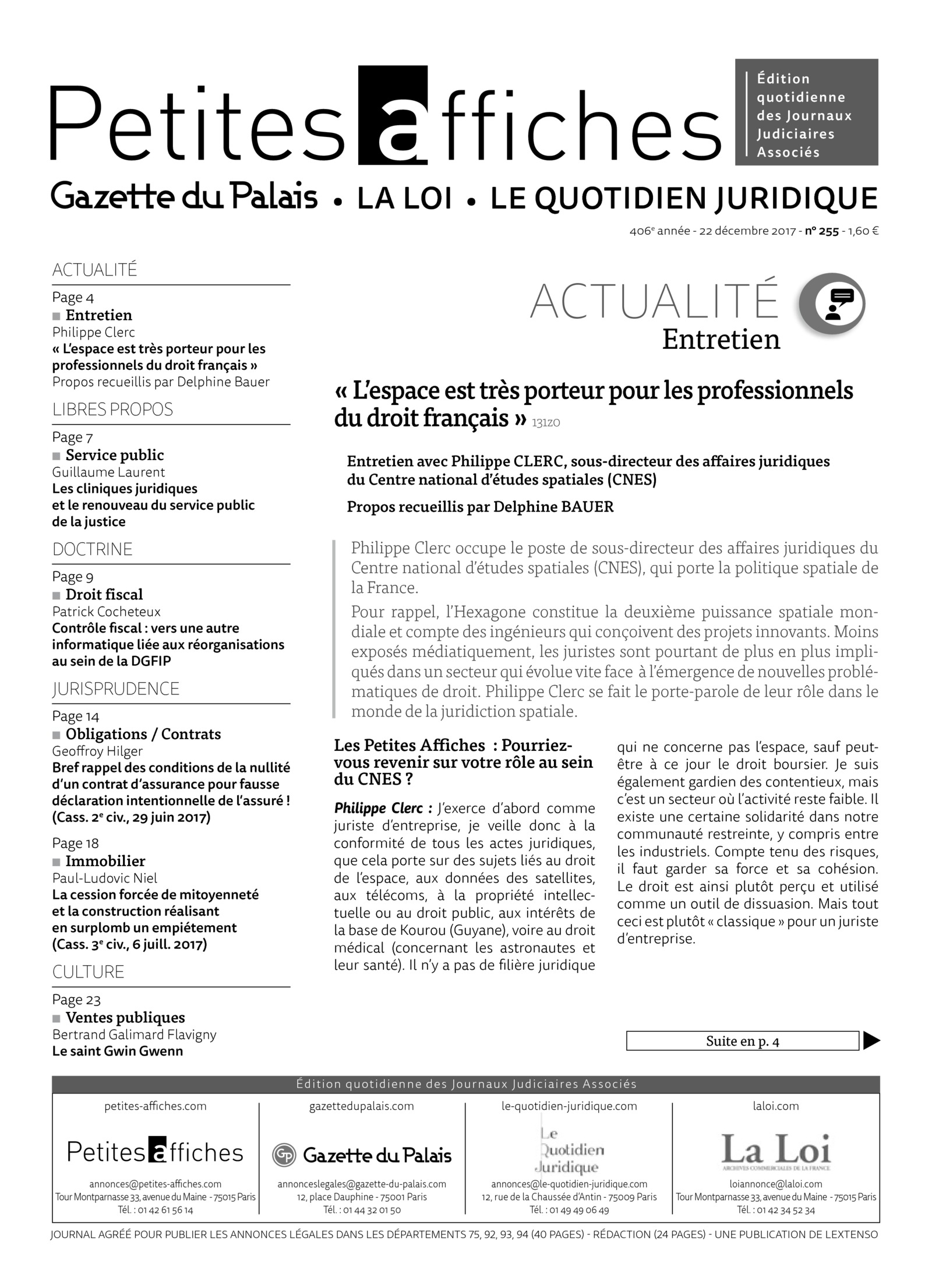« L’espace est très porteur pour les professionnels du droit français »
Philippe Clerc occupe le poste de sous-directeur des affaires juridiques du Centre national d’études spatiales (CNES), qui porte la politique spatiale de la France. Pour rappel, l’Hexagone constitue la deuxième puissance spatiale mondiale et compte des ingénieurs qui conçoivent des projets innovants. Moins exposés médiatiquement, les juristes sont pourtant de plus en plus impliqués dans un secteur qui évolue vite face à l’émergence de nouvelles problématiques de droit. Philippe Clerc se fait le porte-parole de leur rôle dans le monde de la juridiction spatiale.
Les Petites Affiches
Pourriez-vous revenir sur votre rôle au sein du CNES ?
Philippe Clerc
J’exerce d’abord comme juriste d’entreprise, je veille donc à la conformité de tous les actes juridiques, que cela porte sur des sujets liés au droit de l’espace, aux données des satellites, aux télécoms, à la propriété intellectuelle ou au droit public, aux intérêts de la base de Kourou (Guyane), voire au droit médical (concernant les astronautes et leur santé). Il n’y a pas de filière juridique qui ne concerne pas l’espace, sauf peut-être à ce jour le droit boursier. Je suis également gardien des contentieux, mais c’est un secteur où l’activité reste faible. Il existe une certaine solidarité dans notre communauté restreinte, y compris entre les industriels. Compte tenu des risques, il faut garder sa force et sa cohésion. Le droit est ainsi plutôt perçu et utilisé comme un outil de dissuasion. Mais tout ceci est plutôt « classique » pour un juriste d’entreprise. L’aspect le plus original de notre métier au CNES consiste à réfléchir à la façon d’adapter les instruments juridiques qui permettent aux nouvelles technologies spatiales d’émerger dans les meilleures conditions juridiques et institutionnelles.
LPA
Quand est né le droit de l’espace ? Concomitamment à la conquête de l’espace ?
P.C.
On distingue trois grandes périodes. D’abord dans les années 1960. Dès octobre 1957 avec Spoutnik et Youri Gagarine en 1961, et le discours important de JFK qui annonce que d’ici la fin des années 1960, les Américains iront sur la lune et en reviendront. Nous sommes alors en pleine Guerre froide. Le droit a été essentiel pour que l’espace ne devienne pas un nouveau terrain d’affrontement et que la course à la lune reste une aventure purement pacifique. En 1967, ce traité international (sur les principes qui régissent les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, ndlr) est l’un des plus ambitieux et pose le socle du droit de l’espace.
Ensuite, vient ce que l’on appelle la période des applications, avec les services que l’on peut donner sur terre grâce à l’espace, comme la météo, l’observation, la géolocalisation (GPS), les télécom… L’espace devient un relais d’informations et de télécommunications. Dès le début des années 1990 débute la première vague de privatisations. Les États doivent alors se mettre en conformité avec l’article VI du traité de 1967, qui leur attribue la responsabilité des activités privées, lesquelles doivent faire l’objet de leur autorisation et surveillance continue.
La France va faire émerger dès 1999 une large consultation qui aboutit à la loi spatiale de 2008 (LOS). Cette loi est reconnue comme l’une des plus complètes et consolidées dans le monde, car elle a été faite en une seule fois en prenant les opérations spatiales dans leur ensemble, et non, comme aux États-Unis, service par service au gré de leur développement. La France a apporté beaucoup de nouveauté, notamment sur la question des débris spatiaux en fixant un régime de prévention, plutôt que de sanction a posteriori. C’est donc le seul pays à avoir conçu une loi pour ne pas polluer, en amont.
Dernière étape : l’émergence du « New Space », avec de nouveaux acteurs qui viennent surtout de la nouvelle économie en Californie, plutôt que du secteur industriel spatial traditionnel. Ce sont des entrepreneurs qui ont cherché à développer leur propre vision et leur approche de l’espace. Ils viennent d’un monde très concurrentiel qui n’est pas habitué à travailler avec l’État ou en commandes publiques. Ils doivent aussi s’adapter à un secteur spatial, c’est-à-dire prendre en compte les risques humains alors que leur métier d’origine ne valorise que la valeur ajoutée technologique. Ces investisseurs privés recherchent une réduction des coûts à tout prix au détriment, parfois peut-être, de la qualité et de la performance. Apparaissent alors des systèmes moins chers et des nouveaux services (autres qu’opérer un lanceur ou un satellite), puisque désormais — en tout cas sur le papier —, on peut imaginer des systèmes spatiaux « non jetables » : dans le futur, on pourra approvisionner, réorbiter, réaliser le nettoyage d’orbite des vaisseaux… Cela va générer des questionnements intéressants pour nous, les juristes, notamment en ce qui concerne les relations entre acteurs privés. Par exemple, le secteur des opérations spatiales travaille aujourd’hui sur la base de clauses de non recours, ce qui signifie que vous garantissez votre produit ou service au moment où vous le livrez, mais plus après. Dans ce cas-là, il n’y a pas de garantie de type « vice caché » ou de « responsabilité produit » en cas d’incident et ce droit est bien ancré dans les lois nationales et les usages commerciaux. En conséquence la gestion du risque de ces activités très aléatoires repose sur les assureurs et en dernier ressort sur la garantie de l’État pour les dommages aux tiers (pour un montant supérieur à 60 millions d’euros). Les assureurs acceptent contrairement à leurs usages cette absence de recours (autrement dit de non-subrogation, ndlr) car les risques sont limités dans le temps et dans le montant concernant les systèmes actuels, tels que façonnés par les agences spatiales ou les réglementations techniques. Mais cet équilibre peut être remis en cause par ces nouveaux services de conception purement privée : quand on pourra réparer, réapprovisionner, expertiser dans l’espace, ou faire revenir sur terre les vaisseaux, chaque acteur pourra être tenté de rechercher la faute de l’autre dans la délivrance ou non d’un service ou la survenue d’un dommage.
Il faut donc repenser les schémas contractuels et légaux existants en matière de responsabilité contractuelle et délictuelle.
LPA
Quelles sont les particularités du droit de l’espace ?
P.C.
La particularité du droit de l’espace, c’est qu’il n’est pas basé sur une juridiction territoriale, mais découle selon le traité de 1967 d’une approche fonctionnelle liée à la notion d’« objet spatial ». Le droit spatial s’intéresse aux vaisseaux spatiaux, qui sont immatriculés comme les bateaux dans les pavillons maritimes. Il n’y a pas d’appropriation territoriale des corps célestes, astéroïdes, planètes du système solaire, la question ne se pose en l’état que pour leurs ressources minières ou énergétiques éventuelles. Pour le reste, dans l’espace infini, la notion de territoire n’a pas de sens, puisque l’on s’intéresse à des objets défilant à une vitesse d’au moins 8000km/s… Il faut aussi savoir que les droits économiques attachés aux services d’un satellite dépendent surtout de ceux accordés sur ses fréquences et services associés (télécommunication, télédiffusion, observation…) par les États concernés en application d’autres cadres normatifs, à commencer par celui de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Enfin, le droit spatial ne traite pas directement des activités de l’homme dans l’espace ou sur les corps célestes, sauf comme tierce victime potentielle.
Le droit de l’espace est très différent du droit aérien ou du droit commun au sol. Il existe deux types de responsabilités liées aux opérations spatiales : d’une part, la responsabilité dite « absolue » pour les dommages aux sols ou sur les aéronefs (autrement dit sans preuve de la faute, illimitée et solidaire entre les co-responsables) et d’autre part, la responsabilité pour faute dans l’espace proprement dit, notamment en cas de collision entre deux vaisseaux. Il s’agit ainsi d’un régime de responsabilité, très protecteur pour les victimes au sol et assez indéfini sur les dommages entre acteurs spatiaux puisque la notion de faute n’y est pas précisée.
Dans le droit aérien, nous sommes au contraire dans un droit de transport avec des solutions très uniformisées depuis la convention de Varsovie de 1929 en matière de régulation du trafic, des aéronefs et des aéroports ou de la responsabilité à l’égard des passagers, de l’équipage ou en cas de perte matérielle (fret ou bagages) où les clauses de non recours n’ont plus leur place.
Le nouveau droit spatial pose aussi des questionnements concernant le statut de l’homme, c’est sans doute le plus gros travail à faire, notamment sur les travailleurs de l’espace qui, aujourd’hui ont un statut assimilable à celui de « fonctionnaires », intervenant dans le cadre de traités intergouvernementaux.
LPA
Quels impacts dans la vie quotidienne des citoyens ?
P.C.
Le CNES a inauguré ce mois-ci un observatoire de prospective spatiale multidisciplinaire, appelé Space’ibles, qui fait intervenir des ingénieurs, mais aussi des juristes, des scientifiques, des philosophes… Les applications dans la vie courante sont multiples. Par exemple, avec l’émergence des voitures autonomes géolocalisées, il va falloir évaluer leur trajectoire au centimètre près, en surveillant le réseau terrestre avec des capteurs. Le ferroviaire aussi nous adresse une demande de technologies spatiales afin, dans le cas de la SNCF, de détecter où sont ses wagons, le spatial investit tous les territoires. Les experts juridiques sont donc sollicités. Pour résumer, les applications spatiales concernent tous les services spatiaux à destination de la terre comme les télécoms, internet, l’observation… En Europe, on est plus avancé sur ces questions éthiques et sociétales, et notamment au CNES, seule agence spatiale au monde à avoir un expert éthique. Aux États-Unis, par exemple, les acteurs du tourisme spatial pensent qu’il suffit de faire signer une décharge aux futurs clients ! Ce n’est pas une solution tenable à terme, dans la perspective du développement d’un marché grand public. Des questions éthiques et juridiques apparaissent aussi, sur la protection ou l’ouverture des données, sur les risques en cas de rupture ou de détournement de signal : à qui incombe la responsabilité ? Au réseau terrestre ou spatial ?
LPA
Quel est le rôle du droit de l’espace, comme espace de réglementations international ?
P.C.
Le traité de 1967 correspond à une réflexion qui a été très rapide et efficace à l’époque, et tient encore la route. Aujourd’hui, les nations s’accordent sur un consensus mondial, on sait ce que l’on veut éviter à tout prix : que l’espace devienne une nouvelle source de conflits, en réitérant la colonisation et l’épuisement des ressources locales, la guerre liée à l’accaparement unilatéral de territoires… Ainsi qu’éviter des sources de contaminations dans l’espace — en stérilisant les systèmes à embarquer dans l’espace dans des chambres blanches, encore plus performantes que des salles d’opération. Par ailleurs, les nouveaux acteurs privés sont assez frileux quand l’environnement juridique n’est pas clair, car ils doivent engager des banques, leurs actionnaires, démontrer que tel investissement sera rentable et permettra de rendre tel ou tel service… Ce secteur est donc très demandeur de tout encadrement susceptible d’accroître la sécurité juridique de ses projets.
Il en est ainsi d’un système d’autorisation de l’État qui peut apporter une garantie en cas de dommage aux tiers ou des gages de fiabilité et de sécurité technique aux investisseurs, grâce à une réglementation technique appropriée.
Une nouvelle donne naît aussi comme nous venons de l’indiquer avec la nécessité de définir les vices cachés, les responsabilités, en somme en passant d’un système du non recours (où l’objet n’était pas réutilisable) à celui de recours possibles mais de façon encadrée et prévisible.
Aujourd’hui, en tout état de cause, le droit national est assujetti au droit international, et ne se définit que dans la fenêtre laissée dans le régime du traité de 1967, avec la seule voie ouverte pour privatiser : l’autorisation et la surveillance continue par l’État et le droit dont ils relèvent (article VI précité). Dans ce cadre, la loi française s’est exprimée en 2008. Elle a retranscrit les engagements internationaux et a détaillé sa juridiction en ce qui concerne la prévention des débris, comment transférer des systèmes existant en orbite, on a aussi comblé des incertitudes juridiques qui interrogeaient le monde des affaires. On a ainsi mieux précisé les questions de responsabilité aux tiers et de non recours entre participants, les rôles de l’État et du CNES, la répartition des responsabilités entre les opérateurs spatiaux, une fois le vaisseau livré, avec le transfert du risque au client.
LPA
Le « New Space » est-il uniquement américain ?
P.C.
Non, ce ne sont pas que des Américains ! Avec Ariane 6, l’industrie française participe pleinement au développement du New Space, grâce à des programmes appropriés de soutien à l’industrie, à l’innovation, aux nouveaux systèmes, avec un niveau comparable aux États-Unis, à l’instar de l’effort de la Nasa vis-à-vis de Space X (l’entreprise du géant des nouvelles technologies, Elon Musk, ndla) au titre du programme de pré-achat de lancement dénommé COTS (Commercial Orbital transportation services).
LPA
Que dire du droit qui s’appliquera aux vols touristiques ?
P.C.
Des prototypes opérationnels de systèmes suborbitaux existaient en France dans les années 50 même avant les fusées ! Ce n’est donc pas un problème technique. Les vols spatiaux relèveraient plutôt du droit aérien, pour que les voyageurs, ou leurs ayant droits, aient des garanties équivalentes aux passagers d’autres transports. Si le business voit le jour, ce sera avec un système juridique similaire à celui des transports aériens mais avec une réglementation technique certainement aussi exigeante que celle des lanceurs habités.
LPA
L’espace est-il donc un secteur très porteur pour les professionnels du droit ?
P.C.
En effet, c’est un sujet très porteur. En 1989, quand j’ai rejoint le CNES, nous étions trois dans mon service. Aujourd’hui, je suis à la tête d’une équipe de près de 20 personnes et nous faisons appel à de nombreux cabinets, des consultants avocats, des centres de recherche universitaire, car les questionnements assez importants nécessitent une aide extérieure. Deux organisations en France permettent de se former ou de conduire des recherches juridiques sur ces questions : la chaire Sirius rattachée à la faculté de Toulouse, dirigée par le professeur et avocat Lucien Rapp et l’Institut du droit de l’espace et des télécommunications (IDEST) de l’université Paris Saclay avec lequel le CNES vient de constituer un groupement d’intérêt scientifique. D’ici la fin du second semestre 2018, nous avons d’ailleurs comme projet de lancer une invitation à l’attention des grands avocats parisiens afin qu’ils puissent appréhender le droit de l’espace de manière plus concrète ainsi que ses enjeux, c’est un marché en plein essor, avec de plus en plus d’acteurs et de plus en plus d’ambitions, l’on peut déduire que les sujets juridiques vont donc s’amplifier.