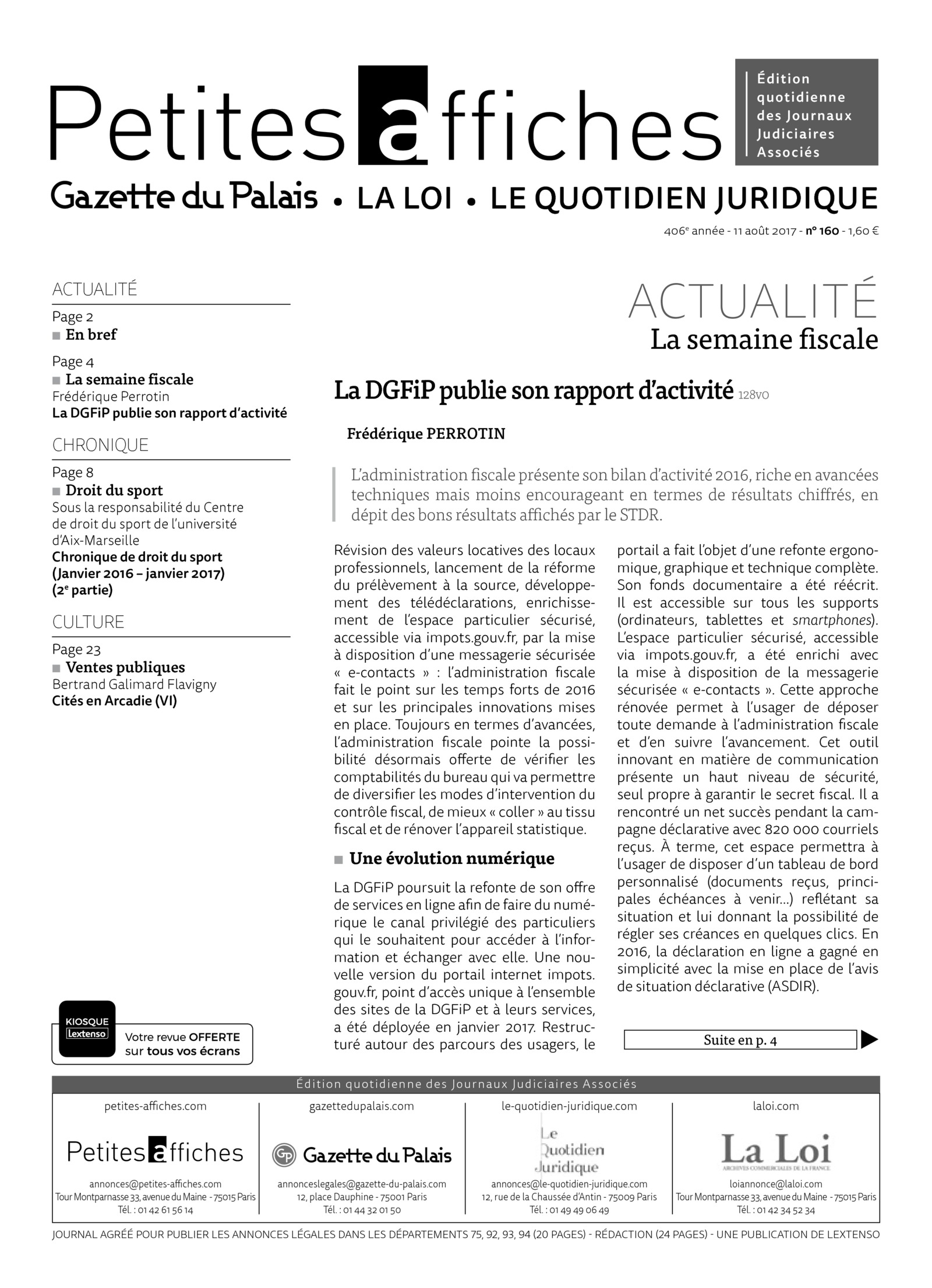Chronique de droit du sport (Janvier 2016 – janvier 2017) (2e partie)
La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2016 et janvier 2017.
I – Le cadre juridique du sport
A – Les législateurs du sport
B – Les lois du sport
1 – Légalité des décisions des fédérations
2 – Concours de normes (…)
C – La justice du sport
1 – Droit disciplinaire
2 – Arbitrage : tribunal arbitral du sport
3 – Arbitrage : chambre arbitrale du sport (…)
4 – Justice publique
5 – Justice sportive (…)
II – Les acteurs du sport
A – Les groupements sportifs
B – Le sportif
1 – Sports collectifs
2 – Sports individuels (…)
C – Les autres acteurs
1 – Entraîneurs
2 – Agents
3 – Arbitres
4 – Médias (…)
5 – Médecins (…)
III – L’activité sportive
A – Le théâtre de l’activité (…)
B – Les compétitions et manifestations sportives
1 – Accès aux compétitions
2 – Résultats des compétitions
3 – Traitement du dopage
Les dispositions relatives à l’usage de substances dopantes ne heurtent pas le principe de légalité des délits et des peines (CE, ord. réf., 22 avr. 2016, n° 398087)
Dans cette affaire, le 7 février 2015 M. A, un pratiquant de muay thaï, membre de la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées fait l’objet d’un contrôle anti-dopage à l’issue d’une compétition internationale (La nuit des Titans) organisée en France, à laquelle il a participé. Ce contrôle s’avère positif et établit la prise d’anabolisants. Suite à la procédure suivie devant la commission de discipline compétente et la sanction prononcée par cette dernière, l’AFLD se saisit de l’affaire (C. sport, art. L. 232-22 3) et prononce une sanction d’interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises concernées. Elle demande également à ces dernières d’annuler les résultats individuels obtenus par M. A le 7 février 2015. Cette décision est contestée sur le fond par le sportif. Dans le même temps, M. A demande au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Pour faire prononcer la suspension de la décision, M. A considérait, outre l’urgence, qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision, en raison spécialement du caractère non constitutionnel des dispositions de l’article L. 232-9 2° du Code du sport. Et pour établir ce doute sérieux, M. A demandait au Conseil d’État de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions précitées. Plus précisément, aux termes de l’article L. 232-9 2° du Code du sport, « il est interdit à tout sportif : d’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ». Or, selon le demandeur les dispositions précitées violaient pêle-mêle les principes de légalité des délits et des peines, de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines, de la présomption d’innocence et le droit au recours effectif garantis par les dispositions des articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen… « dès lors, d’une part, que ces dispositions définissent de façon insuffisamment précise les caractéristiques du comportement incriminé, et, d’autre part, qu’elles instituent, dans l’interprétation qu’en a donnée le Conseil d’État, une présomption irréfragable de culpabilité à l’encontre de tout sportif ayant fait l’objet d’un contrôle antidopage positif ».
Le Conseil d’État balaie sans surprise ces arguments1. Pour le Conseil, tout d’abord, « contrairement à ce qu’affirme le requérant, les dispositions de l’article L. 232-9 du Code du sport énoncent en des termes clairs et suffisamment précis l’interdiction faite à tout sportif d’utiliser ou de tenter d’utiliser, en dehors d’une autorisation à des fins thérapeutiques ou d’une raison médicale dûment justifiée, les substances ou méthodes figurant sur la liste élaborée en application de la Convention internationale contre le dopage dans le sport qui, dans sa version applicable au litige, a été fixée par un amendement à l’annexe I de cette convention, publié au Journal officiel de la République française par le décret du 22 décembre 2014 susvisé ». Sur ce premier point, on peut être en accord avec cette affirmation conforme à l’interprétation du principe de légalité criminelle appliqué au domaine disciplinaire par le Conseil constitutionnel2 sauf éventuellement à remarquer que les substances apparentées envisagées par la liste précitée peuvent ne pas être connues au moment où le sportif prendrait ladite substance3. La question se pose alors de savoir si le renvoi opéré ici par les dispositions du Code du sport est suffisamment précis pour que le sportif connaisse les caractéristiques du comportement réprimé.
Le Conseil d’État estime ensuite « qu’en dehors des cas où le sportif se prévaut d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ou fait état d’une raison médicale dûment justifiée, l’existence d’une violation de l’interdiction posée par l’article L. 232-9 du Code du sport est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire ou sanguin, de l’une des substances ou méthodes figurant sur la liste susmentionnée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’usage de cette substance ou de cette méthode a revêtu un caractère intentionnel ; que si les articles L. 232-21 et L. 232-22 du Code du sport, dont la constitutionnalité n’est au demeurant pas contestée, prévoient que toute personne ayant contrevenu à cette interdiction encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération sportive dont elle est licenciée ou de l’Agence française de lutte contre le dopage, ces dispositions n’instituent aucun automatisme en matière de sanction ; qu’en particulier, elles ne privent aucunement le sportif de la possibilité d’échapper à toute sanction en établissant, dans le cadre de la procédure disciplinaire, que la présence dans le prélèvement de substances ou méthodes interdites est le fruit d’un acte de malveillance dont il a été victime en dépit de l’absence de toute négligence de sa part ». En d’autres termes, si l’infraction disciplinaire est objective, celle-ci n’établit pas une présomption irréfragable de culpabilité à l’encontre de tout sportif ayant fait l’objet d’un contrôle anti-dopage puisque plusieurs moyens existent d’établir son absence de culpabilité4. En outre, les dispositions du Code du sport excluent tout mécanisme de sanction automatique de l’interdiction fulminée à l’article L. 232-9 du Code du sport qui violerait le principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen5. Elles permettent au contraire une individualisation de la sanction du sportif allant jusqu’à une absence de sanction de ce dernier6. On comprend donc que le Conseil d’État ait considéré que la question prioritaire de constitutionnalité posée à propos de l’article L. 232-9 du Code du sport ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, sachant enfin que l’invalidation des résultats individuels du compétiteur dopé obtenue lors de la compétition ne constitue pas une punition.
Didier PORACCHIA
Obligation de localisation du sportif de haut niveau : le judoka battu par ippon ! (CE, 2e/7e ss-sect. réunies, 15 avr. 2016, n° 394199 ; CE, ord., 2 mai 2016, n° 399040 ; CE, 11 juill. 2016, n° 399038)
Cette affaire concerne un judoka suspendu 10 mois par sa fédération suite à trois contrôles manqués (no-show), sanction alourdie à 2 ans par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autosaisie sur la base de son pouvoir de réformation.
Dans un arrêt du 24 novembre 2015, le Conseil d’État avait suspendu l’exécution de la décision de l’AFLD, considérant qu’il existait un doute sérieux quant à sa légalité, la décision fédérale pouvant avoir été adoptée hors des délais légaux. Le problème portait sur le point de départ du délai de 10 semaines dont dispose la fédération pour statuer. Selon l’article L. 232-21 du Code du sport, il court à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée. Le sportif soutenait que le délai commençait à courir à compter de la notification par l’Agence de sa troisième absence et que la décision fédérale était donc hors délais. Le règlement disciplinaire-type précise néanmoins que dans l’hypothèse d’un manquement aux obligations de localisation, l’infraction est considérée comme constatée à la date de la transmission à la fédération du procès-verbal de constat d’infraction si bien que le délai légal aurait été respecté par la fédération. Le Conseil d’État avait estimé que cette « substitution » du point de départ du délai entre le dispositif législatif du Code du sport et le règlement disciplinaire-type était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ce qui avait été critiqué par des auteurs7.
Mais, se prononçant au fond le 15 avril 20168, le Conseil d’État balaie finalement ce raisonnement au motif qu’il résulte des articles L. 232-21 et R. 232-86 du Code du sport et du règlement disciplinaire-type que, s’agissant de l’infraction à l’obligation de localisation, la date à laquelle l’infraction est constatée par la fédération est la date à laquelle cette dernière reçoit de l’Agence le signalement de cette infraction. Le Conseil d’État refuse par ailleurs, d’étudier la question de la légalité de l’inscription du sportif dans le groupe cible, estimant qu’une fois devenue définitive, celle-ci n’est plus susceptible d’être contestée par voie d’exception à l’occasion de la contestation d’une sanction. Il considère, en outre, que la circonstance selon laquelle les agents assermentés n’auraient pas respecté leur obligation de formation professionnelle continue est sans incidence sur leur qualité pour constater l’absence d’un sportif au lieu déclaré par lui en application du Code du sport. Cependant, le Conseil d’État considère qu’il y a lieu de prendre en considération, comme le permet l’article 10.3.2 du Code mondial antidopage, bien qu’il n’ait pas d’effet direct dans notre ordre juridique interne9, le fait que ni ces changements ni l’identification d’autres conduites ne pouvaient laisser sérieusement soupçonner que l’intéressé, inscrit dans le groupe cible depuis 2012, tentait volontairement de se rendre indisponible pour des contrôles ; en particulier, il n’est pas contesté que l’un de ces changements était consécutif à la participation de l’intéressé à une compétition avec l’équipe de France, en conséquence de quoi il convenait de ramener la durée de l’interdiction infligée de deux à un an, étant précisé que devait être déduite de cette suspension d’un an, la période déjà purgée en vertu de la suspension provisoire et de la sanction fédérale, et la durée entre la notification de la sanction de l’AFLD et la suspension de celle-ci par le juge des référés.
L’AFLD, le 21 avril 201610, a alors adopté une décision précisant que la durée totale des périodes déjà purgées par le sportif était de 5 mois et 17 jours et que le reliquat de la sanction restant à exécuter s’établissait à 6 mois et 15 jours. Le judoka a toutefois formé un nouveau recours en référé contre cette décision de l’Agence, considérant qu’il existait un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’aucune disposition réglementaire ou législative ne confère à l’AFLD compétence pour se prononcer sur les conditions d’exécution d’une décision du Conseil d’État ou pour en interpréter le sens. Il soutenait également que les garanties inhérentes à la procédure disciplinaire n’avaient pas été respectées11 et que la décision de l’AFLD méconnaissait les principes de non-rétroactivité et de non-cumul des sanctions. Mais, dans un arrêt du 2 mai 201612, le juge des référés du Conseil d’État rejette sa requête, considérant que l’AFLD n’avait pas pris une nouvelle décision de sanction mais s’était bornée à préciser dans sa décision, conformément aux indications données par le Conseil d’État, la durée de la période déjà purgée devant s’imputer sur la durée totale de la sanction, et la durée du reliquat de la sanction et ce, en se conformant en tout point à la chose jugée par le Conseil d’État dans son arrêt au fond du 15 avril 2016.
Néanmoins, le judoka continuait de contester les modalités de décompte des durées de suspension. Aussi, dans un arrêt du 11 juillet 201613, le Conseil d’État met fin à ce long débat judiciaire en rejetant la requête en annulation du judoka. Ainsi, les juges estiment qu’il « appartenait bien à l’AFLD de prendre, même d’office, les mesures qu’implique nécessairement l’exécution » d’une décision du Conseil d’État réformant l’une des décisions de sanction de l’Agence. Autrement dit, l’AFLD était compétente pour déterminer la période déjà purgée par le sportif, à déduire de la suspension d’un an dont il avait fait l’objet. Puis, le Conseil d’État estime que « compte tenu des impératifs du calendrier sportif », l’urgence était en l’espèce constituée et que la convocation des membres de l’Agence n’était pas irrégulière même si adressée sans respecter le délai de 5 jours prévu par le règlement intérieur de l’AFLD. En outre, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est également rejeté car, s’agissant d’une délibération ne constituant pas une nouvelle sanction mais une simple décision relative à la computation des périodes de suspension effectives de l’intéressé, celui-ci n’avait pas à être à nouveau entendu. Enfin et surtout, sur le fond, le Conseil d’État valide les modalités de computation des périodes de suspension, telles que décidées par l’Agence dans sa décision du 21 avril 2016. Notamment, les juges confirment qu’il n’y a lieu de tenir compte que des périodes pendant lesquelles le sportif a effectivement été privé de la possibilité de participer à des compétitions fédérales. En l’espèce, les périodes pendant lesquelles le sportif a pu participer à des compétitions ne peuvent donc pas être considérées comme des périodes déjà purgées et cela alors même que des décisions ultérieures, de l’AFLD ou de la fédération internationale, ont éventuellement conduit à l’annulation des résultats obtenus par le sportif lors de ces périodes. On retiendra, d’une part, qu’il appartient à l’AFLD de se prononcer sur la computation des périodes effectives de suspension, et d’autre part, que seules les périodes de travail pendant lesquelles le sportif a effectivement été privé de la possibilité de participer à des compétitions doivent être considérées comme des périodes déjà purgées.
Bastien BRIGNON
Notification d’un contrôle antidopage par voie d’affichage (CE, ord., 12 févr. 2016, n° 396215 ; CE, 22 juill. 2016, n° 396214)
Un coureur cycliste professionnel au sein de l’équipe de l’armée de terre, remporte en 2015 une épreuve à l’issue de laquelle 12 coureurs, dont lui-même, sont convoqués par voie d’affichage, à l’initiative de l’AFLD, pour un contrôle antidopage. Le coureur ne se présente pas au contrôle. Il est alors suspendu 4 mois par la fédération française de cyclisme (FFC) et ses résultats sont annulés. L’AFLD s’autosaisit sur le fondement de son pouvoir de réformation. Par une décision du 22 octobre 2015, elle allonge la suspension du coureur à un an, sanction qu’elle étend également aux compétitions organisées par six autres fédérations sportives. Le sportif saisit alors le Conseil d’État en référé lequel, le 12 février 2016, suspend l’exécution de cette décision en retenant le caractère disproportionné de la sanction au regard de la faute14. En effet, l’affichage du « tableau des coureurs à contrôler », effectué sur un pré-imprimé portant mention d’une liste de réserve, créait une confusion sur l’identité des coureurs devant effectivement se présenter au contrôle. En outre, le fait qu’une seule escorte se soit présentée devant le bus de l’équipe du requérant alors même qu’un autre de ses coéquipiers faisait partie des personnes à contrôler, ainsi que la confirmation donnée à deux reprises par les commissaires de courses qu’il n’était pas concerné par le contrôle, ont entretenu cette confusion. Dès lors, si les juges ont relevé que l’encadrement avait fait preuve d’une « négligence fautive » en ne vérifiant pas l’information auprès des préleveurs, ce qui ne peut exonérer le sportif de sa responsabilité15, ils ont également retenu que les carences dans l’organisation du contrôle et le doute qu’elles ont engendré pouvaient, sans l’excuser, expliquer l’absence de l’athlète.
Sur le fond, dans un arrêt du 22 juillet 201616, le Conseil d’État valide finalement la notification par voie d’affiche qui posait difficulté en l’espèce. En effet, il existe en la matière la délibération n° 296 du 12 septembre 2013 prise pour application des dispositions de l’article D. 232-47 du Code du sport relatives aux modalités particulières de notification d’un contrôle antidopage. Ainsi, selon l’article 2 de ladite délibération : « Pour les compétitions cyclistes de quelque nature qu’elles soient, la personne chargée du contrôle porte à la connaissance de l’organisateur, par tout moyen, l’identité des coureurs désignés pour le contrôle au plus tard avant l’arrivée du vainqueur de l’épreuve. La liste des coureurs qui sont tenus de se présenter pour le prélèvement d’échantillons doit être affichée, à l’initiative de l’organisateur, aussi bien à proximité immédiate de la ligne d’arrivée qu’à l’entrée du poste de contrôle du dopage. Les intéressés sont identifiés par leur nom ou par leur numéro de dossard ou, s’il y a lieu, par leur place au classement. Tout coureur, même en l’absence de notification écrite du contrôle, doit, dans les dix minutes suivant le franchissement par lui de la ligne d’arrivée, se rendre à l’emplacement où la liste des personnes soumises au contrôle a été affichée et, s’il y a lieu, rejoindre immédiatement le poste de contrôle du dopage (…) ». Le cycliste soutenait que la délibération ne pouvait substituer de cette manière un simple affichage avec obligation d’aller le consulter à une notification écrite. D’ailleurs, il n’y avait eu, en l’occurrence, qu’un seul affichage. Pour autant, le Conseil d’État juge que « cette délibération, sans exclure la remise d’une notification écrite, prévoit que l’information des coureurs désignés pour un contrôle est assurée, d’une part, par l’indication de leur identité aux organisateurs de la manifestation et, d’autre part, par la voie d’un double affichage ; qu’au demeurant, l’information par voie d’affichage est une modalité utilisée par l’Union cycliste internationale ; qu’ainsi, elle assure des garanties suffisantes de l’origine et la réception de cette notification ». Un tel système reste donc valide. Mais le Conseil d’État annule la décision du 22 octobre 2015 de l’AFLD : « (…) ce tableau faisait en l’espèce apparaître la nature et la date de l’épreuve, le lieu du contrôle ainsi qu’une liste comportant les noms de douze coureurs dont, en dernier, M. B ; qu’il est constant que, contrairement aux prescriptions de la délibération du 12 septembre 2013, le tableau n’a pas fait l’objet d’un autre affichage à l’entrée du poste de contrôle ; que le nom de M. B étant le dernier mentionné sur le tableau affiché, la personne désignée par l’équipe de M. B pour vérifier quels étaient les coureurs concernés par le contrôle a cru que ce dernier ne l’était pas, à la différence de l’un de ses coéquipiers, mais qu’il figurait seulement sur la liste de réserve ; qu’en outre, l’escorte qui s’est présentée devant le bus de l’équipe a procédé à une notification du contrôle à ce seul coéquipier, qu’elle a accompagné jusqu’au lieu du contrôle ; qu’il n’est pas contesté que la personne désignée par l’équipe de M. B pour vérifier le tableau d’affichage a interrogé à deux reprises les commissaires de la course, qui lui ont confirmé que ce dernier n’était pas concerné par le contrôle ; que M. B, vainqueur de la course, est en outre resté pendant quarante minutes environ dans l’aire du podium, à la disposition des organisateurs de la manifestation, lesquels n’avaient, par ailleurs, pas fait procéder à une information par haut-parleur ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme s’étant délibérément soustrait au contrôle au sens des dispositions de l’article L. 232-17 du Code du sport ». La notification d’un contrôle antidopage par voie d’affichage reste valable, en la matière et en général, mais, au cas d’espèce, la décision de l’AFLD est annulée17.
Bastien BRIGNON
Indépendance du département des analyses de l’AFLD (CE, 2e/7e ss-sect. réunies, 23 déc. 2016, n° 398074)
Une athlète figurant sur le groupe-cible fait l’objet d’un contrôle inopiné diligenté par le directeur des contrôles de l’AFLD. Les analyses effectuées par le département des analyses de l’Agence révèlent la présence d’un produit interdit. L’AFLD prononce alors à son encontre la sanction d’interdiction de participer pendant 3 ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises. L’intéressée demande l’annulation de cette décision. Son principal argument est de remettre en cause l’indépendance du laboratoire national antidopage18. Dans un arrêt du 23 décembre 201619, mentionné dans les tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État juge que des garanties suffisantes sont offertes aux sportifs en la matière. Il considère ainsi que les articles L. 232-1820 et R. 232-4321 du Code du sport garantissent l’indépendance opérationnelle du département des analyses de l’AFLD22, conformément aux exigences du standard international pour les laboratoires de l’Agence mondiale antidopage, laquelle l’a, au demeurant, agréé. En effet, aux termes de l’article 4.1.8 du standard international pour les laboratoires de l’Agence mondiale antidopage, rendu applicable en droit interne par l’article R. 232-43 du Code du sport : « le laboratoire sera opérationnellement indépendant des organisations antidopage afin d’assurer une complète confiance en sa compétence, son impartialité, son jugement et son intégrité opérationnelle », étant rappelé que les normes dudit standard international sont, contrairement au Code mondial antidopage, directement applicables en droit français23. En l’espèce, la requérante ne soutient pas que les modalités de fonctionnement du département auraient méconnu ces exigences, de sorte que le moyen tiré de ce que les analyses auraient été effectuées par un laboratoire qui ne serait pas indépendant ne peut qu’être écarté.
Bastien BRIGNON
Notion d’aide substantielle (CE, 23 déc. 2016, n° 399728)
L’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015, qui transpose en droit français le Code mondial antidopage 2015, a ouvert la possibilité d’une clémence – consistant en un sursis à exécution – en cas d’aide substantielle apportée par l’intéressé – la loi parle vaguement de « personne » – afin de découvrir, d’éviter ou de faire cesser une infraction aux règles antidopage et/ou d’identifier son auteur24, l’aide substantielle étant définie par l’article L. 230-4 du Code du sport comme « le fait pour une personne de : 1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ; 2° Et de coopérer à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience. Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d’engager des poursuites ou, si aucune poursuite n’est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être engagées ». Dans un arrêt du 23 décembre 2016 le Conseil d’État est amené, pour la première fois, à statuer sur cette notion d’aide substantielle25. Au cas d’espèce, suspendue par la Fédération française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées pour 6 mois, à la suite d’un contrôle antidopage positif lors d’une compétition de pancrace organisée à Paris, une sportive est finalement sanctionnée de 4 ans de suspension par l’AFLD qui s’est autosaisie. Elle demande au Conseil d’État de réformer cette décision, estimant avoir fourni une aide substantielle, au sens de l’article L. 232-23-3-2 précité. Le jour de la séance du collège des sanctions de l’AFLD, elle avait en effet déclaré par écrit qu’elle allait déposer plainte contre une personne se faisant appeler « Momo » qui lui avait vendu des produits dopants et a fourni un numéro de téléphone présenté comme étant celui de cette personne. Le Conseil d’État juge cependant « qu’en estimant que, compte tenu de leur nature et de leur imprécision, ces informations ne constituaient pas une aide substantielle au sens des dispositions précitées de l’article L. 230-4 du Code du sport, l’AFLD n’a pas inexactement qualifié les faits ; qu’elle a pu en déduire que les conditions posées par les dispositions précitées pour que la sanction infligée à l’intéressée puisse être assortie du sursis n’étaient pas réunies ». Le Conseil d’État a également estimé que la sanction prononcée n’était pas disproportionnée, eu égard à la nature des substances en cause et au comportement de l’intéressée lors du contrôle (elle avait quitté les lieux du contrôle sans y être autorisée et avant d’avoir fourni un prélèvement urinaire supplémentaire). En outre, l’absence de tout antécédent en matière de dopage et le statut d’amateur de l’intéressée n’étaient pas de nature à réduire la sanction. L’aide substantielle ne se résume donc pas à des informations relativement vagues. Elle doit s’accompagner au surplus d’une totale bonne foi, résumée ici à la soumission aux contrôles sans réserve. N’est pas délateur qui veut !
Bastien BRIGNON
Lutte contre le dopage : reconnaissance de la fraude mécanique et technologique (L. n° 2017-261, 1er mars 2017, art. 9)
La loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs contient un article 9 selon lequel « le gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport relatif à la création d’un délit de fraude mécanique et technologique dans le sport et à l’élargissement des compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage à la fraude mécanique et technologique ». On attendra que la mesure soit effective avant tout commentaire.
Bastien BRIGNON
4 – Sécurité des compétitions
Interdiction de stade, refus de vente de titres d’accès, traitement automatisé de données, dissolution d’association de supporters : la France met les moyens pour lutter contre les violences sportives ! (L. n° 2016-564, 10 mai 2016 ; D. n° 2016-957, 12 juill. 2016 ; D. n° 2016-1954, 28 déc. 2016 ; L. n° 2017-86, 27 janv. 2017 ; CEDH, 27 oct. 2016 ; CE, 13 juin 2016, 2 décisions ; CE, 30 déc. 2016)
L’année 2016 a été riche de nouvelles législations et de nouvelles décisions de justice luttant contre les violences sportives.
Commençons par les textes. A d’abord été adoptée la loi n° 2016-564 du 10 mai 201626 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme27. Cette loi28, d’une part, complète l’article L. 332-1 du Code du sport selon lequel « les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 211-11 du Code de la sécurité intérieure ». Ce texte précise désormais qu’ « aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations » (al. 2), et que, « à cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l’avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » (al. 3). On se souvient qu’en octobre 2010, un livre vert du « supportérisme » formulait déjà des propositions d’actions pour le développement du volet préventif de la politique de gestion du hooliganisme et que, initialement, l’un des axes de la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 29 septembre 2015 par Guillaume Larrivé était précisément de donner aux clubs de football, la capacité effective d’exercer les responsabilités qui sont les leurs en matière de sécurité dans les stades (refus de l’accès à l’enceinte sportive aux personnes qui, en raison de leur comportement, ont porté atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et au bon déroulement de ces manifestations, mise en œuvre d’un fichier de ces personnes). Les nouvelles mesures légales, importantes, répondent à l’objectif. Surtout, elles légalisent le fameux fichier Stade29. D’autre part, ladite loi modifie l’article L. 332-16 du Code du sport pour porter la durée maximale de l’interdiction de stade à 24 mois (au lieu de 12), et à 36 (au lieu de 24) en cas de récidive dans les 3 ans. L’alinéa 3 dudit texte, selon lequel « le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure, l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objets de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger », précise dorénavant, à titre de garantie, que « cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne ». De dernière part, la loi du 10 mai 2016 complète les articles L. 332-15 et L. 332-16 du Code du sport afin de permettre la communication de l’identité des personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire ou administrative de stade aux organismes sportifs internationaux, lorsqu’une équipe française participe à une manifestation sportive organisée par leurs soins30. Mais il y a plus. La loi instaure également un nouvel article L. 332-1-1 aux termes duquel : « les cartes annuelles d’abonnement donnant accès aux compétitions sportives professionnelles auxquelles participe une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ne peuvent être vendues que par celles-ci, par une société commerciale mandatée par elle à cet effet ou par un comité d’entreprise » (al. 1er). « Ces titres d’accès peuvent être nominatifs » (al. 2). Les clubs ont donc maintenant l’obligation de vendre directement les cartes annuelles d’abonnement donnant accès aux compétitions sportives professionnelles qu’ils organisent, ou d’en confier la gestion à une société commerciale mandatée à cet effet ou à un comité d’entreprise. L’idée est de sécuriser les ventes d’abonnements annuels aux manifestations sportives et d’éviter ainsi les ventes en bloc. De plus, si le texte initial prévoyait que les titres d’accès seraient nominatifs, il ne s’agit désormais que d’une faculté, compte tenu des difficultés de mise en œuvre de la mesure, en particulier pour les petits clubs ou amateurs. Enfin, trois nouveaux textes précisent que « les supporters et les associations de supporters, par leur comportement et leur activité, participent au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et concourent à la promotion des valeurs du sport »31. « Est instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des Sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil. « Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance »32. « Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, au sens de l’article L. 132-1, assurent le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters. À cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des Sports, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. Un décret détermine les compétences et les conditions de désignation de ces personnes, ainsi que les conditions de leur formation »33. Une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre des Sports, est ainsi instituée. Elle a pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil. Quant à l’article L. 224-3 précité, il s’inspire fortement du modèle des Fan Projekte allemands ou de celui des Supporters Liaison Officers proposé par l’UEFA, étant rappelé que cette disposition n’est entrée en vigueur que le 10 août 2016 et qu’un décret devra toutefois déterminer les compétences et les conditions de désignation de ces personnes, ainsi que les conditions de leur formation.
Il s’agit précisément du décret n° 2016-957 du 12 juillet 201634 pris pour l’application de l’article 6 de la loi n° 2016-564 du 10 mai 201635. S’agissant de l’instance nationale du supportérisme, le décret précise qu’elle est notamment consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations, ainsi que tout projet d’acte de l’Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme36. Elle veille à favoriser les échanges et le partage d’informations entre les acteurs. À ce titre, elle a connaissance de la liste des personnes référentes chargées des relations avec les supporters au sein de chaque discipline gérée par une ligue professionnelle. Elle présente chaque année au ministre des Sports un rapport d’activité qui retrace la contribution de l’instance et celle des différents acteurs du sport, dont la division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur le supportérisme. Ses membres, dont la liste est fixée par l’article D. 224-2 et qui exercent leurs fonctions à titre gratuit, sont nommés par arrêté du ministre des Sports, pour une durée de 3 ans. S’agissant des relations entre les clubs et leurs supporters, ce sont les associations ou sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle qui désignent, après avis des associations de supporters concernées, et en application de l’article L. 224-3 du Code du sport, une ou plusieurs personnes référentes, bénévoles ou salariées, chargées des relations avec leurs supporters37. Elles informent la ligue professionnelle concernée de la ou des personnes référentes désignées. Le référent ne peut ni être membre de l’association de supporters qui soutient le club qui l’a désigné ni être en charge des missions de sécurité des manifestations et compétitions sportives au sein ou pour le compte de ce club. Le référent dialogue avec les référents des autres clubs de la ligue professionnelle concernée et avec le représentant de l’État dans le département (le préfet de police à Paris), dans le cadre de la préparation des manifestations et compétitions sportives. Enfin, pour obtenir l’agrément valable 5 ans, du ministre des Sports, les associations de supporters doivent respecter les conditions fixées par l’article D. 224-9 du Code du sport38.
Ensuite, un autre décret, n° 2016-1954, du 28 décembre 201639, précise les modalités de mise en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif40. En effet, l’article L. 332-1 du Code du sport prévoit que les organisateurs de manifestations sportives peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel. Il s’agit donc du décret, pris après avis motivé et publié de la Cnil, qui fixe le type de données pouvant être inscrites dans le fichier Stade41, les conditions de leur conservation, les destinataires de ces données, ainsi que les conditions d’accès et de rectification des personnes concernées42.
Les données enregistrées concernent les : « 1° Données d’identification : nom ; prénom ; date et lieu de naissance ; adresse ou lieu de résidence ; adresse électronique ; numéro de téléphone ; numéro de carte d’abonnement et photographie associée, le cas échéant ; 2° Motifs de l’enregistrement constituant un manquement aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives, à savoir a) Acte de provocation à la haine ou à la violence dans l’enceinte sportive ou à ses abords immédiats, b) Acte de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens dans l’enceinte sportive ou à ses abords immédiats lors de la manifestation sportive, c) Accès à l’enceinte sportive en état d’ivresse manifeste ou sous l’influence manifeste de produits stupéfiants ; introduction et consommation de boissons alcooliques et/ou de produits stupéfiants dans l’enceinte sportive, d) Introduction dans l’enceinte sportive de tout objet pouvant constituer une arme ou mettre en péril la sécurité des personnes et des biens ; 3° Décisions prises, à savoir : a) Nature de la mesure : suspension, résiliation ou impossibilité de souscrire un nouvel abonnement ; refus de vente d’un titre d’accès ; annulation d’un tel titre ; refus d’accès à une enceinte sportive, b) Date de la décision, c) Durée de la mesure ».
Ces données sont conservées pendant une durée au plus de 18 mois, à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, elles sont effacées automatiquement des traitements. L’article R. 332-17 du Code du sport établit la liste des personnes ayant accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées, et les personnes qui peuvent en être destinataires en tout ou en partie.
Enfin, il faut noter la loi n° 2017-86 du 27 janvier 201743 relative à l’égalité et à la citoyenneté44 dont l’article 207 modifie les articles L. 332-18 et L. 332-19 du Code du sport pour remplacer les mots « orientation ou identité sexuelle » par « orientation sexuelle ou identité de genre ». L’article L. 332-18 permet de dissoudre ou de suspendre pendant 12 mois au maximum l’activité d’une association de supporters dont les membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d’une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. L’article L. 332-19 fixe l’échelle de sanctions en cas d’infractions liées, notamment, à l’orientation sexuelle ou identité de genre de la victime. La notion d’identité de genre intègre donc le Code du sport, la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté prenant désormais en compte la transidentité afin de protéger les personnes transgenres de toute discrimination, notamment celles dont peuvent se rendre coupables les membres des associations de supporters.
Poursuivons avec la jurisprudence. Trois décisions peuvent être retenues. D’abord, celle de la Cour EDH du 27 octobre 2016 déclarant que la dissolution par décret du Premier ministre français des associations de supporters Les Authentiks et Supras Auteuil 91 ne viole pas la Convention EDH45, à savoir ni l’article 6 relatif à un procès équitable ni l’article 11 afférent à la liberté d’association. Si cette décision s’inscrit dans la droite ligne d’une autre rendue par la même Cour le 22 février 201146, pour autant elle comporte un examen bien plus minutieux, sur la recevabilité et sur le fond, des requêtes dirigées contre les décrets. Ensuite, on peut relever deux décisions du Conseil d’État du 13 juin 2016, la première estimant que les règles procédurales encadrant les enquêtes administratives de la Cnil comme des garanties profitant non seulement à « toute personne dont les données nominatives font l’objet du traitement en cause », mais aussi au « gestionnaire du fichier » et à « ses utilisateurs, pour lesquels la limitation d’accès des personnes qualifiées garantit la confidentialité et l’intégrité du fichier concerné »47, et la seconde précisant quelques critères susceptibles de permettre la création et la conservation de « listes noires » par un club de football48. Enfin, il faut noter la décision du 30 décembre 2016 concernant l’interdiction de déplacements de supporters dans le cadre de l’état d’urgence qui n’est pas contraire à la Convention européenne sur la violence de spectateurs et leurs débordements lors de manifestations sportives49.
Il est clair, par conséquent, que la législation française s’est considérablement durcie en matière de lutte contre les violences sportives. L’un des moyens de lutte est le traitement automatisé des données. Gageons que les garanties fondamentales seront respectées et que la violence sera enrayée, du moins très largement contenue, une bonne fois pour toutes.
Bastien BRIGNON
C – Les responsabilités
Le respect des règles de la pratique du ski exclut-il le caractère fautif du comportement litigieux ? (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-16450)
La faute d’imprudence d’un amateur de ski est-elle réductible à la méconnaissance des règles relatives à la pratique de ce sport ? Telle est la question que pose en substance l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 avril 201650. Si, en principe, les juges peuvent, pour apprécier la faute, prendre en considération les règles relatives à la pratique d’un sport, notamment celles relatives au ski51, la faute du skieur peut dépasser les seules hypothèses de contravention à ces règles52. De même que le manquement à une règle de la pratique du ski n’est pas systématiquement illicite53. L’arrêt sous examen peut être analysé différemment. En l’espèce, un enfant de 13 ans, Hugo X, qui descendait une piste rouge, a percuté une skieuse, Mme Y, qui s’était arrêtée sur la piste pour ramasser le bâton d’un jeune skieur qui avait chuté quelques instants plutôt. Blessé dans la collision, Hugo X ainsi que ses parents ont engagé la responsabilité de la skieuse en lui opposant sa faute. Dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Poitiers54 avait, pour retenir la responsabilité de la skieuse, raisonné en deux temps. Elle avait tout d’abord relevé que Mme Y n’avait pas contrevenu à la règle de bonne conduite n° 6 aux termes de laquelle tout skieur doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité. En effet, avait relevé la cour d’appel, la piste était « large, balisée et sécurisée et la visibilité [était] bonne car se présentant sous l’aspect d’une pente de neige peu pentue avec une inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ ». Pas de contravention, donc, aux règles relatives à la pratique du ski telles qu’édictées par la fédération internationale. Mais la cour a ensuite jugé que « cependant, cette règle doit s’interpréter au regard également de la difficulté de la piste dans son ensemble ; que celle-ci était classée rouge, c’est-à-dire par des skieurs expérimentés désirant skier le plus rapidement possible ; qu’en s’arrêtant sur la piste très rapidement pour ramasser un bâton que le jeune qui la précédait avait perdu, après avoir traversé la piste de gauche à droite, Mme Y a eu un comportement imprudent qui engage sa responsabilité ». La formule est ambiguë. La faute d’imprudence est-elle une erreur de conduite totalement détachée de la règle n° 6, ou est-elle au contraire caractérisée au regard de l’interprétation de cette règle, donc au regard de la règle elle-même ? Ce qui retient en tout état de cause l’attention, c’est que la Cour de cassation ne censure pas l’arrêt quant à la qualification de ce comportement, faute d’imprudence ou non. Elle le fait, au contraire, sur l’impossibilité pour les juges du fond de juger, d’un côté, que les règles de la pratique du ski ont été respectées, et de considérer, d’un autre côté, qu’une faute d’imprudence a été commise. Comme si, à rebours du principe préalablement exposé, la faute du sportif était réductible à la méconnaissance des règles de la pratique sportive. En effet pour la Cour de cassation, « en retenant à la fois que Mme Y avait commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité civile et qu’elle n’avait pas méconnu de règle de la pratique du ski alpin, la cour d’appel n’a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations et a violé [l’article 1383 du Code civil] ». Toute différente aurait été l’interprétation d’une cassation intervenue pour défaut de base légale, la Cour de cassation reprochant par exemple à la cour d’appel de ne pas avoir constaté, indépendamment de la règle n° 6 et de son interprétation, que le comportement de M. Y ne correspondait pas à une erreur de conduite susceptible de caractériser une faute d’imprudence. Certes, la haute juridiction est dépendante de la formulation du moyen. Toutefois, et sans vouloir donner une portée excessive à cette décision non publiée, on sait bien que, lorsqu’elle le juge utile, elle sait habilement s’en détacher pour substituer le cas d’ouverture à cassation qu’elle considère le plus opportun.
Claude-Albéric MAETZ
Le passager d’un side-car n’en est pas le co-gardien (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-17732, à paraître au Bulletin)
En matière sportive, le gardien d’une chose instrument du dommage, actionné sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du Code civil – anciennement article 1384, alinéa 1er – dispose, entre autres, de deux parades permettant d’écarter sa responsabilité. La première tient dans la caractérisation de la qualité de co-gardien de la victime. La seconde, plus classique mais dont le champ a été notablement réduit, met en œuvre la théorie de l’acception des risques. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 avril 201655 a précisément répondu aux moyens tirés de l’une et de l’autre de ces parades. Les faits de l’espèce sont simples. Lors d’une course de side-car, un véhicule a quitté la piste de sorte que le passager, appelé le « singe », s’est trouvé grièvement blessé. Son assureur et lui-même ont alors agi en responsabilité contre le conducteur du side-car sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Avec succès. Pour critiquer l’arrêt d’appel, le conducteur et son assureur invoquaient donc, en premier lieu, la circonstance selon laquelle le passager était, au moment de l’accident, co-gardien de l’engin. Il est acquis en effet que, dans l’hypothèse d’une garde commune de la chose instrument du dommage, la victime co-gardienne ne peut invoquer l’article 1384, alinéa 1er à l’encontre des autres gardiens56. Encore faut-il, pour que la garde en commun soit retenue, que chacun des participants ait un pouvoir effectif sur la chose, ce qui est exclu, en principe, dès lors que l’un d’eux dispose d’un pouvoir de décision. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que le skipper d’un voilier et ses coéquipiers n’étaient pas co-gardiens d’un voilier, les usages et règles en matière de course en mer donnant au premier seulement le pouvoir de diriger et de contrôler les manœuvres57. C’est encore la raison pour laquelle une cour d’appel a récemment relevé, au sujet d’un accident survenu dans le cadre d’un rallye automobile, que « le co-pilotage ne confère pas au co-pilote la qualité de “co-gardien” : le copilote dirige le pilote mais pas le véhicule sur lequel il n’a aucun contrôle, le pilote restant toujours libre de suivre ou non les indications du co-pilote »58. De même, pour exclure la qualité de co-gardien, la cour d’appel de Paris a jugé que le co-pilote ne disposait pas de pouvoirs identiques à ceux du pilote dont le rôle est déterminant puisqu’il est seul à maîtriser la direction, la vitesse, le freinage du véhicule, qu’il peut choisir de ne pas tenir compte des informations fournies par son co-pilote et qu’il s’adapte aux conditions de circulation réelles auxquelles il est confronté au fur et à mesure du déroulement de la course59. Le « singe » d’un side-car se trouve-t-il dans une position aussi passive que le co-pilote d’une voiture de course, de sorte que son statut de co-gardien doit être pareillement écarté ? Cela ne va de soi que dans la mesure où le passager du side-car a une influence sur la trajectoire et le comportement de la machine. La Cour de cassation avait déjà implicitement répondu par l’affirmative en censurant une cour d’appel qui avait admis que le pilote et le co-pilote d’un side-car en avaient la garde commune sans rechercher lequel des deux exerçait le pouvoir de direction et de commandement de la machine60. L’arrêt rapporté est plus explicite encore. La Cour de cassation reconnaît tout d’abord le pouvoir souverain par lequel les juges ont constaté « qu’un side-car cross n’avait pas deux pilotes mais un pilote et un passager, appelé “singe”, qui formaient un équipage ; que si l’action, acrobatique, du passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l’engin, notamment dans le franchissement des bosses et des virages, et de le rééquilibrer afin de lui permettre d’atteindre une vitesse et une trajectoire optimales, celle du pilote, déterminante, consistait à diriger la machine ce qui impliquait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant en fonction de la direction qu’il choisissait ; que le pilote pouvait utiliser le véhicule sans être assisté par le passager alors que l’inverse était impossible ; que le pilote, dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule ». Et la Cour de cassation de considérer, exerçant ensuite son pouvoir de contrôle sur la notion de garde, que la cour d’appel « a exactement déduit que M. X avait été seul gardien de la chose ». Exit, donc, la parade tirée de la garde collective. Exit, ensuite, de manière plus prévisible, le moyen tiré de l’opposabilité à la victime de son acceptation des risques. On sait en effet que depuis un arrêt remarqué de la Cour de cassation en date du 4 novembre 201061, le gardien de la chose, assigné sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peut plus opposer à la victime de dommages corporels sa propre acceptation des risques. Cette exclusion trouve-t-elle une exception dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la victime est membre de l’équipage de la chose instrument du dommage. La réponse de la Cour de cassation est évidemment négative. Après avoir rappelé le principe posé dans son arrêt de 2010, la Cour de cassation juge qu’ « ayant retenu que le pilote du side-car en avait la garde de sorte que M. X, en sa qualité de gardien, devait être déclaré responsable des dommages subis par M. Y, son passager, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ». En d’autres termes, le gardien de la chose ne peut trouver dans la théorie de l’acceptation des risques matière à compenser l’exclusion du statut de co-gardien de la victime.
Claude-Albéric MAETZ
Responsabilité de l’association sportive du fait de ses membres : l’indétermination des circonstances de l’accident exclut l’existence d’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-16938)
Aux termes d’une jurisprudence bien établie, la responsabilité d’une association sportive du fait de l’un de ses membres est subordonnée à la démonstration d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu62. La Cour de cassation a même précisé que la responsabilité de l’association pouvait être engagée quand bien même la faute aurait été commise par « un ou plusieurs joueurs, même non identifiés »63. L’indétermination du ou des joueurs fautifs se confond-elle toutefois avec l’indétermination des circonstances de l’accident ? L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 avril 201664 invite à distinguer les deux hypothèses. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la victime avait reçu un coup à la tête lors de la dispute d’un ballon aérien à l’occasion d’un match de football. Déboutée par la cour d’appel de ses demandes d’indemnisation, la victime a alors formé un pourvoi au moyen, principalement, que la circonstance que le coup de tête reçu était nécessairement la traduction d’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu, peu important par ailleurs que l’auteur de cette faute ne soit pas identifié. Or, pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation juge en l’espèce qu’ « ayant relevé, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les circonstances dans lesquelles la victime avait reçu le coup à la tête étaient restées indéterminées, la cour d’appel en a exactement déduit que ce coup, peu important la gravité du dommage en résultant, ne procédait pas d’un manquement caractérisé aux règles du jeu du football ». Cet attendu est instructif à deux égards. En premier lieu, il impose de distinguer selon l’objet du doute. Porte-il sur les circonstances de l’accident, c’est-à-dire sur l’élément matériel ? Alors la caractérisation de la faute qualifiée s’avère impossible de même, par suite, que la mise en jeu de la responsabilité de l’association. Porte-t-il, une fois l’élément matériel déterminé, sur l’auteur de la faute, c’est-à-dire sur l’élément personnel ? Alors cette incertitude, qui est relativement rare en pratique, n’est pas de nature à écarter la responsabilité de l’association. Mais convenons que, de fait, l’indétermination de l’auteur du fait dommageable peut rendre plus complexe, voire impossible, la détermination des circonstances de l’accident. L’étanchéité entre ces deux incertitudes n’est donc pas absolue. Elle l’est d’autant moins, en second lieu, que la Cour de cassation, en jugeant que la gravité du dommage résultant du coup ne doit pas participer de l’examen de la réalité de la faute qualifiée, refuse le raisonnement par induction qui consisterait à reconnaître l’existence d’une faute caractérisée en contemplation du dommage subi65.
Claude-Albéric MAETZ
Obligation de sécurité de résultat de l’organisateur d’un stage de parapente (Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-24696)
L’organisateur d’une activité sportive est tenu, à l’égard des pratiquants avec lesquels il contracte, d’une obligation de sécurité qui est en principe de moyens dans la mesure où les participants ont un rôle actif dans l’activité en cause66. Cette obligation se mue en revanche en obligation de résultat lorsque le pratiquant est totalement passif. Au regard de ce critère, l’organisateur d’une sortie en parapente peut être tenu d’une obligation contractuelle de sécurité de deux natures : de moyens à l’égard du sportif qui effectue un vol en solo, l’obligation de sécurité de l’organisateur est en principe de résultat dans le cadre, par exemple, d’un simple baptême67. À en croire l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 janvier 201768, cette articulation est plus complexe. Dans cette affaire, la victime a participé à un stage de parapente à l’occasion duquel elle a subi un dommage au moment de l’atterrissage imputable, pour partie, à une défaillance de la radio fournie par le prestataire. Précision importante : la victime effectuait à cette occasion son premier vol en solo sous le contrôle d’un moniteur. On pourrait alors légitimement s’étonner que la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que « le contrat formé entre la personne qui participe à un stage de parapente et le professionnel qui l’organise met à la charge de celui-ci une obligation de sécurité de résultat ». Mais la Cour de préciser immédiatement que ladite obligation concerne « le matériel utilisé pour exécuter sa prestation ». La cour d’appel69, pour aboutir à cette qualification surprenante, avait fait le détour par l’ancien article L. 221-1 du Code de la consommation, en considérant que cette disposition met à la charge de l’exploitant une obligation de sécurité de résultat relativement aux produits et services qu’il utilise. On pourrait y trouver une forme de logique : l’aptitude du matériel à remplir sa fonction n’exige aucun rôle actif de l’utilisateur. Ce qui implique alors, pour la même activité, un dédoublement discutable de la nature de l’obligation de sécurité : de moyens s’agissant de l’encadrement de l’activité, elle serait de résultat relativement à la fourniture du matériel. Ce qui d’ailleurs, en pratique, peut poser une difficulté dès lors que la détermination de la cause du dommage – matériel, encadrement – n’est pas aisément identifiable. Après avoir rejeté le moyen du pourvoi principal, la Cour de cassation en fait de même s’agissant du pourvoi incident de la victime qui reprochait aux juges du fond d’avoir limité la responsabilité de l’organisateur en raison de sa propre faute. Selon la Cour en effet, « ayant relevé que Mme X avait reçu une formation adaptée, déjà effectué un vol en quasi-autonomie et répété plusieurs fois les procédures d’atterrissage, la cour d’appel a pu en déduire que l’erreur de pilotage qu’elle avait commise était, nonobstant la panne de radio l’ayant troublée pendant la base d’atterrissage, constitutive d’une faute ayant concouru à la production de son propre préjudice ».
Claude-Albéric MAETZ
Responsabilité d’un centre équestre : la méconnaissance de l’obligation de sécurité de moyens s’apprécie au regard du niveau du cavalier (Cass. 2e civ., 9 juin 2016, n° 15-19020 ; CA Lyon, 1re ch. civ., sect. B, 29 mars 2016, n° 14/05452 ; CA Paris, 18 déc. 2015, n° 14/15461)
Ces trois arrêts70 ont un premier point commun : ils rappellent que l’obligation de sécurité du centre équestre à l’égard du cavalier n’est qu’une obligation de moyens. La nature de cette obligation se justifie pleinement dans la mesure, on l’a expliqué précédemment, où le cavalier a un rôle actif dans l’exercice de cette activité. Il lui revient donc, en cas de chute lui ayant causé un dommage, de rapporter la preuve de la faute de l’organisateur. Or, pour écarter la faute du centre, ces trois décisions se fondent sur le niveau technique, en l’occurrence avancé, des différentes victimes. L’arrêt de la Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi contre l’arrêt d’appel qui a relevé que la cavalière était déjà titulaire du Galop 3 et qui a souverainement apprécié « qu’aucune inadéquation entre le niveau des cavaliers et les exercices effectués au cours de la reprise n’était démontrée ». L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon juge quant à lui que le fait de demander à un élève, titulaire du Galop 4 et préparant le Galop 5, de terminer la séance sans étriers ne relève pas d’un manquement fautif « compte tenu de son niveau ». Et la cour d’appel de résumer le tout ainsi : « la responsabilité du centre équestre doit être appréciée au regard du niveau de pratique de la victime. En effet, lorsque le cavalier est confirmé, l’obligation de moyens pour sa sécurité est allégée, notamment en ce qui concerne l’équipement, le choix de la monture et les exercices proposés ».
Claude-Albéric MAETZ
D – Les assurances
Obligations d’information relatives aux assurances individuelles et fardeaux de la preuve (CA Lyon, 6e ch., 9 juin 2016, n° 14/01032 ; CA Amiens, 12 janv. 2016, n° 13/04451 ; CA Colmar, 2e ch. civ., sect. A, 6 mai 2016, n° 14/02897 ; CA Metz, 1re ch., 5 janv. 2016, n° 14/01198, n° 15/00598)
Peuvent peser sur les fédérations sportives deux sortes d’obligations d’information relatives aux assurances individuelles.
La première est systématique. Prévue par l’article L. 321-4 du Code du sport, elle a pour finalité d’inciter les pratiquants à souscrire une assurance individuelle contre les accidents corporels. C’est-à-dire une assurance offrant aux sportifs une garantie pour les dommages qu’ils se causent à eux-mêmes ou dont on ne trouve pas les auteurs. « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer »71.
La seconde n’est qu’éventuelle. En effet, l’article L. 321-6 oblige les fédérations agréées, lorsqu’elles proposent à leurs membres « qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes » qu’elles ont souscrit, à « formuler cette proposition dans un document, (…) qui indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ». La finalité est ici d’inciter les pratiquants à compléter les garanties offertes par le contrat collectif au moyen d’une assurance individuelle plus étendue.
Le Code du sport ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de manquement aux obligations d’information, mais les fédérations défaillantes n’en engagent pas moins leur responsabilité civile72. En effet, le sportif subissant un préjudice pour ne pas avoir été suffisamment informé sur l’intérêt de la souscription d’une assurance individuelle n’hésitera pas à demander l’indemnisation de celui-ci qu’il obtiendra s’il franchit avec succès les deux étapes suivantes dont témoignent très bien quelques récentes décisions. La première étape concerne le contenu de l’obligation d’information et donc l’appréciation de la faute. La deuxième étape concerne le montant de l’indemnisation et donc la preuve du préjudice lié.
S’agissant du contenu de l’information qui doit être donnée, le Code du sport est plutôt silencieux et on en déduit que l’obligation est « rhéostatique »73, son intensité et son contenu dépendant de la dangerosité du sport74 choisi par le pratiquant ainsi que des facultés de compréhension de ce pratiquant75. Surtout, il revient à la fédération de démontrer qu’elle a effectivement rempli son obligation de délivrer une information « suffisante et adaptée » et cette preuve est difficile à rapporter. Par exemple, produire « un exemplaire vierge du formulaire de demande de licence, qui, s’il comprend un rappel des garanties de bases attachées à la licence, ainsi qu’un bulletin de souscription de garanties complémentaires, n’apporte pas à l’adhérent des informations équivalentes à celles figurant dans la notice établie par l’assureur [conformément au deuxième alinéa de l’article L. 141-4 du Code des assurances] »76. Au demeurant, il ne suffit pas de justifier qu’une information a été donnée, encore faut-il démontrer que le sportif concerné a bénéficié, spécialement, personnellement, de cette information. Par exemple, la production « d’attestations rédigées en termes généraux quant au fait que les dirigeants donnent aux parents lors de la signature des licences sportives, un document présentant les garanties d’assurance complémentaire et que les renseignements concernant ces assurances non obligatoires sont affichés au siège du club de football, n’apporte pas la démonstration que les parents [du sportif] ont bénéficié personnellement de la distribution du document d’information ni du contenu de celui-ci »77. De même, le fait « qu’une information au sujet des assurances complémentaires a été diffusée dans le journal de la fédération de football et dans les clubs sportifs par voie d’affichage » ne saurait exempter de faute le groupement débiteur de l’obligation d’information78.
On comprend bien avec de tels messages l’intérêt des groupements sportifs à se préconstituer et à conserver la preuve d’une parfaite exécution de l’obligation d’information. La plupart des fédérations a désormais des pratiques conformes comme en atteste une décision de la cour d’appel de Lyon qui dédouane la Fédération française de ski au motif qu’elle a justifié non seulement « d’un exemplaire de la licence carte neige remis au titre de l’année 2007-2008 contenant notamment un tableau des garanties proposées aux licenciés carte neige et une notice de l’assureur détaillant l’étendue des garanties assurance et assistance acquise en cas d’accident corporel dans le cadre des différentes options proposées, “Primo”, “loisirs” et “performance” ainsi que les tarifs des différentes garanties » mais encore d’un récépissé de la licence carte neige remis aux parents de la victime qui l’ont signé et sur lequel ils ont apposé une mention dactylographiée attestant la lecture des mentions informatives79.
S’agissant du préjudice, il correspond à l’évidence à une perte de chance. Du fait d’une information défaillante, le pratiquant n’a pas eu la possibilité de mesurer s’il allait de son intérêt de souscrire une assurance individuelle qu’en tout état de cause il n’était pas obligé de souscrire80. L’indemnisation que recevra la victime n’atteindra donc pas le montant de celle qu’elle aurait perçue si elle avait été correctement assurée, par comparaison avec les garanties généralement proposées81. Les dommages et intérêts alloués à la victime représenteront ainsi la différence entre l’indemnité reçue et celle que la victime aurait pu obtenir si elle avait contracté une assurance idoine, étant précisé qu’il conviendra de tenir compte des contrats d’assurance offerts sur le marché au moment de l’adhésion82. En outre, le fardeau de la preuve pèse ici sur le débiteur de l’obligation d’information comme vient justement de le rappeler la cour d’appel de Colmar83. C’est à lui qu’il revient de justifier, le cas échéant, du montant de la garantie individuelle effectivement souscrite, de celui de la garantie maximale qu’elle aurait pu souscrire84, ainsi que de son coût85.
À cet égard, on peut souligner que la situation des sportifs de haut niveau a été améliorée par une loi n° 2015-1541 du 27 novembre 201586 précisée par un décret n° 2016-608 du 13 mai 2016. Aux termes de ces textes, les fédérations sportives délégataires ont l’obligation de souscrire des contrats d’assurance de personne au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et ne peuvent donc plus pour cette catégorie de sportifs se contenter d’une obligation d’information, même renforcée.
Jean-Michel MARMAYOU
IV – Le financement du sport
A – Le financement public
B – Le financement privé
1 – Droits de propriété intellectuelle (…)
2 – Paris sportifs en ligne
3 – Droits audiovisuels
4 – Contrats de sponsoring (…)
5 – Contrats de transfert
6 – Contrats de billetterie (…)
7 – Exploitation de l’image des sportifs
8 – Publicité
9 – Tabacs et alcools (…)
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
CE, ord. réf., 22 avr. 2016, n° 398087 : Cah. Dr. sport 2016, n° 44, p. 68, note Peltier M.
-
2.
Jouette P., Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p.81 ; adde, Déc. Cons. const., 25 nov. 2011, n° 2011-199 QPC.
-
3.
Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 4e éd., LGDJ, n° 935.
-
4.
AUT, échantillon négatif…, v. Colin F., Cah. Dr. sport 2016, n° 44, p. 73 ; Jouette P., préc. – Sur la constitutionnalité des présomptions simples de culpabilité, v. Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC ; comp. Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC.
-
5.
CE, 2e/7e ss-sect. réunies, 21 oct. 2013 : Cah. Dr. sport n° 39, p. 105, note Peltier M.
-
6.
Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., préc., n° 951.
-
7.
CE, ord., 24 nov. 2015, n° 394200, M. B. : Cah. Dr. sport 2016, n° 42, p. 208, note Peltier M. ; Elnet Dict. perm. Droit du sport, veille permanente, 18 févr. 2016, obs. Rocipon P.
-
8.
CE, 2e/7e ss-sect. réunies, 15 avr. 2016, n° 394199 : Cah. Dr. sport 2016, n° 44, p. 77, note Peltier M. et p. 83, note Colin F. ; Elnet Dict. perm. Droit du sport, veille permanente, 2 mai 2016, obs. Rocipon P.
-
9.
CE, 28 oct. 2009, n° 327306, Schumacher : AJDA 2009, p. 2033 ; Peltier M., « Le nouveau Code mondial antidopage », LPA 30 sept. 2014, p. 5 ; adde CE, 1er déc. 2010, n° 334372, Agence mondiale antidopage : Cah. Dr. sport 2011, n° 25, p. 154, note Peltier M.
-
10.
Déc. AFLD n° 2016-49, 21 avr. 2016.
-
11.
Non-convocation de l’intéressé, quorum non réuni, etc.
-
12.
Cah. Dr. sport 2016, n° 44, p. 77, note Peltier M. et p. 87, note Colin F. ; Elnet Dict. perm. Droit du sport, veille permanente, 24 juin 2016, obs. Rocipon P.
-
13.
CE, 11 juill. 2016, n° 399038 : Elnet Dict. perm. Droit du sport, veille permanente, 8 sept. 2016, obs. Rocipon P. ; Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 72, note Colin F.
-
14.
CE, ord., 12 févr. 2016, n° 396215 : Cah. Dr. sport 2016, n° 43, p. 137, note Peltier M. et p. 142, note Antz J.-E., et p. 149, note Colin F. ; Elnet Dict. perm. Droit du sport, veille permanente, 21 mars 2016, obs. Rocipon P.
-
15.
Les coureurs sont personnellement tenus, en application d’une délibération AFLD du 12 septembre 2013, de vérifier s’ils doivent subir un contrôle antidopage.
-
16.
CE, 22 juill. 2016, n° 396214 : Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 77, note Colin F. ; Elnet Dict. perm. Droit du sport, veille permanente, 12 sept.2016, obs. Rémy D.
-
17.
Pour non-respect de la délibération n° 296 du 12 septembre 2013 de l’AFLD.
-
18.
En demandant notamment qu’un autre laboratoire procède à une contre-expertise.
-
19.
Elnet Dict. perm. Droit du sport, veille permanente, 9 janv. 2017, obs. Rémy D.
-
20.
« Les analyses des prélèvements effectués par l’Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses ».
-
21.
« Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l’article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes. Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction ».
-
22.
On pourrait encore citer l’article L. 232-5 du Code du sport selon lequel : « I.- L’Agence française de lutte contre le dopage (…), réalise ou fait réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors des contrôles (…) exerce un pouvoir disciplinaire » mais le II précise que « les missions de contrôle, les missions d’analyse et les compétences disciplinaires de l’Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes ».
-
23.
CE, 23 oct. 2009, n° 321554 et CE, 28 oct. 2009, n° 327306.
-
24.
C. sport, art. L. 232-23-3-2.
-
25.
CE, 23 déc. 2016, n° 399728 : Elnet Dict. perm. Droit du sport, veille permanente, 5 janv. 2017, obs. Rémy D. ; Dalloz actualité 9 janv. 2017, obs. Pastor J.-M.
-
26.
Publiée au JO du 11 mai 2016.
-
27.
Cah. Dr. sport 2016, n° 44, 2016, p. 188.
-
28.
Sur laquelle, v. Renard A., « La loi renforçant le dialogue avec les supporters est publiée », Elnet Veille permanente Droit du sport, 13 mai 2016.
-
29.
CE, 21 sept. 2015, n° 389815 : Cah. Dr. sport 2016, 2016, p. 187, note Colin F. ; Comm. com. électr. 2015, chron. 10, § 1, et LPA 7 juill. 2016, n° 115w9, p. 7, obs. Marmayou J.-M.
-
30.
Cela met fin à un paradoxe qui aboutissait à ce que les organisateurs d’une manifestation internationale en France ne pouvaient pas se voir communiquer l’identité des personnes interdites de stade.
-
31.
C. sport, art. L. 224-1.
-
32.
C. sport, art. L. 224-2.
-
33.
C. sport, art. L. 224-3.
-
34.
Publiée au JO, 13 juill. 2016 ; sur ce décret, v. Renard A., « Un décret fixe les modalités du dialogue avec les supporters », Elnet Veille permanente Droit du sport, 18 juill. 2016.
-
35.
Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 208.
-
36.
C. sport, art. D. 224-1.
-
37.
C. sport, art. D. 224-5.
-
38.
À savoir :
-
39.
- adoption de statuts comportant des dispositions qui garantissent leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ; la liberté d’opinion et l’interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ; la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;
-
40.
- attitude de leurs membres, dans leur activité de supporters, conforme aux principes ci-dessus ;
-
41.
- justification de liens avec l’association sportive, la société sportive, la fédération sportive ou la ligue professionnelle de la discipline qu’elles soutiennent.
-
42.
Publié au JO, 30 déc. 2016 ; v. égal. Délib. Cnil, n° 2016-392, 15 déc. 2016 : JO, 30 déc. 2016.
-
43.
Sur ce décret, v. Ralon A., « Le contenu des fichiers Stade est fixé », Elnet Veille permanente Droit du sport, 6 févr. 2017.
-
44.
En fait, ce sont potentiellement plusieurs fichiers de stade qui peuvent être créés.
-
45.
C. sport, art. R. 332-14 à R. 332-20.
-
46.
JO, 28 janv. 2017.
-
47.
Sur laquelle, v. Renard A., « La notion d’identité de genre intègre le Code du sport », Elnet Veille permanente Droit du sport, 13 févr. 2017.
-
48.
CEDH., sect. 5, 27 oct. 2016, nos 4696/11 et 4703/11, Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c/ France : Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 57, note Miège C.
-
49.
CEDH, sect. 5, 22 févr. 2011, n° 6468/09, Assoc. Boulogne Boys c/ France : Cah. Dr. sport n° 24, 2011, p. 46, note Miège C. ; LPA 15 mai 2012, p. 3, obs. Brignon B.
-
50.
CE, 10e/9e ch. réunies, 13 juin 2016, n° 373063 : Comm. com. électr. 2016, comm. 84, Debet A. ; Comm. com. électr. 2016, chron. 12, obs. Marmayou J-M.
-
51.
CE, 10e/9e ch. réunies, 13 juin 2016, n° 377194 : Comm. com. électr. 2016, comm. 84, Debet A. ; Comm. com. électr. 2016, chron. 12, obs. Marmayou J-M.
-
52.
CE, 30 déc. 2016, n° 395337, Assoc. nationale des supporters, Elnet Veille permanente Droit du sport, 11 janv. 2017, obs. Rémy D.
-
53.
Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-16450 : Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 104, note De Bertier-Lestrade B.
-
54.
Mouly J. et Dudognon C., Rép. civ. Dalloz, v° Sport, n° 145.
-
55.
V. Jourdain P., « À propos de la faute en matière sportive », in Écrits en l’honneur de J. Foyer, 2007, Economica, p. 567. Et pour des illustrations, p. ex. : TGI Albertville, 27 févr. 2004 : Gaz. Pal. 6 mars 2007, n° G3207, p. 27 ; Cass. 2e civ., 22 avr. 1971 : Bull. civ. II, n° 153.
-
56.
V. p. ex., jugeant que la règle n° 3, qui pose le principe de la priorité au skieur aval, est écartée dès que celui-ci « adopte un comportement anormal, en remontant la piste, à contresens » : CA Chambéry, 2 avr. 2002 : JCP 2002, IV, 2646.
-
57.
CA Poitiers, 17 déc. 2014.
-
58.
Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-17732, à paraître au Bulletin : Cah. Dr. sport 2016, n° 44, p. 120, note Gantschnig D.
-
59.
V. p. ex, pour la garde commune d’un ballon de football : Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n° 03-12884 : Bull. civ. II, n° 9.
-
60.
Cass. 2e civ., 8 mars 1995, n° 91-14895 : Bull. civ. II, n° 83.
-
61.
CA Lyon, 21 janv. 2014, pourvoi rejeté par Cass. 2e civ., 21 mai 2015, n° 14-14812 : LPA 7 juill. 2016, n° 115x0, p. 9, obs. Maetz C.-A. ; Jurisport n° 155, p. 9 ; Dict. perm. Sport, Bull. n° 225, p. 4.
-
62.
CA Paris, 2-3, 13 avr. 2015, n° 13/12179 : Jurisport n° 155, p. 9.
-
63.
Cass. 2e civ., 5 mai 1966 : Bull. civ. II, n° 218.
-
64.
Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65947 : Bull. civ. II, n° 176 ; D. 2011, p. 690, note Mouly J. ; JCP G 2011, 435, obs. Bloch C. ; LPA 12 avr. 2011, p. 4, obs. Brignon B.
-
65.
V. not. Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 02-13653 : Bull. civ. II, n° 356 ; RTD civ. 2004, p. 106, obs. Jourdain P. ; D. 2004, p. 300, note Bouché G. – Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18141 : Bull. ass. plén., n° 7.
-
66.
Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18141 : Bull. ass. plén., n° 7.
-
67.
Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-16938 : Cah. Dr. sport 2016, n° 44, p. 108, note De Brier H.
-
68.
V. déjà, rejetant le pourvoi contre l’arrêt qui avait relevé que « la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité de ses blessures » : Cass. 2e civ., 20 nov. 2014, n° 13-23759 : D. 2015, p. 394, obs. Mondou J.
-
69.
V. p. ex., en matière de plongée sous-marine, Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-19816 et Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-24699 : LPA 27 mai 2015, p. 14, obs. Maetz C.-A.
-
70.
V. Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-18558 : Bull. civ. I, n° 287 ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. 355, jugeant que « l’organisateur et le moniteur d’un vol en parapente sont tenus d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols au cours desquels ceux-ci n’ont joué aucun rôle actif ».
-
71.
Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-24696.
-
72.
CA Chambéry, 2 juill. 2015 : LPA 11 déc. 2015, p. 6, note Vial J.-P.
-
73.
V. Vial J.-P., Cah. Dr. sport 2016, n° 45, p. 110.
-
74.
L. n° 84-610, 16 juill. 1984, art. 38 anc.
-
75.
Cass. 1re civ., 16 juill. 1986, n° 84-16903 : Bull. civ. I, n° 209 ; RJES 1987, n° 2, p. 101, obs. Durry G. ; RGDA 1986, p. 453, note Bigot J. – Cass. 1re civ., 4 févr. 1997, n° 94-19375 : Bull. civ. II, n° 89 ; D. 1998, somm. p. 50, note Groutel H. – Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, n° 94-11726 : Bull. civ. I, n° 84 ; D. 1997, somm. 181, obs. Mouly J.
-
76.
Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D. et Rizzo F., Droit du sport, 4e éd., 2015, LGDJ, n° 1155.
-
77.
Cass. 1re civ., 16 janv. 1996, n° 93-15608 ; Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-22625.
-
78.
Il est admis à cet égard qu’un même sport peut présenter des risques plus ou moins importants selon qu’il est pratiqué en loisir ou à haut niveau (CA Versailles, 5 mars 2015, n° 13/01503).
-
79.
CA Colmar, 2e ch. civ., sect. A, 6 mai 2016, n° 14/02897, Abderrahim El A. C/ S.A. Groupama Grand Est et Ligue d’Alsace de football.
-
80.
CA Metz, ch. 1, 5 janv. 2016, nos 14/01198 et 15/00598, Guillaume W. c/ Football Club Voelfling-Château Rouge, Ligue Lorraine de Football, CPAM.
-
81.
CA Metz, ch. 1, 5 janv. 2016, préc.
-
82.
CA Lyon, 6e ch., 9 juin 2016, n° 14/01032, M. Mathieu A. c/ Fédération française de ski.
-
83.
Cass. 2e civ., 15 juin 2000, n° 98-21182.
-
84.
Cass. 1re civ., 12 déc. 1977, n° 75-14870 : Bull. civ. I, n° 474 – CA Colmar, 8 janv. 2010, n° 04/00496 ; CA Aix-en-Provence, 23 nov. 2011, n° 10/07850 (www.droitdusport.com).
-
85.
CA Chambéry, 11 mars 2008 : Cah. Dr. sport 2008, n° 11, p. 167, note Boudot M.
-
86.
CA Colmar, 2e ch. civ., sect. A, 6 mai 2016, préc.
-
87.
CA Amiens, 12 janv. 2016, n° 13/04451, Jean-Pierre P. c/ Culture et loisir MJC et a.
-
88.
Cass. 2e civ., 21 févr. 2002, n° 99-20711 : Bull. civ. II, n° 16.
-
89.
C. sport, art. L. 324-4-1.