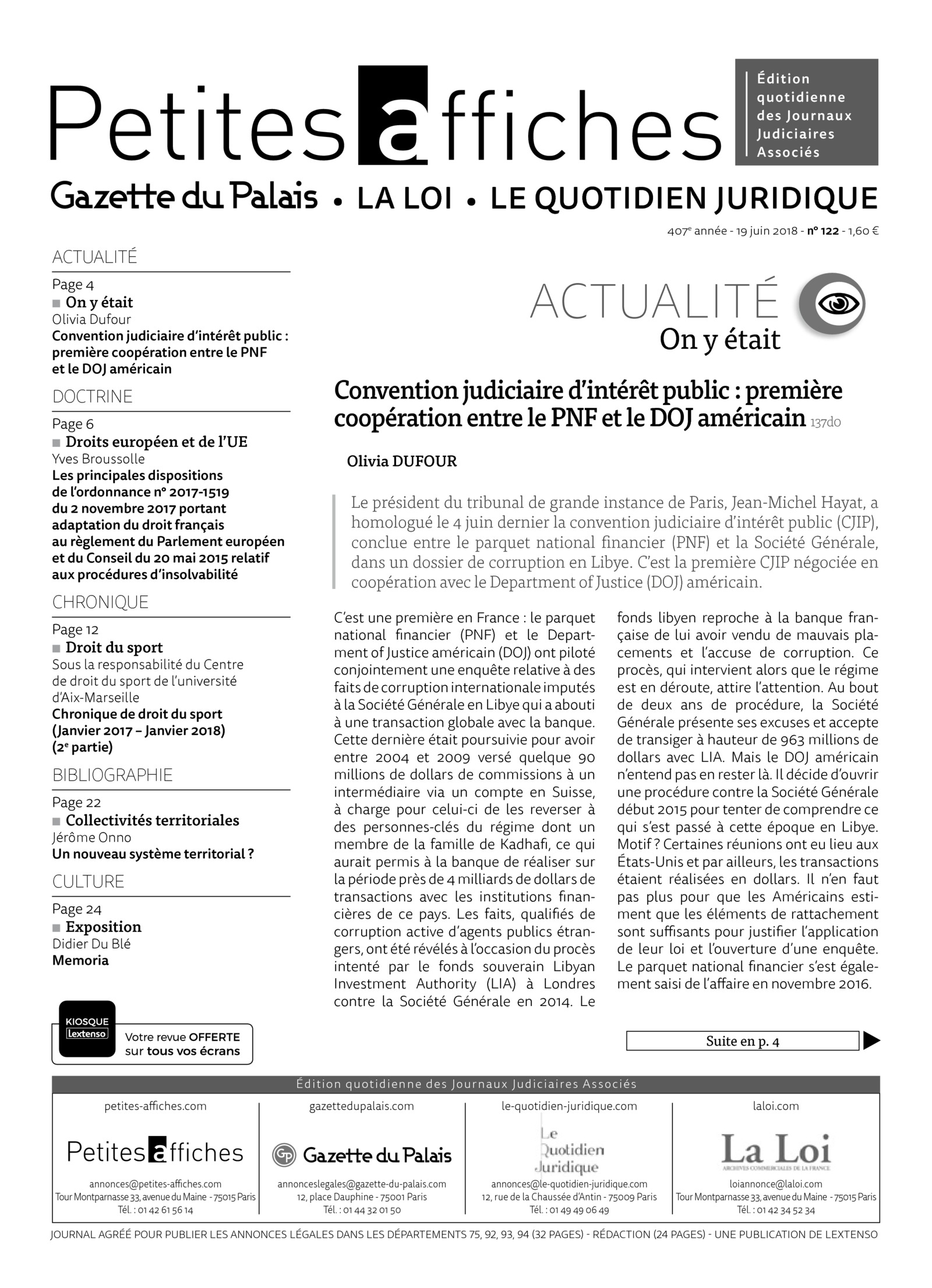Chronique de droit du sport (Janvier 2017 – Janvier 2018) (2e partie)
La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2017 et janvier 2018.
I – Le cadre juridique du sport
A – Les législateurs du sport
B – Les lois du sport
1 – Légalité des décisions des fédérations
2 – Concours de normes (…)
C – La justice du sport
1 – Droit disciplinaire
2 – Arbitrage : tribunal arbitral du sport
3 – Arbitrage : chambre arbitrale du sport (…)
4 – Justice publique
5 – Justice sportive (…)
II – Les acteurs du sport
A – Les groupements sportifs (…)
B – Le sportif
1 – Sports collectifs
La formation des contrats de travail soumise au droit commun
Cass. soc., 21 sept. 2017, nos 16-20103 et 16-20104, MM. X. c/ Sté Union sportive carcassonnaise. Par deux arrêts en date du 21 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a fait application des dispositions du Code civil issues de la réforme de 2016 relatives à l’offre et à la promesse unilatérale afin de statuer sur la question de la formation d’un contrat de travail1. Deux joueurs de rugby reçoivent chacun une proposition de la part d’une même société sportive indiquant leur emploi en qualité de joueur de rugby et comportant la mention de la durée du contrat de travail projeté, une rémunération afférente en somme d’argent et en nature. Moins d’un mois plus tard dans la première espèce et plus de deux mois plus tard dans la seconde, le club indique à l’agent sportif respectif des joueurs ne pas pouvoir donner suite aux contacts noués. Nonobstant cette décision, les sportifs renvoient leur proposition signée au club. Considérant qu’elles devaient être assimilées à de véritables promesses d’embauche valant contrats de travail, ils entendaient obtenir réparation de la rupture abusive de leur contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant fait droit à leurs demandes.
Sur la méthode, on ne peut manquer de se montrer critique. Alors que les relations étaient nouées sous l’empire du droit antérieur à la réforme du droit des contrats, la haute juridiction soutient que « l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ». L’expression n’est pas nouvelle. La cour l’a déjà employée afin de modifier sa position concernant les exigences formelles relatives au mandat de l’agent immobilier2. Mais il avait alors été souligné que la chambre mixte n’avait fait que mettre en œuvre la théorie moderne des nullités3, largement ancrée dans la jurisprudence de la cour, et que le législateur avait fini par consacrer aux termes de la réforme. La référence au droit nouveau à la suite du visa des articles 1134 (anc.) du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail suggère qu’elle procède à son application rétroactive, ce qui serait une violation de l’article 9, alinéa 2, de l’ordonnance. En réalité, l’impact sur le fond invite à tempérer la critique. D’une part, à l’instar de l’arrêt rendu par la chambre mixte, plusieurs décisions s’étaient antérieurement orientées vers la solution plus orthodoxe adoptée par la chambre sociale4. D’autre part, la jurisprudence antérieure – et son arrêt paroxystique du 15 décembre 20105 – avait donné lieu à une interprétation des avant-contrats qui lui étaient soumis et une application du régime juridique de la promesse bien souvent contestables6.
Sur le fond, l’arrêt clarifie le contenu des notions d’offre et de promesse unilatérale de contrat de travail. L’offre de contrat de travail est définie dans l’arrêt comme « l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail ». La promesse unilatérale de contrat de travail s’entend, en revanche, du « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
Au préalable, deux remarques doivent être formulées. D’abord, dépendant des termes des pourvois, l’exercice prétorien s’avère inachevé dans la mesure où la promesse synallagmatique de contrat de travail est toujours à ce stade abandonnée au droit de la vente7. Ensuite, il est dommage que la vision civiliste de la promesse unilatérale s’affiche dans sa désignation – promesse unilatérale de contrat de travail et non promesse d’embauche – alors que l’offre de contrat de travail semble devoir être uniquement le fait de l’employeur8.
Ces définitions surprennent finalement peu. Les arrêts se révèlent néanmoins instructifs sur le contenu de l’une et l’autre. Toutes deux mentionnent au titre des éléments essentiels l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction. Il manque à notre sens l’indication de la durée du contrat ou pour le moins l’accord des parties sur le principe de l’existence d’un terme extinctif au contrat de travail projeté. La transmutation de la promesse unilatérale de contrat de travail en contrat de travail à durée déterminée à l’occasion de la seule levée de l’option paraît difficilement pouvoir s’opérer sans cette indication fondamentale. Cette carence est d’autant plus surprenante en matière sportive que le législateur a imposé le recours à un contrat à durée déterminée spécifique pour les sportifs et entraîneurs professionnels9. Plus encore, l’article L. 222-2-5, I, du Code du sport impose la mention de la durée pour laquelle le contrat de travail est formé. Partant, on peut s’interroger sur le point de savoir si la prétendue « offre » de contrat de travail constitue bien une offre et si, une fois acceptée, elle emporte véritablement la conclusion du contrat de travail. À semblable chapitre, comment la promesse unilatérale dont l’option est levée peut-elle former le contrat définitif alors qu’il ne doit manquer que le consentement du bénéficiaire pour ce faire ? Il en va de même de la promesse synallagmatique de contrat de travail censée valoir contrat définitif. La Cour de cassation a certes admis l’introduction de stipulations nouvelles dans le contrat définitif10 mais il ne s’agissait que d’une disposition accessoire et facultative. On ne saurait soutenir qu’elle s’est contentée de définitions génériques, implicitement adaptables au gré de la nature du contrat, quand par ailleurs, l’auteur des deux pourvois l’invitait à se prononcer sur la formation d’un CDD d’usage. L’absence d’indication de la durée ne remet pas en cause la validité du contrat formé. Seulement, le droit positif impose de le qualifier de contrat de travail à durée indéterminée11. La lacune définitionnelle, fruit de l’absence de prise en compte du droit spécial des activités sportives travaillées, aboutit à une situation d’autant plus ubuesque qu’elle expose l’employeur à des sanctions pénales12.
L’offre de contrat de travail engage donc l’employeur. Il ne peut la rétracter que dans les conditions de droit commun et si la rétractation est fautive, elle est source de responsabilité civile extracontractuelle et n’équivaut pas à un licenciement. L’indemnisation des préjudices subis reste minime puisque ne pouvant compenser la perte des avantages attendus du contrat13. Mais une fois l’offre acceptée par le salarié, le contrat de travail est scellé.
La promesse unilatérale n’opère la transmutation de l’avant-contrat en contrat de travail définitif qu’en cas de levée de l’option. La solution dégagée dans l’arrêt du 15 décembre 2010 s’avère ainsi définitivement enterrée. Si ses critères de qualification sont civilistes mais son contenu travailliste, en revanche le régime juridique de la promesse est entièrement civiliste. Il transparaît toutefois des arrêts une incertitude relativement à l’appréciation du caractère raisonnable du délai de révocation de la promesse. Deux à trois semaines n’avaient précédemment pas été jugées suffisantes14, un mois à presque trois mois15 n’ont pas non plus convaincu les juges dans les présentes décisions. Ce point est fondamental puisque la révocation pendant ledit délai est impuissante à empêcher la formation du contrat16. À défaut de stipulation contractuelle, la casuistique dictera le sort du promettant.
Ce retour en force du droit civil dans la phase précontractuelle des contrats de travail doit être approuvé. Il est d’autant plus justifié dans le sport professionnel que ce secteur est rompu à la technique des avant-contrats ; quoique la décision n’épuise pas toutes les possibilités qu’offre la phase de l’avant-contrat17.
Gaylor RABU
L’inefficacité d’un contrat de travail ne constitue pas une rupture
Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-24028. Une joueuse de basket-ball professionnelle conclut un contrat de travail avec le club dont elle est déjà salariée. Ledit contrat doit prendre effet en début de saison suivante sous réserve que les conditions d’enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage par la joueuse d’un examen médical, dont les modalités étaient définies par les règlements de cette fédération et de la ligue, pratiqué au plus tard trois jours après l’arrivée de la joueuse pour sa prise de fonction, soient remplies. Or la joueuse subit un accident du travail dans le cadre de son contrat alors en cours d’exécution. Son inaptitude constatée, le club estime que l’une des conditions suspensives à la prise d’effet du contrat futur est défaillante le rendant caduc. Prenant acte de la rupture, elle saisit la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail.
Rejetées par les juges du fond, elle portait ainsi ses revendications devant la Cour de cassation. Le premier argument avancé était astucieux : le défaut de perfection du contrat devait, selon la sportive, être assimilé à une rupture de celui-ci. Or il est de jurisprudence constante que les causes de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérées à l’article L. 1243-1 du Code du travail18, par ailleurs d’ordre public. La décision du club serait donc fautive. Le second argument consistait à souligner qu’à défaut de stipulation d’une période d’essai, le contrat de travail ne pouvait conditionner son embauche définitive qu’à un examen pratiqué avant son embauche et non, comme il était prévu, au plus tard dans les trois jours de sa prise de fonction. Les deux arguments sont rejetés par la Cour de cassation19. S’agissant du premier argument, si les dispositions de l’article susmentionné sont bien d’ordre public de sorte qu’un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les cas qu’il prévoit, « elles ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives ». Si la solution nous semble parfaitement exacte, le moins que l’on puisse dire est que la Cour ne s’embarrasse pas d’un effort de démonstration. La condition n’affecte pas la validité du contrat mais l’efficacité, non du contrat – au moins directement –, mais d’une obligation. La différence d’objet empêche d’assimiler la condition suspensive à un mécanisme de rupture du contrat.
La défaillance de l’événement conditionnel a pour conséquence que l’obligation qu’il affecte est réputée n’avoir jamais existé20. La conséquence immédiate de cette défaillance n’est donc pas la rupture du contrat, mais uniquement l’inexistence de l’obligation affectée. Seulement, parce qu’elle était essentielle, son inexistence reconnue ex-post emporte disparition par caducité du contrat de travail. Il n’y a donc pas rupture puisqu’aucun lien contractuel n’est dès lors censé être né. Le présent arrêt énonce ainsi expressément ce que certaines décisions antérieures moins exposées avaient implicitement admis21. Il s’aligne aussi sur sa jurisprudence relative aux contrats de travail à durée indéterminée22. Assurément les conditions résolutoires ne devraient pas connaître un accueil identique dès lors que leur réalisation entraîne la disparition rétroactive d’un contrat formé et exécutable.
L’événement dont il était question portait sur la présence de la sportive à l’examen médical imposé et organisé par les règlements fédéraux23. Rappelons que l’affaire a lieu antérieurement à la réforme du 8 août 2016 qui a substitué une visite d’information et de prévention à la traditionnelle visite médicale d’embauche avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail24. Ériger une telle condition alors que le médecin du travail était seul à pouvoir statuer sur l’inaptitude de la sportive, aux dépens du médecin du club, pouvait à juste titre poser la question de la licéité de la condition. Encore faut-il qu’il y ait eu une incompatibilité entre la stipulation et la disposition : l’objet de la condition suspensive litigieuse portait sur le passage d’un examen médical non sur sa satisfaction. Suivant une telle lecture, le passage constituait une condition objective ne préjugeant pas des résultats auxquels il aurait abouti. Désormais, cette condition ne souffre d’aucune contradiction avec le rôle du médecin du travail et paraît objective, nécessaire et appropriée au sens de l’article 1133 du Code du travail compte tenu des spécificités de l’activité exercée. Enfin, si la solution a été rendue à propos du CDD d’usage, elle a vocation à être transposée aux CDD spécifiques des articles L. 222-2-3 et suivants du Code du sport.
Gaylor RABU
2 – Sports individuels (…)
C – Les autres acteurs
1 – Entraîneurs
La langue et le vice
CA Rouen, 4 avr. 2017, n° 15/00063, Patrick Z. Le contentieux dans ce type d’affaire est suffisamment rare pour mériter une mise en lumière. En l’espèce, un sportif de nationalité tchèque conclut un contrat de travail à durée déterminée avec une association sportive participant à des compétitions de roller hockey. Avant le terme de celui-ci, il est embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’entraîneur. Adressant à son employeur une lettre de démission tout en s’engageant à effectuer son préavis, il décide en cours de celui-ci de ne plus réaliser sa prestation de travail. Son employeur engage alors sa responsabilité civile. Afin d’éviter la condamnation, il prétend que le second contrat de travail n’a pas été traduit dans une langue qu’il comprend, contrairement au premier qui avait été rédigé en langue anglaise. Invoquant le vice de son consentement sur le fondement de l’erreur, il sollicitait l’octroi de dommages et intérêts pour usage abusif d’un contrat à durée indéterminée. Si ses demandes de rappel de salaire ont été accueillies, en revanche cette dernière argumentation est rejetée par la cour d’appel de Rouen. Pour les juges du fond, plusieurs éléments démontrent que « le salarié n’ignorait pas sa situation et la teneur de ses engagements » : « sa qualité d’entraîneur apparaissant sur ses bulletins de paie » ; « son planning, au demeurant traduit en anglais, [comportait] des périodes hebdomadaires d’entraînement des équipes sans qu’il n’ait jamais émis la moindre protestation » ; sa lettre de démission était libellée en langue française ; enfin, les échanges entre l’entraîneur démissionnaire et les autres salariés du club étaient en anglais, le cas échéant, après recours à une assistance linguistique qui lui était systématiquement offerte. En somme, un faisceau d’indices concordants laissait peu de place au doute quant à la compréhension par le salarié du contenu et de la portée de ses engagements.
Par principe, le contrat de travail est établi par écrit – ce qui est exigé aussi bien du CDD de droit commun ou d’usage25 que du nouveau CDD spécifique26 – et doit dès lors être rédigé en français27, dès lors que le contrat est exécuté sur le territoire français28, comme en l’espèce. La règle est plus stricte qu’à l’égard des documents de travail29. Conscient de l’internationalisation du marché du travail30, le législateur a fait preuve de pragmatisme en admettant l’introduction de termes étrangers, dans le contrat de travail rédigé en français, sous réserve d’être explicités31 ou encore la possibilité qu’il soit traduit dans la langue du salarié si ce dernier en fait la demande32. Or la présente espèce ne s’inscrit a priori dans aucune de ces deux exceptions puisque l’entraîneur était de nationalité tchèque et les documents rédigés en anglais. Serait-elle contra legem ? Initialement sportif, le nouveau contrat de travail portait sur l’embauche du salarié pour exercer de nouvelles fonctions. La description du nouveau poste aurait dû respecter les obligations linguistiques respectées lors de la conclusion du précédent contrat de travail33. Pourtant, les juges du fond estiment que les autres documents encadrant la relation individuelle de travail étaient en langue anglaise et qu’il n’avait jamais émis de protestation. La solution paraît justifiée à double titre. En premier lieu, si l’article L. 1321-6, alinéa 3, du Code du travail prévoit une traduction dans la langue du salarié, il n’exige pas que cette dernière soit celle de sa nationalité. Par conséquent, sa maîtrise de l’anglais autorisait à ce que les documents ne soient rédigés ni en français, ni en tchèque. On ajoutera que la traduction du contrat n’est imposée à l’employeur que si le salarié en fait la demande. Il ne l’avait semble-t-il pas sollicité, ayant pu s’appuyer sur une assistance linguistique. Par ailleurs, sa qualité d’éducateur influait nécessairement sur la ou les langues de l’emploi. Devant communiquer avec de jeunes sportifs probablement majoritairement de nationalité française, on peine à envisager qu’il soit embauché sans maîtriser les rudiments de la langue de Molière. En second lieu, quand bien même son consentement aurait été vicié, son absence de toute protestation peut s’analyser en une confirmation de l’acte nul au sens de l’article 1182 du Code civil. Le salarié a en effet exécuté son contrat de travail pendant une période de dix mois avant de démissionner. Ainsi, sous une apparente sévérité à l’égard du salarié, le présent arrêt concilie de façon pragmatique les droits du salarié étranger et les atteintes du club employeur.
Gaylor RABU
Le droit de l’Union européenne et la formation des éducateurs sportifs
D. n° 2017-1270, 9 août 2017, portant adaptation au droit de l’Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice des professions d’éducateur sportif ; Cass. crim., 13 juin 2017, n° 16-84246, Kenneth X. ; Cass. crim., 28 mars 2017, n° 14-87597. Si le sport est un secteur à forte mobilité des travailleurs, cela se vérifie non seulement pour les athlètes mais également pour les éducateurs. Leur mobilité professionnelle se trouve souvent freinée par les législations des États membres qui établissent isolément les exigences auxquelles ils sont soumis, notamment en termes de qualification professionnelle. La directive n° 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, modifiant la directive n° 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, s’est notamment intéressée à la reconnaissance des qualifications professionnelles des éducateurs sportifs. Le décret n° 2017-1270 du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l’Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice des professions d’éducateur sportif34, institue un pouvoir de vérification de la maîtrise du français du déclarant au préfet qui peut exiger, en cas de « doute sérieux et concret », qu’il se soumette à un contrôle, afin de garantir l’exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours35. Quant aux qualifications professionnelles, s’il estime qu’il existe une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir vérifié que cette différence n’est pas entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications. Peu importe que la demande vise l’exercice de la liberté d’établissement36 ou de prestation de service37. La durée d’expérience professionnelle a été réduite d’une année au moins à temps plein (au lieu de deux ans) ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédant la demande d’établissement38 ou la prestation39. Sous conditions, le préfet peut accorder un accès partiel au droit d’établissement40 ou à l’exercice d’une prestation de service41. Enfin, la carte professionnelle européenne des guides de montagne fait désormais l’objet d’une sous-section spécifique dans le Code du sport42.
S’agissant de cette dernière activité, la Cour de cassation a validé les exigences de la réglementation française bien que venant restreindre la libre prestation de services au sens du droit de l’Union européenne dans son arrêt du 13 juin 201743. S’en remettant à l’appréciation des juges du fond qui ont défini l’activité de « ski guide » comme « une activité de montagne, milieu spécifique présentant des risques particuliers nécessitant l’intervention des professionnels ayant une connaissance approfondie du milieu montagnard et de ses risques afin de permettre l’évolution des clients dans des règles optimales », elle a confirmé que le droit français entrait ainsi dans les prévisions de l’article 16, § 1, b) de la directive n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. Indistinctement applicable, il ne crée aucune discrimination et justifie que la condamnation d’un moniteur britannique non autorisé à pratiquer l’activité est confirmée. Les éducateurs non autorisés exercent souvent leur activité en qualité de salarié. En application de l’article L. 212-8 du Code du sport, leurs employeurs encourent un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Tel fut le cas d’un organisateur de séjour touristique établi en Grande-Bretagne, employant des moniteurs de ski non diplômés afin d’accompagner des clients en France44. L’arrêt étend le sceau de conformité conventionnelle à la restriction de l’emploi de moniteur ou d’éducateur de ski jugée proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi.
Gaylor RABU
Le cumul conditionné des fonctions d’entraîneur et de sélectionneur
Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-21196. Un entraîneur de basket-ball conclut un contrat de travail à durée déterminée d’usage avec une société sportive de droit français par la suite renouvelé. En cours d’exécution du second contrat, il s’engage parallèlement par contrat de travail avec la fédération chinoise de basket-ball afin d’entraîner l’équipe nationale. Le club rompt le contrat de travail pour faute grave ce que le salarié contestait ; en vain, la cour d’appel de Limoges rejetant toutes ses prétentions dans son arrêt confirmatif du 16 mars 2015. Saisie d’un pourvoi, la chambre sociale de la Cour de cassation rend un arrêt de cassation partielle45. Elle retient tout d’abord la qualification de faute. L’article 21-1-7 de la convention collective de branche du basket professionnel, applicable à la relation de travail entre le salarié et son club, stipulait dans sa version d’alors que « l’entraîneur sous contrat avec un club ne peut contracter avec un autre club. Il ne peut signer plus d’un engagement à la fois sauf accord du club s’il existe avec lequel il s’est engagé le premier ». Or non seulement l’entraîneur s’était engagé auprès de la fédération chinoise sans l’accord de son club employeur, mais de surcroît la conclusion d’un tel engagement avec un employeur situé à 8 000 kilomètres était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ce qui constituait une faute grave. Sur ce moyen, le salarié proposait une lecture littérale de l’accord collectif qui consacre expressément une interdiction de cumul de contrats de travail avec deux clubs différents et non avec un club, d’une part, et une fédération sportive, d’autre part. À juste titre a priori, dans la mesure où la jurisprudence adopte par principe une telle interprétation littérale des conventions et accords collectifs de travail46 et ne s’en remet à l’esprit du texte qu’à titre subsidiaire47. La raison tient à ce que l’accord naît de négociations entre protagonistes aux intérêts souvent divergents de sorte qu’il paraît bien délicat de s’appuyer sur les règles interprétatives du Code civil qui fait naturellement la part belle au consensualisme. Restait à savoir si la stipulation conventionnelle devait être lue en un seul bloc ou si les deux phrases pouvaient être scindées. Une approche téléologique pourrait être entreprise mais, ainsi que l’a souligné un auteur48, encore faut-il qu’il soit possible de repérer dans la convention ce que les partenaires sociaux ont voulu. Fondamentalement, la commission paritaire d’interprétation et de négociation aurait pu être sollicitée à cette fin49, bien qu’il eût fallu respecter les termes de la convention pour que l’interprétation vaille avenant50, condition indispensable pour qu’elle s’impose au juge51.
Les juges du fond se sont ralliés à un certain pragmatisme en tenant des conditions formelles d’accomplissement des prestations. On en veut pour preuve la référence à la distance séparant le lieu d’exécution des deux contrats. Pourtant, la jurisprudence a précédemment admis que l’entraîneur d’une sélection étrangère pouvait être regardé comme exécutant sa prestation de travail en France52. La distance est ainsi un élément important sans être déterminant. Les conditions de travail réelles du salarié, pris en sa qualité de sélectionneur, auraient alors dû prévaloir.
Une lecture accueillante des articles 12.1 et 12.3.1.3 de la convention collective autorisait, ainsi que le suggéraient les conclusions de l’avocat général, à assimiler la fédération chinoise à une association sportive. Mais ces stipulations ne fondaient pas le pourvoi. Enfin, ladite convention imposait à l’entraîneur qu’il informe son employeur de sa situation de pluralité d’emplois survenant en cours d’exécution de son contrat de travail53. Le manquement à cette obligation suffisait à caractériser une faute. Mais sa gravité aurait de toute façon prêté à discussion, d’autant qu’une convention collective ne peut prédéterminer la faute grave54.
La faute établie, il appartenait aux juges du fond d’en tirer les conséquences sur le plan indemnitaire. Or, sur ce point, l’arrêt d’appel est cassé pour fausse application de la loi. Les juges limougeauds ont en effet appliqué l’article L. 1243-3 du Code du travail relatif à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié tout en constatant que la rupture était en réalité intervenue à l’initiative de l’employeur. La nature du préjudice indemnisable est ainsi reléguée au second plan. La juridiction de renvoi aura ainsi pour mission de statuer sur la question de l’indemnisation. On rappellera sur ce point que si la faute grave justifie la rupture anticipée du contrat de travail, sauf exception55, seule la faute lourde autorise à engager la responsabilité du salarié.
Gaylor RABU
2 – Agents
Silence sur les agents sportifs
En 2017, pas moins de 20 décisions ont été rendues par différentes juridictions sur des affaires mettant en cause l’activité d’agent sportif. C’est certainement une des moissons annuelles les plus importantes depuis 11 ans que cette chronique existe. Mais c’est aussi la plus pauvre qualitativement que l’on ait eue à analyser. Rien ou presque rien qui ne vaille la peine de faire même l’objet d’une recension. Commenter c’est ainsi aussi exclure et se taire.
Jean-Michel MARMAYOU
3 – Arbitres (…)
4 – Médias
L’impossible concurrence du quotidien L’Équipe (suite et fin)
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-19068. En septembre 2008, la société Le Journal du sport avait annoncé le lancement d’un nouveau quotidien sportif dénommé le 10Sport.com qui devait se positionner comme un concurrent du journal L’Équipe. Le groupe Amaury, propriétaire de L’Équipe, avait riposté en créant Aujourd’hui Sport, dont le positionnement (format, prix, contenu éditorial) était strictement identique à celui du 10Sport.com. Une partie des clients ayant été captée par le nouveau quotidien sportif du groupe Amaury, le 10Sport.com n’a pas atteint son point d’équilibre économique ce qui a conduit à son retrait du marché en mars 2009. Quelques mois plus tard, le groupe Amaury a pris la décision de mettre fin à la parution d’Aujourd’hui Sport. Lors d’une précédente chronique56, nous avions évoqué la décision de l’Autorité de la concurrence, saisie par la société Le Journal du sport, qui avait infligé une amende de 3,5 millions d’euros au groupe Amaury pour avoir évincé abusivement un nouvel entrant sur le marché de la presse quotidienne sportive et cherché ainsi à protéger le monopole de son journal L’Équipe57. Cette position de l’Autorité de la concurrence a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2015 contre lequel un pourvoi en cassation a été formé mais finalement rejeté par la chambre commerciale de la haute juridiction dans un arrêt du 1er mars 2017. La Cour de cassation a repris à son compte les analyses développées par l’Autorité de régulation et les juges du second degré.
Tout d’abord, elle a retenu que le marché pertinent était, à l’époque des pratiques reprochées, celui du lectorat de la presse quotidienne nationale d’information sportive distinct du marché des médias gratuits, sur lequel le quotidien L’Équipe était en position dominante. Ensuite, elle a rappelé, comme la cour d’appel, que « l’occupation d’une position dominante impose à l’entreprise concernée l’obligation particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective et non faussée sur le marché intérieur ». Or, la raison d’être du quotidien Aujourd’hui Sport résidant exclusivement dans l’asphyxie financière de son concurrent 10Sport.com, la Cour de cassation a estimé que le groupe Amaury avait commis un abus de position dominante en mettant en œuvre une pratique qui ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une concurrence par les mérites et qui excédait ce qu’autorise le droit de riposte d’une entreprise détenant un pouvoir de marché significatif. Enfin, s’agissant du montant de la sanction financière, la chambre commerciale a approuvé l’évaluation faite par la cour d’appel du dommage à l’économie résultant du comportement du groupe Amaury. En effet, la Cour de cassation a considéré que l’abus de position dominante avait eu pour effet d’évincer du marché le quotidien Le 10Sport.com et donc de supprimer l’offre disponible pour les consommateurs sur le marché des quotidiens sportifs à bas prix.
Fabrice RIZZO
5 – Médecins (…)
III – L’activité sportive
A – Le théâtre de l’activité (…)
B – Les compétitions et manifestations sportives
1 – Accès aux compétitions
La limitation du nombre de joueurs non sélectionnables par les règlements de la fédération française d’escrime n’est pas discriminatoire selon le Conseil d’État
CE, 22 juin 2017, n° 398167. Dans une décision du 5 février 2016, la fédération française d’escrime (FFE), sollicitée par un club strasbourgeois, a refusé de modifier plusieurs textes de ses règlements : l’article 10.1.1 du règlement intérieur qui prévoit que, pour participer aux épreuves fédérales par équipes, chacune d’elles doit être composée d’au moins trois tireurs ayant réglementairement la possibilité d’être sélectionnés en équipe de France ; l’article 10.1.2 du même règlement selon lequel les épreuves individuelles des championnats de France ne sont ouvertes qu’aux personnes sélectionnables en équipe de France ; le règlement sportif 2015-2016 qui précise que, pour les épreuves des championnats de France dans les catégories cadets et juniors, seniors et vétérans, une équipe peut comporter quatre tireurs, dont un seul n’ayant pas réglementairement la possibilité d’être sélectionné en équipe de France. Cette décision déférée par le club de Strasbourg devant le juge administratif n’avait pas été suspendue par le Conseil d’État pour défaut d’urgence58 et, sur le fond, la haute juridiction a également rejeté les prétentions du club requérant59.
Selon le Conseil d’État, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdisant toute forme de discrimination fondée sur la nationalité. En effet, la haute juridiction estime que les règles litigieuses sont justifiées par la spécificité des championnats de France car ces compétitions ont pour objet de distinguer les meilleurs tireurs nationaux afin, notamment, qu’ils représentent la France dans les épreuves internationales. Il n’est donc pas illégitime de restreindre la présence des sportifs qui, en tout état de cause, ne pourront pas porter les couleurs françaises lors des compétitions internationales. Les juges ajoutent que les restrictions prévues ne concernent que ces championnats qui se tiennent sur une ou deux journées dans l’année. Les tireurs de nationalité étrangère sont autorisés à participer à toutes les autres épreuves organisées par la FFE. Enfin, pour asseoir la conformité de sa solution au regard du droit de l’Union européenne, le Conseil d’État se réfère à l’article 165 du TFUE aux termes duquel, « L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. (…) ».
Pour notre part, la solution retenue par le juge ne nous convainc pas. Nous estimons que les dispositions fédérales litigieuses constituent des discriminations directes fondées sur la nationalité et donc contraires aux prescriptions de l’article 18 du TFUE. Il n’est pas possible de les justifier en indiquant qu’elles répondent à un objectif légitime ou à des raisons impérieuses d’intérêt général et qu’elles sont proportionnées. De même, l’article 165 du TFUE n’est d’aucun secours dans la mesure où il ne peut valider une entorse à l’article 18, d’autant plus que sa valeur normative est insignifiante. En effet, l’Union européenne n’a pas de compétence en matière sportive. Son intervention se limite, et l’article 165 en est une illustration topique, à des recommandations ou des lois-cadres n’établissant que des actions d’appui ou d’encouragement.
En définitive, il nous semble que cet arrêt du Conseil d’État ne respecte pas le droit de l’Union européenne et apparaît en contradiction avec le message délivré par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son célèbre arrêt Bosman60.
Fabrice RIZZO
Le système des promotions-relégations peut ne pas être fondé sur des critères essentiellement sportifs : la validité du système des wild cards
CE, 9 juin 2017, n° 400488. Conformément aux principes fondamentaux qui gouvernent l’organisation du sport en France et plus largement en Europe, l’accès aux différents championnats organisés par les fédérations délégataires ou leurs ligues professionnelles dépend principalement des résultats sportifs des clubs. Dans les disciplines collectives, le droit d’accéder aux championnats des divisions supérieures se gagne d’abord sur le terrain61. Certes, les dispositions de l’article L. 131-16, 3°, du Code du sport selon lesquelles les fédérations délégataires édictent : « Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent » autorisent les organisateurs à associer au critère sportif d’autres éléments, notamment les performances économiques des compétiteurs. Mais, en tout état de cause, le mérite sportif demeure le critère principal même s’il peut ne pas être suffisant.
Dans le secteur du basket-ball professionnel, la question a été posée de savoir s’il est possible de remettre en cause ces principes en décidant d’effacer le caractère prédominant du mérite sportif pour permettre à certains clubs d’accéder à une division supérieure. Pour la saison 2014-2015, la Ligue nationale de Basket (LNB) avait décidé de fixer à 18 au lieu de 16 le nombre de clubs admis à participer au championnat de Pro A et avait défini les conditions d’attribution des « invitations » aux clubs appelés à participer, malgré leurs résultats sportifs insuffisants, au championnat de Pro A. Par une décision du 4 juin 2014, la LNB avait « invité » deux clubs qui s’étaient maintenus en Pro B à l’issue de la saison 2013-2014, en se référant à des critères différents : solidité économique, mode de gouvernance, intérêt géographique, caractère innovant et structuré du projet, équipements sportifs…62 Le club du CSP Limoges a contesté devant le juge administratif les nouvelles règles adoptées par la LNB. Dans un arrêt du 9 juin 2017, le Conseil d’État a écarté tous les arguments de fond et de forme soulevés par le requérant63. De manière pour le moins laconique, la haute juridiction a répondu que la décision litigieuse ne constitue pas une atteinte disproportionnée au principe d’égalité au regard des objectifs poursuivis par la LNB, qu’elle n’est pas susceptible d’altérer l’équité ou le bon déroulement des championnats de Pro A et de Pro B et qu’en tout état de cause elle ne viole pas le principe du libre accès aux activités sportives pour tous. Ainsi, pour la première fois, le juge administratif a admis la licéité d’un système de promotion largement déconnecté du classement sportif. Certes, il faut souligner que la LNB avait conditionné les invitations (wild cards) au maintien des clubs concernés en Pro B et que la situation était particulière dans la mesure où les invités ont bénéficié du passage du championnat de Pro A de 16 à 18 clubs permettant de ne pas priver les clubs qui avaient obtenu les deux premières places du classement de Pro B de leur droit – acquis sur le terrain – d’accéder à la division supérieure. Il reste que cet arrêt autorise une entorse importante au système des « promotions-relégations » sans pour autant justifier sa position avec un argumentaire à la hauteur de l’atteinte à un principe fondamental de l’ordre juridique sportif. Même si l’on peut penser que le juge administratif, à l’aide du test de proportionnalité, reste l’un des garants du modèle européen du sport, cette décision ne nous invite pas à l’optimisme.
Fabrice RIZZO
2 – Résultats des compétitions
Les directions nationales de contrôle et de gestion (DNCG) sont des organes internes des fédérations
CE, 22 juin 2017, n° 398082. À l’issue de la saison 2013-2014, la direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) du football avait refusé l’accession du club de Lens en Ligue 1 provoquant le maintien du Football club de Sochaux dans l’élite. Néanmoins, conformément à l’avis formulé par le CNOSF, la fédération française de football (FFF) a modifié la décision de la DNCG en intégrant le RCL en Ligue 1 au détriment du club de Sochaux. Ce dernier, n’ayant pas réussi à obtenir la suspension de la décision de la FFF en référé64, a maintenu ses prétentions dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire. En première instance et en appel, le club sochalien a été entendu65. Selon les juges du fond, la création de la DNCG par la fédération et son absence de personnalité juridique ne suffisaient pas à lui conférer la nature d’un organe fédéral interne66. Dans ces conditions, ses décisions ainsi que celles de la commission d’appel n’entraient pas dans le champ de compétence de la procédure de conciliation organisée sous l’égide du CNOSF et la saisine du conciliateur n’autorisait pas le comité exécutif de la fédération à les réviser. Le tribunal a donc annulé la décision de la FFF du 28 juillet 2014 sur le fondement de son incompétence. L’argument principal avancé par les premier et second juges réside dans l’interprétation des dispositions de l’article L. 132-2 du Code du sport. En attribuant à la DNCG un « pouvoir d’appréciation indépendant », ils ont estimé que le législateur consacre son autonomie structurelle et ne lui octroie pas le statut d’organe fédéral. Les décisions de la DNCG seraient alors soustraites à la procédure de conciliation et surtout au pouvoir de révision des autorités fédérales.
Dans son arrêt du 22 juin 2017, le Conseil d’État a annulé l’arrêt des magistrats du second degré au motif d’une erreur de droit67. La haute juridiction a considéré que la DNCG est un organe interne de la fédération car si le législateur lui garantit un pouvoir d’appréciation indépendant des autres organes de la fédération, il ne lui a pas pour autant conféré la personnalité morale. Elle en a logiquement déduit que les décisions de la DNCG sont des actes fédéraux qui sont soumis à la procédure de conciliation en application de l’article L. 141-5 du Code du sport.
Il nous semble que le raisonnement suivi par le Conseil d’État est incontestable68. L’article L. 132-2 confère effectivement à la DNCG une indépendance dans sa mission de contrôle des finances des clubs. Sur chacun des dossiers qui lui sont soumis, elle doit exercer sa fonction de régulateur économique et juridique sans subir la moindre intervention de la fédération ou de la ligue professionnelle. Mais, ses décisions constituent, comme celles des commissions disciplinaires, des actes de la fédération dont rien dans les articles L. 141-4 et R. 141-5 du Code du sport ne permet de considérer qu’ils échappent à la procédure de conciliation. En l’état du droit positif, la DNCG est un organe fédéral même si l’article L. 132-2 consacre sa totale indépendance dans le processus d’élaboration de ses décisions. Au demeurant, lorsque les organismes de contrôle de gestion adoptent des décisions entachées d’une erreur de droit, d’un détournement de pouvoir ou d’une erreur manifeste d’appréciation, c’est auprès des instances fédérales et de la ligue professionnelle que les clubs demandent réparation de leurs dommages69. Une telle faculté reconnue aux clubs d’engager la responsabilité d’une fédération sur le fondement d’une faute de la DNCG démontre que cette dernière est considérée comme un organe fédéral ordinaire dont le traitement des litiges résultant de son activité ne doit revêtir aucun caractère exceptionnel.
Par ailleurs, le Conseil d’État a également précisé qu’aux termes de l’article 18 des statuts de la FFF, il revient au comité exécutif de cette fédération de se prononcer sur les mesures proposées par le conciliateur, même lorsqu’elles portent sur une décision prise initialement par la DNCG dans le cadre de son pouvoir d’appréciation dont l’indépendance est garantie par l’article L. 132-2 du Code du sport. De manière implicite, le Conseil d’État a admis qu’il appartient aux organes disposant d’une compétence générale de représenter la fédération dans le cadre d’une procédure de conciliation et de statuer sur les mesures proposées par le conciliateur, ce qui semble exclure, en l’espèce, le président de la FFF70.
Fabrice RIZZO
3 – Traitement du dopage
4 – Sécurité des compétitions
C – Les responsabilités
D – Les assurances
IV – Le financement du sport
A – Le financement public (…)
B – Le financement privé
1 – Droits de propriété intellectuelle
2 – Paris sportifs en ligne
3 – Droits audiovisuels (…)
4 – Contrats de sponsoring (…)
5 – Contrats de transfert
6 – Contrats de billetterie (…)
7 – Exploitation de l’image des sportifs (…)
8 – Publicité
9 – Tabacs et alcools
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20103 et Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20104, PB : JCP G 2017, 1238, note Molfessis N. ; ibid., 1269, obs. Loiseau G. ; JCP E 2018, 1002, obs. Seube J.-B. ; JCP S 2017, 1356, note Loiseau G. ; Lexbase Hebdo soc. 2017, n° 714, note Radé C. ; Gaz. Pal. 10 oct. 2017, n° 304x6, p. 13, note Latina M. ; RDT 2017, n° 11, p. 715, note Bento de Carvalho L. ; D. 2017, p. 1920, note Cour de cassation ; ibid., p. 2007, note Mazeaud D. ; ibid., p. 2289, note Bauduin B. et Dubarry J. ; Dr. soc. 2018, p. 175, note Pagnerre Y. ; RTD civ. 2017, p. 837, obs. Barbier H. ; Contrats conc. cons. 2017, comm. 238, obs. Leveneur L. ; Cah. soc. nov. 2017, n° 121v5, p. 527, note Icard J. ; AJ Contrats 2017, n° 11, p. 480, Bucher C.-E. ; Cah. dr. sport 2017, n° 48, p. 58, note Rabu G.
-
2.
Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20411 : RDC 2017, n° 114j8, p. 415, note Genicon T. ; D. 2017, p. 793, note Fauvarque-Cosson B. ; RTD civ. 2017, p. 377, obs. Barbier H. ; Contrats, conc. consom. 2017, n° 5, p. 23, obs. Leveneur L. ; AJCA 2017, p. 175, note Houtcieff D. ; Constr.-Urb. 2017, repère 4, obs. Périnet-Marquet H. ; Defrénois 14 sept. 2017, n° 128a8, p. 36, obs. Seube J.-B.
-
3.
Genicon T., note préc.
-
4.
Rabu G., note préc., spéc. p. 61.
-
5.
Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42951 : Bull. civ. V, n° 296 ; RDC 2011, p. 804, note Genicon T. ; D. 2011, p. 170 ; RDT 2011, p. 108, obs. Auzero G. ; JCP E 2011, 1272, note François G. ; JCP S 2011, 1104, note Puigelier C. ; Gaz. Pal. 7 avr. 2011, n° I5383, p. 17, note Houtcieff D.
-
6.
Rabu G., « Promettre un contrat de travail dans le sport professionnel », Cah. dr. sport 2016, n° 46, p. 11.
-
7.
Ou comment un régime juridique issu du droit spécial est érigé en régime juridique de droit commun.
-
8.
La définition de l’offre de contrat de travail sonne ainsi comme une réminiscence de la notion d’offre d’embauche.
-
9.
C. sport, art. L.222-2-3.
-
10.
Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-14258 : Bull. civ. V, n° 138 ; D. 2014, p. 1331 ; ibid. 2015, p. 829, obs. Porta J. et Lokiec P. ; Dr. soc. 2014, p. 773, obs. Mouly J. ; ibid. 2015, p. 206, chron. Tournaux S. ; JCP S 2014, 1330, note Duchange G. ; Cah. soc. juill. 2014, n° 113y0, p. 415, obs. Icard J.
-
11.
C. sport., art. L. 222-2-8, I.
-
12.
C. sport., art. L. 222-2-8, II.
-
13.
C. civ., art. 1116.
-
14.
CA Aix-en-Provence, 8 sept. 2017, n° 15/00871.
-
15.
Si l’on retient la qualification de promesse unilatérale dans les espèces commentées.
-
16.
C. civ., art. 1124, al. 2. Mais la disposition ne semble pas d’ordre public et pourrait être écartée par les parties.
-
17.
Rabu G., « L’avant-contrat de travail du sportif et de l’entraîneur professionnel », Droitdusport.com, étude à paraître.
-
18.
Justifiant l’inefficacité d’une clause résolutoire (Cass. soc., 11 mai 1988, n° 86-42012 : Bull. civ. V, n° 283), l’impuissance d’une faute ordinaire du salarié à fonder une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail (Cass. soc., 20 mars 1990, n° 87-41418 : Bull. civ. V, n° 121 ; D. 1991, p. 143, note Mouly J.) ou encore l’impossibilité pour le salarié d’accepter, par avance, « la rupture par l’employeur de son contrat de travail à durée déterminée pour une cause non prévue par les dispositions d’ordre public de l’article L.1243-1 du Code du travail » (Cass. soc., 27 mai 1992, n° 89-41704 : Bull. civ. V, n° 342 ; JCP E 1992, II, 379, note Mouly J.).
-
19.
Cass. soc., 15 mars 2017, n° 15-24028 : RDT 2017, p. 324, note Auzero G. ; Dr. social 2017, p. 568, note Mouly J. ; JCP E 2017, 1268, note Jacotot D. ; JSL 2017, n° 430, p. 14, note Lhernould J.-P. ; Lexbase Hebdo soc. 2017, n° 696, note Tournaux S.
-
20.
C. civ., art. 1304-6, al. 3, non applicable à l’espèce antérieure à la réforme.
-
21.
Cass. soc., 13 avr. 2005, n° 02-46962 : JCP S 2006, 1401, note Jacotot D. – Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 08-40023 : Bull. civ. V, n° 165 ; JCP G 2009, 574, n° 3, obs. Mekki M. ; JCP S 2009, 1491, note Bousez F. ; Lexbase Hebdo soc. 2009, n° 359, note Auzero G. ; D. 2010, p. 871, note Lagarde F. ; CSBP nov. 2009, n° S 267, p. 256, obs. Charbonneau C. – Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 08-40716.
-
22.
Cass. soc., 14 déc. 2016, n° 15-26676 ; Cass. soc., 10 mai 1994, n° 94-41950 : JCP E 1995, 730, note Masquéfa C. – Cass. soc., 23 mai 1995, n° 91-44659.
-
23.
Articles 9 de la convention collective de branche du basket professionnel et 400 du règlement de la Ligue nationale de basket. Comp. articles 2.2.1 de la convention collective du rugby professionnel et 741 du règlement de la Ligue nationale de rugby.
-
24.
C. trav., art. L. 4624-1 et C. trav., art. R. 4624-10 et s.
-
25.
C. trav., art. L. 1242-12, al. 1er.
-
26.
C. sport, art. L. 222-2-5, I.
-
27.
C. trav., art. L. 1221-3.
-
28.
Cass. soc., 19 mars 1986, n° 84-44279 : Bull. civ. V, n° 98.
-
29.
C. trav., art. L. 1321-6, al. 3.
-
30.
Supiot A., « Les langues de travail », SSL, n° 1343, p. 25 ; Saint-Didier C., « L’encadrement juridique des langues de travail », Dr. soc. 2014, p. 120.
-
31.
C. trav., art. L. 1242-12, al. 2. Pour une illustration : Cass. soc., 24 juin 2015, n° 14-13829, Mme X. c/ Sté JDA Software France : Dr. soc. 2015, p. 743, note Mouly J. ; JSL 2015, n° 393, p. 10, note Lhernould J.-P. ; Lexbase Hebdo soc. 2015, n° 620, note Auzero G. ; JCP S 2015, 1309, note Guyot H. ; Dr. ouvrier 2015, n° 809, p. 718, note Richard E.
-
32.
C. trav., art. L. 1242-12, al. 3.
-
33.
Ducamp S. et Martinez J., « De l’obligation de la langue française dans les relations de travail », JCP S 2007, 1849, spéc. § 5.
-
34.
JORF, 11 août 2017, n° 181, texte 108.
-
35.
C. sport, art. R. 212-89, al. 2 mod.
-
36.
C. sport, art. R. 212-90-1, al. 2 mod.
-
37.
C. sport, art. R. 212-93, mod.
-
38.
C. sport, art. R. 212-90.
-
39.
C. sport, art. R. 212-93.
-
40.
C. sport, art. R. 212-89-1.
-
41.
C. sport, art. R. 212-93-1.
-
42.
C. sport, art. R. 212-94-1 à C. sport, art. R. 212-94-3.
-
43.
Cass. crim., 13 juin 2017, n° 16-84246 : Cah. dr. sport 2017, n° 48, p. 70, note Rapha S. ; Europe 2017, n° 12, chron. 2, n° 4, obs. Jeanne A.
-
44.
Cass. crim., 28 mars 2017, n° 14-87597 : Jurisport 2017, n° 175, p. 9, obs. Aumeran X.
-
45.
Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-21196, Panayótis Yannákis c/ Sté Limoges CSP SASP, PB ; Dr. soc. 2017, p. 682, obs. Mouly J. ; ibid., p. 843, chron. Tournaux S. ; JCP S 2017, 1190, note Verkindt P.-Y. ; Cah. soc. juin 2017, n° 121a7, p. 294, note Icard J. ; Lexbase Hebdo Soc. 2017, n° 699, obs. Tournaux S. ; JurisSport 2018, n° 182, p. 36, note Liffran H. ; Cah. dr. sport 2017, n° 48, p. 55, note de Brier H.
-
46.
Cass. soc., 26 avr. 2006, n° 04-40939 : Bull. civ. V, n° 150 ; JCP S 2006, 1497, note Verkindt P.-Y. – Cass. soc., 8 avr. 2009, n° 07-41345 : Bull. civ. V, n° 113 – Cass. soc., 9 nov. 2011, n° 10-10363 ; Cass. soc., 17 mai 2011, n° 09-43003 : Bull. civ. V, n° 110 ; JCP S 2011, 1401, note Vincent X. et Beljean L. ; D. 2011, p. 2249, note Lacroix-De Sousa S. ; BJS oct. 2011, n° 402, p. 826, note Morelli N. ; CSBP juill. 2011, n° 232, p. 200, obs. Pansier F.-J. ; Rev. proc. coll. 2011, n° 6, p. 64, obs. Fraimout J.-J.
-
47.
Cass. soc., 13 mars 1968 : Bull. civ. V, n° 153.
-
48.
Verkindt P.-Y., note sous l’arrêt n° 04-40939, préc.
-
49.
CCBBP, art. 6.
-
50.
CCBBP, art. 6.2.3 c), al. 4.
-
51.
Cass. soc., 11 oct. 1994, n° 90-41818 : Bull. civ. V, n° 272 ; D. 1995, somm. p. 369, obs. Soubise V.
-
52.
CA Aix-en-Provence, 24 août 2017, n° 17/00406, Fédération roumaine de rugby.
-
53.
CCBBP, art. 12.3.2.2.
-
54.
Cass. soc., 28 janv. 1970, n° 69-40009 : Bull. civ. V, n° 58.
-
55.
C. trav., art. L. 1243-3.
-
56.
Aut. Conc., 20 févr. 2014, n° 14-D-02 : LPA 27 mai 2015, p. 14, note Rizzo F.
-
57.
Aut. Conc., 20 févr. 2014, n° 14-D-02 : Cah. dr. sport 2014, n° 35, p. 104, note Basnier G. et p. 141, note Chagny F. ; RDC 2014, n° 110x7, p. 492, obs. Prieto C. Dans le calcul de la sanction, l’Autorité a tenu compte des difficultés financières des filiales de presse du groupe Amaury. Elle a alors réduit le montant de la sanction de 60 %.
-
58.
CE, ord., 15 avr. 2016, n° 398110.
-
59.
CE, 22 juin 2017, n° 398167 : Dict. Perm. Droit du sport juill. 2017, p. 7, obs. Rémy D.
-
60.
CJCE, 15 déc. 1995, n° C-415/93 : Rec. CJCE, p. I-4951.
-
61.
Maisonneuve M., « Le Conseil d’État et le mérite sportif », AJDA 2017, n° 27, p. 1521.
-
62.
Une décision du 18 juin 2014 de la LNB a approuvé le passage en Pro A de 16 à 18 clubs avec les deux clubs invités.
-
63.
CE, 9 juin 2017, n° 400488 : Jurisport 2017, n° 177, p. 9, obs. Lagarde F.
-
64.
TA Besançon, ord., 15 sept. 2014, n° 1401377, Football Club Sochaux Montbéliard.
-
65.
TA Besançon, 29 janv. 2015, n° 1401378 : Jurisport 2015, n° 151, p. 9, obs. J. M. ; Jurisport 2015, n° 156, p. 34, note Rémy D. ; Dict. Perm. Droit du sport avr. 2015, p. 6, obs. Rémy D. – CAA Nancy, 1er mars 2016, n° 15NC00582 : Cah. dr. sport 2016, n° 44, p. 62, note Rizzo F. ; Dict. Perm. Droit du sport avr. 2016, p. 1, note Rémy D. ; Jurisport 2016, n° 163, p. 9, obs. J. M.
-
66.
Rémy D., obs. sous TA Besançon, 29 janv. 2015, n° 1401378 : Dict. Perm. Droit du sport avr. 2015, p. 6.
-
67.
CE, 22 juin 2017, n° 398082 : AJDA 2017, n° 35, p. 2027, note Dudognon C. ; Dict. Perm. Droit du sport 2017, n°247, p. 1, note Rémy D.
-
68.
V. égal. l’analyse critique des décisions du tribunal et de la cour : Rémy D., obs. sous TA Besançon, 29 janv. 2015, n° 1401378 : Dict. Perm. Droit du sport avr. 2015, p. 6. ; Jurisport 2015, n° 156, p. 34 – Rémy D., « La DNCG ne serait pas un organe de la FFF : le quiproquo continue », Dict. Perm. Droit du sport avr. 2016, p. 1.
-
69.
Quelques décisions illustrent la mise en œuvre par les clubs de la faculté d’engager la responsabilité d’une fédération sur le fondement d’une faute de la DNCG : CE, 19 juill. 2010, n° 325892, Ligue de football professionnel : Cah. dr. sport 2010, n° 21, p. 102, note Thomas V. ; Jurisport 2010, n° 101, p. 9, obs. Lagarde F. ; LPA 12 avr. 2011, p. 12, note Rizzo F. – CAA Versailles, 5 févr. 2009, n° 07VE01769, Entente Sannois Saint-Gratien : Cah. dr. sport 2009, n° 15, p. 93, note Rizzo F. – CAA Nantes, 19 déc. 2013, n° 12NT00835, Tours Football Club : Cah. dr. sport 2013, n° 34, p. 101, note Rizzo F. – TA Dijon, 25 juin 2013, n° 1201856, Assoc. Football Club de Sens.
-
70.
Rémy D., obs. préc. sous CE, 22 juin 2017.