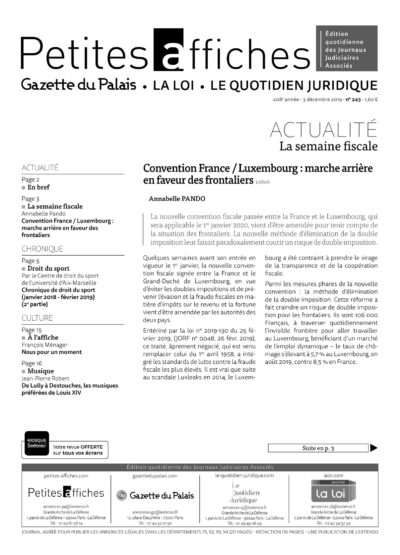Chronique de droit du sport (janvier 2018 – février 2019) (2e partie)
La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2018 et février 2019.
I – Le cadre juridique du sport
A – Les législateurs du sport (…)
B – Les lois du sport
1 – Légalité des décisions des fédérations
2 – Concours de normes (…)
C – La justice du sport
1 – Droit disciplinaire
2 – Arbitrage : tribunal arbitral du sport
L’arbitrage des différends nés du contrat de ville hôte : l’inutilité de l’exceptionnalité ?
L. n° 2018-201, 26 mars 2018, art. 6, relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Conformément à l’article 51. 2 du contrat de ville hôte en vue des Jeux de la XXXIIIe olympiade en 2024, « tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat ville hôte sera résolu de façon concluante par voie d’arbitrage, à l’exclusion des tribunaux étatiques de Suisse, du pays hôte ou de tout autre pays, et jugé par le tribunal arbitral du sport conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport dudit tribunal. Le siège de l’arbitrage sera à Lausanne, canton de Vaud, Suisse. Si, pour une raison quelconque, le tribunal arbitral du sport décline sa compétence, le litige sera résolu de façon concluante devant les tribunaux étatiques à Lausanne, Suisse ». La stipulation écarte donc la compétence des juridictions étatiques au profit de l’arbitrage devant le TAS. La reconnaissance de la compétence du TAS est du point de vue du CIO une règle de principe, favorisant ainsi l’uniformisation du contentieux olympique sans avoir à subir les singularités des droit nationaux, et notamment la dualité juridictionnelle française1.
Seulement, la commune partie au contrat était-elle en droit d’écarter la compétence des juridictions administratives au sein de ce contrat atypique2 ? Conséquemment, les personnes morales de droit public visées peuvent-elles être tenues par une telle clause ? Il ressort en effet de l’article 2060 du Code civil que l’on ne peut compromettre sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public. Pour contourner cette prohibition et donner pleine efficacité à l’engagement de la ville hôte3, le législateur a créé une exception à cette disposition. Suivant l’article 6 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, « par dérogation à l’article 2060 du Code civil, le contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, la ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter du 13 septembre 2017 entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 peuvent comporter des clauses compromissoires ». Relevons que la disposition ne porte, semble-t-il, pas tant sur l’élection d’une juridiction que sur la faculté de compromettre que ce soit dans le contrat de ville hôte ou dans les contrats qu’il mentionne4.
L’utilité de cette dérogation législative mérite la discussion5. Autant elle pourrait se justifier dans le cadre d’un contrat purement interne comme ce fut le cas pour le championnat d’Europe UEFA de football masculin 20166 ; autant elle présente a priori peu d’intérêt s’agissant d’un contrat conclu par des personnes publiques françaises « pour les besoins et dans les conditions conformes aux usages du commerce » international7. Seulement cette différence de régime opérée par la Cour de cassation n’est pas partagée par le Conseil d’État lequel est plutôt favorable à l’application stricte de la disposition, que le différend soit d’ordre interne ou international8. Pour ne pas s’exposer aux affres d’un contentieux sur ce point, la première solution consistait à s’en remettre à une convention internationale telle la convention de Genève sur l’arbitrage commercial international. Son applicabilité à l’accord est néanmoins peu évidente9. Restait alors la dérogation législative qui ne pouvait se retrouver dans l’article 9 de la loi du 19 août 1986 faute de correspondance entre le champ d’application ratione personae et materiae du texte avec celui du contrat de ville hôte10. La seule solution était donc d’adopter une loi spéciale que l’on peut sans trop de crainte considérée comme constitutionnelle11. On soulignera le silence conservé sur le droit applicable alors même que le contrat de ville hôte comporte une clause d’electio juris en faveur du droit suisse ; mais la faculté de compromettre emporte naturellement liberté de choisir le droit applicable.
Gaylor RABU
3 – Arbitrage : chambre arbitrale du sport (…)
4 – Justice publique
Compétence spéciale pour un événement éphémère
D. n° 2018-1249, 26 déc. 2018, attribuant à la cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Si conformément à l’article 34 de la constitution, la loi fixe les règles concernant (…) la création de nouveaux ordres de juridiction, c’est au pouvoir réglementaire que revient la prérogative d’en définir les compétences matérielle et territoriale. Ainsi, l’État français a adopté le 26 décembre 2018 le décret n° 2018-1249 attribuant à la cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. L’article 1er du décret ajoute un 5° à l’article R. 311-2 du Code de justice administrative aux termes duquel la cour administrative d’appel de Paris se voit attribuer une compétence exclusive en premier et en dernier ressort pour les litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l’ensemble des actes afférents : aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu’aux voiries dès lors qu’ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux ; aux documents de toute nature, notamment les documents d’urbanisme et d’aménagement, en tant qu’ils conditionnent la réalisation de ces opérations, infrastructures, équipements et voiries ; aux constructions et opérations d’aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu par l’article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. La désignation de Paris comme ville organisatrice, par ailleurs partie au contrat de ville hôte signé le 13 septembre 2017, se traduit par la réalisation des principales opérations immobilières destinées à l’édification des équipements sportifs, des équipements d’accueil et des aménagements afférents sur le territoire couvert par la juridiction. Sa compétence ratione loci relève ainsi de l’évidence. En revanche, sa compétence exclusive en premier et dernier ressort est plus symptomatique du pragmatisme que requiert le traitement contentieux relatif à un événement aussi important qu’éphémère. Cette dévolution de compétence particulière a été initiée en 201312 consécutivement à l’adoption de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011. Le choix règlementaire s’explique naturellement par la nécessité de mettre fin rapidement aux litiges afin de remplir les objectifs fixés par la ville élue, par ailleurs débitrice d’obligations au titre du contrat de ville hôte.
L’exclusivité de cette compétence est tempérée par la reconnaissance de la compétence en premier et en dernier ressort du tribunal administratif normalement compétent pour le type de litiges susvisés dès lorsqu’il aura été saisi avant le 1er janvier 2019 (art. 2). La compétence de la juridiction de premier degré pour connaître des recours contre les permis de construire, de démolir ou d’aménager lui est néanmoins retirée pour les permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (art. 3). On comprend que cette compétence est dévolue par défaut à la cour administrative d’appel de Paris. Le pouvoir du Comité international olympique se manifeste ici de façon subtile en ce qu’il obtient de l’État un texte spécial portant sur une attribution de compétence juridictionnelle. Il illustre un peu plus comment l’hétéronomie des rapports normatifs entre les ordres juridiques étatiques et l’ordre juridique sportif a tendance à s’inverser à mesure de la dimension transnationale de l’organisateur de la compétition sportive13.
Gaylor RABU
5 – Justice sportive (…)
II – Les acteurs du sport
A – Les groupements sportifs (…)
B – Le sportif
1 – Sports collectifs
Obligations sportives et lien de subordination
Cass. soc., 28 nov. 2018, nos 17-20036 et 17-20037, Assoc. Stade Rodez Aveyron. La présente décision ne présente a priori rien de singulier et ne mériterait guère que l’on s’y attarde. En l’espèce, deux rugbymen ont conclu une « convention » avec un club constitué sous la forme d’une association loi 1901. Ils prirent acte de la rupture de leur contrat de travail, au motif que certains salaires ne leur auraient pas été payés. Encore eût-il fallu qu’ils soient liés par un contrat de travail avec ledit club. Telle était la question centrale de ce litige. Les juges du fond jusqu’à la cour d’appel de Montpellier ont écarté cette qualification faute pour les salariés de démontrer l’existence d’un lien de subordination14. Les arrêts sont cassés et annulés par la Cour de cassation au motif que la juridiction de fond n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Elle avait relevé non seulement l’existence d’une prestation sportive contre rémunération (indemnité mensuelle de 2 200 euros), mais également nombre d’indices qui, aux yeux de la haute juridiction, suffisaient à caractériser un lien de subordination. Les sportifs étaient tenus « de participer aux compétitions, de s’entraîner selon les directives du club, de participer à la politique de formation ». On pouvait en déduire l’existence d’un pouvoir de direction assis par ailleurs sur le « règlement interne du club et la charte des droits et des devoirs du joueur ». En cas de manquement, ils s’exposaient à des « sanctions disciplinaires ». Partant, il importait peu que les auteurs des pourvois n’aient pas été en mesure de rapporter la preuve qu’ils étaient contraints d’exercer leur activité dans un cadre horaire précis, sur un lieu déterminé, avec du matériel du club et qu’ils s’exposaient à des sanctions financières. Il faut reconnaître la constance et la cohérence de la cour d’appel de Montpellier qui avait adopté la même solution dans une affaire identique concernant le même club15.
Quels enseignements tirer ? Assurément, l’arrêt illustre à nouveau que le caractère « amateur » de la pratique sportive – au sens des nomenclatures sportives – est sans incidence sur la qualification d’un contrat de travail. Ensuite, les éléments servant à caractériser une telle relation ressortent inévitablement de la pratique de la discipline sans que l’on puisse distinguer selon la nature travaillée ou simplement sportive de l’activité à partir du moment où l’on admet que le sport puisse constituer une activité travaillée. Enfin, on observera l’économie de motifs dont fait preuve ici la Cour de cassation. Si elle identifie un pouvoir de direction et de sanction qu’elle ne nomme pas, elle s’épargne l’exercice de caractérisation du pouvoir de contrôle dont on pressent qu’elle le déduit de l’obligation de conformité aux règles disciplinaires du club sous peine de sanctions. Si tant est que cela puisse s’avérer satisfaisant au regard de l’exigence de sécurité juridique, on rappellera que l’activité sportive pratiquée en club étant toujours soumise à une discipline collective, la reconnaissance d’une relation individuelle de travail s’en trouve facilitée et s’avère inéluctable en cas de versement, comme en l’espèce, d’une rémunération substantielle.
Gaylor RABU
Épilogue dans l’affaire Scarpelli
CA Angers, 25 janv. 2018, n° 16/02326, Scarpelli. Cette chronique avait accueilli nos observations sur le très important arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016 dans cette affaire16. Elle a posé à cette occasion deux grands principes. Le premier est que « la décision de refus d’homologation constitue un acte administratif qui s’impose au juge judiciaire ». La Cour de cassation distingue maintenant clairement la décision d’homologation ou de refus d’homologation et les conséquences qui doivent ensuite en être tirées sur le plan prud’homal17. Suivant le second, « sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du salarié »18 ; de sorte que l’employeur ne pouvait procéder à la diminution automatique de la rémunération du sportif sans son consentement. Au passage, la cour avait rejeté la demande en réparation fondée sur le préjudice automatique découlant de la non-délivrance de la décision d’homologation. Il a fort à propos été relevé19 que cette position s’inscrivait dans une évolution jurisprudentielle de la cour tendant à réduire le domaine du « dommage déduit de la faute »20.
Le 25 janvier 2018, la cour d’appel de renvoi s’est sans surprise alignée sur la doctrine de la Cour de cassation. Faute de rapporter un quelconque élément probatoire attestant du consentement exprès et spécial du sportif à la diminution de sa rémunération, qui ne pouvait ressortir de sa seule soumission à la charte du football professionnel prévoyant un tel mécanisme, le club employeur ne pouvait le lui imposer. Les juges angevins se sont ensuite prononcés sur une nouvelle demande, parfaitement recevable, tendant à obtenir la réparation du dommage consécutive à la transmission tardive de la demande d’homologation du contrat de travail à la ligue professionnelle. Fondamentalement, ils n’excluent pas le principe de l’indemnisation. En revanche, ils rejettent la prétention du joueur car il ressortait des pièces du dossier qu’il n’avait jamais souhaité prolonger son contrat de travail. Il est noté qu’il avait, semble-t-il, tout mis en œuvre pour ne pas remplir la condition de prolongation automatique du terme extinctif de son contrat et qu’il avait négocié un contrat avec un autre employeur avant la fin de son contrat en cours. On doit y voir un heureux pragmatisme des juges du fond qui ne se sont pas laissé séduire par les demandes salariales pouvant traduire une certaine mauvaise foi du salarié. Cela dit, il convient d’être prudent car on ne saurait systématiquement procéder à de telles déductions du simple fait qu’un joueur négocie avec un autre club : il peut s’agir d’une simple stratégie destinée à obtenir une revalorisation salariale.
Gaylor RABU
Obsolescence programmée d’un revirement de jurisprudence
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-21767, Arruda Paulo César c/ SASP Toulouse Football Club. L’année 2018 a pris fin par quelques décisions nourrissant le contentieux de la requalification du contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée. On retiendra notamment la décision rendue dans l’affaire Paulo César en raison principalement de la motivation de la solution rendue et, ensuite, parce que l’introduction de ce contentieux fut la source de quelques incendies prétoriens ayant stupéfait les clubs employeurs. Initialement conclu pour quatre ans, le contrat de travail liant le sportif à son club employeur avait été résilié d’un commun accord entre les parties. Puis, l’ancien salarié avait saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture. La cour devait se prononcer sur les conditions de recours au CDD d’usage alors en vigueur. Plus précisément, le salarié reprochait à son employeur que, contrairement à ce que prévoyait la charte du football professionnel, le contrat qui devait être établi par écrit ne comportait pas les motifs du recours au CDD d’usage. La haute juridiction confirme pourtant l’analyse des juges du fond21 estimant que l’obligation de motivation était remplie dès lors que le contrat précisait que son objet était de pourvoir un poste de joueur professionnel de football pour une durée de quatre saisons. La solution constitue un spectaculaire revirement de jurisprudence. Spectaculaire car la Cour de cassation avait affirmé avec force que le recours au CDD d’usage devait être justifié « par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois »22, ce qui ne pouvait résulter de la seule invocation de l’aléa sportif et du résultat des compétitions23. Sur cette base, elle avait systématiquement rejeté les justifications fondées sur la simple mention du caractère sportif de l’activité24 ou encore du fait que le contrat fût conclu « pour une saison sportive »25 ou pour « la saison rugbystique 2006/2007 »26. Partant, le contrat de travail était requalifié en CDI. Spectaculaire également car la jurisprudence antérieure avait spécialement motivé la création du contrat de travail à durée déterminée spécifique issu de la loi du 27 novembre 2015. Par incidence, la décision commentée remet en perspective l’utilité de cette nouvelle figure contractuelle. La décision ne nous paraît néanmoins pas conforme au droit positif et en particulier à la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999 mettant en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 imposant de vérifier l’existence de « raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi »27. L’affaire paraît entendue maintenant que le CDD spécifique est en vigueur. Mais sous réserve de prescription de l’action28, la décision satisfera tous les clubs employeurs et éteindra dans l’œuf les velléités contentieuses des joueurs.
Gaylor RABU
Nature et point de départ du délai de prescription de l’action en requalification
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26437. La nature du contrat dicte les conditions de fond de la requalification mais la demande étant judiciaire elle requiert le respect des conditions d’exercice de l’action. Ex multis, elle doit intervenir avant que n’échoie la prescription extinctive. Mais la détermination du délai de prescription comme son bornage ne sont pas toujours des plus aisés comme en atteste le débat ayant accouché de l’arrêt susmentionné du 3 mai 201829. Le litige ne portait pas sur la situation d’un sportif ou d’un entraîneur salarié mais il permet d’en tirer toutes les conséquences dans le secteur considéré à la lumière de la réforme de 2015. En l’espèce, un salarié avait conclu avec la même entreprise plusieurs CDD de manière discontinue dont certains ne mentionnaient pas le motif de recours. Violant l’exigence de l’article L. 1242-12 du Code du travail, le manquement justifiait a priori la requalification-sanction de l’article L. 1242-12 du Code du travail et, conséquemment, l’allocation d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seulement, la demande fut introduite un peu moins de 10 ans après la conclusion du premier contrat de travail. L’action était-elle prescrite ? Pour répondre à cette question, il fallait d’abord déterminer si l’action se rattachait à la formation, l’exécution ou la rupture du contrat. D’aucuns considèrent que l’action vise à sanctionner une irrégularité tenant à la formation du contrat30. La solution semble logique puisque le motif doit figurer dans le contrat au stade de sa conclusion. Dès lors, l’action serait soumise au délai de prescription trentenaire devenu quinquennal aux termes de l’article 2224 du Code civil tel qu’issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. D’autres auteurs ont considéré que cette action était de celles portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail et devait donc intervenir dans les conditions spéciales fixées au sein du Code du travail31. Or le délai d’exercice de celle-ci a été ramené à 2 ans à l’issue de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Aux termes du présent arrêt, la Cour de cassation valide cette seconde proposition en se fondant sur l’article L. 1471-1 du Code du travail. Au-delà du débat de fond, elle offre l’avantage de sécuriser les situations post-contractuelles. Cet arrêt ne préjuge en rien d’un risque de réduction ultérieur du délai de l’action à 1 an consécutivement aux ordonnances Macron32.
S’agissant du point de départ du délai de prescription33, le législateur a opté pour un délai flottant ou glissant – suivant le choix sémantique – puisque courant « à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit »34. La remise de l’écrit contenant des mentions obligatoires doit impérativement intervenir dans les deux jours suivant la conclusion du contrat. La demande étant fondée sur un défaut formel de la mention du motif de recours au CDD, la Cour retient nécessairement la date de la conclusion. La solution pourrait être temporaire puisque la disposition fondant cette solution a été amendée concernant la rupture du contrat et fait désormais partir le délai au jour de la notification de la décision35. Pour autant, la nature du délai pourrait rattacher la prescription non à la rupture mais à l’exécution, influant sur la détermination de ce point de délai. En outre, il faut ajouter que même si le fait litigieux porte sur une mention obligatoire la seconde branche de l’alternative doit pouvoir jouer dans la mesure où le contrat doit être transmis dans les 2 jours suivant sa conclusion. Or c’est à dater de sa réception que le salarié est censé officiellement prendre connaissance des motifs de recours au CDD et non à la date de conclusion du contrat, sauf cas particulier d’un motif stipulé mais erroné36.
En définitive, cet arrêt intéressera fortement les acteurs du sport dès lors que l’article L. 222-2-5 du Code du sport établit une liste de mentions obligatoires (§ I) et un délai de deux jours ouvrables (§ II) pour transmettre au sportif ou à l’entraîneur professionnel salarié son CDD spécifique.
Gaylor RABU
2 – Sports individuels (…)
C – Les autres acteurs
1 – Entraîneurs (…)
2 – Agents
Le contrat d’agence sportive peut-il être passé par email ?
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10458 ; CA Grenoble 16 mai 2019, n° 18/04025. Le lecteur se souvient peut-être de la décision par laquelle la cour d’appel de Lyon avait estimé qu’un échange d’emails ne pouvait constituer l’écrit exigé par l’article L. 222-17 du Code du sport pour la validité des contrats d’agence sportive37. Dans cette affaire, un agent sportif français avait été missionné par un club français pour mener des négociations avec un club allemand en vue du transfert d’un joueur de nationalité gabonaise. La mission avait été donnée par un courriel provenant du club et, par retour de courriel, l’agent sportif avait demandé au club une confirmation du montant de la commission pour établissement de la facture. Le prix dans l’email établissant la mission était en effet exprimé sous forme de pourcentage du prix de transfert et il fallait à l’agent connaître la somme du transfert pour établir sa facture. Pour éviter d’avoir à payer cette facture, le club invoquait justement le fait que le contrat sur lequel se fondait la créance était nul pour non-respect des conditions de forme posées par l’article L. 222-17 du Code du sport selon lequel « (…) le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise : 1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif (…). Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite ». Les premiers juges et ceux de la cour de Lyon avaient reçu cet argument en soulignant : « que [l’agent sportif] ne verse pas aux débats un contrat tel qu’imposé par le texte susvisé à peine de nullité, alors que les courriels dont [il] se prévaut n’y satisfont pas, comme ne regroupant pas dans un seul document les mentions obligatoires, un message électronique ne pouvant d’ailleurs par nature pas constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties ».
Cette analyse ne pouvait pas emporter la conviction tant elle ignorait à la fois la lettre du Code du sport et les principes les plus élémentaires du droit commun des contrats. Il était ainsi logique qu’une cassation intervienne. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi très justement accueilli le pourvoi formé par l’agent : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 222-17 du Code du sport n’impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d’un acte écrit unique, la cour d’appel, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé »38.
Deux raisons au moins justifiaient la censure. Au titre de la première, il n’y avait aucune raison d’exclure, comme l’avaient pourtant fait les juges du fond, la possibilité que le « contrat écrit » de l’article L. 222-17 du Code du sport soit instrumenté sur une pluralité de supports39. Du moment que tous les instrumenta sont des écrits, la formalité ad validitatem est remplie. Au titre de la seconde, il n’y avait aucune raison d’exclure que le « contrat écrit » de l’article L. 222-17 soit instrumenté sur un support électronique et en l’occurrence plusieurs supports électroniques. En affirmant maladroitement qu’« un message électronique ne pouvant d’ailleurs par nature pas constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties », les juges du fond ont ignoré le principe d’égalité de l’écrit électronique avec l’écrit papier consacré depuis 2000 dans le Code civil. À la date des faits, étaient précisément applicables l’article 1108-140 aux termes duquel « lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 » et l’article 1316-141 selon lequel « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’affaire a ainsi été renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble qui, faisant mine de se plier à la vision de la première chambre en appliquant le principe d’égalité des supports, focalise son attention sur l’exigence de signature pour relever qu’en l’occurrence l’échange des deux emails ne pouvait valoir la formalité légale car il leur manquait à chacun une signature électronique. « L’article 1108-1 du Code civil énonce que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 de ce même code, soit doit être doté d’une signature électronique. Il est constant qu’aucun des mails échangés entre les parties n’a été doté d’une signature électronique, qu’ils ne répondent donc pas aux conditions d’exigence de validité de l’écrit électronique »42.
Cette position mérite la critique pour au moins un motif de droit et un motif de fait.
Le premier motif43 tient à la position bien trop rigoriste sur ce qu’il faut entendre par « signature électronique », et d’une certaine manière sur ce qu’il faut entendre par « signature ». Le Code civil ne définit la signature que par sa double fonction : « [elle] identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte »44. Pas plus, pas moins. Le mot commande juste de considérer que la signature est un signe. Quel type de signe ? Sous quelle formalisation ? Le code est silencieux ! Car il est le loin le temps où il n’était de signature que manuscrite et autographe. Tout signe susceptible de remplir la double fonction d’identification et d’adhésion est susceptible d’être considéré comme une signature. Pour « identifier », il suffit que le signe soit celui qui permette au signataire de se faire connaître et d’être reconnu. Il y a là une simple question de fait et non pas une question de droit. Tout dépend alors du contexte, du genre de l’écrit45, de sa destination, de la capacité de celui qui aura à interpréter la signature pour l’imputer à une personne qu’il reconnaît comme son auteur. Pour exprimer une adhésion, il convient simplement que le signe soit placé suffisamment proche du contenu intellectuel de l’acte pour qu’il soit compris en tant que consentement.
La signature peut ainsi être la reproduction manuscrite exacte des mentions de l’état civil de la personne, comme un « grigri » autographe illisible, un paraphe, des initiales46, une griffe, comme la simple indication d’un nom ou d’un prénom ou d’un surnom, éventuellement suivie de différentes qualités et d’autres informations relatives à un lieu, un employeur, des moyens de communication. Bien entendu, l’identification ne passe pas obligatoirement par le nom et le prénom : tout autre signe remplissant les conditions ci-dessus est susceptible de satisfaire les fonctions d’identification et d’adhésion assurées par la signature. Et s’il est des cas où une croix47, un dessin48, des empreintes digitales49 n’ont pas été considérés comme des signatures véritables ce n’était pas pour la raison qu’ils n’identifiaient pas leur auteur, bien au contraire, c’est parce qu’ils révélaient que l’auteur n’avait pas toutes les compétences intellectuelles requises pour adhérer à l’acte en cause (la deuxième fonction).
Concrètement, rien ne s’oppose à ce que les indications placées à la fin d’un courriel exprimant le nom, le prénom, les fonctions, les qualités, l’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, etc., puissent justement être considérées comme une « signature » au sens de l’article 1316-4 du Code civil. C’est comme cela que l’émetteur du courriel le ressent. C’est par cette signature que le destinataire du courriel reconnaît sa provenance. Tous les logiciels de messagerie proposent d’intégrer automatiquement ces indications à tous les courriels envoyés sous l’appellation de « signature automatique » ou de « signature électronique ».
On pourra certainement rétorquer que toute signature électronique, exigée comme condition de forme ou comme mode de preuve, doit être établie dans des conditions de fiabilité précisées par la loi. Certes. Mais il n’y a dans cette exigence aucune disqualification de principe de la signature de « bas de mail »50.
Lisons la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 1316-4 du Code civil51 : « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». C’est l’affirmation d’une condition indispensable pour que la signature électronique remplisse effectivement sa double fonction d’identification et d’adhésion et que l’acte électronique soit d’une valeur juridique égale à l’acte écrit. Reste que cette exigence vise un procédé technique dont il faut apprécier s’il donne ou non au signe pour lequel on l’a utilisé un caractère de fiabilité. C’est là encore une question de fait ! Seul le juge peut faire cette appréciation ; cela relève du pouvoir souverain des juges du fond, tenus d’ailleurs de respecter l’article 287 du Code de procédure civile dont le deuxième alinéa précise : « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
Lisons la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 1316-4 : « La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». En aucune manière cette deuxième phrase ne pose une condition générale de validité pour toutes les signatures électroniques. Elle permet simplement, si des conditions précises sont remplies, de présumer de la fiabilité de certains procédés dont on trouve la description dans le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
Trop souvent il est fait une confusion entre les conditions de la présomption de fiabilité précisée par le décret et les conditions générales de validité de la signature électronique qui ne sont justement pas précisées par l’article 1316-4 du Code civil si ce n’est par le recours à la notion de pur fait de « procédé fiable ». Trop souvent il est ainsi fait une confusion entre la signature numérique cryptée (signature électronique sécurisée)52 prévue par le décret et toutes les signatures électroniques. Pourtant l’article 1er du décret lui-même invite à faire la distinction : « 1. “Signature électronique” : une donnée qui résulte de l’usage d’un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l’article 1316-4 du Code civil ; / 2. “Signature électronique sécurisée” : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes : (…) ».
Imposer toute autre condition plus sévère à la validité d’une signature électronique (qui ne présuppose pas ensuite de son opposabilité) contreviendrait au principe français du consensualisme qui commande d’interpréter de manière restrictive tous les textes imposant une formalité ad validitatem.
Il faut évidemment, et toutefois, tenir compte du fait que la fiabilité technique d’un courriel quant à son imputation est plutôt faible dans la mesure où, même si on peut toujours déterminer de quel ordinateur et de quelle boîte de messagerie il a été expédié, on n’est jamais totalement certain de l’identité de celui qui a concrètement tapé et envoyé le message. Mais c’est justement ici que l’attitude des parties est importante dans l’appréciation que doit faire le juge de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans l’affaire sous commentaire, le courriel exprimant l’ordre de mission permettait d’identifier parfaitement l’expéditeur (exigence de l’article 1316-1) qui n’avait en aucun cas contesté qu’il en était l’auteur ou que son contenu avait été falsifié. Cette chose est capitale dans ce litige car si la Cour de cassation a déjà disqualifié un courriel en ne lui accordant pas la qualité « d’écrit électronique » c’était uniquement parce que, dans l’espèce qu’elle avait à trancher, l’auteur du prétendu courriel déniait l’avoir rédigé53. La haute juridiction n’a jamais posé comme principe que l’email ne pouvait pas accéder au rang d’écrit électronique54. Depuis longtemps d’ailleurs elle admet qu’un acte puisse « être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopie dès lors que son intégrité et l’imputabilité du contenu à son auteur désigné ont été vérifiées ou ne sont pas contestées »55. Le juge du fond a donc bien pour mission d’évaluer, en évitant les pétitions de principe, l’origine et l’authenticité des emails pour en déterminer la force probante, ou la force validante, qui peut aller du néant à celle de l’écrit, en passant par l’adminicule de preuve par écrit56.
Le deuxième motif de critique est d’opportunité. Pour s’opposer à l’interprétation souple pour laquelle nous militons de l’article L. 222-17 du Code du sport, certains diront peut-être que cet article exprime une règle d’ordre public de protection et que son interprétation doit être poussée jusqu’à offrir une sauvegarde concrète et la plus efficace possible à la partie réputée faible : le client de l’agent. L’argument d’opportunité pourrait être reçu si le client de l’agent était un sportif individuel. Mais lorsque la mission est donnée par un club, le negotium préconçu par lui et l’instrumentum établi par lui, le principe de faveur ne mérite-t-il pas d’être inversé pour s’en tenir strictement aux solutions de droit commun ? Raisonner autrement permet finalement au club de tirer indûment parti de son laconisme. L’agent a travaillé pour qu’un transfert se fasse et rapporte de l’argent au club mais celui-ci n’aurait rien à lui payer sous prétexte que l’ordre de mission ne correspond pas, au moins pour partie à cause du club, aux exigences du Code du sport. Lorsque les clubs ne font pas l’effort de missionner leur agent autrement que par SMS ou email, l’efficacité de leurs engagements doit être reconnue du moment qu’ils sont précis, univoques et acceptés. Rappelons qu’en l’espèce le club n’a, à aucun moment, contesté être l’auteur de l’email.
Jean-Michel MARMAYOU
L’exigibilité de la TVA pour les commissions d’agence sportive : précisions bienvenues
CJUE, 29 nov. 2018, n° C-548/17, Finanzamt Goslar v. baumgarten sports & more GmbH. Dans une décision attendue, la Cour de justice de l’UE vient de confirmer une règle importante relative au régime de TVA applicable aux commissions d’agence sportive. Était en question devant la Cour la date d’exigibilité de la TVA à retenir lorsqu’un agent de sportif perçoit ses honoraires d’intermédiation lors d’un contrat de transfert du joueur de football de manière échelonnée et sous la condition que « le joueur reste sous contrat » avec le nouveau club.
L’hésitation était en effet permise quant au point de savoir si les articles 63 et 64 de la directive TVA imposaient qu’une prestation de services dont la rémunération y afférente n’est ni exigible ni due de manière inconditionnelle dès sa réalisation soit ou non considérée comme « effectuée » au sens desdites disposition.
Et la Cour de répondre : « il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 63 de la directive TVA, lu en combinaison avec l’article 64, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le fait générateur et l’exigibilité de la taxe afférente à une prestation de services de placement de joueurs de football professionnel par un agent, telle que celle en cause au principal, qui fait l’objet de paiements échelonnés et conditionnels sur plusieurs années postérieurement au placement, soient regardés comme intervenant à la date de ce dernier ».
Cette position est logique puisqu’elle évite à un agent d’avoir à régler de la TVA sur des commissions qu’il peut finalement ne pas percevoir dans la mesure où elles sont subordonnées à un événement futur et incertain : la présence du joueur dans l’effectif du club à des instants définis dans le contrat d’agence sportive.
Car c’est ce critère de la condition qui justifie la solution. Il ne suffit pas que le paiement des commissions soit échelonné pour retarder l’application de la TVA. Il faut qu’il soit conditionné.
Jean-Michel MARMAYOU
3 – Arbitres (…)
4 – Médias (…)
5 – Médecins (…)
III – L’activité sportive
A – Le théâtre de l’activité
B – Les compétitions et manifestations sportives
1 – Accès aux compétitions
2 – Résultats des compétitions
3 – Traitement du dopage
4 – Sécurité des compétitions
5 – Organisation des compétitions
C – Les responsabilités
D – Les assurances (…)
IV – Le financement du sport
A – Le financement public (…)
B – Le financement privé
1 – Droits de propriété intellectuelle
2 – Paris sportifs en ligne
3 – Droits audiovisuels
4 – Contrats de sponsoring
5 – Contrats de transfert (…)
6 – Contrats de billetterie
7 – Exploitation de l’image des sportifs
8 – Publicité (…)
9 – Tabacs et alcools (…)
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Dion S., « le droit à l’épruve des Jeux olympiques », JCP G 2018, 132.
-
2.
Marmayou J.-M., « Le contrat de ville hôte pour les jeux olympiques », in Maisonneuve M. (dir.), préf. Canivet G., Droit et Olympisme. Contribution à l’étude d’un phénomène juridique transnational, 2015, PUAM, Droit du sport, p. 113.
-
3.
Sans doute au titre d’un discret engagement d’État français garantissant les obligations des parties françaises au contrat de ville hôte.
-
4.
Sur ce point : Maisonneuve M., « Le Tribunal arbitral du sport, juge de l’organisation des jeux », Cah. dr. sport 2019, p. 110, n° 50.
-
5.
Sur ce point : Maisonneuve M., « Le Tribunal arbitral du sport, juge de l’organisation des jeux », op. cit. ; Clay T., « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges », D. 2018, chron. p. 2448.
-
6.
L. n° 2011-617, 1er juin 2011, relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016 : JORF 2 juin 2011, p. 9553 ; D. 2011, p. 3023, spéc. p. 3025, obs. Clay T. ; Rev. arb. 2011, p. 802, obs. Maisonneuve M. ; JCP G 2012, doctr. 779, § 5, obs. Haftel B.
-
7.
Cass. 1re civ., 2 mai 1966, Trésor Public c/ Galakis : Bull. civ. I, n° 256 ; D. 1966, p. 575, note Robert J. ; Rev. crit. DIP 1967, p. 553, note Goldman B. ; JDI 1966, p. 648, note Level P.
-
8.
CE, avis, 6 mars 1986, n° 339710, Eurodisneyland : GACE 2008, 3e éd., p. 161, n° 12, comm. Labetoulle D. ; EDCE 1987, p. 178, n° 38 – CE, ass., 9 nov. 2016, n° 388806, Sté Fosmax ; RFDA 2016, p. 1154, concl. Pellissier G. ; AJDA 2016, p. 2368, chron. Dutheillet de Lamothe L. et Odinet G. ; Pour une critique de l’interprétation stricte de l’article 2060 du Code civil par le Conseil d’État, v. Maisonneuve M., L’arbitrage des litiges sportifs, t. 267, 2011, avant-propos Karaquillo J. -P., préf. Degoffe M. et Richer L., 2011, LGDJ, Bibliothèque de droit public, nos 558 et s.
-
9.
Maisonneuve M., « Le Tribunal arbitral du sport, juge de l’organisation des jeux », op. cit. ; Lahouazi M., « Arbitrage et personnes publiques : une dérogation supplémentaire. Retour sur l’article 6 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », Dr. adm. 2018, étude 11.
-
10.
Lahouazi M., op. cit.
-
11.
Maisonneuve M., « Le Tribunal arbitral du sport, juge de l’organisation des jeux », op. cit.
-
12.
D. n° 2013-730, 13 août 2013.
-
13.
Rabu G., L’organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d’ordre juridique sportif, préf. Poracchia D. et Rizzo F., 2010, PUAM, 2010, nos 598 et s.
-
14.
CA Montpellier, 19 avr. 2017, n° 16/05746.
-
15.
CA Montpellier, 16 nov. 2016, n° 16/01657 : Cah. dr. sport 2016, p. 74, n° 46, note de Brier H.
-
16.
Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-21794, Mathieu Scarpelli c/ SASP En avant Guingamp : Cah. dr. sport 2016, p. 40, n° 45, note Rabu G. ; Dr. soc. 2017, p. 425, note Antonmattéi P.-H. ; JCP S 2016, 1431, note Jacotot D. ; Cah. soc. 2016, p. 597, n° 119, obs. Icard J. ; Jurisport 2016, p. 8, n° 168, obs. Lagarde F. ; Jurisport 2017, p. 34, n° 173, note Kertudo G.
-
17.
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-21767, Paulo César c/ SASP Toulouse Football Club.
-
18.
V. déjà Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26147 : D. 2016, p. 431 ; Dr. sociétés 2016, p. 446, étude Mouly J. ; Dr. sociétés 2016, p. 650, étude Tournaux S. ; JCP S 2016, 1135, étude Jacotot D. ; Lexbase Hebdo éd. Soc. 2016, n° 646, étude Auzero G. ; LPA 10 août 2017, n° 127g4, p. 12, obs. Rabu G.
-
19.
Icard J., note sous l’arrêt.
-
20.
Gratton L., « Le dommage déduit de la faute », RTD civ. 2013, p. 275.
-
21.
CA Toulouse, 19 mai 2017, n° 15/05472.
-
22.
Cass. soc., 12 janv. 2010, nos 08-40053 et 08-43128 : D. 2010, p. 1692, note Mouly J. ; D. 2011, p. 703, obs. Karaquillo J.-P. ; Cah. dr. sport 2010, p. 52, n° 19, note Buy F ; Cah. dr. sport 2010, p. 64, n° 20, note Lhernould J.-P. ; Cah. dr. sport 2010, p. 67, n° 20, note Rabu G. ; Jurisport 2010, p. 34, n° 98, note Karaquillo J.-P. Adde Jacotot D. et Florès P., « La qualification de CDD d’usage de l’entraîneur », Cah. dr. sport 2010, p. 11, n° 19.
-
23.
Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23176 : Bull. civ. V, n° 295 ; Dr. sociétés 2015, p. 185, note Mouly J. ; Jurisport 2015, p. 18, n° 150, note Auzero G. ; CSBP 2015, p. 85, n° 271, obs. Icard J. ; JSL 2015, p. 15, n° 381, note Lhernould J.-P. ; JCP S 2015, 1077, note Chenu D. ; D. 2015, p. 394, obs. Karaa S. ; RLDA 2015, p. 41, n° 103, note Mariano C. ; LPA 9 juin 2015, p. 8, note Rabu G. ; LPA 26 mai 2015, p. 16, obs. Rabu G.
-
24.
CA Aix-en-Provence, 17e ch., 24 août 2017, nos 17/00406, 17/00407 et 17/00408.
-
25.
Cass. soc., 2 mars 2017, n° 16-10038 : D. 2018, p. 435, obs. Karaa S.
-
26.
Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-19073, M. X c/ Union sportive marmandaise :Bull. civ. V, n° 86 ;JCP G 2012, 368, obs. Lefranc-Hamoniaux C. ; JCP S 2012, 1255, note Bousez F. ; JCP S 2012, p. 1404, n° 40, note Mandin F. ; JCP E 2013, p. 1025, n° 2, chron. Bousez F. ; CSBP 2012, p. 170, n° 241, note Pansier F.-J. ; LPA 10 juin 2013, n°115, p. 13, obs. Rabu G.
-
27.
Cass. soc., 23 janv. 2008, nos 06-44197 et 06-40030 : Bull. civ. V, n° 16 ; Cah. dr. sport 2008, p. 49, n° 11, note Buy F. ; JCP G 2008, II 10050, note Jacotot D. ; JCP S 2008, 1164, note Bousez F. et Martinon A. ; RDT 2008, p. 170, obs. Auzero G. ; D. 2008, p. 1321, note Vigneau C. ; RLDA 2008, p. 47, n° 28, obs. Cornesse I. – Ces deux arrêts ont reçu confirmation par la suite : Cass. crim., 6 mai 2008, n° 06-82366 : Bull. crim., n° 105 ; AJDP 2008, p. 374, note Lasserre-Capdeville J. ; JCP S 2008, 1536, note Bousez F. ; RLDA 2008, p. 53, n° 30, note Canut F. ; RDT 2008, p. 594, note Lévy-Amsallem J. – Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-41287 : Lexbase Hebdo éd. Soc., 30 oct. 2008, n° 324, comm. Martin-Cuenot S. – Jurisprudence faisant suite à CJUE, 4 juill. 2006, n° C-212/04, Konstantinos Adeneler et a. c/ Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) : RJS 10/06, n° 1139, cons. 69 ; D. 2006, p. 2209 ; Cah. dr. sport 2007, p. 95, n° 7, note Jacotot D. Adde Vigneau C., « Le régime des contrats à durée déterminée en droit communautaire » : Dr. sociétés 2007, p. 94.
-
28.
Nos obs. sous Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26437, cette revue, ce numéro.
-
29.
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26437 : à paraître au Bulletin ; Procédures 2018, comm. 215, note Bugada A. ; CSBP 2018, p. 291, n° 308, note Icard J. ; Dr. sociétés 2018, p. 765, note Mouly J. ; Lexbase Hebdo éd. Soc., 17 mai 2018, n° 741, note Radé C. ; JCP S 2018, 1196, note Guyot H. ; JCP E 2018, 1629, n° 2, obs. Dauxerre L. ; JSL 2018, p. 15, n° 456, note Pacotte P. et Daguerre S. ; Rev. proc. coll. 2018, p. 26, n° 5, obs. Taquet F.
-
30.
Mouly J., note sous l’arrêt et du même auteur, note sous Cass. soc., 5 oct. 2007, n 16-13581 à 16-13584, PB ; D. 2017, p. 1079 ; sur cet arrêt, v. D. 2018, p. 813, obs. Porta J. ;JCP S 2017, 1418, note De Raincourt G. et Rioche S.
-
31.
Icard J., « Requalification-sanction et prescription », CSBP 2015, n° 273.
-
32.
Icard J., « Requalification-sanction et prescription », CSBP 2015, n° 273.
-
33.
Klein J., Le point de départ de la prescription, t. 33, 2013, Economica, Recherches Juridiques, préf. Molfessis N., n° 8.
-
34.
C. trav., art. 1471-1.
-
35.
C. trav., art. 1471-1, al. 2 ; en ce sens, v. Mouly J., note sous l’arrêt, Dr. sociétés 2018, p. 765.
-
36.
Icard J., « Requalification-sanction et prescription », CSBP 2015, n° 273.
-
37.
CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 15/06511 : Cah. dr. sport 2017, p. 94, n° 46, note Marmayou J.-M. ; LPA 10 août 2017, n° 127g4, p. 17, obs. Marmayou J.-M.
-
38.
Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10458 : Comm. com. électr. 2018, comm. 81, note Loiseau G. ; Comm. com. électr. 2018, comm. 87, note Caprioli E. ; Comm. com. électr. 2018, chron. 12, spéc. n° 12, obs. Marmayou J.-M. ; RDC 2018, n° 115r5, p. 560, obs. Huet J. ; AJ contrats 2018, p. 397, obs. Buy F.
-
39.
Ex multis : Cass. com., 6 janv. 1953 : Bull. civ. III, n° 6 – Cass. soc., 21 févr. 1957 : Bull. civ. IV, n° 205 – Cass. com., 29 nov. 1971 : Bull. civ. IV, n° 286 ; Rev. sociétés 1972, p. 703, note Oppetit B. – CA Paris, 21 mai 1976 : PIBD 1976, III, 330.
-
40.
Aujourd’hui repris à l’article 1174.
-
41.
Aujourd’hui repris à l’article 1366.
-
42.
CA Grenoble 16 mai 2019, n° 18/04025 : v. www.droitdusport.com.
-
43.
Qui vaut sous l’empire des nouveaux textes.
-
44.
C’est une double fonction consacrée en jurisprudence depuis longtemps. Par exemple, la Cour de cassation a déclaré, certes à propos du testament olographe mais par une formule généralisable pour tout acte, que la signature ne doit laisser « aucun doute ni sur l’identité de l’auteur de l’acte, ni sur sa volonté d’en approuver les dispositions » (Cass. 1re civ., 5 oct. 1959 : D. 1959, p. 507, note Holleaux G. ; RTD civ. 1960, p. 148, obs. Savatier R.).
-
45.
Notons que la loi type CNUDCI sur la signature électronique (12 déc. 2001, A/RES/56/80) sur laquelle se base la directive européenne du 8 juin 2000, n° 2000/31/CE, affirme l’équivalence de tous types de signature à la condition que les exigences techniques posées pour reconnaître l’opposabilité de ces signatures soient proportionnées à la nature de l’engagement.
-
46.
Cass. req., 20 oct. 1908 : DP 1910, 1, p. 291 – CA Paris, 22 mai 1975 : D. 1976, somm., p. 8.
-
47.
Cass. req., 8 juill. 1903 : DP 1903, 1, p. 507 – Cass. 1re civ., 15 juill. 1957 : Bull. civ. I, n° 331 ; D. 1957, somm., p. 143.
-
48.
Cass. 1re civ., 12 juill. 1956 : Bull. civ. I, n° 302.
-
49.
Cass. civ., 15 mai 1934 : DP 1934, 1, p. 113, note E. P. ; S.1934, 1, p. 9, note Rousseau H.
-
50.
Il n’y a donc pas lieu d’affirmer comme l’avait fait la cour d’appel de Lyon que l’email ne peut pas « par nature » constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties.
-
51.
Aujourd’hui repris à l’article 1367.
-
52.
La signature numérique est une forme avancée de signature électronique, utilisant des signes qui ne sont pas nécessairement intelligibles, ni de leur émetteur, ni de leur destinataire.
-
53.
Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-68555 : Bull. civ. I, n° 178 ; Comm., com. électr. 2010, n° 129, obs. Caprioli E. ; RTD civ. 2010, p. 785, obs. Fages B.
-
54.
Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-19781 : RDC mars 2016, n° 112t9, p. 39, note Fatôme A.-D.
-
55.
Cass. com., 2 déc. 1997, n° 95-14251 : JCP E 1998, 151, note Bonneau T. ; JCP G 1998, II 10097, note Grynbaum L. ; D. 1998, p. 192, note Martin D.-R. ; Catala P. et Gautier P.-Y., « L’audace technologique à la Cour de cassation : vers la libération de la preuve contractuelle », JCP G 1998, act., 905.
-
56.
Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-41087 ; Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-14850 : Comm. com. électr. 2011, n° 73, obs. Caprioli E. ; v. plus largement Cachard O., « Le désaveu d’écritures : de la lettre missive au simple courrier électronique », RLDC 2011, n° 4152.