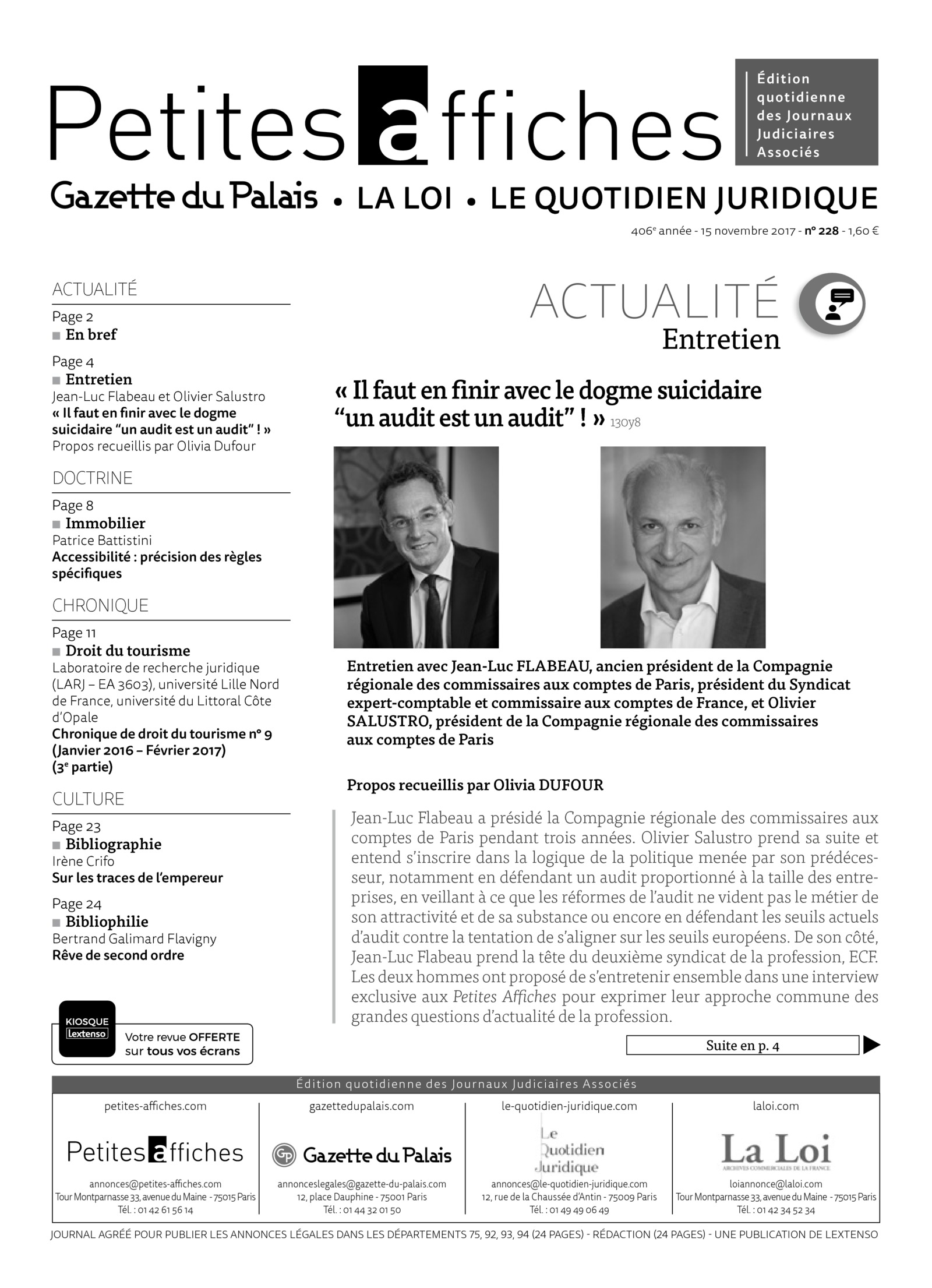Chronique de droit du tourisme n° 9 (Janvier 2016 – Février 2017) (3e partie)
51,9 % des Britanniques ont choisi de quitter l’Union européenne le 23 juin 2016 lors d’un référendum organisé par l’ancien Premier ministre David Cameron. Donald Trump, 70 ans, a remporté les primaires républicaines puis l’élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Le monde change et le tourisme aussi.
Après les dramatiques attentats de 2015 et 2016 en France qui ont eu un impact négatif sur la fréquence touristique, un « fort » rebond au quatrième trimestre 2016 permet à la France de dépasser son niveau de l’automne 2014. Elle devrait ainsi garder sa place de première destination touristique mondiale en 2016. Un nouveau plan pour le tourisme de 42,7 millions d’euros a d’ailleurs été présenté lors du Comité interministériel du tourisme du 7 novembre 2016 qui devrait l’y aider. Cette chronique annuelle est de nouveau l’occasion d’analyser l’actualité juridique concernant ce secteur essentiel à l’économie française.
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics (…)
B – Acteurs privés
1 – Organisations professionnelles (…)
2 – Réglementation des professions
II – Activités du tourisme
A – Exercice des activités touristiques
1 – Financement des activités (…)
2 – Liberté de circulation
3 – Intermédiaires de voyages
4 – Transports
Un cadre pour les centrales de réservation de transport de personnes (L. n° 2016-1920, 29 déc. 2016, relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes)
Cette loi est issue d’une proposition déposée par plusieurs députés, au premier rang desquels Laurent Grandguillaume qui a œuvré depuis le début de l’année 2016 en vue d’apaiser les conflits des acteurs du secteur, sans pour autant interdire toute innovation dans le domaine. Le recours aux technologies numériques a en effet accru la rivalité existant, de fait, entre des professions juridiquement distinctes (taxis, VTC, LOTI, etc.). C’est en particulier le cas des applications disponibles sur smartphones et les procédés de géolocalisation, qui ont permis aux VTC de répondre quasi instantanément à la demande de transport traditionnellement adressée aux taxis, à tel point que les services rendus par les uns et les autres sont devenus, comme l’a démontré l’Autorité de la concurrence dans son avis n° 13-A-23 du 16 décembre 2013 concernant un projet de décret relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur1, en grande partie substituables.
Le législateur poursuit l’effort entrepris, avec la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 dite Thévenoud, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur2 et le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes3, en vue de rationaliser l’activité des professionnels du transport. Dans l’objectif d’instaurer « une plus grande cohérence entre les différents régimes et [une] meilleure régulation des centrales »4, la loi du 29 décembre 2016 introduit dans le Code des transports les règles nécessaires à l’encadrement des activités de courtage des centrales de réservation, c’est-à-dire de mise en relation des conducteurs et de leurs passagers5. Le texte comprend également d’autres mesures, plus mineures.
I. Encadrement de l’activité des centrales de réservation
L’article 1er de la loi définit les modes de transport visés par les nouvelles règles de manière aussi large que possible, puisque est visé aussi bien le transport automobile que celui réalisé à moto. Le but est de « prévenir les détournements de la réglementation résultant des pratiques des centrales de réservation de véhicules légers (automobiles, motos), dont l’activité est en très forte progression »6 : le « faux covoiturage », l’utilisation de certains régimes comme le régime LOTI en dehors de leur métier historique, etc. Certains transports sont toutefois exclus du dispositif, soit parce qu’ils sont déjà soumis à des règles propres (transport organisé dans le cadre d’un conventionnement avec un organisme d’assurance sociale, transport public de personnes, etc.), soit parce qu’ils ne relèvent pas du transport à titre onéreux (services organisés par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations pour le transport de leur propre personnel, covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du Code des transports, etc.).
Le législateur précise ensuite la notion de « centrale de réservation ». Celle-ci s’applique aux « professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements », répondant à certaines caractéristiques : ces transports sont réalisés au moyen de véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises maximum et ne relèvent pas de l’un des transports exclus du champ d’application de ce dispositif7.
Quant aux obligations mises en place, elles visent principalement à assurer la protection des utilisateurs, aussi bien la protection des conducteurs que celle des passagers faisant appel à leurs services.
A. Protection des conducteurs
Les dispositions nouvelles visent à empêcher la centrale de réservation de profiter de sa position de force pour contraindre les conducteurs à des pratiques qui leur seraient défavorables.
Ainsi, une centrale ne peut interdire à un chauffeur de taxi « de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n’est pas rendu indisponible par une réservation et qu’il est arrêté ou stationné ou qu’il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement »8. Toute prévision contraire priverait en effet le professionnel du bénéfice du monopole instauré en sa faveur, puisque seuls les taxis sont autorisés à stationner dans l’attente d’un client ou à pratiquer la maraude9.
De même, la loi intègre un nouvel article L. 420-2-2 dans le Code de commerce, prohibant certaines pratiques déloyales des centrales de réservation. En particulier, ces dernières ne peuvent imposer d’exclusivité aux entreprises de transport : celles-ci restent donc libres d’offrir leurs services, simultanément, via plusieurs plate-formes.
B. Protection des passagers
La protection assurée est d’abord indirecte, puisque les centrales de réservation sont astreintes à une obligation de déclaration annuelle à l’Administration10 : le recensement en étant ainsi assuré, l’Administration devrait être en mesure de vérifier le respect des règles constituant le cadre de l’activité de ces plateformes.
La protection découlant de la loi résulte ainsi en des vérifications auxquelles les centrales doivent procéder en vue de garantir la qualité des prestations des conducteurs qu’elles référencent : permis de conduire, justificatif de l’assurance du véhicule utilisé, justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour l’activité pratiquée, ainsi que, le cas échéant, carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée. Dans le cas où le transport est réalisé par une entreprise, c’est sur le respect des conditions d’exercice de la profession que portent les vérifications de la centrale. Si le déplacement est assuré par un VTC, il convient enfin de contrôler que le véhicule répond aux conditions techniques et de confort mentionnées par les dispositions pertinentes du Code des transports11.
Enfin, le législateur édicte un principe de responsabilité « de plein droit » de toute centrale de réservation à l’égard du client s’agissant « de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci »12. Quoiqu’une plate-forme soit juridiquement tierce par rapport au contrat de transport, la volonté du législateur est ainsi de permettre au client d’identifier facilement le responsable13. Notons, d’ailleurs, que toute centrale doit justifier de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle14. Toutefois, une plate-forme peut encore s’exonérer de sa responsabilité en raison d’une faute de la victime, d’un fait imprévisible et insurmontable du tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat (ce qui n’est donc pas le cas du conducteur) ou d’un cas de force majeure. Tel n’est pas le cas du conducteur du véhicule, qui demeure en tout état de cause soumis à la responsabilité issue de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de véhicules terrestres à moteur.
Le législateur assortit enfin certaines de ces nouvelles obligations de sanctions pénales (défaut de déclaration, non-respect de l’interdiction faite à un exploitant ou un conducteur de taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors qu’il est disponible par réservation, mise en relation de passagers et de conducteurs n’étant pas des entreprises de transport public routier de personnes, ni des exploitants de taxis, de VTC ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues, etc.).
II. Mise en place d’un dispositif de transmission de données utiles
Au-delà du cadre qu’il crée pour l’encadrement de l’activité propre aux centrales de réservation, le législateur met en place un dispositif de transmission des données « utiles » (telles que le chiffre d’affaires, le nombre de conducteurs affiliés ou encore le nombre de courses réalisées) pour l’amélioration de la connaissance du secteur. Cette transmission concerne aussi l’application des règles relatives aux prix des prestations en cause ou relatives aux pratiques anticoncurrentielles15.
III. Nouvelles mesures applicables aux conducteurs
Diverses dispositions visent enfin à imposer aux conducteurs des mesures propres à améliorer la sécurité et la qualité du service qu’ils rendent… ou à limiter la concurrence qu’ils exercent vis-à-vis des professionnels déjà installés.
Ainsi, les personnes accomplissant des prestations de transport à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, et ne répondant pas à des régimes particuliers (ex. : transports publics collectifs), se voient imposer l’obligation de répondre à des conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelle (lesquelles ont été définies par le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du Code des transports). Elles doivent également être titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative.
De même, il est désormais interdit de proposer des prestations de transport LOTI (c’est-à-dire relatives au transport d’un groupe de personnes préconstitué) dans des véhicules de moins de 9 sièges pour des trajets entièrement situés dans le périmètre géographique d’un PDU (Plan de déplacements urbains définis pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Cette interdiction vise à combattre une pratique, fréquente, consistant à enregistrer un véhicule comme LOTI, alors qu’il est en réalité destiné au transport particulier. Mais le champ d’application de l’interdiction ainsi édictée préserve la possibilité d’assurer un transport collectif dans les périmètres n’étant pas inclus dans un PDU ou ne l’étant que partiellement (liaison entre un point situé dans un PDU et un autre point n’étant pas couvert par un PDU ou étant couvert par un PDU distinct).
Les taxis se voient, enfin, imposer de permettre à leurs clients de payer leur course dans le véhicule au moyen d’une carte bancaire et ce, quel que soit le prix de cette course16. Cette prévision dissipe le doute créé sur ce point par la loi Thévenoud précitée qui, définissant les taxis comme des véhicules « munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique »17, n’évoquait l’obligation que de manière implicite.
Marie BLANCHARD
5 – Hébergements touristiques
Des précisions sur l’étendue de l’obligation de sécurité de l’hôtelier (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-16560)
Le contrat d’hôtellerie fait naître à la charge de l’hôtelier de multiples obligations, dont une obligation de sécurité qui n’est que de moyens18, puisque ses clients se déplacent librement dans son établissement. Le client qui subit un dommage corporel au cours de son séjour ne peut dès lors engager la responsabilité de l’hôtelier que s’il parvient à établir qu’il a commis une faute19 à l’origine de son dommage, notamment qu’il serait à l’origine d’un défaut d’entretien des locaux ou du matériel présent dans l’hôtel20. Et, conformément au droit commun de la responsabilité civile contractuelle, sa responsabilité est écartée ou atténuée si le client a lui-même commis une faute à l’origine de tout ou partie de son dommage21. Un arrêt rendu le 17 février 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation montre qu’une fois la faute du professionnel établie, la Cour de cassation admet difficilement que ce lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par son client soit remis en cause.
En l’espèce, le système de fermeture de la porte-fenêtre de sa chambre étant défectueux, un client a tenté d’accéder au balcon d’une autre chambre pour regagner la sienne. Il fait alors une chute mortelle. Sa veuve, agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, assigne l’hôtelier et son assureur en réparation de leur préjudice.
Les juges du fond font partiellement droit à leur demande, décidant que l’hôtelier et la victime ont commis chacun une faute ayant concouru, pour moitié, aux préjudices subis. En effet, le client s’était trouvé dans l’impossibilité de regagner sa chambre en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre, à laquelle l’hôtelier n’avait pas remédié, alors qu’il en connaissait l’existence. Or, s’il l’avait fait, aucune chute n’aurait été à déplorer. Mais, dans le même temps, le client avait lui-même commis une faute, puisqu’il avait choisi, en l’absence de toute urgence et alors qu’existaient plusieurs solutions alternatives, d’entreprendre une manœuvre particulièrement périlleuse au regard de la configuration des lieux.
Les proches du client décédé forment alors un pourvoi en cassation, contestant le partage de responsabilité, tandis que l’hôtelier forme un pourvoi incident par lequel il conteste le lien de causalité entre sa faute et le dommage subi par son client : selon lui, la faute de la victime était à l’origine directe de sa chute mortelle et constituait, dès lors, la cause exclusive des dommages subis par les ayants-droit, victimes par ricochet.
Le pourvoi de l’hôtelier est rejeté : la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir décidé qu’il existait un lien de causalité direct entre la défectuosité imputable à l’hôtelier et les dommages subis par son client, puisque, si le client ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de regagner sa chambre en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre, à laquelle l’hôtelier n’avait pas remédié, alors qu’il en connaissait l’existence, aucune chute n’aurait été à déplorer.
Par contre, celui des proches de son client est accueilli, la Cour de cassation censurant l’arrêt d’appel : après avoir visé l’ancien article 1147, devenu le nouvel article 1231-1 du Code civil, elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si l’hôtelier « n’avait pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité, non seulement en ne réparant pas ou en ne remplaçant pas le système de fermeture défectueux, mais aussi en omettant d’avertir [son client] des difficultés qu’il était susceptible de rencontrer lors de l’utilisation de la porte-fenêtre, de sorte que, dûment informé, il n’aurait pas fermé celle-ci et ne se serait pas trouvé dans l’impossibilité de regagner sa chambre, l’hôtelier étant, dès lors, susceptible d’être tenu à réparation intégrale ».
Ainsi, la faute de l’hôtelier étant à l’origine de la situation qui a conduit le client à commettre la sienne, la Cour de cassation nie tout lien de causalité entre cette deuxième faute et la chute mortelle, et décide que cette chute est entièrement imputable au professionnel.
Cela ne veut bien entendu pas dire que la faute de la victime n’a plus vocation à être prise en compte en présence d’une faute de l’hôtelier. Mais la décision montre que la Cour de cassation peut faire preuve de sévérité vis-à-vis de l’hôtelier qui a manqué à son obligation de sécurité. Certes, son obligation n’est que de moyens, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que si une faute de négligence peut être mise à sa charge. Mais, une fois cette faute établie, le lien de causalité pourra être difficile à remettre en cause.
Sophie MOREIL
Pas de droit de communication au public dans les chambres d’hôtel (CJUE, 16 févr. 2017, n° C-641/15, Verwertungsgeselleschaft Rundfunk GmbH c/ Hetteger Hotel Edelweiss GmbH)
Dans l’espèce présentée à l’examen de la Cour de justice de l’Union européenne, une société autrichienne de gestion collective des droits d’auteur réclamait que la diffusion d’émissions télévisées et radiophoniques dans des chambres d’hôtel soit subordonnée à l’autorisation du producteur, en vertu du droit exclusif des organismes de radiodiffusion prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la directive n° 2006/11522. Elle estimait qu’une telle diffusion réalise un « acte de communication au public » dans le cadre duquel le prix des chambres doit être vu comme un « droit d’entrée » au sens du droit national et de l’article 8, § 3, de la directive n° 2006/115/CE.
Saisie à titre préjudiciel, la CJUE refuse pourtant de faire sienne cette analyse.
Elle ne conteste pas que la diffusion d’émissions par le biais des téléviseurs équipant les chambres d’hôtels constitue bien un acte de communication au public, comme elle l’avait d’ailleurs déjà indiqué dans des arrêts antérieurs23. Toutefois, rappelant que les règles applicables aux organismes de radiodiffusion ne soumettent à l’autorisation du titulaire de droits que la communication réalisée « moyennant paiement d’un droit d’entrée », elle estime que c’est sur ce point que doit se focaliser son attention.
C’est sur la base de la convention de Rome du 26 octobre 196124 qu’il convient d’interpréter la notion de « paiement d’un droit d’entrée », bien que ce texte n’appartienne pas à l’ordre juridique de l’Union européenne. Visant à rapprocher les droits des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion dans les États membres, les dispositions de la directive n° 2006/115/CE doivent en effet être interprétées « de telle manière qu’elles demeurent compatibles avec les notions équivalentes contenues dans ladite convention, en tenant compte également du contexte dans lequel ces notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes, conformément à ce que prévoit le considérant 7 de cette directive »25.
Or, la Cour rappelle que la notion de « paiement d’un droit d’entrée », évoquée à l’article 13, d), de ladite convention, est éclairée par les points 13.5 et 13.6 du guide de la convention de Rome et de la convention Phonogrammes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en ces termes : il s’agit d’un paiement « spécialement demandé en contrepartie d’une communication au public d’une émission télévisée et (…), ainsi, le fait de payer un repas ou des boissons dans un restaurant ou dans un bar où sont diffusées des émissions télévisées n’est pas considéré comme un paiement d’un droit d’entrée au sens de cette disposition »26.
Établissant une analogie avec le prix d’un service de restauration, la Cour conclut que le prix d’une chambre d’hôtel « n’est pas (…) un droit d’entrée spécialement demandé en contrepartie d’une communication au public d’une émission télévisée ou radiophonique ». Il n’est que la contrepartie d’un service d’hébergement, « (…) auquel s’ajoutent, selon la catégorie de l’hôtel, certains services supplémentaires, tels que la communication d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen des appareils de réception équipant les chambres, qui sont normalement indistinctement compris dans le prix de la nuitée »27.
C’est pourquoi la communication au public d’émissions télévisées et radiophoniques au moyen d’appareils de télévision (ou de radio) installés dans des chambres d’hôtel, n’entrant pas dans le champ du droit exclusif des organismes de radiodiffusion, ne justifie pas d’adresser à ceux-ci une demande d’autorisation de diffusion ou le paiement de redevances.
Reste que l’arrêt rendu par la Cour contredit la jurisprudence de la Cour de cassation rendue, sur la même question, il y a plusieurs années déjà28.
Marie BLANCHARD
6 – Tourisme collaboratif
Vers un renforcement de la taxation de l’économie collaborative ? (L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, financement de la Sécurité sociale pour 2017)
L’économie du partage, déjà bien ancrée dans les habitudes des consommateurs, semble avoir un avenir très prometteur, à la fois dans les secteurs déjà concernés et en s’étendant également à de nouveaux domaines29. Ce développement ne peut pas continuer à se faire en dehors d’un cadre clairement défini.
Contrairement à ce que pensent de nombreux contribuables, les revenus issus de l’économie collaborative ne sont pas exonérés d’impôt et des règles juridiques et fiscales existent. Ainsi, les actes de commerce30 comme les actes de location de meubles ou de revente sur internet sont imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les autres sommes, issues d’opérations lucratives qui ne sont pas rattachables à une autre catégorie de revenus, sont imposées au titre des bénéfices non commerciaux31. En matière de TVA, toute prestation de services32 est taxable dès lors qu’elle est réalisée par un assujetti et qu’elle n’est pas exonérée. L’application ou non de la TVA suppose que l’utilisateur de la plate-forme agisse en tant qu’assujetti (cela suppose la réalisation répétée de prestations de services). Il faut souligner que la condition d’habitude33, requise pour que l’activité soit caractérisée comme commerciale et donc imposable, n’est pas nécessairement liée à la répétition fréquente des mêmes opérations. En effet, la fréquence a une incidence certaine mais la périodicité établit également la limite entre le professionnel et le particulier.
Une enquête34 affirmait que seules 15 % des personnes interrogées déclaraient ou avaient l’intention de déclarer leurs revenus issus de l’économie collaborative. Les acteurs de l’économie collaborative se perdent rapidement dans un flou juridique et fiscal, notamment à cause de la distinction difficile entre particuliers et professionnels ou encore des nombreuses sources de revenus. En pratique : « l’absence de déclaration et de paiement de l’impôt est la norme et non pas l’exception »35.
La loi de finances36 2016 oblige les plates-formes collaboratives à envoyer un récapitulatif des revenus bruts générés à leurs utilisateurs et à les informer de leurs obligations en matière fiscale. Une amende de 10 000 € en cas de non-respect de ces exigences a été ajoutée. Toutefois, le contrôle est inadapté et ne permet pas de cerner les revenus liés aux plates-formes. De nombreux contribuables perçoivent de faibles montants de l’économie collaborative. Le droit de communication37 reconnu à l’administration fiscale qui lui permet d’obtenir les informations comme l’identité et les revenus des utilisateurs des plates-formes peut être utilisé dans le cadre de l’assistance technique internationale, dans les limites et selon les modalités prévues par les conventions entre États mais demeure long et lourd à mettre en place.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale38 pour l’année 2017 a été adopté le 5 décembre 2016. Les débats sur la fiscalisation des revenus de l’économie collaborative ont été houleux entre les députés et le gouvernement. Ce texte définit un seuil unique de recettes annuelles de 23 000 € en 2017 au-delà duquel une activité de location de bien meublé de courte durée est considérée comme une activité professionnelle. Pour les locations de biens meubles comme les voitures ou les bateaux, la limite39 est arrêtée à 7 720 €. Au-delà de ces valeurs, les particuliers doivent obligatoirement s’affilier au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles40. Les particuliers dégageant d’importants revenus des plates-formes vont donc payer des cotisations sociales.
Le jeudi 22 décembre 2016, dans le cadre du budget rectificatif 2016, les parlementaires ont contraint les plates-formes en ligne du type Airbnb à une déclaration automatique au Fisc des revenus de leurs utilisateurs à compter de 2019. Le système reposera donc jusque-là sur les seules déclarations des usagers. Toutefois depuis le 1er juillet 2016, les plates-formes de l’économie collaborative sont obligées d’envoyer à leurs utilisateurs un récapitulatif annuel41 de leurs revenus, afin que ces derniers puissent avoir une idée précise de ce qu’ils doivent déclarer.
En pratique et pour l’instant, les revenus sont très rarement déclarés, très rarement contrôlés, et in fine très rarement imposés. Il en résulte une perte de recettes pour l’État, une insécurité juridique pour le contribuable, et une concurrence déloyale pour certains secteurs.
Thierry RIGAUX
Uber : nouvelle péripétie judiciaire sous l’angle des pratiques commerciales trompeuses (Cass. crim., 31 janv. 2017, n° 15-87770 (F-D))
Nouvel épisode dans les démêlés judiciaires de la compagnie américaine en France. On se souvient qu’Uber prétendait mettre en relation des particuliers, via l’usage de smartphones, pour des services de « covoiturage » payant. Transportant dans leur véhicule personnel d’autres particuliers pour un tarif inférieur à celui des taxis et des VTC (voitures de transport avec chauffeur), les « chauffeurs Uber » exerçaient donc cette activité à titre onéreux tout en s’affranchissant des contraintes de la professionnalisation.
C’est cette rupture dans l’égalité des conditions de concurrence que le législateur a entrepris de combattre avec la loi n° 2015-992 du 17 août 201542 définissant le covoiturage comme « le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte »43, ou avec la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur44 créant une infraction pénale relative à la mise en relation des clients avec des particuliers qui effectuent des transports routiers « à titre onéreux » jugée conforme à la Constitution45.
Mais l’effort législatif n’ayant pas encore abouti, à l’époque où les pratiques contestées dans l’arrêt ici commenté ont pris place, certains des professionnels affectés par l’activité des chauffeurs Uberpop ont introduit une action à l’encontre d’Uber. La plate-forme mettait en effet en relation les particuliers intéressés, le transport étant effectué dans le véhicule personnel du conducteur moyennant une contrepartie financière. L’action se fondait sur les règles relatives aux pratiques commerciales trompeuse46.
Condamné en première instance47, Uber a été déclaré « coupable de pratiques commerciales trompeuses par personne morale, caractérisées par des communications commerciales incitant les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer au service Uberpop, en donnant l’impression que ce service est licite alors qu’il ne l’est pas ». Les premiers juges ont en effet contesté la qualification de « covoiturage » donnée par Uber à son service Uberpop. Confirmant l’essentiel du jugement du TGI, la cour d’appel de Paris48 avait relevé que le covoiturage « ne correspond pas au service Uberpop tel qu’il est initialement présenté par la société Uber France dans les allégations publicitaires figurant sur son site internet et dans ses courriels, à savoir la possibilité pour un particulier par ce biais de transporter des individus et de se faire rémunérer au titre du covoiturage onéreux ».
C’est à propos de cet arrêt d’appel qu’a été formé un pourvoi, finalement rejeté par la Cour de cassation dans l’arrêt ici relaté.
La Cour de cassation fait sienne l’interprétation des juges du fond. La chambre criminelle relève en effet que le service rendu par les chauffeurs d’Uber, encadré par les textes, est subordonné à une autorisation administrative. À défaut, l’exercice de l’activité considérée doit être considéré comme illégal. S’inspirant de la définition légale du covoiturage récemment posée à l’article 3132-1 du Code des transports, pourtant inapplicable à l’époque où les faits se sont déroulés, la Cour retient encore que cette qualification ne saurait s’appliquer à l’activité des chauffeurs d’Uberpop car ceux-ci poursuivent en réalité un but lucratif : le paiement sollicité du passager excède en effet les seuls frais induits par l’utilisation du véhicule. De même, la Cour rappelle que le covoiturage ne s’entend que du transport effectué à l’occasion d’un déplacement réalisé par le conducteur pour son propre compte. Or, relevant qu’un conducteur d’Uberpop acceptait de transporter son passager vers une destination « qui n’était pas nécessairement la sienne », la haute juridiction en conclut logiquement que cet élément fait, là encore, défaut.
L’activité ainsi décrite ne pouvant être constitutive de covoiturage, elle aurait par conséquent dû se dérouler dans l’un des cadres autorisés par la loi : celui de taxi ou celui de VTC. N’ayant pas respecté la réglementation applicable, l’activité en cause était illicite.
C’est pourquoi les juges du fond ont pu, sans méconnaître le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, considérer qu’était constitué le délit de pratiques commerciales trompeuses : les utilisateurs des services en cause ont en effet été incités à y recourir au moyen de communications commerciales donnant l’impression d’un service licite, ce qu’il n’était pas.
Marie BLANCHARD
7 – Responsabilités et assurances
La protection des passagers de vols annulés ou retardés devant la Cour de cassation
(Cass. 1re civ., 15 juin 2016, nos 15-16356, 15-16357, 15-16358 et 15-1635949 ; Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-2159050 et Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-2038051 ; Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 15-1273052). Les droits des victimes de retard ou d’annulation de vol consacrés par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 200453 sont au cœur d’un contentieux particulièrement vivant. Devant les juridictions nationales, ce contentieux se concentre pour l’essentiel sur les conditions de fond de la protection offerte aux passagers victimes (I). Le versant probatoire de ce contentieux n’est néanmoins pas ignoré (II).
I. Les conditions de fond
Devant la Cour de cassation, la vitalité du contentieux relatif aux droits des victimes de retard ou d’annulation de vol souligne la place primordiale de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et, de manière sous-jacente, la nécessité d’une réforme. Ces deux aspects sont perceptibles, tant du point de vue des conditions dont la conception est acquise en jurisprudence (A), que du point de vue de celles que la jurisprudence continue à préciser (B).
A. Les conditions acquises en jurisprudence
Les quatre arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 juin 2016 soulignent indéniablement les liens existant entre les solutions nationales et les solutions européennes et, plus particulièrement, la portée de la seconde sur la première. À l’origine de ces quatre affaires, un vol subissant un retard de plus de 3 heures à l’arrivée. Dans chacune de ces affaires, la demande d’indemnisation formulée par la victime se heurte à un refus catégorique des juridictions de première instance, refus fondé sur une lecture littérale des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE). Sans grande surprise, la première chambre civile de la Cour de cassation censure les quatre jugements. La formulation retenue est identique. La censure est prononcée au visa des articles 6 et 7 du règlement (CE) complété de la référence aux deux arrêts qui ont fixé l’interprétation européenne pertinente en la matière. La Cour de cassation fait ainsi successivement référence aux arrêts Sturgeon54 et Nelson55. Ces arrêts s’imposent aux juges nationaux – précise la Cour de cassation – et prévoient que « les textes susvisés doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à 3 heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale 3 heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Signe, s’il en est, de la constance et de la clarté des solutions, la Cour de cassation refuse également de saisir la CJUE d’une question préjudicielle, raison prise de ce que les dispositions des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) ont déjà fait l’objet d’une interprétation de sa part56.
B. Les conditions précisées par la jurisprudence
À l’origine, le contentieux généré par la protection offerte aux victimes de retard ou annulation de vol a permis de préciser, si ce n’est définir, les notions cardinales du règlement (CE), que l’on pense aux notions d’annulation de vol ou de retard de vol. À côté de ce contentieux désormais connu des juridictions tant nationales qu’européenne, semble s’en développer un autre dont la singularité résiderait dans la stratégie des litigants. Si les droits octroyés aux victimes en demeurent l’enjeu, la démarche adoptée consiste moins à « s’attaquer » aux notions de retard ou d’annulation de vol qu’aux autres conditions d’octroi d’une indemnisation. L’arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la première chambre de la Cour de cassation en fournit une illustration topique en matière de vol avec correspondance. L’affaire concerne deux voyageurs munis d’un billet d’avion pour le vol Paris-Kuala Lumpur, via Dubaï. Au départ de Paris, les deux voyageurs sont victimes d’un retard de vol de plus de 2 heures par rapport à l’horaire initialement prévu. La compagnie aérienne fait valoir que le retard au décollage est dû à des défaillances techniques affectant les freins de l’appareil. Les péripéties des voyageurs auraient pu s’arrêter là. Mais les difficultés s’enchaînent. Le retard au départ de Paris empêchant les voyageurs de prendre leur vol de correspondance, ces derniers embarquent le lendemain de la date prévue sur un autre vol et arrivent à Kuala Lumpur avec un retard d’environ 10 heures par rapport à l’horaire initialement prévu. Échaudées, les victimes saisissent la juridiction de proximité de Paris d’une demande d’indemnisation dirigée contre la compagnie aérienne. La demande est fondée sur l’article 7 du règlement (CE), lequel article organise le droit à indemnisation des victimes d’annulation de vol.
Dans un jugement rendu le 12 juin 2015, la juridiction de proximité de Paris accueille les demandes formulées par les victimes et condamne la compagnie aérienne à verser notamment une indemnité d’un montant de 600 € à chacune des victimes.
La réaction de la compagnie aérienne ne se fait pas attendre. L’affaire est portée devant la Cour de cassation. Au soutien du pourvoi sont invoqués deux arguments principaux : l’inapplicabilité du règlement (CE) au vol de correspondance reliant deux États tiers et la caractérisation des circonstances extraordinaires. Par l’arrêt rendu le 30 novembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Cet arrêt est l’occasion d’une précision et d’un rappel.
La précision concerne la détermination du champ d’application du règlement (CE) en présence d’un vol avec correspondance. Plus spécifiquement, il s’agit de déterminer si l’article 3 du règlement (CE) doit s’appliquer au trajet dans sa globalité ou s’il s’applique à chaque vol qui compose le trajet. La difficulté n’est pas anodine pour les victimes. En effet selon la solution retenue, la protection qui leur est accordée pourrait se trouver réduite, raison prise de l’inapplicabilité du règlement (CE) au vol litigieux. Ce faisant, ce qui a été octroyé quelques années auparavant par les arrêts Sturgeon et Nelson57, pourrait être repris à la faveur d’une lecture stricte de ce texte. C’est à tout le moins ce que laisse entrevoir l’un des arguments développés dans le pourvoi. Était en effet soutenu qu’en application de l’article 3 du règlement (CE), ce texte « ne pouvait s’appliquer qu’aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité ainsi qu’aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, lorsque le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ». Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que seul le vol de correspondance reliant Dubaï à Kuala Lumpur est pris en compte. Ce vol relie un pays tiers (Dubaï) à un autre pays tiers (la Malaisie), le transporteur aérien effectif n’étant de surcroît pas un transporteur communautaire. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette l’argument, privilégiant le maintien d’un niveau élevé de protection des passagers victimes. Elle approuve le jugement critiqué en ce qu’il reconnaît aux victimes un droit à indemnisation dès lors qu’est établi un retard de vol à l’arrivée à destination finale de plus de 3 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue. La solution est fondée sur l’interprétation constructive – mais désormais acquise – retenue par la CJUE. Est plus particulièrement « convoqué » l’arrêt Folkerts58 en ce qu’il reconnaît aux passagers d’un vol avec correspondance un droit à indemnisation lorsque le retard à destination finale est égal ou supérieur à 3 heures par rapport à l’horaire d’arrivée initialement prévu59 et ce, indépendamment du déroulement des vols de correspondance. Et la Cour de cassation de confirmer qu’il se déduit de cette solution que le règlement (CE) est applicable « peu important que le vol en cause (…) ait été au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d’un autre pays tiers et réalisé par un transporteur aérien effectif non communautaire ». La Cour de cassation confirme la réception en droit interne d’une approche « globale »60 du trajet. Le trajet à prendre en compte pour se prononcer sur l’applicabilité du règlement (CE) est celui qui est au départ de l’aéroport de Paris et à destination – finale – de l’aéroport de Kuala Lumpur. Les différents vols qui composent le trajet aller sont indifférents.
Cet arrêt est également l’occasion d’un rappel en matière de circonstances extraordinaires61. L’argument n’a a priori rien de très étonnant. En revanche, l’interprétation classiquement stricte de la notion de circonstances extraordinaires62 réduit de manière sensible les occurrences de cette cause exonératoire notamment lorsque sont en cause des problèmes techniques. Il reste qu’en l’espèce, la discussion ne porte pas sur la notion même de circonstances extraordinaires, mais sur la motivation des juges parisiens. Il leur est en effet reproché, après avoir rappelé les éléments de caractérisation de cette cause exonératoire, de s’être arrêtés au seul constat que « tel n’est pas le cas en l’espèce ». Devant la Cour de cassation, ce débat « tourne court ». Le jugement est en effet approuvé. L’exclusion de la qualification de circonstances extraordinaires résulte, selon la Cour de cassation, d’une « décision motivée ». Un élément d’explication peut résider dans le sens de la solution. Il s’agissait pour les juges du fond d’exclure la qualification de circonstances extraordinaires et non de la retenir. Sur le fond, la Cour de cassation rappelle les solutions acquises. Conformément à une jurisprudence désormais constante, les problèmes techniques entraînant des retards de vol confinant à l’annulation de vol ne constituent des circonstances extraordinaires que dans la mesure où ils découlent d’événements qui, par leur nature ou leur origine, n’étaient pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné63.
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 octobre 2016 témoigne également d’une certaine évolution du contentieux. Il souligne en effet le caractère déterminant des caractéristiques du trajet, source du droit à indemnisation. Sont plus directement visées la nature intracommunautaire du vol litigieux et son incidence sur le montant de la réparation octroyée. Étaient en cause, des billets achetés auprès de la compagnie Corsair pour un vol Paris Orly-Saint-Denis de la Réunion. Le vol au départ de Paris Orly est annulé. Son remplacement est alors organisé sur un vol assuré le lendemain. Les voyageurs parviennent finalement à destination de Saint-Denis de la Réunion. Les passagers victimes assignent néanmoins la compagnie aérienne en paiement d’indemnités en raison de l’annulation du vol de départ, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE). Selon les dispositions de cet article, le droit à indemnisation apparaît comme étant fonction de deux critères combinés. Le montant forfaitaire de l’indemnisation est déterminé en fonction de la distance et de la nature intracommunautaire (ou non) du vol. La combinaison de ces deux critères permet de dégager quatre catégories de vol :
-
les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
-
les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres ;
-
les autres vols de 1500 à 3 500 kilomètres ;
-
tous les vols qui ne relèvent pas des catégories précédentes, comme par exemple les vols non intracommunautaires de plus de 3500 kilomètres.
Appréhendé sous l’angle du montant du droit à indemnisation, le nombre de catégories est réduit à trois, les deuxième et troisième catégories susvisées donnant droit à une indemnité identique. Sont ainsi successivement prévues les indemnités forfaitaires de 250 €, de 400 € et de 600 €. Dans un arrêt rendu le 26 mai 2015, le tribunal de proximité de Villejuif condamne la compagnie aérienne au paiement d’une indemnité d’un montant de 600 € par passager. Pour ce faire, les juges de première instance retiennent d’abord que « le renforcement des droits des passagers exclut de qualifier d’intracommunautaires les vols reliant la métropole aux départements d’outre-mer ». Ce faisant, la nature intracommunautaire du vol est placée dans la dépendance des objectifs assignés au règlement (CE). Si l’argument a pu être diversement apprécié64, il n’en rappelle pas moins la démarche adoptée par la CJUE65. Une fois la qualification de vol intracommunautaire exclue, les juges du fond ont déterminé le montant de l’indemnité octroyée aux victimes en appliquant strictement les dispositions de l’article 7 du règlement (CE). En l’espèce, le vol non intracommunautaire annulé couvrait une distance supérieure à 3 500 kilomètres. Fort logiquement, le vol litigieux est rattaché à la catégorie des « (…) autres vols qui ne relèvent pas des catégories précédentes », laquelle catégorie fonde l’octroi d’une indemnité de 600 €.
L’affaire est portée devant la Cour de cassation, laquelle censure le jugement critiqué. Deux points sont successivement discutés l’un étant la conséquence de l’autre : la nature intracommunautaire ou non du vol litigieux et le montant de l’indemnisation.
S’agissant de la nature du vol litigieux, la Cour de cassation retient le caractère intracommunautaire du vol litigieux – soit le vol reliant Paris à Saint-Denis. La qualification a pour particularité d’être déduite non pas des dispositions du règlement (CE), mais de celles des traités fondateurs. La Cour de cassation censure en effet le jugement au visa des articles 52 du traité de l’Union européenne et 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ensemble les articles 5, paragraphe 1, sous c) et 7, paragraphe 1, du règlement (CE). La première chambre civile de la Cour de cassation ajoute « qu’il résulte des deux premiers textes que les dispositions des traités susvisés sont applicables à la Réunion ». Ce faisant, est qualifié d’intracommunautaire, le vol entre aéroports situés sur le territoire d’États membre de l’Union européenne66, comme l’est par exemple le vol reliant Paris à Saint-Denis de la Réunion. À tout le moins, l’est-il « au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b (…) » du règlement (CE), précise la Cour de cassation. L’expression peut susciter quelques interrogations. Elle semble en effet suggérer qu’un vol pourrait être intracommunautaire selon les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) et non selon les dispositions d’autres articles de ce même texte.
Cette solution est significative à plusieurs égards. Le recours aux traités fondateurs souligne en creux l’absence de définition de la notion de « vol intracommunautaire » dans le règlement (CE). Ce constat est sans doute étrange lorsque l’on sait qu’un article 2 est spécifiquement dédié aux définitions et que les dispositions de ce texte se réfèrent – en lui faisant produire un effet juridique – à la notion de vol intracommunautaire. Cette solution suggère également la volonté de la Cour de cassation d’ancrer la notion de vol intracommunautaire dans d’autres textes que le règlement (CE) – à l’heure où sa réforme est envisagée. Comme cela a pu être souligné, des éléments de réponse pouvaient être déduits des termes de certaines dispositions de l’article 10 du règlement (CE)67.
Enfin, conséquence étonnante en ces lieux, la requalification du vol litigieux en vol intracommunautaire a eu pour conséquence la réduction du droit à indemnité des victimes. Devenu intracommunautaire, le vol litigieux relève de la deuxième catégorie de vols visée à l’article 7 du règlement (CE), catégorie à laquelle correspond une indemnité forfaitaire de 400 €. La qualification de vol intracommunautaire n’est donc pas indolore. Ce faisant, elle risque fort de devenir une nouvelle variable dans les contentieux relatifs à l’indemnisation des victimes de retard et d’annulation de vol. De manière sous-jacente cette solution interroge la légitimité des critères utilisés pour fixer les indemnités forfaitaires68. Comme cela a pu être souligné à plusieurs reprises, toute respectueuse de la lettre de l’article 7 du règlement (CE) qu’elle est, la solution retenue justifie des différences de traitement entre les victimes69 difficilement compatibles avec l’objectif poursuivi par ce texte.
II. Les conditions de preuve précisées
Le contentieux classique de la protection des passagers victimes d’annulation de vol est également un contentieux probatoire comme en témoigne l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2016. Dans cette affaire, le passager d’un vol aller-retour Paris-Barcelone a saisi la juridiction de proximité d’Ivry-sur-Seine d’une demande en indemnisation notamment fondée sur les dispositions du règlement (CE). Au soutien de cette demande, le passager invoque l’annulation de vol dont il a été victime. Par un jugement rendu le 28 novembre 2014, la juridiction de proximité rejette sa demande. Si le passager avait produit les billets d’avion pour le vol mentionné dans l’acte d’assignation, il n’établissait pas le retard ou l’annulation du vol en question (n° 8057 du 4 août 2012). Or, selon les juges de première instance, la charge de la preuve lui incombait. L’affaire est portée devant la Cour de cassation, laquelle censure le jugement de première instance. La censure est ferme puisqu’elle est prononcée au visa de l’ancien article 1315 du Code civil70, article selon lequel : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La première chambre civile de la Cour de cassation retient en sus que le tribunal de proximité a inversé la charge de la preuve. Il revenait à la société en cause de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation de transport (donc, de sa libération), le passager ayant pour sa part à rapporter la preuve qu’elle en était débitrice. Retenir cela revient en quelque sorte à considérer que le passager qui se prétend victime d’une annulation de vol bénéficie d’une présomption de droit à indemnisation dès lors que la créance de transport est établie. Cette présomption cèderait devant la preuve de la bonne exécution de la prestation.
D’un point de vue pratique, la solution peut s’avérer particulièrement utile pour les voyageurs. D’abord car ces derniers disposent de moyens et de techniques moins nombreux, moins sophistiqués et moins fiables que ceux dont disposent les compagnies aériennes pour établir l’annulation d’un vol. Ensuite car l’accès au droit à indemnisation en cas d’annulation de vol pourrait s’en trouver facilité, le doute profitant au voyageur. Il reste en revanche à préciser l’étendue de la solution et notamment, si elle s’applique – par voie d’assimilation – aux retards de vol égaux ou supérieurs à 3 heures à l’arrivée.
Valérie DURAND
(À suivre)
8 – Tourisme médical et tourisme procréatif
B – Aménagement des espaces à vocation touristique
1 – Tourisme durable
2 – Tourisme et patrimoine
Notes de bas de pages
-
1.
V. commentaire dans la chronique de droit du tourisme n° 6 : LPA 22 juill. 2014, p. 5.
-
2.
JO, 2 oct. 2014.
-
3.
JO, 31 déc. 2014.
-
4.
V. exposé des motifs de la proposition de loi présentée à l’Assemblée nationale le 21 juin 2016.
-
5.
C. transp., art. L. 3141-1 et s.
-
6.
Ibid.
-
7.
C. transp., art. L. 3141-1.
-
8.
C. transp., art. L. 3142-5.
-
9.
C. transp., art. L. 3121-1 et s.
-
10.
C. transp., art. L. 3142-2.
-
11.
C. transp., art. L. 3141-2, I, II et III.
-
12.
C. transp., art. L. 3142-3.
-
13.
V. not. Delebecque P., « Du nouveau pour les taxis, les VTC et leurs clients : un statut pour les centrales de réservation », D. 2017, p. 314, spéc. n° 8 s. ; Lachièze C., « Transport routier de personnes : un cadre juridique pour les centrales de réservation », Contrats, conc. consom. 2017, comm. 3, p. 41.
-
14.
C. transp., art. L. 3142-4.
-
15.
C. transp., art. L. 3120-6.
-
16.
C. transp., art. L. 3121-11-2.
-
17.
C. transp., art. L. 3121-1.
-
18.
Cass. 1re civ., 7 févr. 1961 : Bull. civ. I, n° 85 – Cass. 1re civ., 15 juill. 1964 : Bull. civ. I, n° 384 – Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 01-10309 : Bull. civ. I, n° 76 ; Resp. civ. et assur. 2005, comm. 132. V. aussi, Cass. 1re civ., 25 nov. 1969 : Bull. civ. I, n° 362 – Cass. 1re civ., 22 mai 1973, n° 71-14278 : Bull. civ. I, n° 174.
-
19.
V. not. Cass. 1re civ., 15 juill. 1964 : Bull. civ. I, n° 384 – Cass. 1re civ., 25 nov. 1969 : Bull. civ. I, n° 362 – Cass. 1re civ., 22 mai 1973, n° 71-14278 : Bull. civ. I, n° 174 – Cass. 1re civ., 22 mai 1991, n° 89-21791 : Bull. civ. I, n° 163.
-
20.
V. not., Cass. 1re civ., 15 juill. 1964, préc.
-
21.
Malaurie P., Aynès L., Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 8e éd., 2016, LGDJ, Defrénois, n° 958.
-
22.
Dir. n° 2006/115/CE du PE et du Cons., 12 déc. 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle : JOUE n° L 376, 27 déc. 2006, p. 28.
-
23.
Sur un arrêt rendu dans le cadre de la directive n° 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JOCE L 167, 22 juin 2001, p. 10 : CJCE, 7 déc. 2006, n° C-306/05, SGAE, pts 47 et 54 ; de la directive n° 2006/115, v. CJUE, 15 mars 2012, n° C-162/10, Phonographic Performance (Ireland), pt 47.
-
24.
Convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.
-
25.
Pt 21.
-
26.
Pt 23.
-
27.
Pt 24.
-
28.
Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-16022.
-
29.
Observatoire de l’ubérisation – http://www.uberisation.org/fr/content/blog/infographie-lub %C3 %A9risation-en-15-secteurs.
-
30.
C. com., art. L110-1.
-
31.
CGI, art. 92.
-
32.
Bulletin officiel des Finances publiques – Impôts, BOI-TVA-BASE-20-20-20141016.
-
33.
BIC – Champ d’application et territorialité – Revenus imposables par nature – Conditions d’exercice des professions commerciales, industrielles et artisanales BOI-BIC-CHAMP-10-20-20120912.
-
34.
Étude Nomadéis TNS SOFRES réalisée en 2014-2015 sur le développement de la consommation collaborative en France (étude commanditée par la Direction générale des entreprises en partenariat avec le PICOM – Pôle de compétitivité des industries du commerce).
-
35.
Rapport du Sénat « économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace » – https://www.senat.fr/rap/r14-690/r14-690.html.
-
36.
L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 de finances pour 2016.
-
37.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2130-PGP.html – BOI-CF-COM-10-20120912.
-
38.
Assemblée nationale : session ordinaire du 5 décembre 2016 projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 – texte adopté n° 851.
-
39.
https://www.senat.fr/enseance/2016-2017/106/Amdt_57.html.
-
40.
CSS, art. L613-1.
-
41.
Assemblée nationale : séance ordinaire 2015-2016, seconde séance de travail du 11 décembre article 37 bis, amendement n° 334 sous la présidence de madame Laurence Dumont.
-
42.
L. n° 2015-992, 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte : JO 18 août 2015.
-
43.
C. transp., art. L. 3132-1, modif. L.
-
44.
JO 2 oct. 2014.
-
45.
V. à ce sujet Cons. const., 22 sept. 2015, n° 2015-484 QPC, commentée dans la chronique de droit du tourisme n° 8 : LPA 6 oct. 2016, n° 120x4, p. 6. V. égal. Gency-Tandonnet D., « L’habillage juridique de solutions discriminatoires contre les VTC et l’avenir du modèle d’Uber », D. 2015, p. 2134 ; Lecourt A., « L’économie collaborative saisie par le droit de la consommation et le droit de la concurrence », RLDA, n° 117, p. 34 ; Broussole D., « Uber, taxis et covoiturage : fin de la saga ? », JCP G 2015, 2032.
-
46.
C. com., art. L. 121-1 et s.
-
47.
TGI Paris, ch. corr., 16 oct. 2014, PI4084000776.
-
48.
CA Paris, 4-10, 7 déc. 2015, n° 14/08876. Sur cet arrêt, v. not. Wilhelm P. et Dumur E., « Les pratiques commerciales trompeuses. Le cas Uberpop », JCP E 2016, 1074.
-
49.
Cass. 1re civ., 15 juin 2016, nos 15-16356, 15-16357, 15-16358 et 15-16359 : Gaz. Pal. 30 août 2016, n° 272h7, p. 16 et s., note Degert-Ribeiro C.
-
50.
Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-21590, PB : JCP G 2017, 84 obs. Heymann J. ; Contrats conc. consom. 2017, comm. 45, Bernheim-Desvaux S. ; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 53, Bloch L. ; D. 2916, p. 2461.
-
51.
Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-20380, PB : JCP G 2016, 1280, Heymann J. ; JCP G 2016, 1138 ; D. 2016, p. 2117 obs. Douville T; Dalloz actualité, 27 oct. 2016, obs. Delpech X. ; Resp. civ. et assur. 2017, comm. 21 ; Contrats conc. consom. 2016, comm. 270, obs. Bernheim-Desvaux S. ; JCP E 2017, p. 1080, note Siguoirt L. ; Dupont G. et Poissonnier P., « L’indemnisation des passagers d’un vol vers l’Outre-mer annulé », Gaz. Pal. 29 nov. 2016, n° 281r1, p. 15 et s.
-
52.
Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 15-12730 : RTD com. 2016, p. 326, Bouloc B. ; Contrats conc. consom. 2016, comm. 88, note Leveneur L. ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 131.
-
53.
Règlement établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91. Par la suite, indiqué sous les termes de règlement (CE).
-
54.
CJUE, 19 nov. 2009, nos C-402/07 et C-432/07, Sturgeon : D. 2010, p. 1461, note Poissonnier G. et Osseland I. ; D. 2011, p. 1445, obs. Kenfack H. ; RTD com. 2010, p. 627, obs. Delebecque P. ; RTD eur. 2010, p. 195, obs. Grard L. ; JCP G 2009, 543, obs. Picod F. ; JCP G 2010, 201, obs. Stuyck J.
-
55.
CJUE, 23 oct. 2012, nos C-581/10 et C-629/10, Nelson : Rev. dr. transp. 2012, comm. 55, note Grard L.
-
56.
Désigné ensuite sous les termes CJUE.
-
57.
CJUE, 19 nov. 2009, nos C-402/07 et C-432/07, Sturgeon, préc. ; CJUE 23 oct. 2012, nos C-581/10 et C-629/10, Nelson, préc. V. pour une application, Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-25351 : Gaz. Pal. 26 févr. 2015, n° 214q8, p. 8, note Paulin C. ; D. 2015, p. 1294, obs. Kenfack H. ; RTD com. 2015, p. 352 obs. Bouloc B. ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 135 note Bloch L. ; JT 2015, p. 12, obs. Delpech X.
-
58.
CJUE, 26 févr. 2013, n° C-11/11, Air France SA c/ Folkerts : D. 2013, p. 638 ; RTD eur. 2014, p. 212, obs. Grard L. ; Rev. dr. transp. 2013, comm. 27, note Rouissi N.
-
59.
V. sur la détermination de l’heure d’arrivée, CJUE, 4 sept. 2014, Germanwings c/ Hennin : D. 2015, p. 1294, obs. Kenfack H. ; RTD eur. 2015, p. 419, obs Grard L. ; Rev. dr. transp. 2014, comm. 64, note Corriera V. ; JT 2015, p. 47, Lachièze C.
-
60.
V. not. Heymann J., JCP G 2017, 84.
-
61.
Article 5 annulation. « (…) 3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ». V. sur la portée de l’exonération, CJCE, 22 déc. 2008, n° C-549/07, Friedericke Wallentin-Hermann c/ Alitalia : RTD eur. 2010, p. 195, obs. Grard L.
-
62.
La qualification de circonstances extraordinaires a été retenue pour la fermeture de l’espace européen à la suite de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull. V. en ce sens, CJUE, 31 janv. 2013, n° C-12/11, Mc Donagh c/ Ryanair Ltd : D. 2013, p. 361 ; RTD eur. 2014, p. 210, obs. Grard L. ; RTD eur. 2015, p. 171, obs. Benoît-Rohmer F. – Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 11-10226 : Resp. civ. et assur. 2012, comm. 142, Bloch L.
-
63.
CJCE, 22 déc. 2008, n° C-549/07, Friederike Wallentin-Hermann c/ Alitalia : Europe 2009, comm. 103, obs. Bernard E. ; CJUE, 19 nov. 2009, nos C-402/07 et C-432/07, Sturgeon préc.
-
64.
Cette affirmation a pu susciter quelques réactions en doctrine. V. not., Delpech X. in Dalloz actualité, 27 oct. 2016.
-
65.
Dupont P. et Poissonnier G., « L’indemnisation des passagers d’un vol vers l’Outre-mer annulé », Gaz. Pal. 29 nov. 2016, n° 281r1, p. 15 et s., avec la jurisprudence citée en note (15).
-
66.
V. Heymann J., note sous Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-20380 : JCP G 2016, p. 1280 et s.
-
67.
Dupont P. et Poissonnier G., « L’indemnisation des passagers d’un vol vers l’Outre-mer annulé », préc., qui se réfèrent aux dispositions de l’article 10 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 qui régissent le surclassement et le déclassement.
-
68.
V. not. en ce sens, Siguoirt L., note sous Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-20380 : JCP E 2017, p. 1080 et s. ; Dupont P. et Poissonnier G., « L’indemnisation des passagers d’un vol vers l’Outre-mer annulé », Gaz. Pal. 29 nov. 2016, n° 281r1, p. 15 et s.
-
69.
Dupont G. et Poissonnier P., préc.
-
70.
Devenu l’article 1353 du Code civil, la réforme n’opérant pas de modification de ce texte.