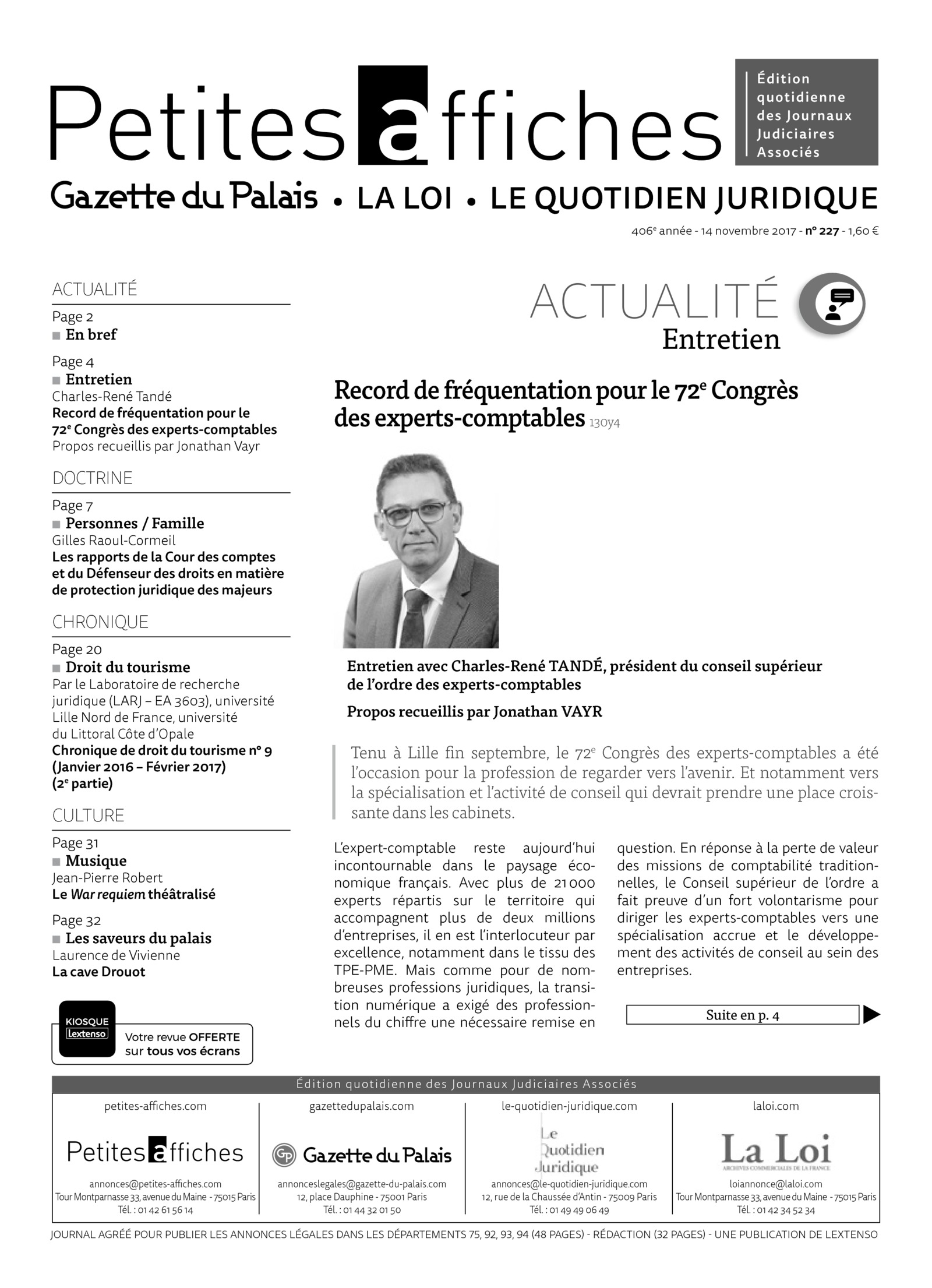Chronique de droit du tourisme n° 9 (Janvier 2016 – Février 2017) (2e partie)
51,9 % des Britanniques ont choisi de quitter l’Union européenne le 23 juin 2016 lors d’un référendum organisé par l’ancien Premier ministre David Cameron. Donald Trump, 70 ans, a remporté les primaires républicaines puis l’élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Le monde change et le tourisme aussi.
Après les dramatiques attentats de 2015 et 2016 en France qui ont eu un impact négatif sur la fréquence touristique, un « fort » rebond au quatrième trimestre 2016 permet à la France de dépasser son niveau de l’automne 2014. Elle devrait ainsi garder sa place de première destination touristique mondiale en 2016. Un nouveau plan pour le tourisme de 42,7 millions d’euros a d’ailleurs été présenté lors du Comité interministériel du tourisme du 7 novembre 2016 qui devrait l’y aider. Cette chronique annuelle est de nouveau l’occasion d’analyser l’actualité juridique concernant ce secteur essentiel à l’économie française.
I – Les acteurs du tourisme
A – Acteurs publics (…)
B – Acteurs privés
1 – Organisations professionnelles (…)
2 – Réglementation des professions
II – Activités du tourisme
A – Exercice des activités touristiques
1 – Financement des activités (…)
2 – Liberté de circulation
Attribution de titres d’occupation domaniale pour l’exploitation d’activités touristiques (CJUE, 14 juill. 2016, nos C‑458/14 Promoimpresa Srl et C‑67/15, Mario Melis c/Comune di Loiri Porto San Paolo)
Levant enfin le doute, la Cour de justice pose l’exigence d’une procédure de sélection transparente pour le renouvellement de titres d’occupation domaniale ayant un intérêt économique, même s’ils n’entrent pas dans le champ des directives « commande publique ». C’est à propos de concessions domaniales permettant l’exploitation d’activités touristico-récréatives qu’elle opère, sur renvoi préjudiciel dans deux affaires jointes, cette importante clarification.
Dans la première affaire, un consortium de communes avait attribué à l’entreprise Promoimpresa une concession pour l’exploitation d’une zone domaniale lacustre à des fins de kiosque, de véranda, de bains, de quai et de ponton sur le lac de Garde. À l’expiration de la concession, Proimpresa avait contesté le refus du consortium de la renouveler automatiquement à son profit, et la décision de soumettre l’attribution des nouvelles concessions à une procédure de sélection comparative. Dans le second litige au principal, M. Melis et plusieurs exploitants demandaient à des collectivités publiques d’appliquer une prorogation automatique prévue par leurs concessions sur le domaine public maritime, pour des activités touristico-récréatives. Les collectivités publiques ont préféré publier un avis en vue de l’attribution de nouvelles concessions portant sur les parcelles occupées. Dans les deux affaires jointes, les juridictions de renvoi demandaient si les articles 49 et 56, et 106 TFUE, ainsi que l’article 12 de la directive Services s’opposent à une législation nationale permettant une prorogation automatique de concessions sur le domaine maritime et lacustre destinées à l’exercice d’activités touristico-récréatives.
La Cour de justice rappelle que « toute mesure nationale dans un domaine qui a fait l’objet d’une harmonisation complète à l’échelle de l’Union doit être appréciée au regard non pas des dispositions du droit primaire mais de celles de cette mesure d’harmonisation » (pt. 59). Elle commence donc par interpréter l’article 12 de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur1. Ce texte prévoit que « lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture ». Il précise que « l’autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l’objet d’une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l’autorisation vient juste d’expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire ». La Cour rappelle que la notion d’autorisation au sens de la directive n° 2006/123 recouvre notamment les procédures administratives par lesquelles sont octroyées des autorisations, licences, agréments ou concessions. Sans hésitation, elle déduit de ce texte que « le droit de l’Union s’oppose à ce que les concessions pour l’exercice des activités touristico-récréatives dans le domaine maritime et lacustre soient prorogées de manière automatique en l’absence de toute procédure de sélection des candidats potentiels ». Dans l’hypothèse où ni la directive Services, ni les directives Commande publique ne seraient applicables, les règles générales du traité peuvent fonder l’exigence d’une publicité préalable et d’une procédure de sélection. La Cour se fonde sur la libre prestation de services, dont « relèvent par leur nature même » des concessions concernant l’occupation « d’une zone domaniale en vue d’une exploitation économique à des fins touristico-récréatives » (pt. 63). Dans la lignée de la jurisprudence Telaustria2, elle estime que lorsqu’une concession présente un intérêt transfrontalier certain, la prorogation automatique de son attribution à une entreprise située dans un État membre introduit une différence de traitement, au détriment des entreprises situées dans un autre État membre, susceptibles d’être intéressées par ces concessions, prohibée, en principe, par l’article 49 TFUE (pt. 70).
Affirmée à propos du renouvellement de conventions d’occupation domaniale conditionnant l’exercice d’activités économiques (notamment de services touristiques), l’obligation d’organiser une procédure de sélection transparente vaut a fortiori pour leur attribution initiale. La Cour confirme que cette obligation découle des libertés de circulation, telles que codifiées par la directive Services (ce qui devrait être le cas le plus fréquent), et à défaut directement de l’article 49 du TFUE. Elle ne repose pas sur le droit de la concurrence, qui avait parfois été invoqué par la doctrine pour justifier une obligation de mise en concurrence des conventions domaniales3. À cet égard, la Cour ne juge pas utile de répondre aux questions relatives à l’article 106 TFUE. De ce fondement découle un vaste champ d’application de l’obligation de mise en concurrence. Il en résulte aussi un large éventail de justifications des limites à la mise en concurrence, avec la théorie des facilités essentielles, qui est reprise par la directive Services. Son article 12 prévoit ainsi que « les États membres peuvent tenir compte, lors de l’établissement des règles pour la procédure de sélection, de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l’environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d’intérêt général ». La Cour exerce toutefois sur de telles justifications un strict contrôle de nécessité et de proportionnalité. Dans l’affaire Promoimpresa, elle considère que les raisons impérieuses d’intérêt général invoquées, telles que la protection de la confiance légitime des titulaires d’autorisation, ne peuvent justifier une prorogation automatique lorsqu’aucune procédure de sélection n’a été organisée lors de l’octroi initial des concessions domaniales.
La Cour de justice apporte ainsi une clarification attendue, qui ne pouvait rester sans répercussions sur le régime français d’octroi des titres d’occupation du domaine (public, voire privé). Elle prend clairement le contre-pied de l’arrêt Jean Bouin4, dans lequel le Conseil d’État affirme qu’aucun principe n’impose à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public ayant pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance, y compris lorsque ces titres conditionnent l’exercice d’activités économique. Suite à l’arrêt Promoimpresa et Melis, l’article 34, 1° de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin 2) a prévu qu’allaient être modifiées par voie d’ordonnance, « les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ».
Anémone CARTIER-BRESSON
3 – Intermédiaires de voyages
Le refus d’embarquement de passagers handicapés caractéristique d’une discrimination imputable au transporteur aérien (Cass. crim., 15 déc. 2015, n° 13-81586)
L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 décembre 2015 précise la distinction entre le refus légitime d’embarquement, par un transporteur aérien, de passagers handicapés et le refus constitutif de discriminations en raison du handicap, délits réprimés par les articles 225-1 et suivants du Code pénal. Pour rappel, l’article 225-2 du Code pénal incrimine, d’une part, le refus de la fourniture d’un bien ou d’un service pour des raisons discriminatoires, d’autre part, la subordination de la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2, c’est-à-dire à une condition discriminatoire.
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté, une compagnie aérienne était poursuivie pour discrimination après qu’ait été refusé l’embarquement, à bord de ses aéronefs, de plusieurs passagers handicapés au motif que sa réglementation interne subordonnait l’embarquement d’une personne handicapée à son accompagnement, ceci alors que les passagers concernés voyageaient fréquemment seuls avec d’autres compagnies aériennes. Saisie de ces faits, commis par les préposés de la société sous-traitante du transporteur aérien poursuivi, la cour d’appel de Paris allait, dans son arrêt du 5 février 2013, condamner ce transporteur à une amende de 70 000 €, lui reprochant d’avoir refusé de fournir une prestation de service en raison d’un handicap et d’avoir offert une prestation de service subordonnée à une condition discriminatoire. Le rejet du pourvoi formé contre cet arrêt permet de revenir à la fois sur la caractérisation du refus d’embarquement discriminatoire (I) et sur les conditions de l’imputation au transporteur aérien d’un tel refus d’embarquement commis par les préposés de son sous-traitant (II).
I. La caractérisation du refus d’embarquement discriminatoire
Les articles 225-1 et suivants du Code pénal, qui posent le principe de l’interdiction des discriminations à raison du handicap, doivent, s’agissant du transport aérien, être combinés avec les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens5. L’article 3 de ce règlement précise en effet qu’un transporteur aérien ou son agent, ou un organisateur de voyages, ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, soit d’accepter une réservation pour un vol au départ ou à destination d’un aéroport, soit d’embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un aéroport dès lors qu’une telle personne dispose d’un billet et d’une réservation valables, de tels agissements étant en principe caractéristiques d’une discrimination fondée sur le handicap. Ce dernier principe n’est toutefois pas absolu dans la mesure où l’article 4 du même règlement prévoit différents motifs pour lesquels le refus d’accepter une réservation ou le refus d’embarquement d’une personne handicapée ou à mobilité réduite est justifié. Il en va ainsi, à suivre ce texte, lorsque de tels refus sont réalisés afin de respecter les exigences de sécurité applicables, qu’elles soient prévues par le droit international, communautaire ou national ou établies par l’autorité qui a délivré son certificat de transporteur aérien au transporteur concerné, ou encore lorsque de tels refus s’expliquent par la taille de l’aéronef ou de ses portes qui rendait physiquement impossible l’embarquement ou le transport de la personne handicapée ou à mobilité réduite. Il en ressort donc que le refus de l’embarquement d’une personne handicapée n’est pas nécessairement infractionnel au sens des articles 225-1 et suivants du Code pénal et peut, en tout état de cause, être couvert par un fait justificatif toutes les fois qu’il trouve sa cause dans un motif légitime.
C’est sur ce dernier point que s’appuyait la compagnie aérienne mise en cause dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2015, invoquant notamment l’existence d’une réglementation interne à cette société prévoyant qu’une personne handicapée ne peut être embarquée en fauteuil roulant à bord de ses aéronefs que si elle est accompagnée. Or, une obligation de sécurité d’origine privée n’étant pas une exigence de sécurité prévue par le droit international, communautaire ou national, qui plus est lorsqu’elle est en contradiction avec ces différentes sources, il est logique que la chambre criminelle ait approuvé les juges du second degré d’avoir considéré que les refus d’embarquement litigieux ne pouvaient être fondés sur aucun motif imposé par le droit et étaient donc discriminatoires. Ils l’étaient d’autant plus que la compagnie aérienne mise en cause avait, en violation de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2006, décidé, à la différence d’autres compagnies, de ne pas former ses personnels à la fourniture d’une assistance spécifique aux personnes handicapées, ce qui la rendait difficilement recevable à invoquer sa propre turpitude pour tenter de justifier les délits qui lui étaient reprochés.
Par la solution adoptée, et l’illustration intéressante qu’il offre d’une caractérisation d’une discrimination en raison du handicap au sens de l’article 225-2 du Code pénal, l’arrêt du 15 décembre 2015 n’est pas sans rappeler celui qui avait été rendu le 20 juin 2006, dans lequel la chambre criminelle s’était également appuyée à la fois sur l’absence de motifs légitimes et sur le comportement du prévenu pour retenir l’existence de l’infraction. Il y avait en effet été jugé que caractérise, en tous ses éléments constitutifs une discrimination punissable, l’arrêt qui retient que les représentants d’une société d’exploitation cinématographique ont refusé l’accès des salles de projection à des personnes se déplaçant en fauteuil roulant malgré les propositions d’aménagement des locaux émanant de la municipalité, alors que l’impossibilité technique de rendre ces locaux accessibles à cette clientèle n’était pas démontrée6.
II. Les conditions de l’imputation au transporteur aérien d’un refus d’embarquement discriminatoire émanant des préposés de son sous-traitant
Le second point important traité par l’arrêt du 15 décembre 2015 a trait aux conditions de l’imputation à un transporteur aérien d’un refus d’embarquement discriminatoire commis par les préposés de son sous-traitant. La compagnie aérienne condamnée en appel contestait en effet le principe de sa responsabilité pénale, notamment en raison du fait que les agissements reprochés n’émanaient pas de son propre personnel. La chambre criminelle a alors approuvé cette condamnation au motif qu’il était établi que le responsable de la compagnie aérienne poursuivie donnait ses instructions à destination de son sous-traitant depuis le siège de la société, agissant pour le compte de celle-ci. Dans l’absolu, il s’agit d’une application classique de l’article 121-2 du Code pénal qui permet d’imputer aux personnes morales les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, ceci alors qu’il avait été relevé que c’était le représentant de la société prévenue qui était à l’origine des instructions ayant provoqué les différents refus d’embarquement litigieux. Force est toutefois de constater que l’arrêt commenté se place quelque peu en retrait de la solution prétorienne réaffirmée constamment depuis 2014, qui tend à subordonner l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales à l’identification de l’organe ou du représentant auteur de l’infraction7. La chambre criminelle s’est en effet contentée, pour approuver l’imputation à la compagnie aérienne poursuivie des agissements commis par les préposés de son sous-traitant, du fait que cette dernière société sous-traitante en charge de l’embarquement avait reçu, par téléphone, du responsable du transporteur qui était situé à Londres, des instructions en application de la procédure mise en place par ce transporteur.
Rodolphe MESA
Le trafic de billets d’avions non constitutif du délit d’abus de confiance (Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-82176)
L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 juin 2016 propose une interprétation stricte des termes de l’article 314-1 du Code pénal incriminant le délit d’abus de confiance à propos de pratiques de trafic de billets d’avions. Dans cette espèce, le prévenu avait été condamné en appel de ce dernier chef pour avoir, en qualité de salarié d’une société de transport aérien, et bénéficiaire, compte tenu de cette qualité, de billets d’avions à prix réduits ou préférentiels réservés exclusivement aux salariés du transporteur ou à leurs proches, obtenu l’émission d’une bonne centaine de tels titres de transport qui lui appartenaient ou qui lui avaient été remis par d’autres salariés qui ne les utilisaient pas, les juges du second degré considérant que le prévenu avait, par ces agissements, détourné de leur finalité les billets dont la délivrance était soumise à des conditions strictes et qui ne pouvaient être vendus. Cette condamnation a été censurée par la chambre criminelle au visa de l’article 314-1 du Code pénal, au motif que l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou des biens remis à titre précaire, alors qu’il ne résultait pas de l’arrêt d’appel attaqué que le prévenu détenait les billets à titre précaire.
Dans l’absolu, la solution retenue par l’arrêt du 29 juin 2016 est parfaitement justifiée. L’article 314-1 du Code pénal exige en effet, au titre des conditions préalables de l’abus de confiance, une remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque, ce qui est assurément le cas d’un titre de transport, mais aussi et surtout que cette remise soit consentie à l’agent à charge pour celui-ci de restituer la chose remise ou d’en faire un usage déterminé. Cette exigence d’une remise à titre précaire est donc pleinement incompatible avec une remise translative de propriété. Or, s’agissant des faits de l’arrêt commenté, le prévenu étant devenu propriétaire des titres de transport qui lui avaient été remis par son employeur ou ses collègues, pareilles remises ne pouvaient être qualifiées de précaires, ce dont il résulte que l’utilisation desdits titres dans des conditions différentes de celles prévues lors de leur émission ne peut en aucun cas tomber dans les prévisions de l’article 314-1 du Code pénal. Par la solution adoptée, l’arrêt du 29 juin 2016 est dans la droite ligne de la jurisprudence constante en matière d’abus de confiance. La chambre criminelle a en effet déjà pu considérer, par exemple, que la remise d’un chèque étant translative de la propriété de la provision, il en ressort qu’un chèque ne peut être remis à son bénéficiaire à titre de dépôt8. Ou encore, que le fait, pour un emprunteur ayant cessé de s’acquitter du montant des mensualités dues, de ne pas avoir utilisé les fonds prêtés pour la réalisation des opérations pour lesquelles le prêt avait été consenti, n’est pas constitutif d’un abus de confiance, l’emprunteur étant devenu propriétaire desdits fonds, ce qui est exclusif d’une remise à titre précaire9. Ou enfin, qu’est justifiée la relaxe d’un prévenu poursuivi du chef d’abus de confiance pour avoir détourné une importante somme d’argent qui lui avait été remise à charge de la rendre, le prévenu ayant eu la libre disposition de cette somme tout en n’étant tenu que de restituer l’équivalent des espèces empruntées, de tels fonds n’ayant pas été remis à titre précaire10.
Rodolphe MESA
La responsabilité de plein droit des agences de voyages réservée aux prestataires rémunérés (Cass. 1re civ., 29 juin 2016, nos 14-30073, 14-30074, 14-30075, 14-30076, 14-30077 et 14-30078, F-D)
L’ancien article L. 211-17 du Code du tourisme, devenu l’article L. 211-16 à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 prévoit que celui qui participe à la conception ou la commercialisation d’un forfait touristique est responsable de plein droit de sa bonne exécution. Cette disposition est-elle applicable à une personne qui a participé bénévolement à la distribution d’un forfait touristique ? Telle est la question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre dans un arrêt rendu le 29 juin 201611.
Les faits étaient les suivants : une personne, investie dans la vie associative de la communauté marocaine de Strasbourg, a transmis un dépliant publicitaire pour un voyage organisé à Médine à plusieurs membres de cette communauté désireux d’effectuer un pèlerinage à La Mecque. Ces personnes lui remettent la somme de 5 000 € par couple pour effectuer le pèlerinage. Le voyage n’a pas lieu. Mais chaque couple n’est remboursé que de 2 800 €.
Les pèlerins intentent dès lors une action en responsabilité civile afin d’obtenir la condamnation solidaire de cet homme et des voyagistes censés assurer l’exécution du forfait à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, incluant le solde du prix du voyage non restitué. Leur recours est fondé sur les articles L. 211-1 et suivants du Code du tourisme dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 2009.
Les juges du fond accueillent leur demande, y compris en ce qu’elle est dirigée contre l’homme qui avait, semble-t-il, servi d’intermédiaire. Ils considèrent en effet que cet homme était un organisateur de fait d’une prestation soumise aux articles L. 211-1 et suivants du Code du tourisme, et que le fait qu’il ait exercé sa mission à titre gratuit n’avait aucune conséquence quant à sa responsabilité envers les voyageurs, les dispositions du Code du tourisme s’appliquant quelles que soient les modalités de la rémunération des personnes physiques organisant les prestations.
Mais l’arrêt est cassé. Dans une décision rendue au visa des articles L. 211-1 et L. 211-17 du Code du tourisme, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 22 juillet 2009, applicable en la cause, la Cour de cassation précise que « la responsabilité de plein droit, prévue par le second de ces textes, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l’organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu du premier, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu’en soient les modalités », pour en déduire que la responsabilité de plein droit ne peut pas peser sur celui qui n’a reçu aucune rémunération.
On reconnaît ici un argument déjà retenu pour écarter la responsabilité d’un comité d’entreprise qui avait commercialisé un voyage au bénéfice des salariés de l’entreprise et de leur famille12 : puisque l’article L. 211-1 soumet au régime prévu par les articles qui le suivent les concepteurs et les personnes qui ont participé à la commercialisation d’un voyage à forfait quelles que soient les modalités de leur rémunération, c’est qu’il n’y soumet pas ceux qui ne reçoivent aucune rémunération, de sorte que l’intermédiaire bénévole y échappe.
La solution est conforme à la ratio legis : les dispositions protectrices de l’« acheteur » de voyages à forfait sont conçues pour peser sur celui qui fait profession d’organiser ou de participer à la distribution de ces voyages. Elles n’ont pas vocation à atteindre celui qui prête son concours bénévolement à cette activité. Elle devrait être maintenue une fois la directive n° 2015/2302, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage, qui précise expressément – ce que ne faisait pas la directive n° 90/314/CEE, du 13 juin 1990, dont les dispositions actuelles du Code du tourisme assurent la transposition – qu’elle entend réglementer les contrats conclus entre les voyageurs, d’une part, et les professionnels relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées, d’autre part, et précise bien que « l’organisateur » et le « détaillant » de ces voyages sont des « professionnels ».
Cela ne veut bien entendu pas dire que la responsabilité de l’intervenant bénévole ne pourra pas être engagée. Mais elle le sera sur un autre fondement. On pourrait sans doute y voir un mandataire des « acheteurs » du voyage, puisqu’il leur a procuré les brochures et s’est chargé de remettre le prix du voyage à l’agence de voyages. Sa responsabilité serait alors engagée sur le fondement de la faute prouvée13, étant entendu que, en application de l’article 1992 alinéa 2 du Code civil, cette faute sera appréciée de manière moins rigoureuse dès lors que le mandat est gratuit14. On pourrait ainsi imaginer que l’intermédiaire se voit reprocher sa légèreté à avoir incité les voyageurs à contracter avec une agence de voyages dont les difficultés financières ou l’incompétence étaient notoires. Mais, sa responsabilité ne peut être engagée du simple fait que le voyage n’a pas eu lieu.
Sophie MOREIL
Voyage à forfait : l’obligation d’information du voyagiste porte aussi sur le nombre de personnes autorisées à conduire le véhicule loué dans le cadre du forfait (Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-18106, F-D, V. c/ SA Axa France IARD)
Le Code du tourisme met à la charge de celui qui conçoit ou « vend » des voyages à forfait une obligation précontractuelle d’information qui l’oblige à transmettre à ses clients potentiels, par écrit, et préalablement à la conclusion du contrat, différentes informations, parmi lesquelles figurent des informations concernant le « contenu des prestations proposées relatives », notamment au transport et au séjour15. Cette première information est complétée lors de la conclusion du contrat de « vente » de voyage lui-même, qui doit être écrit16 et comporter un certain nombre d’indications, notamment relatives « à la description des prestations fournies »17. La jurisprudence adopte traditionnellement une lecture extrêmement large de cette obligation, qu’elle refuse de limiter aux caractéristiques essentielles du voyage ou du séjour18. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 201619 en constitue une parfaite illustration.
Une société avait vendu un forfait touristique comprenant la location d’un véhicule. L’un des clients percute un motocycliste qu’il blesse mortellement au cours du séjour alors qu’il conduisait le véhicule loué. Poursuivi par les ayants-droit de la victime, le conducteur, qui avait appris à l’occasion de l’enquête pénale, qu’il n’était pas assuré pour la conduite, assigne l’agence de voyages afin d’être relevé et garanti de toutes les condamnations civiles qui pourraient être prononcées contre lui. De son côté, l’assureur de l’agence de voyages attrait à la procédure l’organisateur du voyage, dont le conducteur recherchait également la responsabilité.
La cour d’appel refuse d’admettre que la responsabilité de l’agence de voyages ou celle de l’organisateur du voyage est engagée. Il aurait fallu pour cela que les voyageurs parviennent à démontrer qu’ils ont précisément contracté avec cette agence pour quatre conducteurs ou que l’organisateur du séjour aurait omis de lui remettre une brochure lors de la conclusion du contrat.
Mais sa décision est cassée : dans un arrêt rendu au visa des articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du Code du tourisme, la Cour de cassation décide qu’il appartenait à l’agence de voyages et à l’organisateur du séjour d’informer précisément leurs clients du contenu des prestations fournies et de spécifier si le contrat, qui prévoyait la mise à disposition d’un véhicule, permettait ou non à chacun des quatre acheteurs du forfait touristique de conduire le véhicule inclus dans ce forfait et de bénéficier de l’assurance obligatoire corrélative.
La solution n’était pas évidente : la lecture des moyens annexés à la décision nous apprend que le contrat précisait que les dispositions relatives aux assurances figuraient dans la brochure ou le programme de l’organisateur et que la brochure préparée par ce dernier, ainsi qu’un deuxième document destiné à être remis aux clients mentionnaient qu’un supplément serait demandé par conducteur supplémentaire. Par ailleurs, le bon rédigé en France pour la location était au nom d’un seul voyageur, qui était aussi le seul indiqué comme locataire sur le contrat de location, et celui à qui il avait été demandé de fournir un dépôt de garantie. Une information minimale avait ainsi été réalisée, laquelle pouvait sembler à tout le moins devoir susciter le doute dans l’esprit des voyageurs, et ce, d’autant plus que lorsqu’on loue un véhicule en France, seul un conducteur est autorisé à le conduire, sauf à payer un supplément pour les autres conducteurs.
Mais telle n’est donc pas l’analyse faite par la Cour de cassation, qui montre combien l’obligation d’information pesant sur l’agence de voyages est lourde : elle doit porter sur tous les éléments que l’acheteur a besoin de connaître pour profiter entièrement de son séjour, y compris le nombre de conducteurs autorisés à conduire le véhicule loué dans le cadre du forfait touristique. À défaut, la responsabilité de l’agence est engagée, ce qui permet de reporter les conséquences pécuniaires du défaut d’assurance du conducteur sur un professionnel, lui-même assuré.
Sophie MOREIL
4 – Transports
L’obligation de ponctualité de la SNCF est une obligation de résultat (Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-28227, M. X c/ SNCF)
Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 201620 a donné à la Cour de cassation l’occasion de s’interroger sur l’existence et la portée d’une éventuelle obligation de ponctualité pesant sur la SNCF.
Une personne avait acheté deux billets de train pour effectuer le trajet Marseille-Istres en première classe un premier jour et, le lendemain, le voyage Istres-Nîmes avec une correspondance à Miramas. Elle est toutefois contrainte d’effectuer le premier trajet en seconde classe et, le lendemain, de se rendre à Nîmes en taxi, en raison du retard de son train de plus de 30 minutes. Elle intente dès lors une action en responsabilité contre la SNCF.
Le juge de proximité ne la reconnaît toutefois créancière que de 20,80 €, ce qui correspond au remboursement de la différence entre le prix d’un billet de première classe et celui d’un billet de seconde classe ainsi que du billet de train inutilisé. Il refuse par contre de lui accorder le remboursement de la somme demandée par le taxi emprunté pour terminer le trajet ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral et de la perte de temps liée au retard de son train. La réalité et la consistance d’une faute imputable au transporteur ne seraient en effet pas établies, de sorte que la responsabilité de ce dernier ne serait pas engagée.
Mais le jugement est partiellement censuré : dans un arrêt rendu au visa des anciens articles 1147 et 1150 du Code civil, devenus respectivement les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil, la Cour de cassation précise, à notre connaissance pour la première fois21, que « l’obligation de ponctualité à laquelle s’engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ». L’horaire indiqué par la SNCF est donc de rigueur. Et, tenue d’une obligation de ponctualité de résultat22, la SNCF engage sa responsabilité dès qu’un retard est constaté, sans que le voyageur ait besoin de rapporter la preuve d’une faute de son cocontractant. Cette solution ne semblait jusqu’à présent admise par la SNCF qu’à l’égard des trajets de longue distance, qui, sans doute sous l’influence de la réglementation européenne23, bénéficient de la « garantie voyage ». La Cour de cassation précise donc qu’elle vaut également pour les trajets effectués sur des lignes régionales, qui ne profitent pas de cette même garantie.
Mais la reconnaissance d’une telle obligation de ponctualité n’est que d’un intérêt limité pour le voyageur arrivé en retard. En effet, faisant une application habituelle24 de l’ancien article 1150 du Code civil, la Cour de cassation ajoute que « la méconnaissance de cette obligation [de ponctualité] est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l’exécution de celui-ci ». Ainsi, conformément aux prévisions de cet article, seul le dommage que la SNCF pouvait prévoir au jour de la conclusion du contrat sera réparé. Il n’y a que lorsque le débiteur a commis une faute dolosive, à laquelle la jurisprudence assimilait traditionnellement la faute lourde25, que le voyageur pouvait obtenir réparation de son entier dommage, solution dont la substance a été reprise au nouvel article 1231-3 issu de l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, de sorte que la même solution pourra être maintenue s’agissant de contrats conclus après le 1er octobre 2016. La réparation des dommages complémentaires générés par le retard tels que la perte d’un billet d’avion26 ou d’un séjour lorsque le trajet en train devait permettre d’atteindre le moyen de transport devant acheminer le voyageur jusqu’à son lieu de vacances27, ou encore d’un préjudice moral dont le voyageur pourrait se prétendre victime n’interviendra de ce fait que très rarement et les conséquences du caractère de résultat de l’obligation de ponctualité de la SNCF sont limitées.
On remarquera qu’en l’espèce, le recours au droit commun des contrats s’imposait dans la mesure où le voyageur empruntait une ligne régionale, de sorte qu’il échappait aux dispositions issues du règlement européen n° 1371/2007, du 23 octobre 2007, qui n’est pas applicable aux services de transport ferroviaire de voyageurs urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferroviaire28.
La situation du voyageur n’aurait d’ailleurs pas été préférable si le règlement avait été applicable : s’il présente le mérite de mettre à la charge du transporteur ferroviaire une obligation d’assistance en cas de retard et qu’il fixe un plancher d’indemnisation au profit du voyageur, il ne prend en compte le retard que lorsqu’il est supérieur à 60 minutes29. Par ailleurs, il renvoie, s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par le voyageur, aux règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), lesquelles n’organisent la réparation que des préjudices liés aux frais raisonnables d’hébergement et aux frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur30, laissant aux droits nationaux le soin de déterminer si, et dans quelle mesure le transporteur doit indemniser le voyageur d’autres types de préjudice.
Sophie MOREIL
La faute du voyageur ferroviaire partiellement exonératoire (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12217)
Une fois le voyageur descendu du train, le contrat de transport ferroviaire cesse. De ce fait, si un voyageur se blesse, il ne peut plus rechercher la responsabilité de la SNCF que sur le fondement extracontractuel. Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 mars 201631 rappelle que, dans ce cas, la faute de la victime constitue une cause d’exonération partielle de la responsabilité du transporteur.
Les faits étaient d’une grande banalité. Un voyageur se blesse en tombant du train dont il était descendu et dans lequel il tentait de remonter alors qu’il avait redémarré, pour récupérer un bagage oublié. Il assigne la SNCF en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Les juges du fond accueillent sa demande et déclarent la SNCF seule et entière responsable des conséquences dommageables de l’accident. Ils considèrent en effet que le voyageur avait « commis une faute en effectuant une manœuvre interdite et dangereuse », mais que la SNCF était « entièrement responsable de l’accident » dès lors que la faute de la victime n’aurait pas présenté les caractères de la force majeure.
Dans son pourvoi, la SNCF tente de faire admettre que le voyageur avait commis une faute en tentant, en infraction avec la réglementation ferroviaire, de monter, après le signal du départ, dans un train qui roulait à une allure d’au moins 7 km/h et dont les portes étaient fermées, et que cette faute serait la cause exclusive de son dommage. Elle ajoute que cette faute était à la fois irrésistible et imprévisible, rien ne permettant de supposer qu’une personne essaierait de s’introduire dans un train alors même que plus personne n’était visible sur le quai et que le train s’était élancé une dizaine de secondes auparavant.
Le pourvoi invitait dès lors la Cour de cassation à préciser quelle est l’incidence de la faute de la victime qui intente une action en responsabilité contre le gardien de la chose à l’origine de son dommage.
La Cour de cassation rejette le premier moyen. Elle approuve la cour d’appel d’avoir décidé que la faute d’imprudence de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu que le voyageur a commis une faute en effectuant une manœuvre interdite et dangereuse. Mais ils ont également souverainement relevé que cette faute n’était ni imprévisible, la SNCF étant régulièrement confrontée à ce type de comportement, ni irrésistible puisque des moyens peuvent permettre d’empêcher les passagers de remonter dans le train dans ces conditions, comme la présence d’agents sur le quai, ce qui n’était pas le cas le jour de l’accident, ou la mise en place de systèmes différents de fermeture des portes. Cette faute constitue toutefois une cause d’exonération partielle. L’arrêt est en effet cassé au visa de l’ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil, devenu l’article 1242 du même code, en ce qu’il déclare la SNCF seule et entière responsable des conséquences dommageables de l’accident, puisque « le gardien d’une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage ».
Ce faisant, la Cour de cassation fait une application on ne peut plus classique des règles de la responsabilité civile du fait des choses : la responsabilité du gardien de la chose à l’origine du dommage est écartée toutes les fois que ce dommage a été causé par un événement de force majeure, le fait d’un tiers ou une faute de la victime lorsque, s’agissant de ces deux derniers éléments, ils ont présenté les caractères de la force majeure32. À défaut, ces événements ne pourront constituer que des causes d’exonération partielle33. Et l’on sait qu’en matière délictuelle, la force majeure est analysée avec rigueur : elle suppose que l’événement en cause ait été à la fois imprévisible et irrésistible au moment de sa survenance34, ce qui est très difficile à établir, surtout s’agissant d’un dommage que l’on prétend reprocher à la SNCF. Il n’est dès lors pas étonnant que la Cour de cassation refuse de voir, dans la tentative du voyageur de remonter dans un train en cours de démarrage, un événement de force majeure : il est prévisible que des voyageurs qui ont oublié leurs bagages à bord essaient de les récupérer avant que le train ne parte, y compris lorsque le départ de ce train est annoncé. Et il appartient à la SNCF de prendre les précautions nécessaires pour l’éviter. Celle-ci ne rappelle-t-elle pas régulièrement de s’éloigner de la bordure du quai au moment où les trains démarrent, comme elle prévient les voyageurs qu’ils ne doivent pas tenter de descendre d’un train en marche ou arrêté en pleine voie ? Comme le note la Cour de cassation, il aurait pu, en l’espèce, y avoir du personnel chargé de surveiller les personnes restées sur le quai.
Mais la Cour de cassation décide que la faute de la victime, même légère, permet à la SNCF de s’exonérer partiellement de sa responsabilité. Ce faisant, elle applique, là encore, les règles traditionnelles du droit de la responsabilité civile – elle parle d’ailleurs de la responsabilité du « gardien », qui s’appuie sur une faute de la « victime », et non de la responsabilité de la « SNCF » ou du « transporteur ferroviaire » confrontée à la faute du « voyageur ».
La faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure constitue une cause d’exonération partielle de la responsabilité du gardien35, puisque l’on ne conçoit pas qu’une victime puisse obtenir la réparation intégrale d’un dommage à la réalisation duquel elle a, au moins partiellement, concouru.
Cette solution s’accorde mal il est vrai avec le souci contemporain de ne pas laisser les dommages corporels sans réparation, souci dont témoigne l’évolution de la jurisprudence dans l’hypothèse où l’accident du voyageur est survenu à un moment où le contrat de transport ferroviaire n’avait pas encore pris fin. En effet, la jurisprudence décide que la SNCF est tenue, vis-à-vis de ses clients, d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat qui apparaît au moment où le voyageur commence à monter dans le train et qui cesse lorsqu’il achève d’en descendre36. Et, depuis un arrêt du 13 mars 200837, la Cour de cassation décide que, lorsqu’un accident survient en cours de transport, la faute de la victime ne peut pas constituer une cause d’exonération partielle. Elle n’est susceptible d’être prise en compte que si elle présente les caractères de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage du voyageur38, ce qui permet d’offrir au voyageur muni d’un titre de transport une indemnisation quasi systématique des dommages corporels qu’il a subis durant le transport. Il n’y a, dans ce cas, qu’en présence d’un suicide39 que la responsabilité de la SNCF est écartée, solution dont l’arrêt du 30 mars 2016 montre qu’elle n’a pas été transposée au cas où le dommage a été subi par une personne qui n’était pas liée contractuellement à la SNCF, avec cette conséquence que la victime sera traitée différemment selon qu’elle sera descendue du train avant de se blesser en tentant d’y remonter40 ou qu’elle aura tardé à en descendre et se sera blessée en essayant de sauter du train alors que celui-ci est en train de repartir41.
Cela étonne d’autant plus à une époque où l’on réfléchit à étendre aux accidents de chemins de fer et de tramways le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation42, laquelle offre aux victimes qui n’ont pas la qualité de conducteur une réparation quasi systématique de leur dommage, y compris lorsque leur faute a été la cause exclusive de leur dommage, la seule cause d’exonération que peut invoquer le responsable étant la faute inexcusable de la victime qui aurait été la cause exclusive du dommage, faute qui correspond à l’hypothèse dans laquelle la victime a volontairement recherché son dommage.
Reste que l’on peut s’interroger sur le point de savoir si l’affaire relevait réellement de la responsabilité civile de droit commun43. En effet, le règlement n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires précise les conditions de la réparation des accidents « en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu[s] pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte, quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée » (CIV, art. 26 al. 1er, auquel renvoie le règlement). Et l’on peut se demander si l’accident en cause n’était pas précisément « en relation avec l’exploitation ferroviaire ».
Sophie MOREIL
Récupération d’aides au secteur aérien : absence de prise en compte des répercussions de l’avantage sur les clients des entreprises bénéficiaires (CJUE, 3e ch., 21 déc. 2016, nos C-164/15 P et C-165/15 P, Commission c/ Aer Lingus et Ryanair)
La récupération d’une aide illégale doit correspondre à l’avantage procuré à son bénéficiaire, et non à l’éventuel bénéfice économique réalisé par l’exploitation de cet avantage. La Cour de justice l’a précisé à propos de réductions de taxes de transport aérien (TTA) pratiquées par l’Irlande entre 2009 et 2011. Ces réductions avaient été qualifiées d’aides d’État incompatibles par la Commission en 201244. Des compagnies aériennes opérant de nombreux trajets au départ d’un aéroport irlandais vers des destinations situées à moins de 300 km de l’aéroport de Dublin avaient ainsi bénéficié d’un taux réduit de 2 € par passager (au lieu du taux standard de 10 €). La Commission a ordonné la restitution de ces aides, en considérant que leur montant correspondait à la différence entre les deux taux de taxe, soit 8 € par passager. Saisi de recours en annulation par les compagnies Aer Lingus et Ryanair, le Tribunal a confirmé en 2015 la qualification d’aide d’État incompatible45. Il a rappelé que la contrariété d’une mesure à d’autres dispositions du TFUE ne saurait faire obstacle à la qualification d’aide au sens de l’article 107, § 1 (en l’espèce, la Commission avait également qualifié la taxation différenciée d’entrave à la libre prestation de services). Cependant le Tribunal a partiellement annulé la décision de la Commission s’agissant de la détermination du montant de l’aide récupérable. Le Tribunal a estimé que la TTA avait vocation à être répercutée sur les passagers, du fait de son caractère de droit d’accise, ainsi qu’en raison de l’obligation imposée aux compagnies aériennes d’indiquer séparément le montant des taxes dans le prix de chaque billet. Par conséquent, il a reproché à la Commission de n’avoir pas tenu compte de la répercussion éventuelle de la réduction de taxe par les entreprises bénéficiaires de l’aide sur le prix du billet payé par les passagers. La prise en compte du seul montant non répercuté d’une taxe évoque pourtant davantage les règles de la répétition de l’indu (notamment pour des taxes contraires aux libertés de circulation46) que le droit des aides d’État.
Un pourvoi formé par la Commission a fourni à la Cour l’occasion de réaffirmer la finalité spécifique de la récupération des aides incompatibles. La Cour commence par rappeler que cette finalité est de rétablir la situation antérieure à l’octroi de l’aide. Par cette restitution, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et la situation antérieure au versement est donc rétablie. Suivant les conclusions de l’avocat général Mengozzi, la Cour en déduit que la restitution doit correspondre à l’avantage procuré par la mesure d’aide, et non à l’éventuel bénéfice économique correspondant à l’exploitation de cet avantage (pts 91 et 92). En l’espèce, l’avantage ne consistait pas dans le fait que ces compagnies aériennes pouvaient profiter de la réduction de TTA pour offrir des prix plus compétitifs par rapport à leurs concurrents. Il résultait simplement du fait que ces sociétés ont dû s’acquitter d’un montant inférieur à celui qu’elles auraient dû payer si leurs vols avaient été soumis au taux standard. La Commission n’était donc pas tenue d’examiner dans quelle mesure les bénéficiaires de l’aide avaient utilisé l’avantage économique résultant de l’application du taux réduit, « une telle évaluation étant sans pertinence pour la récupération de l’aide » (pt 102). Sans surprise, la Cour écarte également l’argument de Ryanair tiré de la directive n° 2014/104/UE du 26 novembre sur les actions en réparation du fait d’une violation des règles de concurrence, qui permet au défendeur d’invoquer la répercussion de surcoûts. Elle rappelle à cette occasion la différence de finalités entre une action en réparation pour pratique anticoncurrentielle et la restitution d’une aide d’État.
Alors qu’elle n’hésite pas à débusquer le transfert du bénéfice d’aides illégales vers d’autres entreprises bénéficiaires47, la Cour refuse de prendre en compte leurs éventuelles répercussions sur les consommateurs pour la récupération des aides. Au-delà des arguments juridiques avancés, on imagine les difficultés pratiques que pourrait engendrer l’adoption de ce « nouveau critère économique » (selon les termes de l’avocat général Mengozzi) pour déterminer le montant récupérable d’aides illégales.
Anémone CARTIER-BRESSON
(À suivre)
5 – Hébergements touristiques
6 – Tourisme collaboratif
7 – Responsabilités et assurances
8 – Tourisme médical et tourisme procréatif
B – Aménagement des espaces à vocation touristique
1 – Tourisme durable
2 – Tourisme et patrimoine
Notes de bas de pages
-
1.
JO, 2006, L 376, p. 36.
-
2.
CJCE, 7 déc. 2000, n° C‑324/98, Telaustria et Telefonadress.
-
3.
V. à propos de ce débat Cartier-Bresson A., « Titres d’occupation du domaine public et concurrence : des relations condamnées à l’ambiguïté ? », in Mélanges P. Godfrin, 2014, éd. Mare et Martin, p. 71.
-
4.
CE, sect., 3 déc. 2010, nos 338272 et 338527, Ville de Paris, Assoc. Paris Jean Bouin : Dr. adm. 2011, comm. 17, Brenet F. et Melleray F. ; RDI 2011, p. 162, note Braconnier S. et Noguellou R.
-
5.
Règl. (CE) n° 1107/2006 du PE et du Cons., 5 juill. 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens : JOUE L 204/1.
-
6.
Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85888 : Dr. pén. 2006, comm. 133, obs. Véron M.
-
7.
Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 12-86501 : Bull. crim., n° 99 ; Gaz. Pal. 15 mai 2014, n° 177c1, p. 10, note Mesa R. – Cass. crim., 6 mai 2014, nos 12-88354, 13-81406 et 13-82677 (3 arrêts) : Bull. crim., nos 124, 125 et 126 ; Gaz. Pal. 18 juin 2014, n° 181r6, p. 8, note Mesa R. ; RTD com. 2014, p. 703, obs. Bouloc B. ; JCP G 2014, p. 1234, note Robert J.-H. – Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-81484 : RJDA déc. 2016, p. 867, obs. Pichon E. ; AJ pénal 2016, p. 381, obs. Lasserre Capdeville J.
-
8.
Cass. crim., 10 févr. 1972, n° 70-91613 : Bull. crim., n° 55.
-
9.
Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-82283 : Bull. crim., n° 48 ; Dr. pén. 2007, comm. 84, obs. Véron M.
-
10.
Cass. crim., 5 sept. 2007, n° 07-80529 : Bull. crim., n° 194 ; JCP G 2007, II 10186, note Detraz S. ; Dr. pén. 2007, comm. 157, obs. Véron M.
-
11.
Cass. 1re civ., 29 juin 2016, nos 14-30073 et 14-30078 : JT 2016, p. 11, obs. Delpech X.
-
12.
Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, nos 14-15720 et 14-18014 : Bull. civ. I, n° 88 ; JT 2015, p. 14, obs. Delpech X. ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 206 ; LPA 22 juin 2015, p. 12, note Dagorne-Labbe Y. – Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 11-26881 : JT 2013, p. 12, obs. X. D. et D. 2013, p. 45, note Lachièze C. V. aussi, Cass. 1re civ., 16 mars 1994, n° 92-17050 : Bull. civ. I, n° 101 ; RTD com. 1996, p. 499, obs. Alfandari E. et Jeantin M. ; D. 1995, p. 9, note Boulanger F. ; Dr. soc. 1994, p. 789, obs. Savatier J.
-
13.
Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 87-16530 : D. 1989, p. 302, note Larroumet C. ; RTD civ. 1989, p. 558, obs. Jourdain P., et 572, obs. Rémy P. – Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 03-19936 : Bull. civ. I, n° 241. V. aussi, à propos d’un comité d’entreprise, Cass. 1re civ., 16 mars 1994, préc.
-
14.
Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 03-19936 : Bull. civ. I, n° 241. V. aussi, Cass. 1re civ., 14 juin 2000, n° 98-17752.
-
15.
C. tourisme, art. L. 211-8 et C. tourisme, art. R. 211-4.
-
16.
C. tourisme, art. L. 211-10.
-
17.
C. tourisme, art. L. 211-10 et C. tourisme, art. R. 211-6.
-
18.
Dagorne-Labbée Y., « Agences de voyages », in Rép. com. Dalloz, n° 57.
-
19.
Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-18106 : JT 2016, p. 11, obs. Aumeran X. ; RGDA nov. 2016, n° 114c4, p. 565, note Landel J.
-
20.
Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-28227 : D. 2016, p. 981, note Gauchon C. ; D. 2016, p. 1396, obs. Kenfack H. ; D. 2017, p. 24 et s., obs. Gout O. ; RTD com. 2016, p. 326, obs. Bouloc B. ; JT 2016, p. 12, obs. Delpech X. ; JCP E 2016, 1189, obs. Siguoirt L. ; Gaz. Pal. 23 févr. 2016, n° 258r0, p. 25, obs. Paulin C. ; RDC 2016, n° 113j0, p. 462, obs. Latina M. ; Énergie - Env. - Infrastr. 2016, comm. 68, obs. Delebecque P. ; Contrats, conc., consom. 2016, comm. 87, note Leveneur L.
-
21.
Seuls les juges du fond en avaient jusqu’à présent reconnu l’existence aussi nettement. V. CA Riom, 6 juin 1995, n° 2990/94 : Juris-Data n° 1995-049009 – CA Paris, 4 oct. 1996 : JCP G 1997, II 22811, note Paisant G. et Brun P. – CA Paris, 22 sept. 2010, n° 08/14438 : D. 2011, p. 12, obs. Gallmeister I. ; D. 2011, p. 1449, obs. Kenfack H. V. depuis, CA Metz, 21 avr. 2016, n° 09/02560 : BTL 2016, n° 3596.
-
22.
La doctrine était déjà en ce sens. V. Bernadet M., Bon-Garcin I. et Reinhard Y., Droit des transports, 2010, Dalloz, Précis, n° 496 ; Gency-Tandonnet D. et Piedelièvre S., Droit des transports, 2013, Lexisnexis, Manuel, n° 453.
-
23.
Sur laquelle, v. infra.
-
24.
Cass. 1re civ., 28 avr. 2011, n° 10-15056 : D. 2011, p. 1280, obs. Gallmeister I. ; D. 2011, p. 1725, note Bacache M. ; D. 2012, p. 47, obs. Brun P. et Gout O. ; D. 2012, p. 459, obs. Amrani Mekki S. et Mekki M. ; RTD civ. 2011, p. 547, obs. Jourdain P. – Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-13177 : Dalloz actualité, 8 oct. 2012, obs. Kilgus N. ; D. 2012, p. 2305, obs. Gallmeister I. ; D. 2012, p. 2649, obs. Rome F. ; D. 2013, p. 2432, obs. Kenfack H. ; RTD com. 2012, p. 843, obs. Bouloc B. – Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-26975. V. déjà, CA Paris, 31 mars 1994 : D. 1994, IR, p. 134. V. depuis, CA Metz, 21 avr. 2016, n° 09/02560, préc.
-
25.
Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-21980.
-
26.
Cass. 1re civ., 23 juin 2011, n° 10-11539 ; Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-26975.
-
27.
Cass. 1re civ., 28 avr. 2011, n° 10-15056.
-
28.
C. transp., art. L. 2151-2.
-
29.
Règl., art. 15 et s.
-
30.
CIV, art. 32.
-
31.
Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12217 : Gaz. Pal. 26 avr. 2016, n° 264a6, p. 17, note Receveur B. ; Gaz. Pal. 17 mai 2016, n° 264r5, p. 28, note Jaouen M. ; Gaz. Pal. 6 sept. 2016, n° 272k3, p. 31, note Carayol R. ; D. 2016, p. 1396, obs. Kenfack H. ; D. 2016, p. 766, note Rias N. ; D. 2017, p. 24, obs. Gout O. ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 174, obs. Hocquet-Berg S. ; JCP G 2016, 1117, obs. Bloch C. ; JCP E 2016, 1284, note Le Gac-Pech S. ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 174, note Hocquet-Berg S. ; Énergie - Env. - Infrastr. 2016, comm 48, note Delebecque P. ; RLDC 2016/5, p. 16, note Dumery A.
-
32.
Malaurie P. , Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 8e éd., 2016, LGDJ, Defrénois, nos 194 et s.
-
33.
Cass. 2e civ., 6 avr. 1987 : Bull. civ. II, n° 86.
-
34.
Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 04-18902 : Bull. ass. plén., n° 6 ; Resp. civ. et assur. 2006, étude 8, Bloch L. ; JCP G 2006, II 10087, note Grosser P. ; JCP E 2006, 2224, n° 11, obs. Legros C. ; Contrats conc. consom. 2006, comm. 152, Leveneur L. ; D. 2006, p. 1577, note Jourdain P. ; D. 2006, p. 1131, obs. Gallmeister I. ; D. 2006, p. 1566, Noguéro D. ; D. 2006, p. 1933, obs. Brun P. et 2645, obs. Fauvarge-Cosson B. ; Gaz. Pal. Rec. 2006, p. 2496, concl. de Gouttes R. ; Defrénois 30 août 2006, n° 38433, p. 1212, obs. Savaux E. ; RLDC 2006/29, n° 2129, note Mekki M. ; LPA 6 juill. 2006, p. 14, note Le Magueresse C. ; RDC 2006, p. 1083, obs. Laithier Y.-M. et 1207, obs. Viney G. ; RTD com. 2006, p. 904, obs. Bouloc B.
-
35.
Cass. 2e civ., 6 avr. 1987, n° 85-12833 : Bull. civ. II, 1987, n° 86 – Cass. 2e civ., 4 juill. 2013, n° 12-23562.
-
36.
Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-11493 : Bull. civ. I, n° 118. V. déjà, Cass. 1re civ., 1er juill. 1969 : Bull. civ. I, n° 260. Pour une application récente, v. Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 15-22066.
-
37.
Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 05-12551 : Bull. civ. I, n° 76 ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 159, Leduc F. ; Resp. civ. et assur. 2008, étude 6, Hocquet-Berg S. ; JCP G 2008, II 10085, note Grosser P. ; JCP G 2008, I 186, n° 8, obs. Stoffel-Munck P. ; Contrats conc. consom. 2008, comm. 173, Leveneur L. ; D. 2008, p. 1582, obs. Gallmeister I. ; D. 2008, p. 1582, note Viney G. ; D. 2008, p. 2363, n° 7, obs. Creton C. ; D. 2008, p. 2894, obs. Brun P. ; D. 2009, p. 972, obs. Kenfack H. ; RTD civ. 2008, p. 312, obs. Jourdain P. ; RTD com. 2008, p. 843.
-
38.
Cass. 1re civ., 13 mars 2008, précit. V. aussi, même si certains ont pu douter de la portée de cette décision, Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12307 : Bull. ch. mixte, n° 3 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 4, Hocquet-Berg S. ; JCP G 2009, II 10011, note Grosser P. ; D. 2008, p. 3079, note Gallmeister I. ; D. 2009, p. 461, note Viney G. ; D. 2009, p. 972, obs. Kenfack H. ; RTD civ. 2009, p. 129, obs. Jourdain P.
-
39.
Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 04-18902 : Bull. ass. plén., n° 6 ; Resp. civ. et assur. 2006, étude 8, Bloch L. ; JCP G 2006, II 10087, note Grosser P. ; JCP E 2006, 2224, n° 11, obs. Legros C. ; Contrats conc. consom. 2006, comm. 152, Leveneur L. ; D. 2006, p. 1577, note Jourdain P. ; D. 2006, p. 1131, obs. Gallmeister I. ; D. 2006, p. 1566, Noguéro D. ; D. 2006, p. 1933, obs. Brun P. et 2645, obs. Fauvarge-Cosson B. ; Gaz. Pal. Rec. 2006, p. 2496, concl. de Gouttes R. ; Defrénois 30 août 2006, n° 38433, p. 1212, obs. Savaux E. ; RLDC 2006/29, n° 2129, note Mekki M. ; LPA 6 juill. 2006, p. 14, note Le Magueresse C. ; RDC 2006, p. 1083, obs. Laithier Y.-M. et 1207, obs. Viney G. ; RTD com. 2006, p. 904, obs. Bouloc B.
-
40.
La responsabilité est alors de nature extracontractuelle (Cass. 1re civ., 7 mars 1989, préc.) et engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
-
41.
Rias N., note ss Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12217 : D. 2016, p. 766.
-
42.
Telle est l’ambition de l’avant-projet Catala (avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 25 sept. 2005, Doc. fr. 2006, art. 1385), du projet rédigé dans le cadre de l’Académie des sciences morales et politiques (Terré F. (ss. dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, 2011, Dalloz, Thèmes et commentaires, art. 25), de l’avant-dernier Avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile, diffusé en avr. 2016, art. 1285) et du dernier projet de réforme du droit de la responsabilité présentés par la Chancellerie (Projet de réforme de la responsabilité civile, publié en mars 2017, art. 1285), qui n’excluent plus du champ d’application des dispositions relatives aux accidents de la circulation le transport ferroviaire.
-
43.
Delebecque P., note ss Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12217 : Énergie - Env. - Infrastr. 2016, comm. 48.
-
44.
JOUE L 119, 30 avr. 2013.
-
45.
Trib. UE, 5 févr. 2015, n° T-473/12, Aer Lingus, et n° T-500/12, Ryanair.
-
46.
Dans l’hypothèse inverse, où un opérateur ayant acquitté une taxe illégale l’a répercutée sur les acheteurs, ce qui peut faire obstacle à ce que cette taxe lui soit restituée (CJCE, 14 janv. 1997, n° C-192/95, Comateb).
-
47.
V. par ex. CJUE, 13 juin 2002, n° C-382/99, Pays-Bas c/ Commission, pt 60 et s.