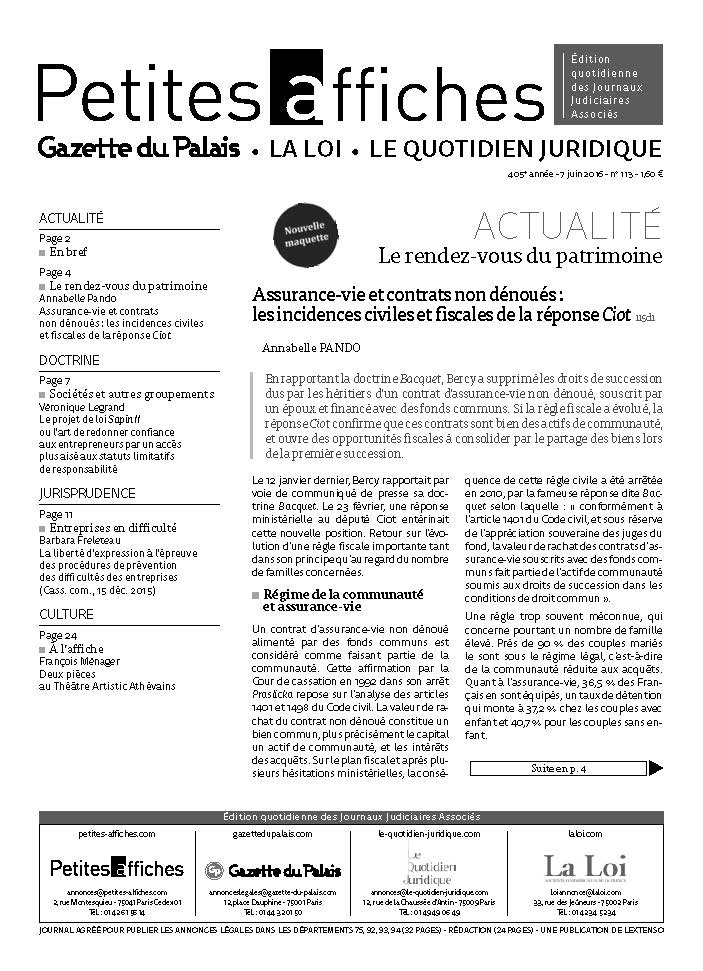« La réponse Ciot produit des effets fiscaux à consolider »


Quels sont les effets du changement de doctrine fiscale ? Qu’en est-il sur le plan civil ? Décryptage de l’impact de la réponse ministérielle Ciot pour les héritiers et le conjoint survivant par Pascal Julien Saint-Amand et Sophie Gonsard, membres du réseau notarial Althémis.
LPA : Quels sont les enseignements fiscaux apportés par la réponse Ciot ?
P. J. S.-A. et S. G. : Tout d’abord la réponse Ciot fixe la date à laquelle la réponse Bacquet est effectivement rapportée. Pour les décès intervenus entre le 29 juin 2010 et le 31 décembre 2015, la valeur de rachat des contrats non dénoués et financés avec des primes communes est taxée pour sa fraction entrant dans la succession du conjoint décédé. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, les héritiers n’ont plus à payer de droits de succession sur cette fraction de la valeur de rachat. Pour ceux pour lesquels cette prise en compte les aurait amenés à dépasser l’abattement fiscal personnel (100 000 euros par enfant par tranche de 15 années), ou ce qu’il en reste, cette évolution présente effectivement un allègement de la fiscalité.
LPA : Dès lors, que se passera-t-il sur le plan fiscal lors du dénouement du contrat ?
P. J. S.-A. et S. G. : Si le contrat n’a pas fait l’objet d’un rachat par le conjoint survivant, il se dénouera à son décès, et la fiscalité s’appliquera dans les conditions de droit commun de l’assurance-vie. Seuls les bénéficiaires désignés par le souscripteur seront imposés sur les capitaux transmis, ès qualité, même s’il s’agit par ailleurs des héritiers du conjoint décédé le premier. La réponse Ciot ne reporte pas au second décès l’imposition qui aurait été due lors du premier décès sous l’empire de la doctrine Bacquet, elle l’efface définitivement.
LPA : Quels enseignements civils tirer de la réponse Ciot ?
P. J. S.-A. et S. G. : La réponse Ciot confirme le caractère commun du contrat non dénoué financés avec des fonds communs, malgré l’analyse différente proposée par l’auteur de la question. Celui-ci conteste « une incohérence avec la substance même du contrat d’assurance-vie, qui est un contrat aléatoire, l’exécution de la prestation étant liée à un événement incertain ». Dès lors, il fait primer la règle de la propriété apparente, la théorie de l’accession et la nature de « patrimoine en instance d’affectation » de l’assurance-vie « dont l’attribution finale doit attendre le dénouement effectif du contrat » pour faire échec à l’application des effets des régimes matrimoniaux communautaires. La réponse Ciot se doit donc d’écarter cette analyse erronée du parlementaire, visant à créer une corrélation entre la règle fiscale et un sous-jacent civil. Elle débute donc, écartant cette polémique sans fondement selon nous, par une réaffirmation du principe selon lequel, « conformément à l’article 1401 du Code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat, fait partie de l’actif de communauté ».
LPA : Est-ce que la réponse Ciot éteint toutes les interrogations fiscales ?
P. J. S.-A. et S. G. : Pas vraiment. Il reste une question en suspens : celle de savoir si l’exonération dépend du fait que le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant soit le conjoint prédécédé. Cette question se pose parce que le texte même de la réponse vise la « valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat ». Si tel devait être le cas, cela impliquerait de justifier de l’identité du bénéficiaire du contrat du conjoint survivant lors de la succession du conjoint premier décédé. Cette justification pourrait prendre la forme d’une attestation de la compagnie d’assurance, mais lorsque la clause est testamentaire, la production du testament désignant le bénéficiaire n’est pas envisageable. D’autant qu’elle devrait être accompagnée d’une attestation sur l’honneur de son rédacteur, certifiant qu’il ne l’a pas modifiée ensuite. Cette condition d’identité du bénéficiaire écarterait aussi les co-adhésions avec dénouement au second décès. En effet, par construction, les deux époux seront décédés au jour du dénouement d’un tel contrat, ce qui exclut toute désignation du conjoint comme bénéficiaire. Si l’on s’en réfère au communiqué de presse Sapin qui dégage le principe de cette non-taxation, nous pensons plutôt que l’exonération de droits de succession au premier décès se fonde sur l’ignorance de l’identité des bénéficiaires finaux des capitaux décès, identité qui ressort du libre choix de l’époux souscripteur, avant comme après le décès de son conjoint survivant. Dès lors, l’exonération ne devrait pas être conditionnée par la désignation du conjoint comme bénéficiaire. Ce point mériterait d’être précisé par l’administration fiscale, car il n’est pas possible de faire dire au texte lui-même plus que ce qu’il n’écrit. En attendant, on peut signaler de manière pragmatique que par le passé, aucun contrôle n’est à notre connaissance intervenu sur cette question alors même que la rédaction des textes permettant de bénéficier de l’exonération visait la même configuration de contrat souscrit avec des fonds communs en faveur du conjoint. Pour autant, compte tenu de la complexité des enjeux et de la spécificité des fondements de cet avantage fiscal, il n’est pas exclu qu’une interprétation stricte prévale.
LPA : Comment tirer parti de la réponse Ciot ?
P. J. S.-A. et S. G. : La réponse Ciot entraîne bel et bien une diminution de la fiscalité de la base imposable au titre de la succession par rapport à celle calculée en application de la doctrine Bacquet, sans diminuer pour autant la valeur des droits des héritiers dans la succession (contrairement à d’autres interprétations du passé, par exemple la réponse ministérielle Bataille : JOAN 3 juill. 2000, n° 35728). Lors du premier décès, ses héritiers, conjoint et enfants, sont sur le plan civil considérés comme ayant hérité de la moitié des capitaux décès, et ce, sans droits de succession à payer. Dès lors, il est judicieux de chercher à consolider ces droits en procédant au partage des actifs de la succession entre les héritiers au décès du premier des époux, plutôt que de repousser ce partage au décès du conjoint survivant. Le partage permet ainsi de consolider l’avantage fiscal et sur le plan civil de « remettre les choses en ordre » en attribuant le contrat non dénoué au conjoint et d’autres actifs aux héritiers. Au décès du conjoint survivant la succession comprendra les biens attribués au conjoint par le partage, mais ces biens seront diminués de la valeur du contrat d’assurance-vie dont il est assuré et qui se dénoue à son décès (et éventuellement majorés du capital décès reçu en tant que bénéficiaire du contrat dénoué au décès de son conjoint). Avant comme après la réponse Ciot, en l’absence de partage les droits des enfants liés à la prise en compte civile du contrat non dénoué pour sa fraction dépendant de la succession risquent de ne pas être matérialisés.
LPA : Quel est le coût de ce partage ?
P. J. S.-A. et S. G. : Ce partage représente en effet un coût, puisqu’il entraîne une ponction fiscale de 2,5 % de la valeur nette partagée au titre du droit de partage, montant auquel s’ajoute le coût de la rédaction de l’acte. Mais il sera totalement ou partiellement couvert par l’allègement de la fiscalité afférente à la non prise en compte fiscale du contrat non dénoué. Surtout, le partage permet aux héritiers de préserver leurs droits. Il est donc particulièrement judicieux en familles recomposées. En l’absence de partage, les enfants non communs du conjoint décédé le premier n’héritent pas du conjoint survivant avec qui ils n’ont pas de lien direct, et n’ont pas vocation à être les bénéficiaires du contrat commun, dont leur beaux-parents est seul souscripteur et assuré. Le partage revêt pour eux toute son importance pour préserver leurs droits et éviter les contentieux futurs.
LPA : Est-ce que les solutions développées pour éviter les effets de la doctrine Bacquet gardent de leur pertinence ?
P. J. S.-A. et S. G. : Deux principaux types de stratégie ont été mis en œuvre : la souscription d’assurance-vie en co-adhésion avec dénouement au premier décès, et l’aménagement du régime matrimonial. Elles offrent la caractéristique commune d’éviter toute taxation entre les mains des enfants, parce que dans les deux cas, la valeur de rachat du contrat est extraite de la communauté, pour être attribuée au conjoint survivant :
-
par le biais de l’article L. 132-16 du Code des assurances s’agissant du contrat dénoué en faveur du conjoint (le capital décès est un propre du conjoint survivant, avec dispense de récompense à la communauté sauf primes exagérées),
-
par le biais d’une clause d’attribution intégrale de la communauté, ou une clause de préciput permettant au conjoint survivant de prélever certains actifs communs, dont le contrat d’assurance-vie non dénoué.
Selon nous, en matière de régimes matrimoniaux, la meilleure stratégie consiste à privilégier le préciput plutôt que l’attribution intégrale de la communauté car il laisse le choix au conjoint survivant de prélever ou non le contrat, selon ses besoins. Si ces droits lui suffisent, il laissera les capitaux dans la communauté et les héritiers du défunt pourront bénéficier des effets de la réponse Ciot. S’il a besoin d’accroître ses droits sur la succession de son conjoint, il prélèvera sur la communauté en priorité d’autres actifs, mais aussi, s’il l’estime judicieux, le contrat non dénoué. Le conjoint survivant pourra également prélever les contrats dont le conjoint n’était pas le bénéficiaire désigné, si l’administration fiscale devait réserver les effets fiscaux de la réponse Ciot aux contrats non dénoués dont le conjoint survivant est bénéficiaire.