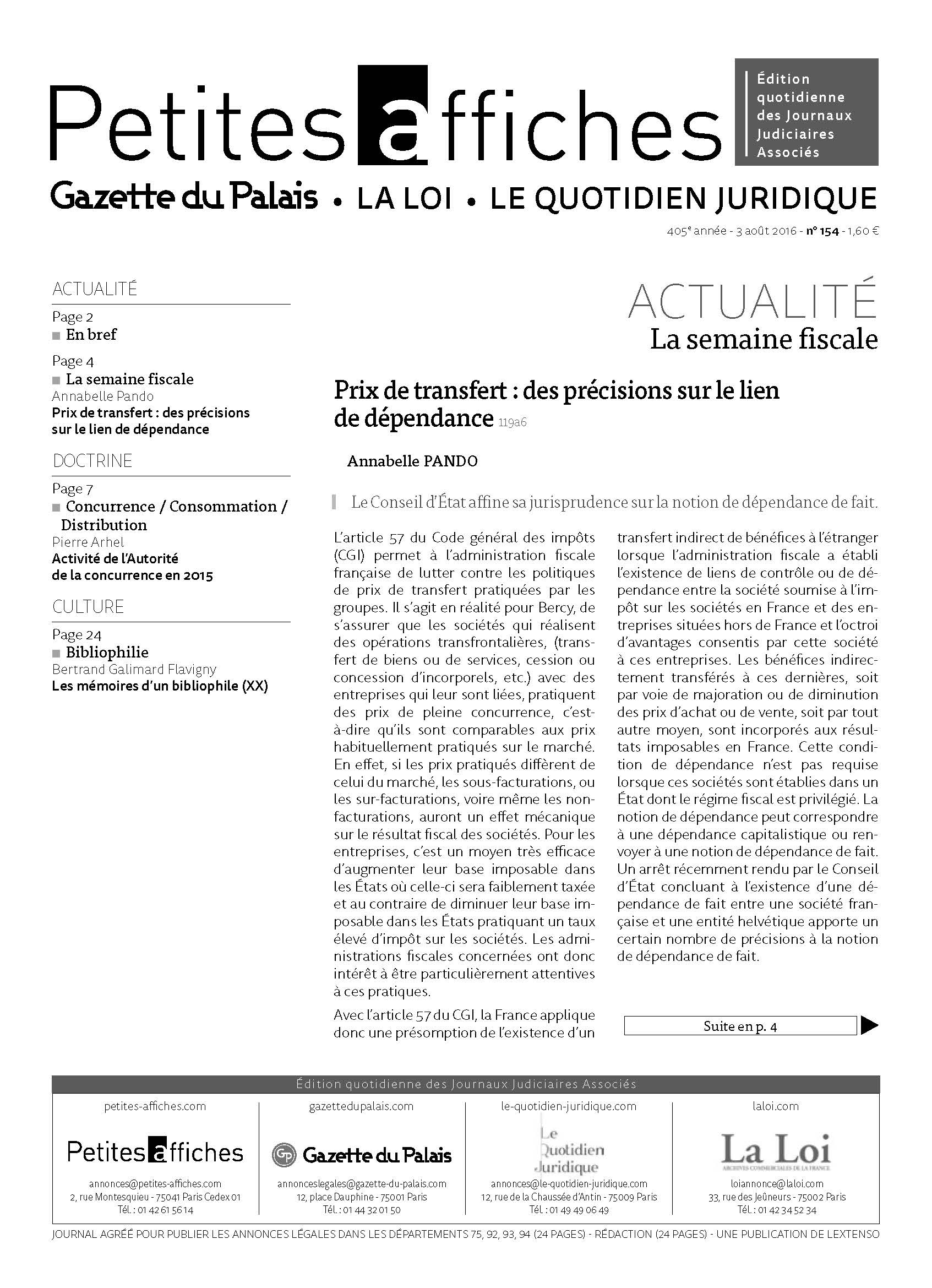Prix de transfert : des précisions sur le lien de dépendance
Le Conseil d’État affine sa jurisprudence sur la notion de dépendance de fait.
L’article 57 du Code général des impôts (CGI) permet à l’administration fiscale française de lutter contre les politiques de prix de transfert pratiquées par les groupes. Il s’agit en réalité pour Bercy, de s’assurer que les sociétés qui réalisent des opérations transfrontalières, (transfert de biens ou de services, cession ou concession d’incorporels, etc.) avec des entreprises qui leur sont liées, pratiquent des prix de pleine concurrence, c’est-à-dire qu’ils sont comparables aux prix habituellement pratiqués sur le marché. En effet, si les prix pratiqués diffèrent de celui du marché, les sous-facturations, ou les sur-facturations, voire même les non-facturations, auront un effet mécanique sur le résultat fiscal des sociétés. Pour les entreprises, c’est un moyen très efficace d’augmenter leur base imposable dans les États où celle-ci sera faiblement taxée et au contraire de diminuer leur base imposable dans les États pratiquant un taux élevé d’impôt sur les sociétés. Les administrations fiscales concernées ont donc intérêt à être particulièrement attentives à ces pratiques.
Avec l’article 57 du CGI, la France applique donc une présomption de l’existence d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger lorsque l’administration fiscale a établi l’existence de liens de contrôle ou de dépendance entre la société soumise à l’impôt sur les sociétés en France et des entreprises situées hors de France et l’octroi d’avantages consentis par cette société à ces entreprises. Les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats imposables en France. Cette condition de dépendance n’est pas requise lorsque ces sociétés sont établies dans un État dont le régime fiscal est privilégié. La notion de dépendance peut correspondre à une dépendance capitalistique ou renvoyer à une notion de dépendance de fait. Un arrêt récemment rendu par le Conseil d’État concluant à l’existence d’une dépendance de fait entre une société française et une entité helvétique apporte un certain nombre de précisions à la notion de dépendance de fait1. Rappelons qu’on recourt pour l’application de l’article 57 du CGI à la notion de dépendance de fait, conformément à la doctrine de l’administration fiscale, si la dépendance juridique ne peut être démontrée. Ce lien de dépendance peut être contractuel ou découler des conditions dans lesquelles s’établissent les relations entre deux entreprises.
Un contrat de distribution exclusif
La société LifeStand vivre debout (LSVD) exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de « fauteuils verticalisateurs » pour personnes handicapées ou à mobilité réduite. Le 7 janvier 2003, elle a conclu un contrat de distribution exclusif avec la société de droit suisse LifeStand international SA (LSI) chargeant cette dernière de la distribution des produits LifeStand dans le monde entier, excepté la France, l’Allemagne, la Grèce et les pays de l’Europe de l’Est. À l’issue de deux vérifications de comptabilité, l’administration fiscale a considéré, sur le fondement de l’article 57 du CGI, que la société LSVD avait indirectement transféré à la société LSI une partie de son bénéfice, compte tenu des sommes qu’elle lui avait versées en exécution du contrat de distribution exclusif. Elle a donc rehaussé à due concurrence le résultat imposable de la société LSVD pour les années 2003, 2004 et 2005 et l’a assujettie, dans cette mesure, à une retenue à la source au taux de 18 %.
Sa réclamation devant l’administration fiscale s’étant révélée infructueuse, la société LifeStand vivre debout a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes et, d’autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006. Le tribunal administratif de Lyon, après avoir déchargé la société des pénalités correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande2. La cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société LSVD contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable3. La société LSVD s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’État, demandant à la haute juridiction d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon et, en réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Une dépendance de fait
Le Conseil d’État commence par rappeler que l’existence d’un lien de dépendance entre deux sociétés, pour l’application de l’article 57 du CGI, n’est pas subordonnée à celle d’un lien capitalistique ou à la présence de dirigeants de droit communs. Dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une dépendance de fait de la société LSI à l’égard de la société LSVD pour considérer que ces dispositions anti-abus étaient applicables. Le Conseil d’État revient ensuite sur les relations existant entre les deux sociétés au moment des faits et qui ont conduit la cour administrative d’appel à l’existence d’une dépendance de fait entre ces deux entités. Pour juger que la société LSI était placée sous la dépendance de la société LSVD, la cour a notamment relevé, en premier lieu, qu’elle était établie en Suisse à une adresse de domiciliation sans qu’aucun loyer afférent à des locaux commerciaux ne figure dans sa comptabilité au titre de 2004. Elle a relevé en deuxième lieu, que l’essentiel des fonctions confiées à la société LSI continuaient à être exercé par la société LSVD, qui conservait la maîtrise de la production des documents relatifs aux actions de promotion de la société LSI ainsi que le développement de son site internet. Enfin, la cour a précisé le gérant de la société LSVD exerçait en fait la direction et le contrôle de la société LSI. En regardant ces faits, qu’elle a souverainement appréciés, comme caractérisant la dépendance de fait de la société LSI à l’égard de la société LSVD, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique, conclut le Conseil d’État. Il est à noter que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État4, la notion de dépendance de fait ne peut se réduire à la seule constatation d’une dépendance économique. Ainsi ni une étroite communauté d’intérêt unissant deux sociétés, et démontrée, notamment, par le fait qu’aucun contrat ne régissait leurs relations commerciales, ni le fait que dans les motifs d’un arrêt confirmant la condamnation pour fraude fiscale du dirigeant de la société française, il a été constaté qu’il y avait une interdépendance économique entre les sociétés et que la première était tributaire de la seconde, tant pour ses approvisionnements que pour la fixation des prix ne suffisent à caractériser l’existence d’un lien de dépendance au sens de l’article 57 du CGI.
Articulation de la convention franco-suisse avec l’article 57 du CGI
L’article 9 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 permet à l’administration fiscale française de faire application de l’article 57 du CGI relatif à la réintégration de bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France, comme l’a déjà souligné le Conseil d’État5. En effet, en vertu des stipulations de l’article 9 de la convention fiscale franco-suisse6, lorsqu’une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, ou au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans et l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Un exercice de comparaison nécessaire
Lorsque l’Administration constate que les prix payés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres fournisseurs dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des fournisseurs dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s’explique par la situation différente de ces fournisseurs, l’Administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. À défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’Administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer une présomption de transfert de bénéfices mais doit établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
En l’espèce, il incombait à la cour, une fois établie l’existence d’un lien de dépendance entre la société LSI et la société LSVD, soit de vérifier si le taux de commission de 25 % prévu par le contrat de distribution était supérieur à ceux que des entreprises similaires exploitées normalement pratiquaient avec des fournisseurs dépourvus de liens de dépendance avec elles pour des prestations telles que celles dont ce contrat prévoyait la fourniture, soit, à défaut, de rechercher si l’Administration établissait que la société LSVD avait consenti à la société LSI une libéralité en acquittant un prix excessif pour les prestations qu’elle avait reçues d’elle. Or les juges du fond n’ont pas recherché si le taux de commission de 25 % devait en l’espèce être regardé comme normal. Ils n’ont d’autre part, pas regardé comme entièrement dépourvue de contrepartie l’intervention de la société LSI. Cependant, il leur incombait de rechercher si l’Administration avait établi que la société LSVD avait acquitté un prix excessif pour les prestations en cause. Faute d’une telle recherche, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon doit être, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, annulé.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Amycel7 dont elle reprend le considérant. Avec cette jurisprudence, le Conseil d’État a précisé qu’en matière de prix de transfert, l’administration fiscale doit démontrer l’irrégularité des prix de ventes pratiqués en examinant les prix pratiqués auprès de clients se trouvant dans une situation comparable. Dans cette affaire, la société Amycel France ayant pour activité la production et la commercialisation de mycélium contestait le redressement que l’administration fiscale avait mis à sa charge au titre des exercices 2007 et 2008. Pour l’administration fiscale, la société Amycel France, ayant pour société mère une société américaine appartenant au groupe Monterrey mushrooms, vendait ses produits à ses sociétés sœurs situées au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, Amycel UK et Amycel NL, à des prix inférieurs à ceux qu’elle pratiquait avec les tiers et réalisait ainsi un transfert de bénéfices tombant sous le coup de l’article 57 du CGI. Le Conseil d’État a donné raison à la société et annulé l’arrêt rendu par les juges du fond pour erreur de droit, dans la mesure où ils se sont abstenus de rechercher si l’écart de prix constaté pouvait s’expliquer, comme le soutenait la société, par la différence de situation entre les sociétés sœurs qui étaient des distributeurs et les clients tiers qui étaient des consommateurs finaux.
Notes de bas de pages
-
1.
CE, 15 avr. 2016, n° 372097, D.
-
2.
TA Lyon, 28 déc. 2010, nos 0901811, 0901806 et 0901873.
-
3.
CAA Lyon, 11 juill. 2013, nos 11LY00819 et 11LY00678.
-
4.
CE, 18 mars 1994, nos 68799 et 70814, SA Sovemarco-Europe.
-
5.
Ibid.
-
6.
Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée.
-
7.
CE, 16 mars 2016, n° 372372, Société Amycel France.