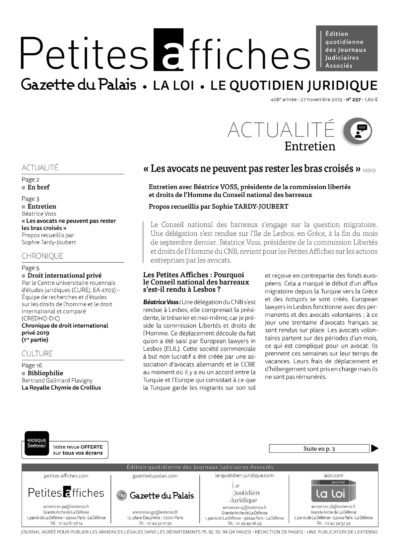Chronique de droit international privé 2019 (1re partie)
Cette chronique de droit international privé dirigée par le Centre universitaire rouennais d’études juridiques, couvre l’année 2019.
I – L’adoption constitue-t-elle une voie satisfaisante pour reconnaître le lien de filiation entre le parent d’intention et l’enfant issu d’une gestation pour autrui à l’étranger ?
1. En l’état actuel du droit positif, la reconnaissance du lien de filiation du père biologique de l’enfant issu d’une gestation pour autrui (GPA) à l’étranger n’est pas appréhendée de la même façon que celle des autres parents d’intention, qu’il s’agisse de la mère d’intention ou, plus largement, du parent d’intention qui n’est pas le géniteur l’enfant.
2. Dès 2014, et à plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation qui refusait de reconnaître tout lien de filiation entre les parents d’intention et l’enfant issu d’une GPA à l’étranger, y compris dans le cas où le parent d’intention était également le géniteur, en s’opposant tant à la transcription des actes étrangers sur les registres d’état civil français1, qu’à l’établissement de la filiation en droit interne2. La CEDH a alors conclu à la violation du droit au respect de la vie privée des enfants, dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de cassation faisait « obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne de leur lien de filiation à l’égard de leur père biologique ». Or, la Cour a rappelé que le respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme implique que « chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain » dont la filiation est un aspect essentiel3. Après cette condamnation, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en admettant la transcription des actes étrangers des enfants issus d’une GPA sur les registres de l’état civil français dès lors que, en vertu de l’article 47 du Code civil, ils ne sont ni irréguliers ni falsifiés et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité4. Ainsi, la transcription est intégrale lorsque l’acte désigne le père biologique et la femme qui a accouché comme étant les parents de l’enfant issu de la GPA. Elle n’est que partielle lorsque l’acte désigne le père biologique et le second parent d’intention comme étant les parents de l’enfant issu de la GPA5. La transcription des actes étrangers à l’égard du père biologique est une solution désormais acquise6. Bien que la transcription ne permette pas d’établir un lien de filiation incontestable7, en pratique, elle constitue une reconnaissance de la filiation établie à l’étranger8.
En revanche, cette solution laisse entière la délicate question de la parenté d’intention. En s’appuyant sur l’article 47 du Code civil, la Cour de cassation refuse la transcription des actes étrangers dès lors qu’ils désignent la mère d’intention comme parent de l’enfant issu d’une GPA parce que, selon elle, la réalité au sens de ce texte est celle de l’accouchement9. Afin de pondérer ce refus, la Cour de cassation a ouvert la voie de l’adoption tant pour la mère d’intention dans un couple hétérosexuel10 que pour le père d’intention dans un couple homosexuel11, si les conditions légales sont remplies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cadre du réexamen de l’affaire Mennesson rendu possible par la loi du 18 novembre 201612, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a sursis à statuer et a sollicité pour la première fois l’avis de la CEDH à propos de la maternité d’intention13. Cette procédure a été introduite par le protocole n° 16, entré en vigueur le 1er août 2018, qui permet aux plus hautes juridictions des États parties d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour. La Cour de cassation a posé deux questions à la CEDH :
1°) En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui en ce qu’il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d’intention », alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le « père d’intention », père biologique de l’enfant, un État partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d’intention » ?
2°) Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ?
3. La CEDH ne s’était jamais explicitement prononcée sur la question de la maternité d’intention. Par cette demande d’avis, la Cour de cassation demande finalement à la CEDH de se prononcer sur la compatibilité de sa jurisprudence avec l’article 8 de la Convention. La CEDH a rendu son avis le 10 avril 201914. Il en résulte que le respect de la vie privée de l’enfant implique une reconnaissance d’un lien de filiation entre celui-ci et sa mère d’intention mais, au regard de la marge d’appréciation des États parties, cette reconnaissance ne passe pas nécessairement par la transcription de l’acte de naissance étranger ; l’adoption de l’enfant peut y suppléer. La CEDH conforte ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation. À ce titre, l’adoption permet de reconnaître le lien de filiation entre la mère d’intention et l’enfant issu d’une GPA à l’étranger. Cette solution a vocation à s’étendre à l’ensemble des parentés d’intention en matière de GPA, y compris au sein d’un couple homosexuel, ainsi qu’en matière d’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger15. Eu égard à la jurisprudence de la CEDH et à son avis consultatif, il semble que la Cour de cassation soit enfin parvenue à une solution pérenne. L’adoption, initialement destinée à donner une famille à un enfant qui n’en a pas, est également devenue l’aboutissement en France du processus de GPA réalisé à l’étranger. À ce titre, il convient de déterminer si, dans ce cadre, le recours à l’adoption est satisfaisant au regard de son esprit, de la législation qui y est relative, des droits et intérêts de chacun, et du but poursuivi. Si l’adoption permet d’aboutir à une solution de compromis (I), elle constitue un mécanisme imparfait (II).
I. L’adoption, une solution de compromis
4. La Cour de cassation est parvenue à un point d’équilibre entre le rejet de la pratique des mères porteuses et le droit de l’enfant au respect de sa vie privée (A). Néanmoins, l’adoption apparaît comme un rempart illusoire à décourager la pratique et à préserver la mère porteuse ou l’enfant (B).
A. Un point d’équilibre entre le rejet de la GPA et le droit de l’enfant au respect de sa vie privée
5. La lecture de l’avis de la CEDH met en évidence que la solution à laquelle est parvenue la Cour de cassation est une solution de compromis.
En réponse à la première question posée, la Cour se réfère d’abord au principe selon lequel, chaque fois qu’est en cause la situation d’un enfant, son intérêt supérieur doit primer. Elle constate que l’absence de reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant né d’une GPA à l’étranger et sa mère d’intention a des conséquences négatives sur plusieurs aspects du droit de l’enfant au respect de sa vie privée. Ensuite, la Cour met en balance ces aspects avec d’autres impératifs tels que la protection contre les risques d’abus de la GPA et la connaissance de ses origines. Néanmoins, elle conclut que l’impossibilité générale et absolue de parvenir à la reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention n’est pas conciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant. La marge d’appréciation des États parties est réduite dans les cas où un aspect particulièrement important de l’identité de l’individu est en cause et, à ce titre, le droit interne doit offrir une possibilité de reconnaître ce lien, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’enfant a été conçu avec les gamètes de la mère d’intention ou non. Ainsi, les États parties doivent faire en sorte de reconnaître le lien de filiation entre l’enfant et sa mère d’intention.
S’agissant de la seconde question, la CEDH considère que le choix des moyens à mettre en œuvre pour reconnaître ce lien relève de la marge d’appréciation des États. L’intérêt de l’enfant implique que le lien légalement établi à l’étranger soit reconnu au plus tard lorsqu’il s’est concrétisé. Il appartient aux États de déterminer à partir de quand ce lien s’est concrétisé. En revanche, le droit au respect de la vie privée de l’enfant n’impose pas la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte légalement établi à l’étranger. La reconnaissance du lien entre la mère d’intention et l’enfant issu d’une GPA peut s’effectuer par d’autres moyens, comme celui de l’adoption.
L’avis de la CEDH ne concerne que la maternité d’intention mais la Cour de cassation semble vouloir étendre l’adoption par le parent d’intention ayant eu recours à une GPA à la situation des couples homosexuels. La haute juridiction avait déjà considéré en 2017 que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas obstacle, en lui-même, au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant »16. Puis, le 20 mars dernier, la Cour de cassation a sursis à statuer dans une affaire dans laquelle un couple d’hommes avait eu recours à une mère porteuse en Californie. L’un d’eux étant père biologique, la cour d’appel de Rennes a ordonné la transcription partielle des actes de naissance avec la mention de ce dernier, mais a refusé la transcription de la mention relative à son conjoint. Un pourvoi a été formé contre le refus de la transcription du conjoint et la Cour de cassation a considéré que cette question « présente un lien suffisamment étroit avec la question de la “maternité d’intention” pour justifier qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la Cour européenne des droits de l’Homme et de l’arrêt de l’assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° 10-19053 »17. La position de la Cour de cassation met en évidence son intention de généraliser à la paternité d’intention, et plus généralement aux parentés d’intention, l’avis donné par la CEDH18.
6. Depuis 2017, plusieurs adoptions d’enfants issus de GPA à l’étranger par le parent d’intention ont été prononcées, que ce soit en la forme simple19 ou plénière20. Ce « montage », envisagé pour éviter une condamnation de la CEDH21, marque le rejet de la pratique des mères porteuses. Il permet également de se conformer au principe traditionnel français selon lequel la mère est celle qui accouche en évitant de passer par la possession d’état ou la reconnaissance de maternité. Il conduit enfin à préserver l’intérêt de l’enfant. En ce sens, le recours à l’adoption est satisfaisant en ce qu’il constitue un point d’équilibre entre tous ces impératifs. Néanmoins, contrairement à ce que semblait sous-entendre la Cour de cassation, il ne permet pas de préserver l’enfant et la mère porteuse ou de décourager la pratique.
B. L’adoption, un rempart illusoire
7. Selon la Cour de cassation, le refus de transcrire la parenté d’intention poursuit un but légitime dans la mesure où il vise « à la protection de l’enfant et de la mère porteuse » et « à décourager la pratique de la GPA prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil »22. La CEDH, dans son avis, a également pris en compte, à l’égard de l’enfant, « la protection contre les risques d’abus que comporte la GPA »23.
S’agissant de la mère porteuse, l’objectif est de s’assurer que l’établissement d’une autre maternité (ou paternité pour un couple homosexuel) que la sienne ne soit pas réalisé contre sa volonté. En droit positif, les parents légaux doivent consentir à l’adoption (C. civ., art. 347 et C. civ., art. 348). Cependant, le consentement du parent d’origine qui n’a plus aucun lien légal avec l’enfant n’est plus requis24. Dès lors, le consentement de la mère porteuse ne devrait être demandé que lorsqu’un lien de filiation est établi à l’étranger à son égard, c’est-à-dire lorsqu’elle figure dans l’acte de naissance étranger de l’enfant issu d’une GPA. À défaut, exiger son consentement va au-delà des conditions posées par la loi25. Il en résulte que, par principe, l’adoption n’est pas en mesure de préserver la mère porteuse dans la situation où sa filiation n’est pas établie à l’égard de l’enfant qu’elle a mis au monde. Cependant, certains juges ont refusé de prononcer l’adoption en exigeant la preuve que la mère porteuse avait renoncé volontairement à sa filiation en se rattachant à l’intérêt de l’enfant26.
La préservation de l’enfant implique qu’il puisse avoir accès à ses origines. Cependant, dans un certain nombre de cas, aucun lien de filiation n’est établi entre l’enfant et la mère porteuse qui ne figure pas dans l’acte de naissance étranger. Par ailleurs, dans le cas où la mère porteuse serait mentionnée dans les actes étrangers de l’état civil, le recours à l’adoption plénière, admis par la jurisprudence, rompt tous les liens entre l’enfant et la famille d’origine. L’enfant sera alors coupé de tout lien avec la mère porteuse.
Enfin, il est difficile de voir en quoi l’adoption serait susceptible de décourager la pratique : on imagine mal un couple renoncer à la GPA à l’étranger parce que le parent d’intention devra recourir à l’adoption en France27.
Le recours à l’adoption constitue un rempart illusoire : il ne permet pas de préserver la mère porteuse ainsi que l’enfant, et il n’est pas à même de décourager la pratique.
II. L’adoption, un mécanisme imparfait
8. Le recours à l’adoption en matière de GPA comporte de nombreuses insuffisances inhérentes aux règles qui la gouvernent (A). En outre, l’esprit dans lequel elle a été érigée en droit français n’est pas adapté à la GPA (B).
A. Les insuffisances inhérentes à la législation relative à l’adoption
9. L’adoption de l’enfant issu d’une GPA à l’étranger par le parent d’intention n’est ouverte que si les conditions légales sont remplies. Ainsi, les règles inhérentes à l’adoption en droit français, qui s’appliquent lorsque l’adoptant est français, limitent la reconnaissance du lien de filiation entre le parent d’intention et l’enfant issu d’une GPA. Parmi les conditions érigées en droit français, la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté doit être respectée (C. civ., art. 344), le consentement du ou des parents légaux est requis (C. civ., art. 347 et C. civ., art. 348), et l’adoption doit être dans l’intérêt de l’enfant (C. civ., art. 353, al. 1er). Mais la condition la plus restrictive est celle du mariage. L’adoption plénière du compagnon non marié est exclue parce qu’elle anéantirait la première filiation (C. civ., art. 356)28. L’adoption simple du compagnon non marié est également impossible parce qu’elle aboutirait à la perte de l’autorité parentale du parent légal (C. civ., art. 365, al. 1er)29. Ainsi le recours à l’adoption par le parent d’intention n’est possible que si ce dernier est marié avec le parent biologique de l’enfant issu d’une GPA. Le mécanisme de l’adoption constitue une source de discrimination entre les couples d’une part, et entre les enfants en fonction du statut juridique du couple qui a eu recours à la GPA d’autre part. L’adoption n’est alors pas de nature à permettre la reconnaissance de toutes les parentés d’intention. En outre, l’adoption retarde l’établissement de la filiation vis-à-vis du parent d’intention, ce qui peut soulever des difficultés en cas de survenance d’un conflit dans le couple ou d’une séparation30. Dans une telle situation, le parent biologique dont la filiation aura été transcrite pourra s’opposer à l’adoption.
Les règles relatives à l’adoption ne sont pas adaptées à la reconnaissance du lien de filiation entre le parent d’intention et l’enfant issu d’une GPA. En outre, la GPA n’est pas en adéquation avec l’esprit de l’adoption.
B. Le détournement de l’esprit de l’adoption
10. L’adoption tend à donner une famille à un enfant qui n’en a pas. Cet objectif s’accorde mal avec la reconnaissance du lien de filiation entre le parent d’intention et l’enfant issu d’une GPA. Ce dernier ne se trouve à aucun moment dans une situation d’abandon stricto sensu dans la mesure où, dès sa conception, une famille l’attend.
Le caractère inapproprié de l’adoption à la situation de GPA apparaît de manière plus criante dans le cas où la mère d’intention est également la mère biologique au sens scientifique du terme. En droit français, la mère est nécessairement celle qui accouche. Il y a ainsi une différence de traitement entre l’appréhension de la paternité et de la maternité. Néanmoins, la mère d’intention qui a fourni ses ovocytes pour la conception de l’enfant issu d’une GPA est la mère génétique au même titre que le père qui a donné ses gamètes. En ce sens, l’adoption qui reflète la vérité biologique et non la vérité sociologique n’est pas satisfaisante pour la mère génétique de l’enfant31. En outre, si la mère d’intention qui a fourni ses ovocytes pour la conception de l’enfant issu d’une GPA n’est pas mariée au père biologique, elle ne pourra pas recourir à l’adoption. Cette situation semble contraire à la jurisprudence de la CEDH selon laquelle la filiation biologique est un aspect essentiel de l’identité d’une personne.
Dans son avis, la CEDH semble avoir conscience de l’inopportunité de recourir à l’adoption pour la mère génétique. En effet, l’affaire Mennesson, sur laquelle l’avis est sollicité, vise la situation où la mère d’intention n’est pas la mère génétique de l’enfant. Or, s’agissant de la réponse à la première question, la CEDH prend soin de préciser que la nécessité d’offrir une possibilité de reconnaissance du lien de filiation vaut également dans le cas où la mère d’intention est la mère génétique. En revanche, sur le second point, la CEDH semble ne viser que la situation dans laquelle la mère d’intention n’est pas la mère génétique. Il est donc possible de penser que l’adoption de l’enfant issu d’une GPA dans le cas où la mère d’intention est également la mère génétique de l’enfant ne serait pas conforme à l’article 8 de la Convention.
11. Si l’adoption permet aujourd’hui de trouver un point d’équilibre entre le rejet de la GPA et le droit au respect de la vie privée de l’enfant qui en est issu, elle constitue en réalité une solution de transition inadaptée qui évite toute réflexion approfondie sur les fondements de la filiation32. La reconnaissance du lien de filiation entre le parent d’intention et l’enfant issu d’une GPA à l’étranger devrait être réalisée par un mécanisme sui generis adaptée à cette pratique33. Ce mécanisme naîtra peut-être du groupe d’experts sur le projet Filiation/Maternité de substitution de la Conférence de La Haye dont la dernière concertation a eu lieu en janvier et février derniers. À ce jour, la question de la reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et ses parents d’intention lorsqu’aucun d’eux n’est le géniteur demeure. De même, la question de la reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et ses parents d’intention lorsque la GPA a eu lieu en France reste posée.
Anne-Violette VINCENT
II – L’ordre public de proximité européen et les répudiations musulmanes (Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-16102)
Les répudiations unilatérales ont fait l’objet d’une jurisprudence évolutive34 qui reflète la difficulté à laquelle est confronté le droit international privé lorsqu’il s’agit de coordonner des ordres juridiques aux dispositions substantiellement divergentes en matière de droit de la famille. Pour mémoire, les arrêts du 17 février 200435 de la Cour de cassation ont freiné l’accueil des répudiations unilatérales en affirmant que les décisions prononçant cette forme de désunion étaient contraires au principe d’égalité des époux consacré à l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et partant à l’ordre public international dès lors que l’épouse était ressortissante française ou domiciliée en France. Bien que cette solution ait jusqu’alors donné lieu à une jurisprudence constante, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 201836 nous enseigne que le sort des répudiations unilatérales n’est pas définitivement scellé. En l’espèce, il s’agissait d’un couple de bi-nationaux, de nationalité française et algérienne, marié en 1965 en Algérie. Le 9 juillet 2012, l’épouse saisit le juge aux affaires familiales d’une requête en séparation de corps. À la suite d’une demande reconventionnelle de l’époux en divorce, le juge aux affaires familiales de Colmar prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’époux interjette appel de cette décision en soulevant l’autorité de chose jugée d’un jugement algérien ayant prononcé la désunion du couple par la volonté unilatérale de l’époux. Par un arrêt infirmatif du 15 décembre 201537, la cour d’appel de Colmar a déclaré la demande de l’épouse irrecevable au regard du jugement de divorce algérien ayant autorité de la chose jugée. Au visa de l’article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et de l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la CEDH, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en affirmant que la décision rendue par les juridictions algériennes, consacrant une répudiation unilatérale, était « contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international, dès lors que les époux de nationalité algérienne sont domiciliés sur le territoire d’un État contractant, même s’ils sont séparés ». La Cour confirme une innovation apportée à sa solution de principe en procédant à une libéralisation des conditions de déclenchement de l’ordre public de proximité38 : le jeu de ce mécanisme correcteur n’est plus cantonné à un rattachement avec l’ordre juridique français. Ce faisant, cet arrêt participe à la consécration d’un ordre public de proximité étendu à l’espace européen des droits de l’Homme (I) dont les conditions de mise en œuvre doivent être identifiées (II).
I. Le rejet des répudiations unilatérales étrangères fondé sur l’ordre public de proximité européen
La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 juillet 2018, opère une rupture avec la solution jurisprudentielle issue des arrêts du 17 février 2004, au regard du lien de rattachement exigé dans la mise en œuvre de l’ordre public de proximité. Tandis que la jurisprudence antérieure retenait le jeu de l’ordre public de proximité en présence d’une épouse française ou domiciliée en France, la Cour de cassation, dans sa décision du 4 juillet 2018, fait application de ce mécanisme correcteur lorsque le couple est domicilié sur le territoire d’un État contractant à la CEDH. Dans le cadre des répudiations étrangères, l’ordre public de proximité européen semble se substituer à l’ordre public de proximité traditionnel. Ce n’est pas la première fois que la haute juridiction rejette une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée à l’étranger en se fondant sur cet ordre public de proximité étendu. Par un arrêt du 15 avril 201539 suivi d’une décision du 25 mai 201640, la Cour avait déjà affirmé que l’ordre public de proximité jouait à l’encontre des répudiations étrangères à la condition que le domicile du couple soit situé sur le territoire d’un État contractant. Bien que ces décisions aient pu paraître isolées41, le maintien de leur solution par l’arrêt du 4 juillet 2018 illustre la volonté de la Cour de cassation d’imposer une nouvelle modalité d’intervention de l’ordre public de proximité. Cette décision s’inscrit alors dans la continuité en rappelant que l’ordre public de proximité conditionne toujours le sort des répudiations unilatérales étrangères42. Le maintien de l’ordre public de proximité en matière de désunion unilatérale sur la volonté discrétionnaire de l’époux illustre la fonction particulière de l’ordre public de proximité. L’ordre public international intervient en tant que mécanisme correcteur afin de sauvegarder les valeurs de l’ordre juridique du for43. L’ordre public de proximité, quant à lui, a vocation à protéger les droits subjectifs44. En décidant qu’une répudiation unilatérale ne peut être opposée à l’épouse dès lors que le couple est domicilié sur le territoire d’un État contractant, la Cour de cassation a étendu le champ de protection couvert par l’ordre public de proximité. La Cour s’inscrit dans une volonté de protéger les droits subjectifs des épouses qui relèvent de sa juridiction, en raison des liens que le couple entretient avec un État qui partage les mêmes valeurs de justice substantielle que l’ordre juridique français45. La Cour vient affirmer que toute répudiation obtenue à l’étranger sera rejetée, que le couple soit rattaché à la France ou à tout autre État contractant. Par conséquent, tous les couples domiciliés sur le territoire d’un État contractant à la CEDH verront leur désunion placée sous l’empire du principe d’égalité des époux consacré par ce texte conventionnel, sans qu’un lien de rattachement spécifique avec le for ne soit exigé. Tandis que les arrêts du 17 février 2004 ont renforcé le contenu de l’ordre public46, l’arrêt du 4 juillet 2018 opère un élargissement de l’aire de protection des droits fondamentaux par le recours à un ordre public de proximité européanisé.
Néanmoins, il est permis de questionner la pertinence de la substitution de l’ordre public de proximité européen à l’ordre public de proximité traditionnel. D’une part, la Cour européenne a déjà eu l’occasion de répondre positivement à la question de la conformité au droit européen de la jurisprudence française relative aux répudiations prononcées à l’étranger47. Ainsi l’application de l’ordre public de proximité, dans sa conception traditionnelle, répondait aux exigences de la CEDH. D’autre part, dans l’arrêt du 4 juillet 2018, la Cour aurait pu tenir en échec la répudiation étrangère en maintenant sa jurisprudence antérieure issue des décisions du 17 avril 2004. En l’espèce, le domicile des époux était situé sur le territoire français et les époux étaient tout à la fois ressortissants algériens et français. Il en résulte que les rattachements de la situation à l’ordre juridique français suffisaient à faire jouer l’effet d’éviction attaché à l’ordre public de proximité. Ainsi, le recours à l’ordre public de proximité européen peut paraître superfétatoire dans la mesure où il résulte de son application une solution identique à celle qui aurait résulté de l’application de l’ordre public de proximité classique.
Cependant, bien que n’ayant aucune incidence sur le cas d’espèce commenté, le changement d’ordre juridique de référence48 opéré par la Cour de cassation se justifie sur le plan théorique en offrant une solution plus cohérente que celle consacrée par la jurisprudence antérieure49. En effet, une partie de la doctrine avait critiqué l’inadéquation des liens de proximité déclenchant l’ordre public de proximité avec la source du principe méconnu par les répudiations musulmanes50. Dans la mesure où le principe d’égalité des époux est issu d’une norme européenne, le jeu de l’ordre public de proximité cloisonné aux situations exclusivement rattachées à l’ordre juridique français peinait à trouver une justification. Puisque « le droit de ne pas se faire répudier »51 est consacré par une norme européenne, l’appréciation des liens de proximité doit s’effectuer au regard d’un rattachement entre la situation et un État contractant à la Convention européenne. Ainsi, le maintien de la solution du 15 avril 2015 et du 25 mai 2016, par l’arrêt du 4 juillet 2018 témoigne de la volonté de consacrer de manière pérenne la notion d’ordre public de proximité européen. Il restera alors à préciser les conditions de mise en œuvre de cet ordre public de proximité revisité.
II. Les conditions de mise en œuvre de l’ordre public de proximité européen
Les conditions de mise en œuvre de l’ordre public de proximité exigent de s’intéresser au lien de proximité retenu par l’arrêt du 4 juillet 2018 pour refuser d’accueillir les décisions étrangères consacrant une désunion fondée sur le droit pour le mari de mettre fin de façon discrétionnaire au mariage. La Cour retient que l’ordre public de proximité européen tenait en échec la décision algérienne dès lors que les époux « de nationalité algérienne sont domiciliés sur le territoire d’un État contractant ». Les arrêts du 15 avril 2015 et du 25 mai 2016, qui avaient déjà fait obstacle à la désunion par volonté unilatérale de l’époux sur le fondement de l’ordre public de proximité européen, retenaient le même critère. L’arrêt du 4 juillet 2018 précise cependant que ce lien de proximité déclenche l’ordre public de proximité européen « même s’ils sont séparés ». Ainsi, le départ à l’étranger de l’époux qui souhaite délocaliser la dissolution de son mariage est sans incidence sur le jeu de l’ordre public de proximité européen. Par conséquent, la Cour de cassation s’est calquée sur l’ordre public de proximité traditionnel pour déclencher l’ordre public de proximité européen en ayant recours au critère du domicile. En effet, dans les arrêts du 17 février 2004, l’accueil des répudiations musulmanes était tenu en échec dès lors que le domicile du couple52 ou de la femme53 se situait sur le territoire français. Il y a donc une analogie entre l’ordre public de proximité traditionnel et l’ordre public de proximité européen qui repose sur la nature du critère retenu lors de leur mise en œuvre. La Cour de cassation admet que le domicile suffit à déclencher l’effet d’éviction attaché à l’exception d’ordre public en matière de répudiation, sans égard à l’ordre juridique de référence.
Cependant, l’ordre public de proximité européen se distingue de l’ordre public traditionnel. En effet, les arrêts qui ont suivi les décisions du 17 février 2004 ont tantôt retenu le critère du domicile de la femme, et a fortiori celui du couple, tantôt retenu le critère de la nationalité54 pour rattacher la situation à l’ordre juridique français. Les répudiations musulmanes étrangères sont rejetées dès lors que la situation est rattachée à l’ordre juridique français, soit en raison de la localisation du domicile de la femme ou du couple sur le territoire français, soit en raison de la nationalité commune du couple. Or, l’arrêt du 4 juillet 2018 ne fait jouer l’ordre public de proximité européen que si le domicile du couple est situé sur le territoire d’un État contractant. La Cour de cassation ne fait donc pas référence à la nationalité de la femme ou du couple lorsqu’elle retient l’ordre public de proximité étendu à la sphère européenne55. Il est pourtant permis de s’interroger sur l’opportunité de refuser l’accueil aux répudiations musulmanes prononcées à l’encontre d’une ressortissante d’un État contractant, lorsque le domicile du couple est situé sur le territoire d’un État tiers à l’espace européen. Manifestement, le sort des répudiations unilatérales prononcées à l’étranger ne semble toujours pas scellé.
Charlotte MEBAREK
III – De très anciennes dispositions sexistes en matière de nationalité devant le Conseil constitutionnel (Cons. const., 5 oct. 2018, n° 2018-737 QPC)
À l’origine de cette affaire, un homme chilien né au Chili en 1924 souhaite se voir reconnaître la nationalité française en invoquant la nationalité française de son arrière-grand-mère, qui aurait été transmise à son grand-père lui-même né au Chili. La difficulté est qu’une disposition de la loi du 10 août 1927 conditionne la transmission de la nationalité française par la mère légitime au cas où l’enfant est né en France, étant précisé que cette condition est absente lorsque c’est le père qui est français. Saisi dans le cadre d’une QPC, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de cette disposition à la constitution, dans une décision du 5 octobre 201856.
Longtemps, la transmission de la nationalité française par filiation n’était possible que par le père. Plus généralement, le droit de la nationalité contenait d’importantes règles ne traitant pas à égalité les femmes et les hommes57. Ces solutions étaient le prolongement des fonctions de chef de famille et de détenteur de la puissance paternelle attribuées aux hommes, desquelles découlait l’idée que l’identité du mari et père déterminait celle de la famille, dont il était le représentant vis-à-vis du corps social. La transmission du nom du mari et père, à l’épouse à titre d’usage et aux enfants à titre de patronyme, en était également une manifestation58. En outre, la transmission de la nationalité du père aux enfants servait également l’objectif d’unité de nationalité dans la famille, dans la mesure où la nationalité d’une femme mariée était en principe celle de son mari. La loi du 10 août 1927 a atténué la dépendance de la nationalité à celle du mari et du père afin de mieux tenir compte de la situation des ménages installés en France dont l’épouse était française et l’époux étranger59. Cette loi a permis aux femmes dans cette situation de conserver leur nationalité française60 et de la transmettre à leurs enfants mais à la condition qu’ils soient nés en France61. Ce n’est qu’en 1945 que l’enfant né à l’étranger d’une mère française et d’un père étranger s’est vu attribuer la nationalité française, avec une possibilité de répudiation. Puis la loi du 9 janvier 1973, tirant les conséquences du principe d’égalité entre les parents et d’égalité des filiations, a posé la règle selon laquelle l’enfant légitime ou naturel dont au moins l’un des parents est français, acquiert la nationalité française62. Sans surprise, confronté à la question de la conformité de la solution de 1927 aux principes d’égalité devant la loi et entre les sexes, le Conseil constitutionnel conclut à une inconstitutionnalité (I) mais, compte tenu de l’ampleur des effets dans le temps des dispositions relatives à la nationalité, il restreint ensuite les effets dans le temps de cette déclaration d’inconstitutionnalité (II).
I. Une inconstitutionnalité de principe
Après s’être référé à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel rappelle que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (§ 5). Il mentionne également le troisième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 spécifique à l’égalité entre les femmes et les hommes puis il constate que « les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre enfants légitimes nés à l’étranger d’un seul parent français, selon qu’il s’agit de leur mère ou de leur père, ainsi qu’une différence de traitement entre les pères et mères » (§ 7). Le Conseil constitutionnel se penche ensuite sur les objectifs du législateur. Sur ce point, il relève qu’il poursuivait « un objectif démographique d’élargissement de l’accès à la nationalité française » (§ 8), puis précise que les justifications avancées pour poser une condition de naissance en France, ne concernant que les enfants dont seule la mère était française, « reposaient, d’une part, sur l’application des règles relatives à la conscription et, d’autre part, sur le souci d’éviter d’éventuels conflits de nationalité ». Or, selon le Conseil constitutionnel, « aucun de ces motifs n’est de nature à justifier les différences de traitement contestées ».
La conclusion est sans surprise dans la mesure où aucune différence de situation ni aucune raison d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi ne semblent pouvoir justifier d’imposer une condition de naissance en France lorsque le parent français est une femme. La règle était discriminatoire, elle s’inscrivait dans un système et une législation familiale marquée par le sexisme. En outre, il faut également relever que rien ne faisait obstacle à l’application du principe d’égalité à une disposition législative en matière de nationalité.
En 2014, le Conseil constitutionnel a déjà fait application de ce principe et conclu à l’inconstitutionnalité d’une règle restreignant les cas de perte de la nationalité française pour les seuls hommes acquérant une nationalité étrangère63. Il avait eu l’occasion d’énoncer que toute distinction en fonction du sexe en matière de nationalité ne constitue pas nécessairement une violation du principe d’égalité. En effet, le Conseil constitutionnel avait alors précisé que le législateur avait la possibilité de poser une règle spécifique aux seuls Français du sexe masculin sans méconnaître le principe d’égalité « dans le but de faire obstacle à l’utilisation des règles relatives à la nationalité pour échapper aux obligations du service militaire » (§ 8), mais à condition bien sûr que les dispositions correspondent réellement à ce cas de figure, ce qui n’était pas le cas de la règle en cause en 2014, qui avait donc été jugée contraire au principe d’égalité. En revanche, dans un arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation64 a refusé de transmettre une QPC en considérant que la question posée était dépourvue de caractère sérieux dès lors que la règle dont il était alors question empêchait les Français du sexe masculin, en âge de servir, d’échapper aux obligations du service militaire en acquérant une nationalité étrangère et se trouvait donc en rapport avec l’objectif poursuivi par le texte.
Ainsi, toute distinction entre les femmes et les hommes en matière de nationalité ne constitue pas forcément une violation du principe d’égalité. Mais les règles anciennes ne constituant que l’un des aspects de l’ensemble d’une législation reflétant un système patriarcal, comme c’était le cas dans la décision commentée, seront probablement jugées contraires au principe d’égalité.
Ces solutions ne s’imposent pas seulement au regard de la constitution mais aussi des textes internationaux. Ainsi, l’article 9, § 2 de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)65 énonce que « les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants ». La convention européenne sur la nationalité de 199766 prohibe, dans son article 5, les distinctions ou pratiques constituant une discrimination fondée sur le sexe. Quant à la CEDH, elle a conclu à une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 à propos de la législation maltaise ne permettant pas la transmission de la nationalité par le père à l’enfant né hors mariage67.
Ce n’étaient pas ici ces textes qui étaient invoqués dans la mesure où la question était posée au Conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPC. Ce mécanisme de remise en cause d’une disposition législative offre la possibilité de conduire à une abrogation, ce qui est le cas ici. Des limites quant aux effets dans le temps de l’abrogation peuvent être posées, conformément à l’article 62 de la constitution, ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision.
II. Une inconstitutionnalité limitée dans le temps
Le Conseil constitutionnel restreint les effets dans le temps de sa déclaration d’inconstitutionnalité. Il considère que « la remise en cause des situations juridiques résultant de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences manifestement excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes nées à l’étranger de mère française n’ayant pas obtenu la nationalité française du fait de ces dispositions » (§ 12). Il décide donc que la déclaration d’inconstitutionnalité « peut être invoquée par les seules personnes nées à l’étranger d’une mère française entre le 16 août 1906 et le 21 octobre 1924 à qui la nationalité française n’a pas été transmise du fait de ces dispositions. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date » (§ 13). La même solution avait été retenue dans le cadre de la précédente QPC ayant conclu à une inconstitutionnalité au regard du principe d’égalité en raison d’une différence fondée sur le sexe68. Cela avait ensuite conduit la Cour de cassation à juger que le descendant d’une personne ayant automatiquement perdu la nationalité française à la suite de l’acquisition d’une autre nationalité parce qu’elle est une femme ne peut invoquer l’inconstitutionnalité du dispositif que s’il peut se prévaloir d’une décision reconnaissant que cette femme a conservé sa nationalité française69. Une telle limitation des effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité peut être critiquée dans la mesure où elle conduit à persister à appliquer des dispositions discriminatoires. Il reste que la législation sur la nationalité produit des effets presque infinis dans le temps et que l’on ne peut pas revenir indéfiniment sur ce qui a été. En outre, les personnes restées étrangères parce que descendantes de femmes françaises pendant un temps aujourd’hui devenu très long se trouvent désormais, de fait et en raison de l’œuvre de ce temps, dans une situation différente de celles qui ont été de nationalité française depuis maintenant plusieurs générations. Cette différence de situation peut peut-être justifier une différence de traitement telle que celle produite par l’absence de bénéfice de la déclaration d’inconstitutionnalité.
Toutefois, il n’est pas certain que l’application persistante des dispositions discriminatoires de la loi de 1927 à des descendants ne pouvant bénéficier de la déclaration d’inconstitutionnalité soit conforme aux engagements internationaux de la France. Ainsi, en Italie, alors qu’une limitation dans le temps semblable à celle retenue ici par le Conseil constitutionnel avait dans un premier temps été retenue, la Cour de cassation a finalement donné gain de cause aux descendants70 sur le fondement, notamment, de l’article 9 de la CEDEF71.
Amélie DIONISI-PEYRUSSE
IV – La nature contractuelle de l’action paulienne (CJUE, 4 oct. 2018, n° C-337/17, Feniks sp. z o.o. c/ Azteca Products & Services SL)
V – La responsabilité extracontractuelle ne permet pas de se soustraire à la clause compromissoire transmise à un affactureur (Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-13067 (1re esp.) et Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-13069 (2e esp.))
VI – Les lois de police à l’aune du règlement Rome II (CJUE, 31 janv. 2019, n° C 149/18, da Silva Martins c/ Dekra Claims Services Portugal SA)
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Sur le refus de transcription au nom des principes essentiels du droit français qui composent l’ordre public international, v. Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, nos 09-66486 et 10-19053 : D. 2012, p. 1228, obs. Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F. ; D. 2011, p. 1522, note Bethiau D. et Brunet L., p. 1585, obs. Granet-Lambrechts F. ; RTD civ. 2011, p. 340, obs. Hauser J. – Sur le refus de transcription sur le fondement de la fraude à la loi française, Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, nos 12-18315 et 12-30138 : JDI 2014, p. 134, note Guillaumé J. ; RTD civ. 2013, p. 816, obs. Hauser J.
-
2.
Sur le refus d’établir la filiation par possession d’état, v. Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 09-17130 : D. 2011, p. 1585, obs. Granet-Lambrechts F. ; RTD civ. 2011, p. 340, obs. Hauser J. – Sur le refus d’établir la filiation par reconnaissance de paternité, Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-18315.
-
3.
CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France, et n° 65941/11, Labassée c/ France : D. 2015, p. 702, obs. Granet-Lambrechts F. ; D. 2015, p. 1056, obs. Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F. ; D. 2014, p. 1773, obs. Fulchiron H. et Bidaud-Garon C. ; JDI 2014, p. 1265, note Guillaumé J. ; Dalloz actualité 30 juin 2014, obs. Coustet T. ; RTD civ. 2014, p. 616, obs. Hauser J., p. 835, note Marguénaud J.-P. – v., dans le même sens, CEDH, 21 juill. 2016, n° 9063/14, Foulon c/ France, et CEDH, 21 juill. 2016, n° 10410/14, Bouvet c/ France : JDI 2017, p. 1116, note Dionisi-Peyrusse A. ; Dalloz actualité 25 juill. 2016, obs. Coustet T. ; D. 2017, p. 729, obs. Granet-Lambrechts F. ; Dr. famille 2016, n° 10, p. 50, note Fulchiron H. ; RTD civ. 2016, p. 819, obs. Hauser J. – v. également, CEDH, 19 janv. 2017, n° 44024/13, Laborie c/ France : D. 2017, p. 1011, obs. Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F. ; AJ fam. 2017, p. 93, obs. Dionisi-Peyrusse A.
-
4.
Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, nos 14-21323 et 15-50002 : D. 2016, p. 857, obs. Granet-Lambrechts F. ; JDI 2016, p. 103, note Guillaumé J. ; Dr. famille 2015, n° 9, p. 1, note Binet J.-R. ; RTD civ. 2015, p. 581, obs. Hauser J.
-
5.
Cependant, le tribunal de grande instance de Nantes fait de la résistance et décide de transcrire l’acte de naissance étranger de manière intégrale, y compris lorsque la mère d’intention est mentionnée comme étant le parent de l’enfant ; v. en ce sens TGI Nantes 21 févr. 2019, n° 17/07477 : AJ fam. 2019, p. 175, obs. Dionisi-Peyrusse A.
-
6.
V. not. Cass. 1re civ., 20 mars 2019, nos 18-50006, 18-50007 et 18-50008 : Dalloz actualité 8 avr. 2019, obs. Cottet M. – Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 12-30138 : D. 2019, p. 663, obs. Granet-Lambrechts F. ; RTD civ. 2019, p. 90, obs. Leroyer A.-M. ; AJ fam. 2018, p. 569, obs. Dionisi-Peyrusse A. – Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, nos 15-28597 et 16-50025 : D. 2018, p. 966, obs. Clavel S. et Jault-Seseke F. ; D. 2017, p. 1737, note Fulchiron H. ; AJ fam. 2017, p. 482, note Dionisi-Peyrusse A.
-
7.
Fulchiron H. et Bidaud-Garon C., « Reconnaissance ou reconstruction », Rev. crit. DIP 2015, p. 1.
-
8.
Cottet M., Dalloz actualité 8 avr. 2019.
-
9.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, nos 15-28597 et 16-16901 : D. 2018, p. 1737, note Fulchiron H. ; Dr. famille 2017, n° 9, p. 10, obs. Binet J.-R.
-
10.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, nos 15-28597 et 16-16901.
-
11.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16455 : D. 2018, p. 966, obs. Clavel S. et Jault-Seseke F. ; D. 2017, p. 1737, note Fulchiron H. ; Dr. famille 2017, n° 9, p. 10, obs Binet J.-R.
-
12.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice au XXIe siècle : D. 2016, p. 2152, comm. Caire A.-B. ; AJ fam. 2016, p. 595, comm. Chénedé F.
-
13.
Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 10-19053 : D. 2019, p. 663, obs. Granet-Lambrechts F., p. 725, obs. Galloux J.-C. ; Dr. famille 2019, n° 1, p. 47, note Binet J.-R. ; RTD civ. 2019, p. 90, obs. Leroyer A.-M. ; AJ fam. 2018, p. 569, obs. Dionisi-Peyrusse A.
-
14.
CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P16-2018-001 : Dalloz actualité 19 avr. 2019, obs. Coustet T. ; LEFP mai 2019, n° 112b0, p. 2, obs. Batteur A.
-
15.
Notons que la Cour de cassation a sursis à statuer dans une affaire dans laquelle deux femmes mariées avaient eu recours à deux assistances médicales à la procréation et chacune d’elles étaient désignées dans l’acte de naissance étranger comme étant les parents des deux enfants qui en ont été issus. La Cour de cassation a sursis à statuer en attendant l’avis de la CEDH en considérant que la question présentait « un lien suffisamment étroit avec la question de la maternité d’intention ». Cass. 1re civ., 20 mars 2019, nos 18-14751 et 18-50007.
-
16.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16455.
-
17.
Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-11815 : AJ fam. 2019, p. 175, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; AJ fam. 2019, p. 218, obs. Berdeaux F.
-
18.
Cottet M., Dalloz actualité 8 avr. 2019.
-
19.
TGI Créteil, 14 sept. 2017, n° 16/08343 : AJ fam. 2017, p. 588, note Berdeaux F.
-
20.
CA Paris, 18 sept. 2018, n° 16/23399 : AJ fam. 2019, p. 616, note Dionisi-Peyrusse A.
-
21.
Hauser J., « L’adoption simple, joker de la crise de la parenté ! », Dr. famille 2010, n° 9, p. 2.
-
22.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, nos 15-28597 et 16-16901.
-
23.
CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P16-2018-001.
-
24.
C. civ., art. 348-1 ; sur ce point v. Salvage-Gerest P., « L’adoption par la mère d’intention en cas de GPA : qu’en penser ? », AJ fam. 2017, p. 243.
-
25.
Leroyer A.-M., obs. sous Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-50021 : RTD civ. 2018, p. 377.
-
26.
CA Paris, 1-2, 30 janv. 2018, n° 18/003358 : Dr. famille 2018, n° 4, p. 34, note Fulchiron H.
-
27.
Leroyer A.-M., RTD civ. 2018, p. 377 ; Salvage-Gerest P., « L’adoption par la mère d’intention en cas de GPA : qu’en penser ? », AJ fam. 2017, p. 243.
-
28.
Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-11069 : Dalloz actualité 8 mars 2018, obs. Coustet T. ; D. 2018, p. 663, obs. Granet-Lambrechts F. ; D. 2018, p. 1083, obs. Fulchiron H. ; RTD civ. 2018, p. 373, obs. Leroyer A.-M.
-
29.
Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 04-15676 : D. 2007, p. 1047, note Vigneau D. ; D. 2007, p. 1460, obs. Granet-Lambrechts F. ; RTD civ. 2007, p. 325, obs. Hauser J.
-
30.
CE, Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ?, 28 juin 2018, spéc. p. 85 et s.
-
31.
Dionisi-Peyrusse A., note sous Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 15-28597.
-
32.
Dionisi-Peyrusse A., note sous CA Paris, 18 sept. 2018, n° 16/23402 : AJ fam. 2018, p. 616.
-
33.
Salvage-Gerest P., « L’adoption par la mère d’intention en cas de GPA : qu’en penser ? », AJ fam. 2017, p. 243 ; Chaigneau A., « Pour un droit du lien : le débat sur la gestation pour autrui comme catalyseur d’un droit de la filiation renouvelé », RTD civ. 2016, p. 263.
-
34.
Cavarroc F., « Le rejet des répudiations musulmanes », D. 2004, p. 824 ; Niboyet M.-L., « Regard français sur la reconnaissance en France des répudiations musulmanes », RIDC 2006, p. 27.
-
35.
Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, nos 01-11549 et 02-11618 : RTD civ. 2004, p. 367, obs. Marguénaud J.-P. ; D. 2004, p. 815, note Courbe P. ; D. 2004, p. 824, note Cavarroc F. ; Gaz. Pal. 26 févr. 2004, n° F3325, p. 29, note Niboyet M.-L. ; Rev. crit. DIP 2004, p. 423, note Hammje P. ; JDI 2004, p. 1200, note Gannagé L. ; JCP 2004, p. 10128, note Fulchiron H. ; Defrénois 15 juin 2004, n° 37957, p. 812 et s., note Massip J.
-
36.
Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-16102 : Dr. famille 2018, n° 11, p. 207, obs. Farge M.
-
37.
CA Colmar, 15 déc. 2015, n° 14/03002.
-
38.
Sur cette notion : v. Lagarde P., « La théorie de l’ordre public international face à la polygamie et à la répudiation », Mélanges François Rigaux, 1993, Bruylant, p. 27 ; Courbe P., « L’ordre public de proximité », in Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, 2005, Dalloz, p. 227 ; Guillaumé J., JCl. Droit international, V° « Ordre public », fasc. 534-10, art. 3.
-
39.
Cass. 1re civ., 15 avr 2015, n° 14-13420 : Gaz. Pal. 6 oct. 2015, n° 141z1, p. 37, note Darmois V.
-
40.
Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-10532 : Gaz. Pal. 25 oct. 2016, n° 277r2, p. 66, note Dufloux C.
-
41.
Ces deux arrêts ainsi que celui du 4 juillet 2018 ne sont pas publiés au Bulletin.
-
42.
Cette décision vient alors contredire l’obsolescence annoncée de cette modalité d’intervention de l’ordre public international, qui a résulté de l’abandon des conditions de proximité de la situation de l’enfant tenant au déclenchement de l’ordre public en matière de filiation. V. en ce sens : Sindres D., « Vers la disparition de l’ordre public de proximité ? », JDI 2012, n° 3, doctr. 10.
-
43.
Cass. 1re civ., 25 mai 1948, Lautour : Rev. crit. DIP 1949, p. 89, note Batiffol H. ; D. 1948, p. 357, note P.L/-P. ; S. 1949, n° 1, p. 21, note Niboyet J.-P. ; JCP 1948, II 4532, note Vasseur.
-
44.
Guillaumé J., « Ordre public plein, ordre public atténué, ordre public de proximité ? : quelle rationalité dans le choix du juge ? » in Mélanges en l’honneur de Patrick Courbe, 2012, Dalloz, p. 294.
-
45.
À la suite de l’introduction du mariage pour tous en droit interne français et de la codification de la règle de conflit de lois à l’article 202-1 du Code civil, l’ordre public de proximité a été étendu en matière de mariage. La Cour de cassation a eu l’occasion de rejeter l’application de la loi marocaine, « qui s’oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l’une d’elles, soit la personnelles, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet » ; v. Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50059 : Gaz. Pal. 5 févr. 2015, n° 210x6, p. 11 et s., avis Sarcelet J.-D. ; AJ fam. 2015, p. 71, obs. Haftel B. ; AJ fam. 2015, p. 172, obs. Boiché A. ; RTD civ. 2015, p. 91, obs. Puig P. ; D. 2015, p. 264, Gallmeister I. ; D. 2015, p. 464, Fulchiron H. ; D. 2015, p. 481, Libchaber R. ; Dr. famille 2015, comm. 63, obs. Devers A. et Farge M. ; RLDC 2017, n° 127, p. 38, Hyde A.-A. ; Rev. crit. DIP 2015, p. 400, Boden D., Bollée S., Haftel B., Hammje P. et de Vareilles-Sommières P.
-
46.
Hammje P., « Rejet des répudiations musulmanes », Rev. crit. DIP 2004, p. 423.
-
47.
CEDH, 8 nov. 2005, n° 3/02, D.-D. c/ France : Procédures 2006, p. 105, obs. Nourissat C. ; Gaz. Pal. 25 févr. 2006, n° G0514, p. 16, obs. Niboyet M.-L.
-
48.
Guillaumé J., JCl. Droit international, V° « Ordre public », fasc. 534-10, art. 3.
-
49.
Hammje P., « Rejet des répudiations musulmanes », Rev. crit. DIP 2004, p. 423 ; « Le rejet des répudiations musulmanes », D. 2004, p. 815, note Courbe P.
-
50.
Hammje P., « Rejet des répudiations musulmanes », Rev. crit. DIP 2004, p. 423 ; Courbe P., « Le rejet des répudiations musulmanes », D. 2004, p. 815 ; Mayer P. et Heuzé V., Droit international privé, 11e éd., 2014, Montchrestien, p. 446, n° 587 ; Guillaumé J., JCl. Droit international, V° « Ordre public », fasc. 534-10, art. 3.
-
51.
Guillaumé J., JCl. Droit international, V° « Ordre public », fasc. 534-10, art. 3.
-
52.
Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 01-11549 ; Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 06-19577 : Rev. crit. DIP 2007, p. 575, note Muir Watt H. – Cass. 1re civ., 4 nov. 2009, n° 08-20574 ; Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-19750 ; Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-25802.
-
53.
Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 12-11618 ; Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-25015 ; Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-21344 ; Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-21751 : Dr. famille 2014, p. 174, obs. Farge M.
-
54.
Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-19444 : RJPF 2006-9/29, p. 17, obs. Garé T.
-
55.
En limitant le jeu de l’ordre public de proximité européen, en matière de répudiation, aux seuls couples domiciliés sur le territoire d’un État contractant, sans égard à la nationalité, la solution de la Cour de cassation témoigne du recul du critère de la nationalité en matière personnelle et familiale. Cette observation avait déjà été formulée à propos des arrêts du 17 février 2004 qui n’avaient retenu que le critère du domicile de l’épouse ou du couple pour faire jouer l’ordre public de proximité. V. en ce sens : Hammje P., « Rejet des répudiations musulmanes », Rev. crit. DIP 2004, p. 423.
-
56.
Cons. const., 5 oct. 2018, n° 2018-737 QPC : AJ fam. 2018, p. 612, note Carayon L. ; RTD civ. 2019, p. 82, obs. Leroyer A.-M.
-
57.
V. not. Légier G., Histoire du droit de la nationalité française, Des origines à la veille de la réforme de 1889, 2014, PUAM, deux tomes, spéc. p. 98 et s. (« Le parent dont la nationalité se transmet à l’enfant : la prépondérance paternelle »), p. 241 et s. (« L’“Étranger” qui est né en France : peut-il s’agir de la mère ? ») et p. 731 et s. (« L’incidence du mariage sur la nationalité de l’épouse ») ; Weil P., « Le statut de la femme en droit de la nationalité. Une égalité tardive », in Kastoryano R. (dir.), Les codes de la différence, 2005, Presses de Sciences Po, p. 123.
-
58.
Möschel M., « La famille : “unité fondamentale” de discriminations ? », in Roman D. (dir.), La Convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, 2014, Pedone, p. 219, spéc. p. 228. L’auteur parle de « dynamique similaire ».
-
59.
V. not. Lagarde P., Rép. internat. Dalloz, V° Nationalité, 2013, actu. 2019, spéc. n° 107.
-
60.
Avec toutefois des exceptions, v. not. Fulchiron H. et Cornut É., JCl. Droit international, « Nationalité. – Acquisition de la nationalité française à raison du mariage », fasc. 502-60, 2010, spéc. nos 36 et s.
-
61.
Fulchiron H. et Cornut É., JCl. Droit international, « Nationalité. Naturalisation. – Attribution de la nationalité française par filiation ou naissance en France », fasc. 502-20, 2013, spéc. nos 14 et s.
-
62.
C. civ., art. 18 (C. nat., art. 17 anc.) ; une possibilité de répudiation dans certains cas est prévue à l’article C. civ., art. 18-1.
-
63.
Cons. const., 9 janv. 2014, n° 2013-360 QPC : AJDA 2014, p. 78 ; D. 2014, p. 459, note Laffaille F. ; D. 2015, p. 450, obs. Boskovic O. ; Rev. crit. DIP 2014, p. 329, note Lagarde P.
-
64.
Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-40247.
-
65.
Nations unies, 18 déc. 1979. La France a ratifié cette convention le 14 décembre 1983. Sur ce texte, v. Roman D. (dir.), La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 2014, Pedone.
-
66.
Conseil de l’Europe, 6 nov. 1997, STCE n° 166 ; Convention et rapport explicatif, www.conventions.coe.int ; la France a signé cette convention le 4 juillet 2000 mais ne l’a pas ratifiée ; v. Dionisi-Peyrusse A., Jault-Seseke F., Marchadier F. et Parisot V. (dir.), La nationalité : enjeux et perspectives, 2019, Varenne-LGDJ-Lextenso.
-
67.
CEDH, 11 oct. 2011, n° 53124/09, Genovese c/ Malte : Marchadier F., « L’attribution de la nationalité à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’Homme – Réflexions à partir de l’arrêt Genovese c/ Malte », Rev. crit. DIP 2012, p. 61.
-
68.
Cons. const., 9 janv. 2014, n° 2013-360 QPC.
-
69.
Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 14-50071 : AJ fam. 2016, p. 341, obs. Dionisi-Peyrusse A.
-
70.
Cass. civ. Sezioni unite, 25 févr. 2009, n° 4466, citée par Möschel M., « La famille : “unité fondamentale” de discriminations ? », in Roman D. (dir.), La Convention pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, 2014, Pedone, p. 219, spéc. p. 228.
-
71.
V. note 65 : Nations unies, 18 déc. 1979. La France a ratifié cette convention le 14 décembre 1983. Sur ce texte, v. Roman D. (dir.), La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 2014, Pedone.