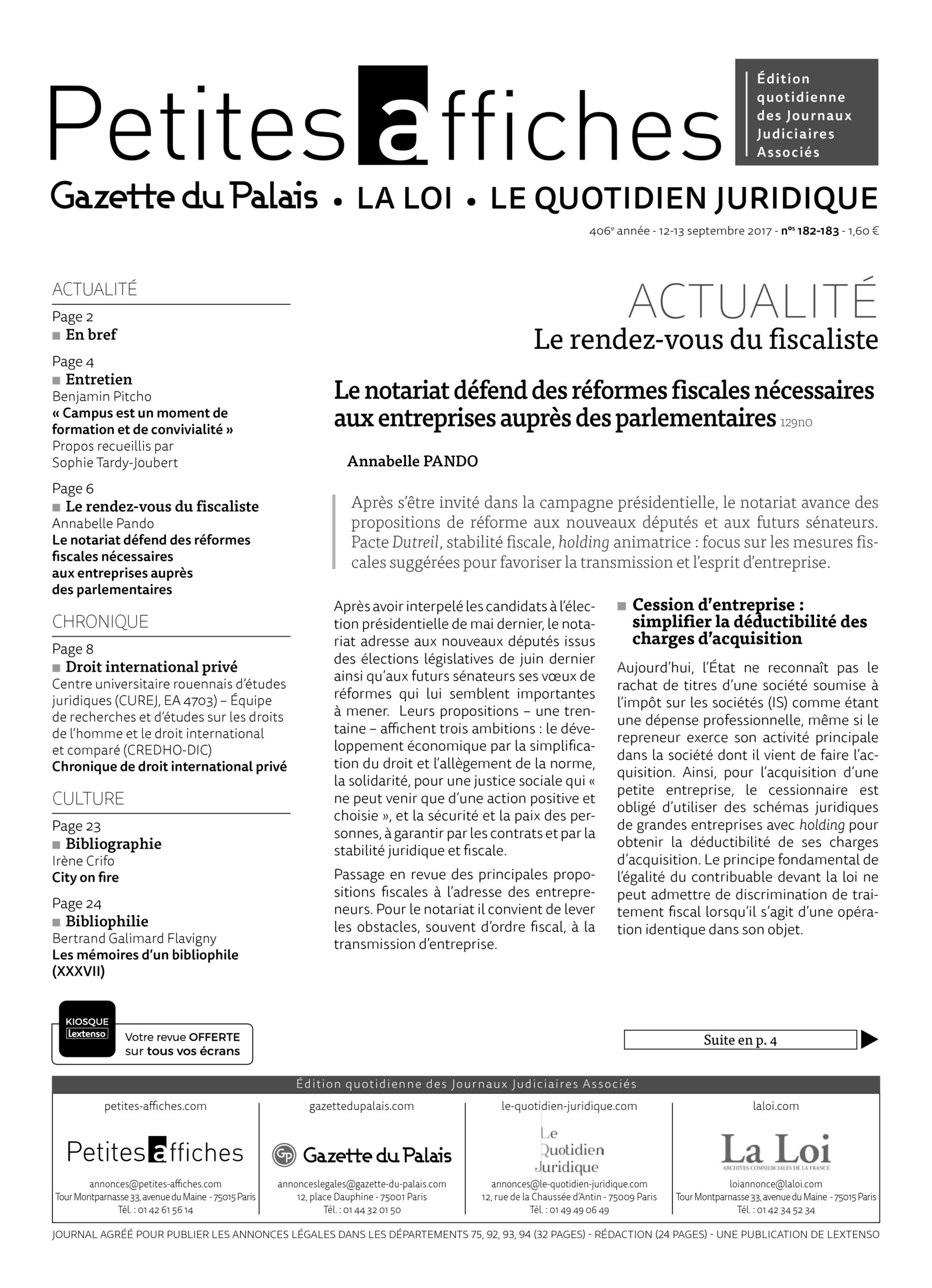Chronique de droit international privé
I – Les élections de for dans le contentieux de la responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. Retour sur plusieurs arrêts récents
L’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ». La disposition, introduite en 1996 pour lutter contre les pratiques de déréférencement abusif apparues avec le développement des hypermarchés, a été considérablement élargie par la suite1. Elle constitue aujourd’hui l’une des dispositions phares de la rupture des contrats d’affaires. Or, près de vingt ans après son apparition, le contentieux reste nourri. Il se concentre, dans les litiges internationaux, sur la question de l’efficacité tant des clauses attributives de juridiction (I) que des clauses compromissoires (II). Plusieurs arrêts récents permettent de dresser un état des lieux du droit positif.
I. L’efficacité des clauses attributives de juridiction
La Cour de cassation autorise le jeu des clauses attributives de juridiction dans les litiges fondés sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Deux éléments sont à cet égard indifférents : la nature de la responsabilité d’une part (A) et le caractère impératif des dispositions applicables au fond d’autre part (B).
A. L’indifférence quant à la nature de la responsabilité
Dans les relations internationales, le jeu des clauses attributives de juridiction est admis en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, quelle que soit la nature – délictuelle ou contractuelle – de la responsabilité en cause. La solution a été posée avec une grande fermeté dans un arrêt du 20 mars 20122 statuant sur le fondement du règlement Bruxelles I : la clause attribuant compétence aux juridictions allemandes « [s’applique aux litiges] découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ». Cette efficacité des clauses attributives de juridiction n’est nullement remise en cause, en matière internationale, par l’arrêt du 1er mars 20173 qui interdit aux parties, en droit interne, de tenir en échec la répartition interne des compétences organisée par les articles L. 442-6, III, in fine, et D. 442-3 du Code de commerce4. Simplement, on peut penser que si les parties à une relation internationale choisissent les juridictions françaises, elles devront nécessairement opter pour l’une des juridictions spécialisées désignées par ces textes.
La mise en œuvre systématique de la clause, indépendamment de la qualification de l’action, doit être approuvée. Outre le fait qu’elle œuvre pour le respect de la parole donnée, elle offre l’avantage de la simplicité. En effet, la nature de la responsabilité est controversée en droit interne5 et elle a récemment fait l’objet, par la Cour de justice6, d’une qualification autonome relativement énigmatique. Dans une affaire où les relations commerciales entre les parties étaient établies sans contrat-cadre ni stipulation d’exclusivité, la Cour de justice admet pourtant la possibilité, le cas échéant, de démontrer l’existence d’une relation contractuelle tacite7, en se fondant « sur un faisceau d’éléments concordants »8. Cette jurisprudence ne manquera pas de susciter des interrogations et il est heureux que ces incertitudes ne rejaillissent pas sur le contentieux international, où le besoin de prévisibilité juridique est accru. Surtout, rien n’impose de limiter l’effet des clauses attributives de juridiction aux litiges contractuels : en la matière, l’applicabilité de telles clauses ne dépend pas de la nature – contractuelle ou délictuelle – des règles applicables mais bien davantage de l’intention des parties9.
Tout est donc affaire d’interprétation de la volonté des parties. Or, en l’absence de ligne directrice claire, cette opération peut s’avérer délicate. Tantôt, il suffit, pour donner effet à la clause, de constater qu’elle vise de façon générale « tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties »10 ou « tout litige né du contrat »11. Tantôt, il est en outre exigé qu’elle soit « suffisamment large et compréhensive pour s’appliquer [aux litiges] découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties »12. Allant plus loin, un arrêt – rendu il est vrai dans un litige interne – prive même d’effet la clause qui concerne certes « tout différend ou litige relatif à la formation, l’interprétation, l’exécution, la résiliation ou la cessation du contrat » mais qui ne vise pas spécifiquement la rupture des relations commerciales entre les parties13. Cette dernière solution doit être rapprochée de celle qui est retenue lorsqu’il s’agit de sanctionner une pratique anticoncurrentielle. S’appuyant sur l’arrêt Cartel Damage Claims de la Cour de justice14, la Cour de cassation décide en effet qu’une clause attributive de juridiction dérogeant à la règle de compétence posée pour la matière délictuelle ne peut être prise en compte qu’à la condition qu’elle se réfère expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence15. Où est la cohérence entre ces différentes décisions16 ?
En toute hypothèse, la Cour de cassation en vient, lorsqu’elle exige une telle référence expresse pour les seuls litiges de nature délictuelle, à rendre la validité de la clause tributaire des dispositions de fond. Le résultat est difficilement conciliable avec l’indifférence affirmée par ailleurs quant au caractère impératif desdites dispositions.
B. L’indifférence quant au caractère impératif des dispositions de fond
La mise en œuvre de la clause attributive de juridiction est indifférente au caractère impératif des dispositions applicables au fond du litige. Autrement formulé : l’application d’une loi de police française au litige ne fait pas obstacle à la désignation d’un juge étranger. Le principe, énoncé pour la première fois par l’arrêt Monster Cable17 dans le cadre du droit commun, a récemment été étendu au droit de l’Union européenne. Dans un arrêt en date du 18 janvier 201718, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir donné effet à la clause attributive de juridiction désignant les tribunaux anglais pour statuer sur la rupture brutale de la relation établie entre les parties, « des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige ». Elle se montre ainsi insensible à l’argument du pourvoi selon lequel l’application du droit anglais par les juges anglais ferait « échec aux dispositions impératives de l’article L. 442-6-I, 5°, qui relèvent de l’ordre public économique ».
Le corollaire de cette jurisprudence s’impose de lui-même : si l’applicabilité de dispositions impératives au fond du litige n’interdit pas la désignation d’un juge étranger, elle n’impose pas davantage la compétence du juge français. Les mêmes arguments peuvent être convoqués dans l’un et l’autre cas. C’est ce que permet d’illustrer un arrêt du 24 novembre 201519. Après avoir écarté la convention attributive de juridiction au profit des juridictions allemandes, une cour d’appel avait fondé la compétence des juges français sur le fait que « la loi de police fondant la demande s’impose en tant que règle obligatoire pour le juge français ». L’arrêt est cassé au visa de l’article 3 du Code civil, des principes généraux du droit international privé et des articles 3 et 5 du règlement Bruxelles I : « en statuant ainsi, alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ».
Dans ces différents arrêts, la Cour de cassation laisse planer l’ambiguïté qui affecte la qualification de loi de police de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Il est regrettable qu’elle n’ait pas saisi les différentes occasions qui se sont présentées à elle pour clarifier une question dont l’importance est indéniable dès lors qu’il s’agit de déterminer la loi applicable à la rupture. Seule la question de l’efficacité – indépendamment du droit applicable au fond – de la clause attributive de juridiction et, dans son prolongement, la question de l’absence de compétence impérative du juge français, sont explicitement tranchées par la haute juridiction. Les enseignements à tirer de l’arrêt Lauterbach sont clairs. L’arrêt d’appel qui déduit la compétence du juge français de la seule applicabilité au litige de l’article L. 442-6, I, 5° encourt doublement la censure. Sur le fondement des principes généraux du droit international privé d’abord, parce qu’il ne respecte pas l’indépendance, du point de vue de la méthode, du conflit de juridictions et du conflit de lois. Sur le terrain du règlement Bruxelles I ensuite (Bruxelles I bis aujourd’hui), en ce que le droit de l’Union, qui prime le droit commun, ne prévoit nullement de donner compétence à un juge d’un État membre au seul motif que l’une de ses lois de police est applicable au fond20. Le raisonnement est pleinement transposable aux clauses attributives de juridiction.
Il suffit donc aux parties, pour désactiver l’impérativité de la disposition prohibitive du Code de commerce, de s’entendre sur la désignation d’un juge étranger21 et l’on peut alors craindre que la partie la plus forte n’use de ce moyen pour priver l’entreprise la plus vulnérable de la protection que le législateur a entendu lui accorder22. Le même résultat, au demeurant, peut être atteint par la stipulation d’une clause compromissoire, dont l’efficacité est pareillement consacrée dans ce type de litiges.
II. L’efficacité des clauses compromissoires
L’efficacité de la clause compromissoire, admise lorsque le litige oppose les parties au contrat qui contient la clause (A), est en revanche refusée lorsque l’action est intentée par le ministre de l’Économie (B).
A. Dans le litige opposant les parties au contrat
L’efficacité de la clause compromissoire dans le litige opposant les parties au contrat qui la contient a pu être discutée au regard des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du Code de commerce, qui attribuent une compétence exclusive en la matière à huit tribunaux de commerce en particulier, dont les décisions ne peuvent faire l’objet d’un appel que devant la cour d’appel de Paris23. L’arrêt Scamark du 21 octobre 201524 décide que « le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques de l’application de l’article L. 442-6, [n’est pas exclu par ces dispositions], l’action aux fins d’indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales [n’étant] pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques ». En outre, la seule volonté « des parties de soumettre à l’arbitrage tous les litiges découlant du contrat sans s’arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action engagée » suffit à rendre le tribunal arbitral compétent. L’indifférence quant à la nature de la responsabilité engagée ne présentant pas de particularité dans le cadre de l’arbitrage25, seul le premier aspect de la décision retiendra notre attention.
Le principe, posé pour l’arbitrage interne, vaut également pour l’arbitrage international26 : l’attribution exclusive de compétence à un juge étatique déterminé n’a pas pour conséquence d’exclure l’arbitrage. L’arbitrabilité qui est ainsi retenue suscite la réflexion. En droit des procédures collectives par exemple, il est acquis que les litiges qui entrent dans le domaine de la compétence exclusive du juge devant lequel une procédure collective est ouverte27 sont – à l’exclusion des litiges purement contractuels – inarbitrables. Les raisons invoquées pour justifier la soustraction de la matière à l’arbitrage sont doubles28. Le droit des procédures collectives intéresse l’ordre public économique de direction, de par les objectifs de redressement de l’entreprise, de sauvegarde de l’emploi et d’apurement du passif qu’il poursuit. De plus, la centralisation de la procédure qui est recherchée, au nom de l’intérêt général du crédit et de la sauvegarde des entreprises en difficulté, ne saurait être atteinte si les parties pouvaient porter leur litige devant une autre juridiction, qu’il s’agisse d’une juridiction étatique ou d’un tribunal arbitral.
Or, des considérations semblables ne se retrouvent-elles pas à propos de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ?
À l’instar du droit des procédures collectives, la disposition n’est pas étrangère à l’ordre public. Certes, elle protège au premier chef des intérêts privés, puisqu’elle offre à la victime du changement brutal de politique de son partenaire commercial une possibilité d’être indemnisée, qui s’ajoute à celle prévue par le droit commun de la responsabilité. Néanmoins, elle relève également de l’ordre public économique. D’une part, en ce qu’elle garantit la loyauté de la compétition commerciale, préoccupation d’ordre public justifiant l’intervention, le cas échéant, du ministre de l’Économie à côté des victimes29 ; d’autre part, en ce que la rupture brutale de relations établie peut, parfois, conduire à qualifier la pratique anticoncurrentielle d’abus de position dominante susceptible d’être sanctionnée par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-2 du Code de commerce. C’est dire que, en tant que telle, la rupture de relations commerciales établies dépasse largement le cercle des seuls intérêts privés.
Et pourtant, l’argument ne suffit plus, aujourd’hui, à rendre le contentieux qu’il génère inarbitrable. Depuis l’arrêt Labinal rendu par la cour d’appel de Paris le 19 mai 199330, il est admis que l’arbitre a le pouvoir – comme tout autre juge civil – d’appliquer et de sanctionner le droit de la concurrence. La solution, posée à propos du droit européen de la concurrence, vaut également pour le droit national de la concurrence. Elle est par ailleurs parfaitement cohérente avec la jurisprudence initiée en 201031 qui, dans la lignée de l’arrêt Monster Cable précité32, décide qu’une clause compromissoire n’est pas manifestement inapplicable en présence de dispositions d’ordre public régissant le fond du litige « dès lors que le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, sont applicables ». La formule a été reprise à l’identique, ou presque, dans un arrêt du 1er mars 201733.
Comme dans le domaine des procédures collectives encore, l’article L. 442-6, III, du Code de commerce entend en outre réaliser une concentration du contentieux. Celle-ci, qui résulte de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008, procède de l’idée que les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence – dont fait partie le contentieux examiné – soulèvent des questions techniques qui doivent être confiées à des juridictions spécialisées. Il s’agit de « [garantir] une certaine homogénéité de l’interprétation de la loi [ainsi que le] développement d’une véritable expertise de ce contentieux »34. Or, si l’on peut aisément concevoir que les arbitres, qui peuvent être choisis en raison de leurs compétences particulières, sont à même de disposer d’une expertise au moins équivalente à celle des juges étatiques, ils ne sauraient en revanche assurer une interprétation uniforme de la loi. Comment, dans ces conditions, peut-on justifier la possibilité de recourir à l’arbitrage ? En réalité, l’arbitrabilité du litige, en dépit de l’attribution de compétence à des juridictions spécialisées, s’explique sans doute par le fait que les articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du Code de commerce constituent un simple mode d’organisation interne à la justice judiciaire35 : en tant que tel, ils ne s’imposent donc pas à l’arbitre36. De fait, en saisissant une juridiction extérieure au service public de la justice étatique, les parties n’attentent pas à son bon fonctionnement.
En tout état de cause, la faveur ici exprimée pour l’arbitrage, à supposer même qu’elle soit fondée, n’est pas sans inconvénient. Il existe en effet un risque non négligeable de distorsion ou, à tout le moins, de complication du contentieux toutes les fois que le ministre chargé de l’Économie ou le ministère public entendront agir, parallèlement à la victime, afin de demander la sanction de telles pratiques. Leur action, en effet, ne peut être portée que devant les juridictions étatiques.
B. Dans l’action intentée par le ministre chargé de l’Économie ou par le ministère public
L’efficacité du dispositif de sanction des pratiques restrictives de concurrence est renforcée par l’article L. 442-6, III, alinéa 2, du Code de commerce, qui prévoit que le ministre chargé de l’Économie et le ministère public peuvent demander, à la juridiction civile ou commerciale compétente, d’ordonner la cessation desdites pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l’indu ainsi que le prononcé d’une amende civile et la réparation des préjudices subis par la victime. Or de telles actions échappent de toute évidence à l’arbitrage.
Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation le 6 juillet 201637, le ministre de l’Économie avait justement assigné, sur le fondement de ce texte, deux sociétés Apple38 devant la justice consulaire pour faire prononcer la nullité de certaines clauses du contrat de distribution conclu par l’une d’elles avec la société Orange. Les sociétés Apple ont alors soulevé l’incompétence de la juridiction étatique sur le fondement de la clause compromissoire stipulée au contrat de distribution. La Cour de cassation approuve à juste titre la cour d’appel d’avoir rejeté le contredit et l’exception d’incompétence, au motif que la convention d’arbitrage était manifestement inapplicable au litige.
Deux éléments en particulier justifient l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, stipulée dans le contrat de distribution, lorsque l’action est intentée par le ministre de l’Économie. La Cour de cassation relève d’abord que « l’action ainsi attribuée [au ministre de l’Économie] au titre d’une mission de gardien de l’ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ». Cette qualification de l’action exercée par le ministre de l’Économie n’est pas nouvelle39. Elle invite à transposer, en droit des pratiques restrictives de concurrence, la distinction, bien connue du droit antitrust, entre les litiges purement privés, qui relèvent du « private enforcement », et la défense du marché, qui relève du « public enforcement ». Or, la compétence de l’arbitre est traditionnellement exclue dans le domaine du « public enforcement ». Le ministre qui agit sur le fondement de l’article L. 442-6, III, met en œuvre une action publique : l’inarbitrabilité du litige constatée par la Cour en ce cas est donc, de ce seul point de vue, pleinement justifiée40.
La Cour de cassation observe ensuite que le ministre n’agit « ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci ». De fait, la clause compromissoire a été stipulée dans le contrat de distribution conclu entre Orange et Apple distribution international. Le ministre chargé de l’Économie est donc un tiers à ce contrat ; bien plus, il intervient même contre les parties au contrat. Par suite, le principe de l’effet relatif des conventions41 s’oppose à ce que la clause ait force obligatoire à son égard. Certes, une convention d’arbitrage peut, en certains cas, lier un tiers. À l’évidence toutefois, aucune des hypothèses d’extension reconnues par la jurisprudence n’était pertinente à l’endroit du ministre42.
La solution, si elle mérite d’être approuvée, est néanmoins susceptible de conduire, potentiellement, à deux procédures distinctes menées en parallèle, l’une devant l’arbitre par les opérateurs économiques, et l’autre devant la juridiction étatique, par le ministre de l’Économie. Le risque de contradiction entre les décisions ne doit pas être négligé et il faudra attendre de nouvelles décisions afin de mettre fin aux incertitudes liées à l’articulation des procédures. Le contentieux lié à l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n’est, décidément, pas près de se tarir.
Valérie Parisot
II – La nouvelle règle de reconnaissance du nom étranger
Le nom est un élément de l’identité qui permet aux individus de se distinguer dans leur vie sociale et d’exprimer un lien d’appartenance familiale. Le nom est aussi une institution de police administrative qui permet aux États d’identifier les individus. Pour ces raisons, il est important que le nom d’une personne ne varie pas d’un pays à l’autre, ce qui n’est pas toujours le cas en présence d’un élément d’extranéité compte tenu de la diversité législative existant en la matière.
La diversité législative s’exprime tant au niveau des règles matérielles d’attribution du nom qu’au niveau des règles de droit international privé43. Il résulte de cette diversité législative qu’un individu peut porter deux noms différents, un dans l’État X, un autre dans l’État Y. Imaginons un mariage célébré en Allemagne entre une Française et un Allemand. Conformément à la loi allemande, le couple fait une déclaration à l’officier de l’état civil afin de choisir un nom matrimonial : il choisit le nom du mari comme nom de mariage. Aux yeux de l’ordre juridique allemand, l’épouse a perdu son nom de jeune fille et acquis un nouveau nom. Aux yeux de l’ordre juridique français, elle a conservé son nom de naissance. Si l’un des deux États concernés reconnaît le nom attribué par l’autre, la dualité d’état de l’individu se trouve alors résolue. C’est cette solution qui a été consacrée par le nouvel article 61-3-1 du Code civil, créé par la loi de modernisation de la justice au XXIe siècle du 18 novembre 2016.
La première phrase du premier alinéa dispose : « Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État ». Pour la première fois, le législateur français consacre une règle de reconnaissance des situations. Nous étudierons le contexte dans lequel la règle a été créée (I), puis nous nous intéresserons à son contenu (II).
I. Le contexte
La nouvelle règle française de reconnaissance du nom répond aux exigences de la jurisprudence des cours supranationales (A) et rejoint la solution adoptée par certains textes internationaux et nationaux (B).
A. La jurisprudence
L’un des objectifs classiques du droit international privé est la continuité de la vie juridique des individus au-delà des frontières : un individu ne doit pas changer d’état et de statut au gré de ses déplacements d’un pays à un autre. Cet objectif général est renforcé en matière de nom au sein des États membres de l’Union européenne, puisque le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres implique de porter le même nom dans tous ces États. Deux arrêts de la Cour de justice de Luxembourg peuvent être citées à titre d’exemple.
L’arrêt Konstantinidis concernait un travailleur indépendant grec établi en Allemagne qui contestait la translittération de son nom grec dans les registres allemands de l’état civil au motif qu’elle rendait son nom méconnaissable. La CJCE a jugé qu’il est contraire au principe de non-discrimination et au droit d’établissement que ce ressortissant grec soit obligé d’utiliser un nom qui risque de donner lieu à une confusion de personne auprès de sa clientèle potentielle44.
L’arrêt Grunkin Paul concernait un enfant allemand né au Danemark et résidant dans ce pays depuis sa naissance. L’acte de naissance danois indiquait que l’enfant avait reçu un nom double, composé du nom de son père et de celui de sa mère. Les autorités allemandes ont refusé l’enregistrement de ce nom au motif que la loi allemande, désignée par la règle allemande de conflit de lois en tant que loi nationale, imposait de porter un nom unique. Selon la CJCE, le fait pour une personne de porter un nom dans un État membre (celui dont elle est ressortissante) et un autre nom dans un autre État membre (celui dans lequel elle réside) est susceptible d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Ainsi, l’État membre dont l’individu a la nationalité doit reconnaître le nom patronymique tel qu’il a été déterminé et enregistré sur les registres de l’état civil d’un autre État membre, cela indépendamment de la loi compétente selon la règle de conflit du for45.
L’obligation pour un État membre de reconnaître le nom d’un de ses ressortissants tel qu’il a été attribué dans un autre État membre n’est pas absolue. Des considérations objectives, liées notamment à l’ordre public, sont susceptibles de justifier le refus de reconnaissance du nom. Par exemple, le refus de reconnaissance est justifié si le nom enregistré à l’étranger comprend un titre de noblesse non admis dans l’État membre dont l’intéressé est ressortissant au titre de son droit constitutionnel mettant en œuvre le principe d’égalité46.
Mais l’obligation de reconnaître le nom tel qu’il a été attribué à l’étranger s’étend au-delà des États membres de l’Union européenne, la Convention européenne des droits de l’Homme pouvant également être invoquée en ce sens. En effet, la CEDH considère que le nom d’une personne relève de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par l’article 8 de la Convention47. C’est sur le fondement de cet article que la France a été condamnée dans l’arrêt Kismoun48. L’intéressé, un Franco-Algérien né en France, avait été déclaré à l’état civil français sous le nom de sa mère, Henry. Rapidement abandonné par sa mère, il a ensuite été recueilli par son père qui l’a emmené vivre en Algérie où il a été enregistré sur les registres d’état civil sous le nom de son père, Kismoun. Lorsqu’il a découvert, une fois majeur, que son état civil était différent d’un pays à l’autre, il a demandé aux autorités françaises de substituer son nom tel qu’établi en Algérie à celui qui figurait sur les registres français. Saisie d’un recours, la CEDH s’interroge sur le point de savoir si les autorités françaises ont ménagé un juste équilibre dans la mise en balance des intérêts en jeu qui sont ; à savoir, d’une part, l’intérêt public à réglementer le choix des noms et, d’autre part, l’intérêt du requérant à porter son nom algérien. La France est condamnée au motif que les autorités françaises n’ont pas pris en compte l’aspect identitaire de la demande du requérant : « la reconnaissance de son identité construite en Algérie » impliquait la reconnaissance de son nom algérien, « l’un des éléments majeurs de cette identité ».
B. Les textes
La convention d’Antalya de la Commission internationale de l’état civil du 16 septembre 2005 sur la reconnaissance des noms propose un système de reconnaissance mutuelle des noms attribués dans les États contractants. Cette convention n’est pas entrée en vigueur. On peut également évoquer la proposition de règlement européen relative au nom, qui propose d’unifier les règles de conflit de lois des États membres en la matière et qui instaure une règle de reconnaissance49. Ces textes ne sont pas de droit positif mais ils ont le mérite d’avoir pu inspirer les législateurs nationaux.
En Allemagne, une loi du 23 janvier 2013 a introduit un nouvel article 48 au sein du Code civil allemand : lorsque le nom d’une personne est régi par le droit allemand, l’intéressé peut choisir le nom acquis pendant qu’il résidait habituellement dans un autre État membre et qui a été inscrit dans un registre de l’état civil de cet État, à moins que cela ne soit manifestement incompatible avec des principes essentiels du droit allemand. Cette règle, dont le champ d’application spatial est limité aux États membres, n’intègre pas la jurisprudence de la CEDH.
D’autres États membres ont adopté une règle de reconnaissance plus large. Ainsi, les Pays-Bas ont adopté une règle de reconnaissance du nom dont le domaine d’application spatiale n’est pas limité aux États membres de l’Union européenne50. En réalité, cette règle s’inscrit dans une politique plus générale de reconnaissance des situations consacrée par la loi hollandaise de droit international privé51. La loi roumaine de droit international privé pose également un principe général de reconnaissance des droits acquis à l’étranger52, lesquels englobent le nom acquis à l’étranger.
II. Le contenu
Le législateur français n’a pas introduit de principe général de reconnaissance des situations. Toutefois, compte tenu de son large domaine d’application (A) et de la souplesse de la règle consacrée à l’article 61-3-1 du Code civil (B), celui-ci laisse présager que la méthode de la reconnaissance pourrait être étendue à d’autres domaines.
A. Le domaine d’application
Aux termes de l’article 61-3-1 du Code civil, tout nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un État doit être reconnu en France à la demande de l’intéressé. L’officier de l’état civil français saisi de la déclaration devra modifier le nom figurant dans l’acte de naissance établi en France, permettant ainsi à l’individu de porter un nom unique.
Le nom étranger peut avoir été attribué dans un État membre comme dans un État tiers, à un Français ou à un étranger. En outre, aucune distinction n’est faite suivant que le nom a été transmis à la naissance, ou qu’il a été modifié après la naissance en raison d’une évolution du statut personnel (modification de la filiation, mariage, partenariat enregistré) ou par l’effet d’une décision de justice53 (soit qui modifie la situation familiale, soit en dehors de toute modification de la situation familiale). Ainsi, le nouvel article 61-3-1 soumet le nom étranger à une méthode unique de la reconnaissance, qui consiste à un effacement du point de vue de l’ordre juridique d’accueil au profit de l’ordre juridique dans lequel le nom étranger a été enregistré. Ainsi, peu importe la source d’attribution du nom54 : seule compte sa « cristallisation »55 dans l’ordre juridique étranger par l’inscription dans le registre d’état civil. Par conséquent, la décision étrangère qui porte un changement de nom ne pourrait plus faire l’objet d’une action en inopposabilité devant le juge français. En revanche, la substitution sur le registre d’état civil français du nom étranger à la place du nom français n’implique pas la validité de la relation familiale à l’origine du nom reconnu. Imaginons que le changement de nom résulte d’un divorce prononcé à l’étranger et transcrit sur le registre d’état civil étranger : la modification du nom résultant du divorce sur le registre français de l’état civil ne signifie pas que le jugement de divorce étranger remplit les conditions de régularité du droit français. La règle de reconnaissance énoncée par le nouvel article 61-3-1 ne concerne que le nom.
Enfin, la règle de reconnaissance du nom ne concerne pas l’attribution du nom, laquelle demeure régie par la méthode conflictuelle. La loi applicable à l’attribution du nom est source d’incertitudes. La Cour de cassation a affirmé que la loi des effets du mariage est compétente pour régir la transmission du nom aux enfants légitimes56. Mais il est difficile d’en déduire que le nom est régi par la loi de l’institution dont le nom est un effet, et ce pour plusieurs raisons : la formule de l’arrêt n’est pas générale ; l’arrêt est resté isolé ; et surtout, l’Instruction générale relative à l’état civil57 (IGREC) dispose que l’attribution du nom est régie par la loi nationale des individus58. La règle de reconnaissance ne posant aucune condition liée à la chronologie de l’attribution des noms, peu importe que le nom français ait été acquis en premier lieu ou en second lieu. Dès lors, on peut se demander si la règle de reconnaissance n’aura pas une incidence sur la loi applicable à l’attribution du nom en France. Imaginons des parents de nationalité française qui vivent dans le pays X et qui donnent naissance à un enfant en France. À quoi sert-il d’attribuer le nom de l’enfant en application de la règle de conflit de lois française qui désigne la loi nationale française si la règle de conflit X désigne la loi du milieu de vie, soit la loi X ? L’officier d’état civil français attribuera le nom en application de la loi française, tandis que l’officier d’état civil X l’attribuera en application de la loi X, mais l’intéressé (ou ses représentants) pourra demander à l’officier français de substituer le nom étranger au nom français. La règle de reconnaissance du nom oriente la loi applicable à l’attribution du nom vers une option de législation qui permettrait à l’intéressé (ou à son représentant) de choisir la loi applicable59, ce qui permettrait d’éviter le conflit de noms. Ainsi, même si la nouvelle règle est une règle de reconnaissance du nom étranger, elle est susceptible d’avoir une incidence sur la résolution du conflit de lois au stade de l’attribution du nom.
B. Les conditions d’application
Les conditions de la reconnaissance sont souples : la seule exigence est que le nom soit inscrit sur le registre de l’état civil étranger. L’objet de cette condition est de prouver que le nom dont la reconnaissance est demandée en France a bien été acquis à l’étranger. Mais la règle risque de voir son application limitée toutes les fois où le nom aura été acquis dans un État dont le système d’état civil n’est pas opérationnel. La règle de reconnaissance aurait été d’une plus grande efficacité si l’intéressé avait pu prouver le nom acquis à l’étranger par tout moyen.
Hormis l’inscription du nom sur le registre étranger, la règle ne pose aucune autre condition. Ainsi, aucune condition de proximité n’est exigée entre l’intéressé et l’État dans lequel le nom a été acquis60. La règle ne pose pas non plus de condition relative à l’absence de fraude ou à la conformité à l’ordre public international. La fraude consisterait à délocaliser la situation à l’origine de l’attribution du nom (naissance, mariage, par exemple) en considération de la loi applicable au nom. Si des liens réels préexistent entre les intéressés et le lieu d’attribution du nom, aucune fraude ne peut être reprochée. En l’absence de liens réels préexistants, une manœuvre frauduleuse pourrait être relevée, rendant ainsi le nom étranger inopposable. Cependant, dans la mesure où la règle de reconnaissance ne pose aucune condition de proximité, il n’est pas certain que l’exception de fraude puisse jouer. En revanche, même si la règle ne le prévoit pas, il faut considérer que l’exception d’ordre public pourra constituer un refus légitime de reconnaître le nom acquis à l’étranger, notamment sur le fondement du principe de l’égalité des sexes.
Johanna Guillaumé
III – Observations relatives à l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2016
Dans un arrêt du 25 mai 201661, la Cour de cassation a été confrontée à la question de la validité, au regard du consentement, d’un mariage entre un Français et une Coréenne. Dans cette affaire, le mariage a été célébré en France le 22 mai 2009. L’époux a ensuite demandé la nullité du mariage en invoquant une erreur sur les qualités essentielles de son épouse. La cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’une telle erreur n’est pas une cause de nullité du mariage en droit coréen. La Cour de cassation vise l’article 3 du Code civil puis rappelle que « selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle »62 et casse la décision. Selon la Cour de cassation, les conditions de fond du mariage « sont régies par la loi personnelle de chacun des époux » et c’est la loi française qui devait être appliquée pour se prononcer sur l’erreur invoquée par l’époux.
Il faut souligner qu’ici, l’époux demande la nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse tenant à l’absence de sincérité des sentiments qu’elle prétendait nourrir à son égard. Il invoque ainsi l’article 180 du Code civil et un vice de son propre consentement alors que l’analyse classique aurait conduit à envisager la difficulté sous l’angle de l’article 146 du Code civil et du défaut d’intention conjugale de l’épouse.
Cette stratégie visait à permettre l’application de la loi personnelle du mari, la loi française (A). Elle aurait pu être inutile si l’article 202-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 201463, avait été appliqué (B).
A. La jurisprudence déduit de l’article 3 du Code civil que les conditions de fond du mariage sont soumises à la loi nationale de chacun des époux64. Par conséquent, le défaut de consentement au mariage de l’époux étranger doit s’apprécier au regard de sa loi nationale. Dès lors, un époux français ne peut pas demander la nullité de son mariage sur le fondement de la loi française en invoquant un défaut de consentement de son conjoint étranger. Ainsi, la Cour de cassation, en 2009, avait refusé la nullité d’un mariage d’un Français avec une étrangère pour absence d’intention matrimoniale de celle-ci au motif que la loi applicable au consentement de l’épouse de nationalité roumaine était la loi roumaine qui ne posait pas l’exigence d’une véritable intention conjugale65. Cette solution a été critiquée, notamment au regard des effets du mariage en termes de nationalité et de titre de séjour66.
Afin d’éviter ces solutions, le demandeur a opté, dans cette affaire, pour une autre stratégie : plutôt que de fonder sa demande sur un défaut d’intention conjugale de son épouse, il invoque un vice de son propre consentement. Plus précisément, il considère qu’il a été abusé sur la sincérité des sentiments de son épouse et, partant sur une de ses qualités essentielles. C’est ainsi une condition de fond qui portait sur lui qui n’aurait pas été respectée : s’il n’a pas donné un consentement exempt de vice, une condition de fond de sa loi personnelle, la loi française, n’a pas été respectée67.
De ce point de vue, la cassation est logique puisque la cour d’appel a appliqué la loi coréenne alors qu’il lui appartenait d’appliquer la loi désignée par la règle de conflit, c’est-à-dire ici la loi française.
En revanche, s’agissant du consentement de l’épouse, seule une application de l’article 202-1 du Code civil aurait pu permettre une application de l’article 146, dont il n’est pas question ici.
B. L’article 202-1 du Code civil n’est pas mentionné dans l’arrêt. Ce texte, créé par la loi du 17 mars 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, rappelle que les conditions de fond du mariage sont soumises à la loi personnelle de chacun des époux. En outre, dès 2013, le législateur a apporté une exception à la règle afin d’étendre les possibilités de mariage des couples de même sexe même en présence d’une loi étrangère prohibitive normalement applicable. Une deuxième exception a été ajoutée par la loi du 4 août 2014. Désormais, l’article 202-1 du Code civil précise : « Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 ». Ainsi, le mariage requiert toujours un consentement non vicié par la violence et correspondant à une véritable intention conjugale. Concrètement, cela vise les mariages forcés et les mariages simulés tels que les mariages blancs.
Par cet ajout, le législateur a persisté dans son choix de déroger aux règles habituelles de droit international privé pour étendre le champ d’application de la loi française de manière exorbitante. Il l’avait fait en 2013 en faveur des homosexuels, il a réitéré en 2014 en prétendant le faire en faveur des femmes françaises victimes de mariage forcé68. Dans la réalité, et à y regarder de plus près, le nouveau texte ne change rien dans cette hypothèse. En effet, le consentement au mariage d’une Française était déjà soumis à la loi française en application du principe, nul besoin donc d’une exception. En revanche, l’un des véritables changements apportés par le texte est la possibilité de prononcer la nullité du mariage lorsqu’un étranger n’avait pas d’intention conjugale, et notamment lorsqu’il n’a contracté le mariage que pour obtenir une nationalité ou un titre de séjour.
Ce texte n’est pas utilisé dans cette affaire. Tant le mariage que la décision des premiers juges sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de 2014. On pourrait considérer que, s’agissant des conditions de validité d’une situation juridique, le nouveau texte n’avait pas à s’appliquer (les dispositions transitoires de la loi du 4 août 2014 ne précisent rien à cet égard). Néanmoins, la nouvelle disposition relève du mécanisme des lois de police : elle impose l’application de dispositions de la loi française (C. civ., art. 146 et 180, al. 1er) sans détour par la règle de conflit de lois69. Or, si l’on retient la même logique que celle qui conduit au principe d’actualité de l’ordre public international70, selon lequel il doit être défini au jour où le juge statue, les lois de police devraient s’appliquer immédiatement, y compris aux instances en cours71.
Plusieurs décisions des juges du fond portant sur le consentement d’un époux étranger à un mariage antérieur à la loi de 2014 ont été rendues depuis l’entrée en vigueur de cette loi. Les solutions retenues sont divergentes. Certains juges ne mentionnent pas la difficulté d’application de la loi dans le temps. Ainsi, la cour d’appel de Paris a appliqué le texte antérieur à 201372 sans s’en expliquer et la cour d’appel de Caen73 a fait application de l’article 202-1 mais seulement en ce qu’il posait la règle de la compétence de la loi personnelle de chaque époux s’agissant des conditions de fond du mariage, sans donner non plus de justification. D’autres cours d’appel justifient leurs choix mais la divergence de solution demeure. Ainsi, la cour d’appel de Grenoble précise que « les dispositions de l’article 202-1 du Code civil ne sont applicables que pour les unions célébrées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2014 »74. La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient la solution inverse en considérant que l’article 55 de la loi de 2014 qui a modifié l’article 202-1 du Code civil est « applicable aux instances en cours » et que le consentement d’époux de nationalité française et étrangère, même mariés à l’étranger, « ne s’apprécie qu’à l’aune de la loi française, l’article 202-1 du Code civil modifié étant devenu une loi de police s’appliquant à tous ceux qui habitent le territoire »75.
Si l’absence de mention de l’article 202-1 du Code civil dans l’arrêt du 25 mars 2016 signifie bien que la Cour de cassation le juge inapplicable en l’espèce, la raison de ce choix demeure mystérieuse. Il semble pourtant que tel est bien le sens de l’arrêt : dans la mesure où la Cour de cassation précise que la loi française aurait dû être appliquée, l’article 202-1, qui pose désormais la règle de conflit de lois aurait pu apparaître, même si, en l’espèce, la question portant sur la loi applicable à une erreur sur les qualités essentielles de la personne émanant d’un Français, son application n’aurait pas modifié la solution.
Amélie Dionisi-Peyrusse
IV – La compétence internationale en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires (CJUE, 15 févr. 2017, n° C-499/15)
L’arrêt de la CJUE du 15 février 2017 porte sur l’interprétation de l’article 8 du règlement n° 2201/2003 dit Bruxelles II bis et de l’article 3 du règlement n° 4/2009 dit Aliments. L’espèce ayant donné lieu à la question préjudicielle posée par une juridiction lituanienne est complexe.
Un enfant possédant les nationalités lituanienne et italienne est né en 2006 aux Pays-Bas d’un père lituanien et d’une mère de nationalité néerlandaise et argentine. À la suite de la séparation des parents, l’enfant réside avec sa mère aux Pays-Bas, le père ayant quant à lui sa résidence en Lituanie.
Saisies par le père, les juridictions lituaniennes ont prononcé le divorce des époux, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, accordé un droit de visite au père et précisé le montant des obligations alimentaires de ce dernier envers l’enfant. De son côté, la mère a saisi le juge néerlandais lequel lui a accordé la garde exclusive de l’enfant et a fixé les obligations alimentaires du père envers ce dernier. Le juge lituanien a refusé de déclarer exécutoire la décision néerlandaise. Le juge néerlandais a refusé de déclarer exécutoire la décision lituanienne, sauf en ce qui concerne le droit de visite accordé au père. Le père a de nouveau saisi le juge lituanien pour qu’il modifie la décision qu’il avait initialement rendue en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires.
C’est dans ce contexte que le juge lituanien s’interrogeant sur sa compétence posa une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Reformulant la question posée, la CJUE précisa que les juridictions de l’État membre ayant adopté à l’égard d’un enfant mineur une décision passée en force de chose jugée, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, sont incompétentes pour statuer sur une demande de modification de cette décision lorsque l’enfant a sa résidence habituelle dans un autre État membre. La CJUE rappelle que l’identification de la résidence habituelle servant de critère de compétence dans les contentieux liés à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires est fondée sur une approche fonctionnelle (I) afin de respecter l’objectif de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant assigné en la matière aux règles de compétence (II).
I. La notion de résidence habituelle
Le règlement Bruxelles II bis ne définit pas la notion de résidence habituelle utilisée comme facteur de rattachement. L’intérêt d’une définition de la notion n’est guère évident dès lors qu’elle implique une appréciation factuelle peu compatible avec une formule descriptive abstraite76.
Affirmant qu’il s’agit d’un concept autonome du droit de l’Union européenne, la CJUE appréhende de manière souple et pragmatique77 la notion de résidence habituelle, comme le rappelle l’arrêt rapporté. Dans un arrêt remarqué du 2 avril 2009, la CJUE a indiqué que cette notion correspond au « lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial »78. La Cour a fourni une liste non exhaustive d’indices susceptibles d’aider le juge national à localiser la résidence habituelle de l’enfant. Le juge doit ainsi prendre notamment en considération « la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État ».
La localisation de la résidence habituelle de l’enfant est incontournable au regard du règlement Bruxelles II bis qu’il s’agisse de déterminer si l’enfant a été illicitement déplacé79 ou quel est le juge compétent pour statuer en matière d’autorité parentale. La compétence déterminée en cette matière est étendue à la question des obligations alimentaires. Aux termes de l’article 3 d) du règlement n° 4/2009, sont compétentes pour statuer en matière d’aliments, les juridictions désignées par le règlement Bruxelles II bis « pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action ».
Le concept de résidence habituelle repose pour l’essentiel sur des considérations factuelles. Son identification grâce à la technique du faisceau d’indices objectifs et subjectifs implique une appréciation au cas par cas. L’un de ces indices pris isolément ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une résidence habituelle. Seule la convergence d’un ensemble de critères qualitatifs et quantitatifs vers un lieu permet de localiser la résidence habituelle et, par conséquent, de déterminer le juge compétent. Cette méthode prône « une appréciation circonstanciée »80 mêlant indices temporels et intentionnels81.
En l’espèce, les juridictions lituaniennes ont rendu une décision définitive dont le père a ensuite demandé la modification. Initialement, le juge lituanien a probablement fondé sa compétence sur l’article 14 du règlement Bruxelles II bis82. Ce texte édicte une règle de compétence résiduelle ou « supplétive »83 renvoyant au droit interne de l’État membre « lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13 » du règlement Bruxelles II bis. Lors de la demande de modification de la décision lituanienne formulée par le père, la résidence habituelle de l’enfant n’était pas localisée en Lituanie où ce dernier n’a jamais vécu. Le seul lien rattachant l’enfant à ce pays est constitué par sa nationalité. Or cette circonstance est insuffisante pour localiser une résidence habituelle dans un État membre dans lequel l’enfant ne s’est jamais rendu. La CJUE rappelle que l’identification d’une résidence habituelle implique une présence physique de l’enfant dans l’État membre concerné, s’inscrivant dans la durée et la stabilité. Une présence occasionnelle ou temporaire de l’enfant dans un État membre exclut également toute caractérisation d’une résidence habituelle dans ce pays84.
Les juridictions néerlandaises étant compétentes sur le fondement de l’article 8 du règlement Bruxelles II bis, en tant que juge de la résidence habituelle de l’enfant, restait encore à indiquer si la compétence du juge lituanien pouvait reposer sur un autre fondement.
II. La recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant
Le 12e considérant du règlement Bruxelles II bis affirme que les règles de compétence qu’il édicte « sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité ». L’objectif du règlement est de déterminer le for le plus apte à statuer sur le contentieux parental.
Ainsi, la juridiction du lieu de la résidence habituelle de l’enfant est censée être la mieux placée pour prendre les mesures le concernant en raison de la proximité géographique et matérielle existante entre le for et le litige. Les articles 9 à 15 du règlement Bruxelles II bis prévoient des règles dérogatoires à la règle de compétence générale formulée à l’article 8. Néanmoins, celles-ci doivent être interprétées strictement à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant. La demande de modification des dispositions prises par une décision du juge lituanien devenue définitive constitue une nouvelle procédure laquelle implique de vérifier et de déterminer à nouveau la juridiction compétente. La CJUE a déjà eu en effet l’occasion d’indiquer que la compétence d’une juridiction « n’est pas maintenue au-delà du terme d’une procédure pendante »85.
En l’espèce, aucune des règles spécifiques ne permettait de justifier la compétence des juges lituaniens actionnés par le père de l’enfant. Certes, les articles 9 à 11 rendent possible le maintien de la compétence des juridictions de l’État de la résidence habituelle de l’enfant, mais le jeu de ces textes est lié aux hypothèses particulières de déménagement de l’enfant ou de déplacement illicite de ce dernier. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, l’enfant n’a nullement fait l’objet d’un déplacement illicite. Il n’a pas non plus déménagé de la Lituanie vers les Pays-Bas puisqu’il ne s’est jamais rendu dans ce premier pays86. L’article 12 du règlement Bruxelles II bis octroie une compétence à la juridiction de l’État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit lorsque l’enfant est ressortissant de cet État. Or l’enfant a la nationalité lituanienne. Toutefois, cette prorogation de compétence suppose qu’elle soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant et soit acceptée par toutes les parties à la procédure. L’accord de la mère faisait défaut dans cette affaire87.
Enfin, les juridictions lituaniennes ne pouvaient fonder leur compétence sur l’article 15 du règlement Bruxelles II bis. Les juridictions néerlandaises n’ont à aucun moment renvoyé le litige au juge lituanien lequel ne pouvait nullement être mieux placé pour l’examiner. En effet, ainsi que la CJUE l’a indiqué dans un arrêt du 27 octobre 2016, le recours au forum more conveniens doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant88. Sa mise en œuvre suppose un lien de proximité particulier par opposition au lien de proximité général qui unit l’enfant au lieu de sa résidence habituelle. L’article 15 précise que ce lien peut résulter de la nationalité de l’enfant. Il ne faisait aucun doute que la résidence habituelle de l’enfant est située aux Pays-Bas, pays dans lequel il vit depuis plusieurs années avec sa mère, conformément à une décision lituanienne ayant fixé sa résidence chez celle-ci. À supposer que les juges néerlandais soient saisis en tant que juges de la résidence habituelle, leur désistement éventuel au profit des juges lituaniens n’apporterait « aucune valeur ajoutée réelle et concrète à l’examen de l’affaire »89, contrairement à ce qu’exige la CJUE et pourrait même s’avérer préjudiciable à l’enfant.
La CJUE se refuse ainsi à toute instrumentalisation des règles de compétence retenues en matière de responsabilité parentale lesquelles ont indirectement une incidence sur l’identification du juge compétent s’agissant des obligations alimentaires. Toute incitation au forum shopping par une interprétation extensive des règles de compétence dérogatoires est à éviter en ce domaine où les juges nationaux lorsqu’ils déterminent s’ils sont compétents en vertu du règlement Bruxelles II bis n’ont qu’un seul guide, celui de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Carine Brière
V – Le champ d’application dans l’espace du monopole bancaire (Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 13-88557)
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2015 se prononce sur le champ d’application dans l’espace du monopole bancaire90. Bien qu’il ne soit pas publié au Bulletin, il mérite d’être signalé car la jurisprudence sur cette question est peu fournie91.
En l’espèce, et non sans une certaine ironie, le directeur d’une agence bancaire est condamné pour complicité d’exercice illégal de la profession de banquier. En effet, ce directeur d’agence d’une banque française a mis en relation la victime et l’auteur de l’infraction. Ce dernier proposait un compte courant rémunéré à un taux de 10 % par an. Certes, les intérêts ont bien été versés à la victime, mais le capital, de 150 000 €, a rapidement été détourné. Entre-temps, la victime, rassurée par le paiement des intérêts, s’était portée garante de l’auteur de l’infraction à hauteur de 230 000 €, aggravant ainsi son préjudice lorsque cette garantie a été mise en œuvre.
La fuite précipitée à l’étranger de l’auteur de l’infraction n’est pas le seul élément d’extranéité de cette affaire. Le placement était proposé au nom d’une société établie dans les Iles Vierges qui détenait un compte au Luxembourg. L’argent de la victime provenait de comptes en Suisse. Il avait été transféré au Luxembourg par l’intermédiaire d’un compte personnel dans une banque située au Royaume-Uni.
Évidemment, ni l’auteur de l’infraction, ni la société qu’il représentait ne disposait d’un agrément bancaire en France. Le pourvoi formé par le complice tente de revenir sur la condamnation prononcée en soulevant le fait que le monopole bancaire est territorial, que les opérations de banque accomplies à l’étranger par une personne non agréée en France comme établissement de crédit ne contreviennent pas à la législation française, et ne constituent pas le délit d’exercice illégal de la profession de banquier.
Ce pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui estime que la cour d’appel a justifié sa décision en retenant que « les opérations de banque ont été, au moins en partie, réalisées en France » et que le prévenu a sciemment, en qualité d’intermédiaire, permis à l’auteur de l’infraction, non habilité à procéder à de telles opérations, d’obtenir la remise, aux fins de placement financier, de fonds appartenant à la victime, puis de les détourner.
Au préalable, il faut observer que la qualification d’exercice illégal de l’activité bancaire n’était pas nécessaire en l’espèce pour condamner l’auteur de l’infraction et de son complice. Il a en effet été relevé que les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance étaient clairement localisés sur le territoire français où le détournement avait notamment été commis92. La cour d’appel de Bordeaux a d’ailleurs en partie retenu ce fondement pour condamner le complice à un an d’emprisonnement avec sursis.
Sous l’angle bancaire, le Code monétaire et financier interdit notamment « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public »93. La méconnaissance de cette interdiction expose son auteur à des sanctions pénales, trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende94. En l’espèce, la condition d’habitude était remplie dès lors qu’il ressort de l’arrêt que onze autres victimes, étaient concernées par les agissements similaires. La collecte de fonds sur un compte a probablement conduit à privilégier la qualification d’exercice illégal de l’activité bancaire. Cette qualification n’était pas la seule possible dès lors que les dépôts servaient à alimenter des placements.
Le droit pénal français protégeant le monopole bancaire avait-il pour autant vocation à s’appliquer dans ce contexte international ? Selon le Code pénal, la « loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire »95. Cependant, en l’espèce, l’auteur de l’infraction n’a pas reçu « à titre habituel des fonds remboursables du public » sur le territoire français, mais à l’étranger. Le seul fait que la victime soit en France ne peut être suffisant. Le Code monétaire et financier protège le monopole bancaire français et ne peut préjuger de l’organisation de cette activité à l’étranger. Pourtant, la jurisprudence paraît se contenter d’une offre sur le territoire français ou encore de la commercialisation en France d’un produit soumis au monopole bancaire. La cour d’appel de Bordeaux avait notamment relevé en l’espèce que « tous les éléments préalables et accords amenant la victime au transfert ont eu lieu à Bordeaux ».
Localiser l’activité bancaire là où le contrat a été proposé ou conclu ne va pas de soi. Le Code monétaire autorise clairement l’implantation en France de bureaux de représentation de banques étrangères, non agréées dans l’Union européenne96. La possibilité pour une banque étrangère de recourir au démarchage est débattue en doctrine97, même s’il faut noter qu’hier le CECEI (Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement)98 et aujourd’hui l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)99 condamnent clairement le démarchage en France au profit de banques étrangères non agrées.
En effet, le monopole bancaire protège non seulement l’activité bancaire, mais également la clientèle. Cependant la définition de ce monopole ne retient que des éléments relatifs à l’activité. Dès lors, il nous semble que seule une réglementation de la commercialisation des produits bancaires permet de protéger la clientèle à l’égard d’offres émanant d’entités étrangères. Au contraire, l’interprétation extensive par la jurisprudence du délit l’exercice illégal de l’activité bancaire afin de protéger la clientèle n’est pas opportune et peut s’avérer dangereuse. Elle n’est pas opportune car la répression de l’abus de confiance, et de l’escroquerie suffit à protéger le client contre des malversations financières d’entités financières situées à l’étranger. Elle peut s’avérer dangereuse car crée une insécurité sur l’activité des banques étrangères. Dès lors, seul un renforcement de la réglementation sur la commercialisation de produits bancaires permet de protéger réellement et directement la clientèle. La législation française a d’ailleurs pris cette direction, notamment par la création d’un statut d’intermédiaire en opération de banque et services de paiement. Afin d’éviter une disparité de concurrence, ce statut mériterait toutefois d’être adopté et harmonisé à un niveau européen.
Frédéric Leplat
Notes de bas de pages
-
1.
Cet élargissement est le fruit de modifications législatives du texte et, surtout, de son interprétation particulièrement extensive par la jurisprudence, laquelle est dénoncée par Vogel L., « La dérive du droit de la rupture brutale de relations commerciales établies. Plaidoyer pour une réforme », in Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, 2015, LGDJ, p. 855.
-
2.
Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-11570, SBMM.
-
3.
Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-22675, Lavalin : JCP G 2017, 406, note Mouralis D. ; Gaz. Pal. 2 mai 2017, n° 292q8, p. 22, note Courdier-Cuisinier A.-S.
-
4.
V. infra II, A, sur ces dispositions.
-
5.
De nature délictuelle pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, la responsabilité est de nature contractuelle pour la première chambre civile : v. les arrêts cités par Mainguy D., « La nature de la responsabilité du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies : une controverse jurisprudentielle à résoudre », D. 2011, p. 1495.
-
6.
CJUE, 14 juill. 2016, n° C-196/15, Granarolo, statuant dans le cadre du règlement Bruxelles I, relatif à la compétence en matière civile et commerciale.
-
7.
Pts 25 et s.
-
8.
La Cour de justice mentionne à ce titre « l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée » (pt 26).
-
9.
V. en ce sens Bollée S., « La responsabilité extracontractuelle du cocontractant en droit international privé », in Mélanges en l’honneur du Professeur Bernard Audit, 2014, LGDJ, spéc. p. 133-134 ; Corneloup S., « La responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie et le droit international privé de l’Union européenne », in Mélanges offerts au Professeur Pascale Bloch, 2015, Bruylant, spéc. p. 421-423.
-
10.
Cass. 1re civ., 6 mars 2007, n° 06-10946, Frankonia – comp. dans le même sens Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 15-26105, Riviera Motors.
-
11.
Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-15823, Monster Cable.
-
12.
Cass. com., 20 mars 2012, SBMM, préc.
-
13.
Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-10216, John Deere.
-
14.
CJUE, 21 mai 2015, n° C-352/13, Cartel Damage Claims.
-
15.
Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-16898, eBizcuss ; JDI 2016, p. 929, note Kleiner C.
-
16.
V. la note critique de Kleiner C., JDI 2016, p. 929.
-
17.
Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, Monster Cable, préc., rendu au visa de l’article 3 du Code civil et des principes généraux du droit international privé, accepte la mise en œuvre de la clause désignant les juridictions de San Francisco, « des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige ».
-
18.
Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, Riviera Motors, préc.
-
19.
Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-14924, Lauterbach : JDI 2016, p. 939, note Usunier L.
-
20.
V. sur ces aspects Usunier L. note préc., JDI 2016, spéc. p. 947-978.
-
21.
Conformément à l’arrêt Lauterbach, la compétence du juge étranger peut également résulter, à défaut d’élection de for, du jeu des règles ordinaires de compétence.
-
22.
V. sur l’ensemble de la question Bureau D., Muir Watt H., « L’impérativité désactivée ? À propos de Cass. 1re civ., 22 octobre 2008 », Rev. crit. DIP 2009, p. 1.
-
23.
C. com., art. D. 442-4. Il appartient en revanche aux autres cours d’appel, conformément à l’article R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort et qui ne sont pas spécialement désignées par l’article D. 442-3 du Code de commerce, et ce même si elles tranchent une affaire mettant en cause l’article L. 442-6 du Code de commerce : Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17659, Fascom – Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-24241, Sodisco – et Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-15337, Estudia (revirements partiels de jurisprudence) : JCP G 2017, 498, note Behar-Touchais M. ; solution réitérée par Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-26780, Afid.
-
24.
Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25080, Scamark.
-
25.
V. I, A, notre analyse sur le terrain des clauses attributives de juridiction.
-
26.
V. implicitement en ce sens Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-19389, MJA : JCP G 2016, 1002, note de Fontmichel M.
-
27.
Il s’agit, selon le cas, du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance.
-
28.
Loquin É., L’arbitrage du commerce international, 2015, Joly., n° 91, spéc. p. 88.
-
29.
V. infra II, B.
-
30.
CA Paris, 19 mai 1993, nos 92/21091, 92/21361 et 92/20943, Labinal : Rev. arb. 1993, p. 645, note Jarrosson C. ; JDI 1993, p. 957, note Idot L.
-
31.
Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-67013, Doga : Rev. arb. 2010, p. 513, note Dupeyré ; Rev. crit. DIP 2010, p. 743, note Bureau D. et Muir Watt H.
-
32.
V. I, B, sur le terrain des clauses attributives de juridiction.
-
33.
Cass. com., 1er mars 2017, Lavalin, préc. : « l’arbitrage n’était pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce étaient applicables ».
-
34.
Rapp. Charié J.-P. à AN, 22 mai 2008, n° 908, spéc. p. 322.
-
35.
Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, Scamark, préc., précise que ces dispositions « ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence ».
-
36.
Clay T, D. 2015, spéc. p. 2590.
-
37.
Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-21811, Apple : D. 2016, p. 1910, note Roda J.-C.
-
38.
Il s’agissait de la société Apple distribution international et de la société Apple France.
-
39.
V. déjà Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-16761, Le Galec – qualification reprise plus récemment par Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23547, Le Galec.
-
40.
V. pour une démonstration : Roda J.-C., note préc. sous Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-21811, Apple ; adde Behar-Touchais M., « Et si l’action du ministre fondée sur l’article L. 442-6, III, du Code de commerce n’était ni contractuelle, ni délictuelle au sens des règlements Bruxelles I, Rome I et Rome II ? », RDC 2015, p. 889.
-
41.
C. civ., art. 1165 devenu C. civ., art. 1199.
-
42.
L’extension de la convention d’arbitrage à un tiers qui ne l’a pas signée a été retenue soit au sein de groupes de sociétés, soit, plus largement, lorsqu’une implication directe du tiers dans l’exécution du contrat peut être constatée. Elle est admise lorsque le comportement du tiers révèle son adhésion implicite à la convention : v. Racine J.-B., Droit de l’arbitrage, 2016, PUF, p. 244-252.
-
43.
Lagarde P., « Le droit du nom. Est-il besoin de légiférer ? », Parlement européen, affaires juridiques et parlementaires, 2015, spéc. p. 5 et s., www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html.
-
44.
CJCE, 30 mars 1993, n° C-168/9, Konstantinidis.
-
45.
CJCE, 14 oct. 2008, n° C-353/06, Grunkin Paul.
-
46.
CJUE, 22 déc. 2010, n° C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein c/ Landeshauptmann von Wien.
-
47.
V. par ex. CEDH, 22 févr. 1994, n° 16213/90, Burghartz c/ Suisse.
-
48.
CEDH, 5 déc. 2013, n° 32265/10, Kismoun c/ France.
-
49.
Cette proposition a été établie par un groupe de travail de l’Assemblée fédérale allemande des officiers de l’état civil : Rev. crit. DIP 2014, p. 733.
-
50.
Art. 2,4 § 1, de la loi du 9 mai 2011 : « « Lorsque le nom ou les prénoms d’une personne ont été enregistrés en dehors des Pays-Bas à sa naissance ou qu’ils ont été modifiés à la suite d’un changement de son état personnel intervenu en dehors des Pays-Bas et que ces nom ou prénoms ont été consignés dans un acte dressé par une autorité compétente conformément aux dispositions locales en vigueur, le nom ou les prénoms ainsi enregistrés ou modifiés sont reconnus aux Pays-Bas. La reconnaissance ne peut être refusée pour cause d’incompatibilité avec l’ordre public au seul motif qu’une autre loi a été appliquée que celle applicable en vertu du présent titre ».
-
51.
Art. 9 de la loi du 9 mai 2011 : « Lorsque des effets juridiques sont attachés à un fait par un État étranger concerné en application de la loi désignée par son droit international privé, ces mêmes effets peuvent être reconnus à ce fait aux Pays-Bas, même par dérogation à la loi applicable en vertu du droit international privé néerlandais, dans la mesure où le refus de reconnaître de tels effets constituerait une violation inacceptable de la confiance justifiée des parties ou de la sécurité juridique ».
-
52.
Art. 2.567 de la loi du 24 juillet 2009 : « Les droits acquis dans un pays étranger sont respectés en Roumanie, à l’exception des cas où ils seraient contraires à l’ordre public de droit international privé roumain ».
-
53.
Contrairement à la convention CIEC précitée, selon laquelle l’État qui ne reconnaît pas la décision modifiant l’état des personnes ayant conduit au changement de nom peut refuser de reconnaître le changement de nom (art. 5.1).
-
54.
La CEDH ne distingue pas non plus la source de la situation. V. par ex CEDH, 28 juin 2007, n° 76240/01, Wagner c/ Luxembourg.
-
55.
Sur la notion de cristallisation, V. Mayer P., « Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé », in Mélanges Paul Lagarde, 2005, Dalloz, p. 547.
-
56.
Cass. 1re civ., 7 oct. 1997, n° 95-16933, Canovas-Guttierez.
-
57.
L’IGREC regroupe les dispositions législatives et réglementaires, circulaires et décisions jurisprudentielles relatives à l’état civil. Bien qu’elle n’ait pas valeur normative, cette circulaire constitue le texte de référence en matière d’état civil à l’usage des parquets et des officiers de l’état civil.
-
58.
IGREC, n° 531.
-
59.
L’IGREC (n° 532-2) offre déjà une option de législation aux étrangers concernant la transmission du nom dans le cadre de la filiation : les parents de l’enfant peuvent écarter la loi nationale étrangère au profit de la loi française ; v. égal. C. civ., art. 311-24-1.
-
60.
À la différence des règles énoncées par la convention CIEC, préc.
-
61.
Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-14666 : Dr. fam. n° 9, comm. 191, note Farge M. ; Rev. crit. DIP 2016, p. 668, note Ralser É.
-
62.
V. dernièrement en ce sens not. Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-14365 : AJ fam. 2016, p. 342, note Boiché A. ; Dr. fam. 2016, comm. 116, Devers A.
-
63.
L. n° 2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : D. 2014, p. 1895, commentaire Regine. Sur la modification de l’article 202-1 du Code civil opérée par cette loi, v. Fulchiron H., « Règle de conflit de lois et lutte contre les mariages forcés – Qui mal embrasse, trop étreint », JCP G 2015, 171.
-
64.
V. not. Bourdelois B., Rép. Dr. Int., V° Mariage et les réf. cit.
-
65.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2009, n° 08-10387, not. Rev. crit. DIP 2009, p. 493, note Lagarde P. – v. égal. Cass. 1re civ., 16 mars 2016, préc.
-
66.
V. Lagarde P., note préc.
-
67.
Cette stratégie semble fonctionner devant les juges du fond, v. par ex. CA Montpellier, 14 déc. 1992 : RTD civ. 1994, p. 80, obs. Hauser J. ; CA Lyon, 2 juill. 2009, n° 08/00663.
-
68.
Cette disposition est issue d’un amendement parlementaire tendant « à faciliter l’annulation d’un mariage contracté à l’étranger de manière forcée » car « les femmes françaises ne parviennent pas à faire annuler ce type de mariages », Propos de Lemaire A., Rapp. AN, n° 1663, 18 déc. 2013.
-
69.
Considérant que la méthode s’apparente à celle des lois de police, Fulchiron H., art. préc.
-
70.
Selon l’étude du Rapport annuel 2013 de la Cour de cassation (« L’ordre public »), p.128 : « L’ordre public international s’exprime sous une forme positive lorsque le juge français applique directement une loi étrangère ou une loi de police française » (sur ce rapport, v. not. Guillaumé J., « L’ordre public international selon le rapport 2013 de la Cour de cassation », D. 2014, p. 2121.
-
71.
Selon Boiché A., note préc. : « dans la mesure où il s’agit d’une loi de police, elle devrait s’appliquer immédiatement aux procédures en cours ».
-
72.
CA Paris, 27 janv. 2015, n° 14/13610.
-
73.
CA Caen, 7 mai 2015, n° 14/02414.
-
74.
CA Grenoble, 3 mai 2016, n° 15/01439 – dans le même sens, v. aussi CA Grenoble, 1er mars 2017, n° 15/03775.
-
75.
CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2016, n° 15/17715 – v. aussi dans le même sens, CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 15/05620 – CA Aix-en-Provence, 8 mars 2016, n° 15/17016 – CA Aix-en-Provence, 25 oct. 2016, n° 15/12616 (dans cette affaire, la Cour écarte l’application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 en considérant que les dispositions de l’article 202-1 sont d’ordre public).
-
76.
Une telle approche a toutefois été retenue par la Cour de cassation dans le cadre d’un contentieux de la désunion relevant à l’époque du règlement Bruxelles II. Selon la haute juridiction, la résidence habituelle correspond au « lieu où l’intéressé a fixé, avec volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ». V. Cass. 1re civ., 14 déc. 2005, n° 05-10951, Moore : D. 2006, p. 1502, obs. Courbe P. et Jault-Seseke F. V. égal. Farge M., « Était-il opportun de définir la notion de résidence habituelle en droit international privé communautaire ? À propos de Cass. 1re civ., 14 déc. 2005 », Dr. fam. 2006, étude 17, p. 19.
-
77.
C’est l’approche classiquement suivie par la CJUE vis-à-vis des notions contenues dans les règlements régissant des aspects de droit international privé quelle que soit la matière. Voir dans un tout autre domaine, la démarche privilégiée à propos de la notion d’activité dirigée à laquelle se réfère la règle de compétence protectrice du consommateur énoncée à l’article 15 du règlement Bruxelles I ou 18 du règlement Bruxelles I bis, CJUE, 7 déc. 2010, nos C-585/08 et C-144/09, Pammer et Hotel Alpenhof – CJUE, 17 oct. 2013, n° C-218/12, Emrek.
-
78.
CJCE, 2 avr. 2009, n° C-523/07 : Rev. crit. DIP 2009, p. 791, note Gallant E. ; JCP G 2009, 316, Boulanger F. – CJUE, 22 déc. 2010, n° C-497/10, Mercredi. V. égal. Brière C. L’essentiel des Grands arrêts du Droit international privé, 1re éd., 2016, Gualino, Lextenso, p. 32.
-
79.
En matière d’enlèvement d’enfants, v. CJUE, 9 oct. 2014, n° C-374/14 – Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 04-19015 : AJ fam. 2015, p. 283, note Boiché A.
-
80.
Hammje P., art. 2 du règlement Bruxelles II bis, in : Corneloup S. (dir.), Droit européen du divorce, Travaux du CREDIMI, 2013, LexisNexis, p. 231.
-
81.
Cette méthode a également sa place en matière de désunion même si la CJUE n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ce point. Un raisonnement par analogie devrait être logiquement privilégié par la CJUE en ce domaine même si une adaptation à cette matière des indices sera nécessaire pour tenir compte de ses spécificités.
-
82.
En ce sens, Bot Y., Avocat général, conclusions sous CJUE, 15 févr. 2017, n° C-499/15.
-
83.
Barrière Brousse I. et Douchy-Oudot M. (dir), Les contentieux familiaux, 2e éd., 2016, LGDJ, Lextenso, n° 1123.
-
84.
CJUE, 22 déc. 2010, Mercredi, op. cit., pt. 47.
-
85.
CJUE, 1re oct. 2014, n° C-436/13, pt. 40.
-
86.
A fortiori, le for de nécessité prévu par l’article 13 du règlement Bruxelles II bis et fondé sur le présence d’un enfant sur le territoire d’un État membre et l’impossibilité de localiser sa résidence habituelle ne pouvait être retenu en l’espèce.
-
87.
Pour un autre exemple de défaut d’acceptation de la compétence des juridictions saisies par l’un des parents sur le fondement de l’article 12 du règlement Bruxelles II bis, v. CJUE, 21 oct. 2015, n° C-215/15, Gogova.
-
88.
CJUE, 27 oct. 2016, n° C-428/15, pt. 58.
-
89.
CJUE, 27 oct. 2016, préc., pt. 57.
-
90.
Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 13-88557 : Gaz. Pal. 10 nov. 2015, n° F7358, p. 34, note Morel-Maroger J. ; Sciascia F., La Cour de cassation s’exprime sur le champ d’application du monopole bancaire, 2015, Éditions législatives ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 1, obs. Crédot Francis-J. et Samin T.
-
91.
Cass. crim., 28 nov. 1996, n° 95-80168 – Cass. crim., 22 sept. 2010, n° 09-85665.
-
92.
Morel-Maroger J., op. cit.
-
93.
C. mon. fin., art. L. 511-5, al. 2.
-
94.
C. mon. fin., art. L. 571-3.
-
95.
C. pén., art. 113-2.
-
96.
Selon C. mon. fin., art. L. 511-19 : « Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger ouvrent des bureaux ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation, l’ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l’Autorité de contrôle prudentiel. Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l’établissement de crédit qu’ils représentent ».
-
97.
Stoufflet J., Bouretz E., « Statut bancaire en droit international », JCl. Banque, Crédit, Bourse, fasc. 20, n° 18.
-
98.
Rapp. CECEI 2004, p. 41 cité par JCl. Banque, op cit.
-
99.
Le site internet de l’ACPR indique, concernant les IOBSP, qu’il « est rappelé que les IOBSP ne peuvent proposer à des résidents français que les produits des établissements de crédit autorisés à intervenir en France ». https://acpr.banque-france.fr/vous-etes/intermediaires/intermediaires-en-operations-de-banque/faq-iobsp.html (page consultée le 17 avr. 2016).