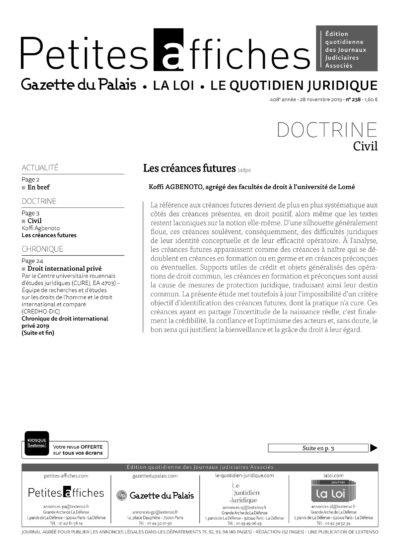Chronique de droit international privé 2019 (Suite et fin)
Cette chronique de droit international privé dirigée par le Centre universitaire rouennais d’études juridiques, couvre l’année 2019.
I – L’adoption constitue-t-elle une voie satisfaisante pour reconnaître le lien de filiation entre le parent d’intention et l’enfant issu d’une gestation pour autrui à l’étranger ?
II – L’ordre public de proximité européen et les répudiations musulmanes (Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-16102)
III – De très anciennes dispositions sexistes en matière de nationalité devant le Conseil constitutionnel (Cons. const., 5 oct. 2018, n° 2018-737 QPC)
IV – La nature contractuelle de l’action paulienne (CJUE, 4 oct. 2018, n° C-337/17, Feniks sp. z o.o. c/ Azteca Products & Services SL)
L’action paulienne, héritée du droit romain, revêt aujourd’hui de multiples visages selon les droits nationaux. Son caractère triangulaire soulève des difficultés de compétence internationale insoupçonnées à l’origine. C’est ce qu’illustre un arrêt très remarqué de la Cour de justice, en date du 4 octobre 20181.
En l’espèce, deux sociétés, ayant leur siège social en Pologne, ont conclu un contrat de travaux de construction dans le cadre d’un projet d’investissement immobilier sis en Pologne. Afin d’exécuter ce contrat, l’entrepreneur a eu recours à plusieurs sous-traitants mais il ne s’est pas acquitté de ses obligations à l’égard d’une partie de ceux-ci. L’investisseur a alors été obligé, en application du droit polonais, de payer directement les sous-traitants à la place de l’entrepreneur. Par la suite, et faute d’avoir pu obtenir le remboursement des sommes versées, il a assigné devant le juge polonais une société espagnole à laquelle l’entrepreneur, devenu insolvable, avait cédé un immeuble situé en Pologne. Il entendait exercer l’action paulienne prévue par le droit polonais, qui l’autorisait à voir déclarer inopposable cette vente, consentie en fraude de ses droits.
S’interrogeant sur sa compétence, le juge polonais a saisi la Cour de justice de questions préjudicielles en interprétation du règlement Bruxelles I bis2 : l’action paulienne intentée par l’investisseur polonais à l’encontre de la société espagnole relève-t-elle de la matière contractuelle et, partant, de la règle de compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), qui désigne le juge polonais, ou doit-elle être portée devant les juridictions espagnoles du domicile de la société défenderesse, compétentes en vertu de la règle générale de l’article 4, point 1 ? Contrairement à la position exprimée par l’avocat général, la Cour de justice opte pour la première branche de l’alternative et la solution qu’elle pose est transposable à l’action paulienne du droit français : l’« action paulienne, par laquelle le titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a) ». Elle retient ainsi une conception particulièrement extensive de la matière contractuelle (I), dont il n’est pas certain qu’elle soit réellement conforme aux objectifs de proximité et de prévisibilité des règles de compétence (II).
I. Une conception particulièrement extensive de la matière contractuelle
En déclarant applicable l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis, la Cour de justice écarte à juste titre, et même si ce n’est qu’implicitement, les autres chefs de compétence envisageables, qu’il s’agisse des règles de compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers3 et d’exécution des décisions4, de la règle de compétence optionnelle spéciale en matière délictuelle5 ou du for du provisoire6. Ce faisant, elle confirme les arrêts Reichert7 et ces éléments ne retiendront donc pas davantage notre attention. L’intérêt de l’arrêt commenté est ailleurs : il est, pour la première fois, d’intégrer explicitement l’action paulienne dans la « matière contractuelle », ce que ne laissaient pas présager les décisions antérieures8. Cette qualification surprend de prime abord. L’affaire met bien en cause deux relations contractuelles – un contrat de construction et un contrat de vente – mais aucun de ces contrats ne lie les parties litigantes : la société espagnole, partie au contrat de vente, est tiers au contrat de construction conclu par l’investisseur, tandis que ce dernier, partie au contrat de construction, est tiers au contrat de vente frauduleusement conclu par la société espagnole. Comment expliquer, en ce cas, que la qualification contractuelle de l’action paulienne ait pu être retenue ?
De façon tout à fait classique, la Cour de justice rappelle d’abord que la notion de « matière contractuelle » doit être « interprétée de manière autonome » (pt 38)9. Puis, réécrivant l’arrêt Jacob Handte10 afin d’élargir la notion, elle précise que l’application de la règle de compétence spéciale de l’article 7, point 1, sous a) du règlement Bruxelles I bis, « présuppose l’existence d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur »11 (pt 39). Elle ajoute que cette règle « repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties » (pt 48). En d’autres termes, il faut et il suffit, pour qu’un litige entre dans la « matière contractuelle » au sens de ce texte, que le demandeur puisse fonder son action sur une « obligation juridique librement consentie ». Il n’est en revanche pas nécessaire que cette obligation ait été consentie à son égard par le défendeur : le juge du contrat peut être compétent à l’égard d’un tiers à ce contrat.
Le propos n’est pas entièrement nouveau. Deux arrêts récents n’ont pas hésité à donner compétence au for contractuel dans des hypothèses où aucun contrat stricto sensu ne liait les parties au procès. Ont ainsi été intégrées dans la « matière contractuelle » l’action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit (arrêt Kareda)12 ou encore l’action d’un passager en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance, contre un transporteur aérien effectif qui n’était pas son cocontractant (arrêt flightright)13. Toutefois, et à la différence de l’arrêt commenté, les défendeurs n’étaient pas réellement des tiers au contrat sur lequel le demandeur fondait son action14. L’arrêt Feniks va plus loin que ces précédents : il donne compétence au for contractuel dans une hypothèse où le défendeur est complètement étranger au contrat conclu par le demandeur et sur lequel celui-ci fonde son action.
Selon la Cour de justice, en effet, l’action paulienne « trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier à l’égard de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second » (pt 40). Or, tant ce droit de gage que l’action en inopposabilité de la vente consentie par ce débiteur à un tiers – objet même de l’action paulienne – trouvent leur source dans les obligations juridiques librement consenties par l’entrepreneur à l’égard de l’investisseur, lors de la conclusion du contrat de construction (pt 42). Par suite, l’action paulienne relève bien de la « matière contractuelle » au sens de l’article 7, point 1), sous a) du règlement Bruxelles I bis. Bien plus, la « cause » de l’action paulienne se trouve dans le contrat de construction et non dans le contrat de vente, et ce alors que c’est le contrat de vente – auquel la société défenderesse est partie et qui porte préjudice au demandeur – qui se trouve au cœur de la contestation15. Dans ces conditions, l’article 7, point 1, sous b), relatif à la fourniture de services, désigne, pour statuer sur l’action paulienne, le juge polonais, juge du lieu où les travaux de construction ont été fournis.
Cette conception très large de la matière contractuelle conduit à admettre la compétence du for contractuel à l’égard d’un tiers qui ne présente aucun lien avec le contrat invoqué par le demandeur au soutien de son action. Or, et contrairement à ce qu’affirme la Cour de justice, il n’est pas certain qu’elle réponde aux objectifs de proximité et de prévisibilité poursuivis par l’article 7 du règlement Bruxelles I bis.
II. Une conception difficilement conciliable avec les objectifs de proximité et de prévisibilité des règles de compétence
De façon générale, les options spéciales de compétence formulées par l’article 7 du règlement Bruxelles I bis sont justifiées notamment par le fait « qu’il existe un lien de rattachement étroit entre la contestation et le tribunal qui est appelé à en connaître »16. La Cour de justice, toutefois, loin de relever les liens existants entre le juge polonais et la situation litigieuse, se contente d’observer qu’une qualification autre que contractuelle contraindrait le créancier à « introduire son action devant la juridiction du domicile du défendeur, ce for, prévu à l’article 4, point 1, du règlement n° 1215/2012, pouvant le cas échéant être exempt de tout lien avec le lieu d’exécution des obligations du débiteur à l’égard de son créancier » (pt 45). La formulation est maladroite, l’existence d’un lien entre la situation et le for du défendeur étant dépourvue de pertinence. La compétence des juridictions de l’État du domicile du défendeur constitue « la compétence de principe » ; elle « devrait toujours être disponible »17, ce qui signifie qu’« il est impossible d’écarter cette juridiction au motif qu’[elle] ne serait pas le for convenient »18. La théorie du forum non conveniens, fermement condamnée par ailleurs19, n’est pourtant pas très loin dans le présent arrêt.
En réalité, la Pologne – dont les juges sont reconnus compétents – constitue, de facto, le « centre de gravité » de l’affaire, qui est à l’origine purement interne à cet État : les travaux de construction, conclus entre deux sociétés polonaises, portent sur des immeubles situés en Pologne, et c’est en application des règles du droit polonais relatives à la responsabilité solidaire de l’investisseur que ce dernier a payé les sous-traitants au lieu et place de l’entrepreneur. L’élément d’extranéité n’est apparu que plus tard, avec la cession – arguée de fraude – d’un immeuble, néanmoins situé en Pologne, à une société espagnole. En l’espèce, la compétence du juge polonais peut donc sembler opportune. Toutefois, ce rattachement purement factuel de la situation à un seul pays suffit-il à considérer qu’il existera toujours « un lien de rattachement étroit » entre l’action paulienne et le juge du contrat dont le demandeur tire sa créance ? Que décider, par exemple, si un entrepreneur espagnol passe contrat avec un investisseur espagnol, pour un projet immobilier portant sur des biens situés en Pologne, avant de céder frauduleusement, à une autre société espagnole, un bien immobilier situé en Espagne ? Les circonstances particulières de l’affaire sous commentaire conduisent alors à douter de la portée générale de la solution posée par la Cour de justice et paraissent reléguer cet arrêt au rang des arrêts d’espèce. La Cour, au demeurant, ne dit pas le contraire, puisqu’elle précise dans ses motifs que la solution qu’elle pose vaut « dans une situation telle que celle en cause au principal ».
La Cour de justice estime par ailleurs que la qualification contractuelle de l’action paulienne répond à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence : « Un professionnel ayant conclu un contrat d’achat immobilier peut, lorsqu’un créancier de son cocontractant réclame que ce contrat entrave indûment l’exécution des obligations de ce cocontractant vis-à-vis de ce créancier, raisonnablement s’attendre à être attrait devant une juridiction du lieu d’exécution [desdites] obligations » (pt 47). L’affirmation ne convainc pas et marque, une nouvelle fois, la limite de l’analogie précédemment relevée avec les arrêts Kareda et flighright. Dans l’arrêt Kareda, les parties litigantes étaient codébiteurs solidaires d’un prêt immobilier. Certes, aucun contrat ne liait directement les parties mais la qualification contractuelle retenue par la Cour de justice, à propos de l’action récursoire intentée par l’un des codébiteurs contre l’autre, conduisait à retenir la compétence de la juridiction du lieu du siège social de la banque, ce qui n’était nullement imprévisible pour le codébiteur n’ayant pas payé sa part. Dans l’arrêt flightright encore, le transporteur effectif, qui n’avait conclu aucun contrat avec le passager intentant une action contre lui, était néanmoins réputé agir au nom du cocontractant du passager20, de sorte que la compétence tirée du contrat de transport ne pouvait complètement le surprendre. Rien de tel dans l’affaire commentée. Le juge polonais est le juge du lieu d’exécution des obligations du contrat de construction conclu par le demandeur et ce contrat n’entretient strictement aucun lien avec la société espagnole assignée en justice ; celle-ci n’est pas partie au contrat liant le demandeur. Bien plus, elle peut même jusqu’à en ignorer l’existence21. En effet, comment l’acquéreur d’un bien immobilier – et le fait qu’il soit un professionnel ne paraît rien changer à la donne – pourrait-il connaître les différents créanciers de son vendeur et, partant, raisonnablement s’attendre à être attrait en tout lieu où les obligations contractées par ce dernier doivent être exécutées ?22
Faisant fi tant du principe de l’interprétation stricte des règles optionnelles de compétence que du principe de l’effet relatif des conventions, la Cour de justice est sans doute allée trop loin dans sa conception extensive de la matière contractuelle. Il aurait sans doute mieux valu s’en tenir à la compétence de principe, défendue par l’avocat général, des juridictions du domicile du défendeur qui ne peut être retenue, si l’on interprète a contrario l’arrêt commenté23, que si celui qui exerce l’action paulienne est titulaire d’un droit de créance d’une nature autre que contractuelle24.
Valérie PARISOT
V – La responsabilité extracontractuelle ne permet pas de se soustraire à la clause compromissoire transmise à un affactureur (Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-13067 (1re esp.) et Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-13069 (2e esp.))
Les arrêts. Invoquer la responsabilité extracontractuelle du débiteur d’une créance transmise par subrogation ne suffit pas à caractériser l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire transmise à l’affactureur avec la créance.
Tel est l’enseignement qui ressort de deux arrêts rendus le 4 juillet 2018 par la chambre commerciale de la Cour de cassation25. Auparavant, la première chambre civile de la Cour de cassation s’était prononcée dans le même sens le 13 septembre 2017 à l’occasion d’un litige opposant le même affactureur avec d’autres clients des mêmes entreprises26.
Il ressort de la première espèce que les sociétés françaises Tiwy et Laboulet ont vendu des graines de tournesol à la société de droit allemand Mayerhofer. Les créances sur Mayerhofer, constatées par les factures émises par Tiwy et Laboulet, ont été transférées à la banque Delubac en exécution d’un contrat d’affacturage. À l’échéance, Mayerhofer a refusé de les payer car une commande n’a jamais été livrée, et les autres ont été payées par compensation. La banque n’a pas d’autre choix que de poursuivre Mayerhofer car Laboulet et Tiwy sont soumises à des procédures collectives. La banque a assigné Mayerhofer en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de commerce pour comportement déloyal. La société se défend en soulevant l’incompétence du tribunal étatique en raison des clauses d’arbitrage prévues dans les contrats de vente. La seconde espèce sur laquelle se prononce la Cour de cassation est pratiquement identique.
Dans tous les cas, les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Paris qui ont jugé que le tribunal de commerce n’est pas compétent sont rejetés. La demande de la banque étant « en lien avec les contrats de vente conclus » et « contenant les clauses compromissoires », la cour d’appel « a pu en déduire que le caractère délictuel de l’action engagée » par la banque « ne suffisait pas à caractériser l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ».
Sous l’angle procédural : action en responsabilité extracontractuelle et absence d’« inapplicabilité manifeste » de la convention d’arbitrage. La clause compromissoire se transmet avec la créance à l’affactureur subrogé dans les droits de son client contre le débiteur. En effet, il a été démontré qu’en présence d’une opération translative, la clause compromissoire, un accessoire, se transmet à l’ayant cause27. Il en résulte notamment que la clause compromissoire se transmet à l’affactureur subrogé dans les droits de son client, subrogeant. Si l’extension à des tiers de la clause compromissoire soulève de nombreux débats, tel n’est pas le cas pour les opérations translatives. L’ayant cause dispose des mêmes droits que son auteur, autrement dit, l’affactureur subrogé ne dispose pas de plus de droits contre le débiteur que le subrogeant. Dès lors la clause compromissoire stipulée dans le contrat lui est donc opposable. La solution est solidement ancrée en jurisprudence28, même s’il ne semblait pas exister de précédent à propos de la subrogation.
À ce stade, la situation ne diffère donc pas de celle qui aurait existé si le litige était intervenu directement entre les parties au contrat initial. Certes, l’affactureur n’a probablement pas eu connaissance de la clause compromissoire à la date de la subrogation. En outre, cette clause risque de modifier substantiellement le coût du recouvrement. Ces considérations sont toutefois indifférentes. Une opération translative ne peut modifier les droits et obligations du débiteur inhérents à la créance transmise. Rien ne justifie de priver le débiteur de la possibilité de se prévaloir de l’arbitrage conformément aux prévisions du contrat initialement conclu.
Le fondement extracontractuel et non contractuel de l’action intentée par l’affactureur est-il de nature à modifier cette solution ? Le principe de compétence-compétence est consacré par le Code de procédure civile. Selon ce code, lorsqu’un litige, relevant d’une convention d’arbitrage, est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si cette convention est « manifestement nulle » ou « inapplicable »29. Il faut donc se demander si la clause compromissoire est « manifestement inapplicable » lorsque le subrogé n’agit pas sur un fondement contractuel mais extracontractuel. Il a été jugé qu’une convention d’arbitrage n’est pas applicable à un litige concernant une action en responsabilité délictuelle engagée par un tiers contre un contractant car l’action ne visait pas à demander l’exécution du contrat dans lequel se trouvait la clause compromissoire30. Au contraire, il a été jugé que la clause d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable dans un litige portant sur l’existence d’un dol commis par l’un des contractants31.
En l’espèce, la Cour de cassation dans les deux décisions de 2018, comme dans celle de 2017, considère que la nature délictuelle de l’action engagée par la banque ne suffit pas à caractériser l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage. La Cour contrôle la qualification de cette notion par les juges du fond. Mais les critères sur lesquels repose cette qualification sont peu explicités. La première chambre de la Cour de cassation est la plus prolixe en relevant que les factures litigieuses étaient postérieures d’à peine quelques semaines aux contrats contenant la convention d’arbitrage. Cette précision laisse perplexe : la proximité entre la conclusion du contrat comprenant une clause compromissoire et l’émission des factures n’a aucun rapport avec la notion d’« inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ». Quant à la chambre commerciale, elle relève que la Cour d’appel a pu motiver sa décision en constatant que les factures émises au titre des contrats de vente avaient été transférées en exécution du contrat d’affacturage conclu avec la banque, ce dont il résultait que la demande de la banque était en lien avec ces ventes. L’existence d’un lien contractuel transmis à l’affactureur est évidemment importante pour affirmer qu’il ne peut être soutenu l’« inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ». Un lien contractuel n’est toutefois pas toujours suffisant, comme le montre la jurisprudence précédemment évoquée concernant la responsabilité délictuelle.
Finalement, les décisions rendues ne sont pas contestables, mais leur motivation reposant uniquement sur des principes de procédure n’aurait pas dû occulter le débat sous-jacent sur le fond.
Sous l’angle substantiel : absence de responsabilité extracontractuelle du débiteur. Pour déterminer si la convention d’arbitrage est ou non « manifestement inapplicable » il faut placer le débat sur le terrain de la nature de la responsabilité du débiteur.
Il ressort des trois décisions rendues que la banque reproche aux débiteurs leur « comportement déloyal ». D’ores et déjà, il est surprenant que les trois sociétés débitrices concernées par ces trois procédures distinctes aient précisément adopté le même comportement, qualifié de déloyal par la banque. Selon le pourvoi, le comportement déloyal du débiteur engage sa responsabilité délictuelle pour avoir contribué à l’inexécution de la convention d’affacturage à l’égard de laquelle ce débiteur est un tiers. La lecture de l’arrêt de la cour d’appel32 nous apprend que la faute reprochée à la société débitrice est de n’avoir pas eu la loyauté d’informer l’affactureur « qu’elle n’entendait pas payer alors qu’elle savait que le factor avait été abusé par ses clientes ». La banque paraît en outre insinuer une fraude du débiteur en affirmant que le débiteur « savait » que l’affactureur avait été abusé par ses clients, mais sans parvenir à la démontrer.
Or il a déjà été jugé à plusieurs reprises que, sauf fraude, le fait pour un débiteur cédé de conserver le silence n’est pas de nature à engager sa responsabilité à l’égard du cessionnaire33. En effet, la transmission de la créance ne peut augmenter les obligations du débiteur et mettre à sa charge une obligation d’information. En l’espèce, il n’existait donc aucune responsabilité des sociétés débitrices des créances transmises à l’affactureur.
Conclusion. Finalement, pour justifier que la convention d’arbitrage n’était pas « manifestement inapplicable », il aurait été préférable de constater que la complicité du débiteur avec le subrogeant pour porter atteinte aux droits de l’affactureur n’était pas invoquée et encore moins démontrée, et qu’en l’absence d’une telle complicité, le débiteur n’avait manifestement aucune obligation d’information à l’égard de l’affactureur.
Certes, un tel raisonnement revient à se prononcer sur le fond de l’affaire et donc à nier le principe de compétence-compétence.
Toutefois, dès lors que le principe de compétence-compétence est encadré par des conditions édictées par le Code de procédure civile, il est nécessaire que la juridiction étatique, saisie du litige, se prononce sur ces conditions posées par le code et, en conséquence indirectement sur le fond de l’affaire. À défaut, l’appréciation de la notion d’« inapplicabilité manifeste » de la convention d’arbitrage reste excessivement fuyante.
Frédéric LEPLAT
VI – Les lois de police à l’aune du règlement Rome II (CJUE, 31 janv. 2019, n° C 149/18, da Silva Martins c/ Dekra Claims Services Portugal SA)
Bien que le rôle des lois de police soit moindre en matière extracontractuelle, les difficultés liées à leur identification sont tout aussi prégnantes que celles rencontrées dans le contentieux contractuel. L’arrêt commenté du 31 janvier 2019, rendu par la CJUE dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle, en constitue une illustration.
En 2015, une collision s’est produite en Espagne entre un véhicule immatriculé au Portugal et un autre immatriculé en Espagne. Le conducteur de ce dernier véhicule étant seul responsable de l’accident de circulation, son assureur a pris en charge le coût de la réparation de l’autre véhicule impliqué dans le sinistre. Le litige résulta de la demande de réparation de dommages indirects formulée par le propriétaire du véhicule immatriculé au Portugal. Pour l’assureur, la demande non introduite dans le délai d’un an prévu par la loi espagnole n’est pas recevable. Au contraire, pour le propriétaire du véhicule endommagé, la loi portugaise prévoyant un délai de prescription de 3 ans de l’action en réparation est applicable en tant que loi de police.
L’article 16 du règlement CE n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II, prévoit que « les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle ». Même s’il s’intitule « dispositions impératives dérogatoires »34, le texte envisage sans aucun doute l’application des lois de police du for. Il ne contient toutefois aucune définition de ce concept, contrairement au règlement Rome I. La CJUE réaffirme, dans l’arrêt rapporté, sa volonté d’assurer la cohérence des deux règlements (I). Elle apporte des précisions aidant à justifier la mise en œuvre d’une norme en tant que loi de police lorsqu’elle est relative au délai de prescription d’une action en réparation d’un sinistre (II).
I. Une interprétation harmonieuse des textes
Le considérant 7 du règlement Rome II rappelle l’exigence de cohérence entre les différents textes européens dont le règlement Rome I, lequel contient une disposition similaire. L’obligation de tenir compte de l’environnement juridique d’un texte est régulièrement mentionnée par la CJUE dans ses décisions35. L’harmonie recherchée impose d’interpréter de manière identique les notions utilisées à la fois par les règlements Rome I et Rome II. Tel est le cas de la notion de lois de police. La définition de ce concept figurant à l’article 9 du règlement Rome I est transposable au règlement Rome II. Cette définition a été initialement formulée par la CJUE dans l’arrêt Arblade du 23 novembre 199936. La Cour s’est largement inspirée de la formule de Francescakis37 fondée sur le critère finaliste38. La définition prétorienne a été reprise et complétée lors de l’élaboration du règlement Rome I. L’article 9 de celui-ci dispose qu’une « loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement »39. Cette formule tranche avec le caractère elliptique de celle retenue par le règlement Rome II, renforçant de facto l’imprévisibilité s’attachant à la notion de loi de police. Le règlement Rome II met davantage en exergue, par la terminologie qu’il retient, le caractère « conflictuellement dérogatoire »40 de la méthode des lois de police. L’idée de nécessité d’application des lois de police a été remplacée par le caractère crucial de la mise en œuvre d’une disposition internationalement impérative pour restreindre encore davantage l’emprise des lois de police.
Tout en insistant sur l’interprétation stricte de la notion de loi de police41, la CJUE exclut que l’ensemble des dispositions harmonisées par une directive puisse recevoir systématiquement la qualification de loi de police42. La directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité permet aux États membres d’adopter des règles plus favorables pour les victimes par rapport à celles qu’elle prévoit43. La loi nationale prise en vertu de la directive ne peut recevoir la qualification de loi de police que si elle réussit avec succès le test européen de compatibilité. Pour être qualifiée de loi de police, la disposition litigieuse doit revêtir « une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable désignée en application de ce règlement ». Cette appréciation doit être faite par le juge national « sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition ». Pour admettre l’impérativité d’une loi prévoyant un délai de prescription en matière de réparation, la CJUE fournit des indications spécifiques.
II. Les incidences en matière de prescription
L’article 15 du règlement Rome II précise le champ d’application de la lex loci damni. Celle-ci régit les questions liées à la prescription. Pour appliquer un délai de prescription autre que celui prévu par cette loi, la CJUE exige « l’identification de raisons particulièrement importantes, telles qu’une atteinte manifeste au droit à un recours effectif et à une protection juridictionnelle effective » qui résulterait de la mise en œuvre de la lex loci damni. En l’espèce, la loi portugaise, même si elle prévoit une meilleure protection de la victime avec un délai de prescription plus long, n’est pas une loi de police, la loi espagnole en tant que lex loci damni ne privant nullement la victime de tout recours44.
À l’heure actuelle, la solution se dégageant de l’arrêt rapporté n’est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence française statuant en la matière. Rares sont les décisions ayant retenu la qualification de loi de police à l’encontre de dispositions législatives françaises régissant la matière extracontractuelle. Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2004 a affirmé que les dispositions du droit français relatives à l’indemnisation des victimes d’infraction ont « le caractère d’une loi d’application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger »45. Cette loi prévoit un mécanisme fondé sur la solidarité nationale d’indemnisation du dommage résultant d’une infraction commise à l’étranger. La qualification de loi de police ainsi retenue répond à la définition et aux critères que la CJUE en donne.
La qualification de loi de police a aussi été privilégiée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 octobre 200446, à l’égard de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Cet arrêt a été prononcé dans le cadre d’une action en diffamation pour l’instant exclue du champ d’application du règlement Rome II. Pourtant, dans l’hypothèse d’une révision du règlement Rome II pour y intégrer les « obligations non contractuelles découlant d’atteintes à la vie privée comprenant les droits de la personnalité et la diffamation »47, l’adéquation du maintien de cette qualification avec la position de la CJUE n’est guère évidente. D’aucuns estiment que la Cour de cassation dénature le mécanisme des lois de police48 en l’appliquant à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sans dégager clairement quel « objectif sociétal »49 était en cause. Or la défense de valeurs, et plus précisément la protection de la liberté d’expression en présence d’une loi prévoyant un délai de prescription excessif, devrait s’effectuer grâce à un autre mécanisme, celui de l’exception d’ordre public et non par l’intermédiaire de la technique des lois de police utilisée à tort.
La solution exprimée par la CJUE, dans son arrêt du 31 janvier 2019, encadre de manière restrictive le jeu de la méthode des lois de police en matière de prescription. Rares seront les cas dans lesquels elle devrait intervenir puisqu’elle suppose que la loi désignée par le règlement Rome II prévoit, par exemple, un bref délai dans lequel il était impossible d’agir. Il appartient au juge national de s’assurer que la loi normalement applicable ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif50. Lorsque cette loi ne prive pas l’intéressé du droit d’agir, les dispositions considérées par le juge national, comme des lois de police, n’ont pas vocation à s’appliquer. La CJUE n’estime donc pas a priori que les lois de police soient d’application immédiate51. Selon elle, les lois de police ne s’appliquent pas en raison de leur nature, indépendamment de l’usage du mécanisme conflictuel52. La CJUE concentre son contrôle sur l’énoncé des éléments permettant de départager la loi désignée par la règle de conflit et la loi de police pointant les limites d’une définition abstraite de celle-ci. L’approche traditionnellement conceptuelle est dépassée au profit d’une démarche fonctionnelle visant à déterminer si la disposition impérative peut revendiquer son application dans un cas précis.
La CJUE n’encourt pas la critique souvent formulée à l’encontre de certaines de ses décisions et liée à l’économie du raisonnement dont elle fait preuve lorsqu’elle est confrontée à une question de droit international privé. Toutefois, la réserve de l’atteinte manifeste au droit à un recours effectif et à une protection juridictionnelle effective s’apparente davantage à la défense de valeurs plus qu’à la poursuite d’un objectif sociétal. Par conséquent, le recours à la technique des lois de police n’est pas adapté en la matière.
Carine BRIÈRE
Notes de bas de pages
-
1.
CJUE, 4 oct. 2018, n° C-337/17, Feniks sp. z o.o. c/ Azteca Products & Services SL : D. 2019, p. 516, note Jault-Seseke F. ; Dalloz actualité 17 oct. 2018, obs. Mélin F. ; AJ Contrat 2018, p. 537, obs. Nourissat C. ; Europe 2018, comm. 495, obs. Idot L. ; Procédures 2018, comm. 370, obs. Nourissat C. ; RDC mars 2019, n° 115v7, p. 53, note Libchaber R. ; RDC mars 2019, n° 115v5, p. 85, note Haftel B. ; RDC mars 2019, n° 115u5, p. 154, note Tenenbaum A. ; Gaz. Pal. 19 févr. 2019, n° 342h6, p. 77, obs. Kleiner C.
-
2.
Règl. (UE) n° 1215/2012, 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. L’applicabilité du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité est exclue par la Cour de justice : arrêt commenté, pts 28 à 33.
-
3.
Article 24, pt 1, du règlement Bruxelles I bis. L’exclusion de l’action paulienne de la catégorie des actions réelles confirme l’éclatement de la catégorie des actions mixtes du droit français, qui peuvent, selon qu’elles portent sur des droits réels ou sur des droits personnels, être qualifiées ou non d’actions réelles : v. notre démonstration en ce sens, note sous Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-16983 : JDI 2018, comm. 5, p. 134, spéc. p. 142.
-
4.
Article 24, pt 5, du règlement Bruxelles I bis.
-
5.
Article 7, pt 2, du règlement Bruxelles I bis.
-
6.
Article 35 du règlement Bruxelles I bis.
-
7.
CJCE, 10 janv. 1990, n° C-115/88, Reichert I, et CJCE, 26 mars 1992, n° C-261/90, Reichert II (arrêts rendus à propos de l’action paulienne du droit français, dirigée dans cette affaire contre une donation immobilière).
-
8.
V., rejetant la qualification contractuelle à propos de CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, préc. : Gulmann C., av. gén., concl. sous cet arrêt : Rec. CJCE 1992, I, p. 2160, spéc. p. 2164, 1re col., et p. 2169, 2e col., et Ancel B., note sous cet arrêt : Rev. crit. DIP 1992, p. 714, spéc. n° 12, p. 725.
-
9.
Les controverses affectant, en droit interne, la nature de cette action (v. sur ce point Sautonie-Laguionie L., Rép. civ. Dalloz, V° Action paulienne, n° 6), sont par conséquent dépourvues de pertinence pour l’application des textes du droit de l’Union européenne.
-
10.
CJCE, 17 juin 1992, n° C-26/91, Jakob Handte, pt 15 : « La notion de “matière contractuelle” (…) ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre ». Il faut en déduire que la qualification contractuelle est exclue en l’absence de tout lien entre les plaideurs.
-
11.
Condition rappelée en dernier lieu par CJUE, 8 mai 2019, n° C-25/18, Brian Andrew Kerr, qui reprend toutefois également la définition posée par l’arrêt Jakob Handte (pts 24 et 25). Les deux formulations ne sont pourtant pas équivalentes.
-
12.
CJUE, 15 juin 2017, n° C-249/16, Saale Kareda.
-
13.
CJUE, 7 mars 2018, nos C-274/16, C-447/16 et C-448/16, flightright, Becker et Barkan.
-
14.
Les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit ne sont pas liés entre eux par un contrat mais ils sont l’un et l’autre parties au contrat de crédit. De même, le transporteur aérien effectif n’est pas lié par un contrat au passager mais il peut être considéré comme le mandataire du cocontractant du passager, exécutant, en tant que tel, les obligations qui résultent du contrat de transport conclu entre ces derniers (règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens, art. 3 § 5, et CJUE, 7 mars 2018, flightright, préc., pts 62 et 63).
-
15.
V. en particulier Libchaber R., note précitée sous l’arrêt commenté, pour une appréciation critique du rattachement de l’action paulienne à la créance protégée plutôt qu’à la vente immobilière.
-
16.
Jenard P., Rapport sur la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : JOCE n° C 59, 5 mars 1979, p. 1, spéc. p. 22. ; Adde, arrêt commenté, pt 36.
-
17.
Considérant 15 du règlement Bruxelles I bis.
-
18.
Gaudemet-Tallon H. et Ancel M.-É., Compétence et exécution des jugements en Europe, 6e éd., 2018, LGDJ/Lextenso, n° 85, spéc. p. 122-123.
-
19.
CJCE, gde ch., 1er mars 2005, n° C-281/02, Owusu.
-
20.
V. sur ce point supra note 85.
-
21.
Les liens étroits existants dans cette affaire entre l’entrepreneur et la société espagnole, qui pourraient traduire une collusion frauduleuse, ne modifient pas le constat.
-
22.
Comp. sur ce point Haftel B., note précitée sous l’arrêt commenté. Si l’on suit la Cour de justice, « l’acquéreur d’un immeuble en France pourrait raisonnablement s’attendre à être attrait en Roumanie dès lors que le vendeur avait un créancier roumain. L’affirmation est particulièrement absurde ».
-
23.
La règle optionnelle en matière contractuelle ne joue que si celui qui exerce l’action paulienne est « titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat » (arrêt commenté, pt 49 et motifs). Elle est donc exclue si le droit de créance n’est pas « issu d’un contrat », seule demeurant en ce cas la compétence de principe du for du défendeur.
-
24.
V., s’émouvant du « sacrifice de l’homogénéité procédurale de la catégorie paulienne » qui en résulte, Libchaber R., note précitée sous l’arrêt commenté.
-
25.
Cass. com., 4 juill. 2018, nos 17-13067 et 17-13069 (1re et 2e espèce) : Gaz. Pal. 6 nov. 2018, n° 333n5, p. 22, obs. Bensaude D. ; D. 2018, p. 2448, obs. Clay T.
-
26.
Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-18178 : Banque et droit 2018, n° 177, p. 38-39, obs. Morel-Maroger J.
-
27.
Legros C., L’arbitrage et les opérations juridiques à trois personnes, thèse, Martine Behar-Touchais (dir.), 1999, Université de Rouen.
-
28.
À propos de la cession de créance, v. not. Cass. civ., 12 juill. 1950 : JDI 1950, p. 1206, note Goldman B. – Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-10806 : Rev. arb. 2002, p. 379, note Legros C., et à propos d’une cession de créances professionnelle, Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-20202 : Rev. arb. 2000, p. 85, 1re esp., note Cohen D. ; JDI 1999, p. 787, 1re esp., note Poillot-Peruzzetto S. ; Rev. crit. DIP 1999, p. 536, 2e arrêt, note Pataut É. ; Defrénois 1999, p. 752, obs. Delebecque P.
-
29.
CPC, art. 1448, al. 1er , applicable à l’arbitrage international en application de l’article 1506 du CPC.
-
30.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2014, n° 13-17495 : Bull. civ. I, n° 126 ; D. 2014, p. 2092, note Mazeaud V. ; RTD civ. 2014, p. 888, obs. Barbier H. ; RGDA nov. 2014, n° 111k3, p. 543, note Heuzé V.
-
31.
Cass. 1re civ., 6 nov. 2013, n° 12-22370 : D. 2013, p. 2936, obs. Clay T. ; RLDA 2014, p. 78, obs. Mestre J. et Mestre-Chami A.-S.
-
32.
CA Paris, 10 mai 2016, n° 15/21115 : Gaz. Pal. 12 juill. 2016, n° 269v2, p. 21, obs. Bensaude D.
-
33.
V. not. Cass. com., 24 mars 1992, n° 90-14678 : Bull. civ. IV, n° 128 ; JCP G 1992, II 21939, note Legeais D. – Cass. com., 23 mars 1993, n° 91-10415 : Bull. civ. IV, n° 112 – Cass. com., 29 nov. 1994, n° 92-19367 : Bull. civ. IV, n° 352.
-
34.
La terminologie varie suivant la version linguistique du texte ; dans la version espagnole, le texte s’intitule « leyes de policía ».
-
35.
V. déjà à propos de l’interprétation du règlement Rome II, CJUE, 21 janv. 2016, nos C-359/14 et C-475/14, Ergo Insurance SE : Europe 2016, comm. 119, obs. Idot L.
-
36.
CJUE, 23 nov. 1999, nos C-369/96 et C-376/96 Arblade : Rev. crit. DIP 2000, p. 710, note Fallon M. ; JDI 2000, p. 493, note Luby M.
-
37.
Francescakis P., « Quelques précisions sur les “lois d’application immédiate” et leurs rapports avec les règles de conflits de lois », Rev. crit. DIP 1966, p. 1.
-
38.
Sur les critiques formulées à l’encontre du critère finaliste, v. Rémy B., Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, 2008, Dalloz, nos 218 et s.
-
39.
S’agissant des lois de police étrangères, celles-ci peuvent être prises en considération comme éléments de fait. La jurisprudence Nikiforidis (CJUE, 18 oct. 2016, n° C-135/15, Nikiforidis : JCP 2016, 62, note Lemaire S. et Perreau-Saussine L. ; JDI 2017, comm. 5, note Fohrer-Dedeurwaerder E. ; Rev. crit. DIP 2017, p. 238, note Bureau D. et Muir Watt H.) interprétant l’article 9, § 3 du règlement Rome I est également transposable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement Rome II (v. art. 17 du règlement).
-
40.
Vareilles-Sommières P., « Lois de police et politiques législatives », Rev. crit. DIP 2011, p. 207, spéc. p. 219.
-
41.
CJUE, 17 oct. 2013, n° C-184/12, Unamar : D. 2014, p. 60, note d’Avout L. ; JDI 2014, p. 625, note Jacquet J.-M.
-
42.
Comp. CJCE, 9 nov. 2000, n° C-381/98, Ingmar : Rev. crit. DIP 2001, p. 107, note Idot L.
-
43.
Cette directive ne contient pas de règles de conflit de lois. L’article 27 du règlement Rome II, qui réserve l’application des dispositions du droit de l’Union, dans des matières particulières qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, n’a donc pas à être mis en œuvre à l’égard de la directive (v. CJUE, 31 janv. 2019, n° C-149/18, pt 38).
-
44.
L’exigence d’une protection juridictionnelle effective se rencontre en d’autres domaines du droit de l’Union européenne et notamment en matière de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue par défaut (v. CJUE, 28 avr. 2009, n° C-420/07, Apostolides : Rev. crit. DIP 2010, p. 377, note Pataut É).
-
45.
Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 02-12989 : Rev. crit. DIP 2004, p. 750, note Bureau D.
-
46.
Cass. 1re civ., 19 oct. 2004, n° 02-15680 : D. 2005, p. 878, note Montfort C. ; D. 2005, p. 1194, obs. Courbe P.
-
47.
V. résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission européenne sur la modification du règlement Rome II du 10 mai 2012 : 2009/2170 (INI).
-
48.
Montfort C., note sous Cass. 1re civ., 19 oct. 2004, n° 02-15680.
-
49.
Rémy B., Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, 2008, Dalloz, nos 218 et s.
-
50.
Pour éviter que des délais de prescription trop courts entravent l’accès effectif à la justice au sein de l’Union européenne, le Parlement européen a invité la Commission à présenter une proposition de directive visant à prévoir un délai de prescription d’au moins 4 ans en cas d’accidents de la circulation routière (v. Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017, P_8TA(2017)081). L’harmonisation souhaitée aurait pour effet d’éviter les contentieux, tel celui ayant donné lieu à l’arrêt commenté.
-
51.
Une telle approche est aussi défendue par une partie de la doctrine, v. Rémy B., Exception d’ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, 2008, Dalloz.
-
52.
Ce raisonnement se limite à l’hypothèse où les lois en concours sont celles d’États membres. En revanche, lorsque la loi d’un État tiers est en concurrence avec une loi de police d’un État membre, celle-ci s’applique de manière inconditionnelle en raison de sa nature même. Pour décrire cette distinction, la doctrine parle de « lois de police à géométrie variable », v. Idot L., note sous CJCE, 9 nov. 2000, n° C-381/98, Ingmar : Rev. crit. DIP 2001, p. 115.