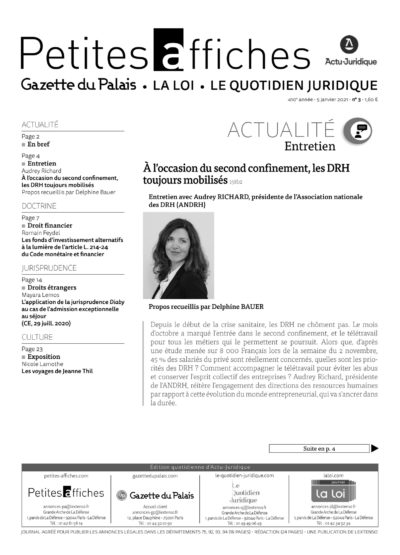L’application de la jurisprudence Diaby au cas de l’admission exceptionnelle au séjour
Par son arrêt du 29 juillet 2020, le Conseil d’État rappelle que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cependant, il précise que tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un étranger ne peut donc pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. La solution adoptée en l’espèce, motivée ainsi, est conforme à la jurisprudence et renforce la sécurité juridique, mais peut poser difficulté dès lors qu’on s’interroge sur l’articulation faite avec le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-11, 7°, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
CE, 29 juill. 2020, no 428231
L’arrêt du Conseil d’État du 29 juillet 2020 apporte des précisions quant à l’invocabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), au soutien d’un recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Aux termes de cette disposition, « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 (…) ».
En l’espèce, une ressortissante sénégalaise, entrée en France le 7 avril 2007 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 avril 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 août 2017. Par arrêté du 6 décembre 2017, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
L’intéressée a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation dudit arrêté, lequel, par un jugement du 13 février 2018, a rejeté sa demande. Toutefois, par un arrêt du 21 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement en se fondant sur une méconnaissance de l’article L. 313-14 du CESEDA. La cour administrative d’appel a aussi enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de 2 mois et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Le ministre de l’Intérieur s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
La particularité de cette affaire tient à ce que l’obligation de quitter le territoire français n’était pas fondée sur un refus de titre de séjour adopté au visa de l’article L. 313-14 du CESEDA, mais sur le fondement de l’alinéa 6, du I, de l’article L. 511-1 de ce même code, aux termes duquel l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il était en effet constant qu’aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du CESEDA n’avait été effectuée. La question s’est donc posée de savoir si le moyen tiré de ce qu’un étranger peut prétendre à un titre de séjour, au soutien d’une demande d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire est ou n’est pas opérant.
Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel du 21 décembre 2018, tout en lui renvoyant l’affaire. Il distingue alors deux cas de figure : est opérant, au soutien d’un recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l’étranger pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour (I). Il en va autrement, lorsque l’Administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire et donc d’une marge d’appréciation pour décider de délivrer ou non un titre (II). Une telle solution pose cependant des difficultés dès lors que l’on met en parallèle les conditions d’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du CESEDA et de l’article L. 313-11, 7°, de ce même code (III).
I – L’hypothèse de l’existence d’un droit au titre de séjour : un moyen opérant
Le CESEDA prévoit sous quelles conditions un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, tout en admettant des exceptions. À ces exceptions législatives, le Conseil d’État a ajouté une exception jurisprudentielle, laquelle a été confirmée en l’espèce.
L’article L. 511-1 du CESEDA prévoit que l’étranger non ressortissant de l’Union européenne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas d’entrée irrégulière, de maintien irrégulier sur le territoire, de refus de délivrance d’un titre de séjour, de refus de la qualité de réfugié, de menace à l’ordre public ou de travail illégal.
En particulier, l’alinéa 6° de l’article L. 511-1 du CESEDA admet l’obligation de quitter le territoire si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
En l’espèce, la requérante avait présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 25 avril 2017 et confirmée par la CNDA le 28 août. Le préfet a alors adopté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l’article L. 511-1 du CESEDA. Pour l’application de cette disposition, le refus doit être définitif. Ainsi, si la mesure est prise avant l’écoulement du délai pour former un pourvoi contre l’arrêt de la CNDA, elle encourt l’annulation. Le délai de recours auprès du Conseil d’État est de 2 mois à compter de la notification de la décision de la Cour. En l’espèce, l’arrêté a été adopté le 6 décembre 2017. Sur ce point, il ne posait donc pas de difficultés.
L’article L. 511-4 du CESEDA quant à lui prévoit 10 cas dans lesquels l’étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il en va ainsi par exemple de l’étranger mineur de 18 ans, de l’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 13 ans, ou encore de l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant ».
Au-delà de cette liste dressée par l’article L. 511-4 du CESEDA, la jurisprudence est venue ajouter une exception.
En effet, le CESEDA prévoit plusieurs catégories d’étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire. Il s’agit des étrangers relevant des catégories énumérées aux articles L. 313-11 et L. 313-11-1, mais aussi de ceux victimes de violences conjugales ou de mariage forcé, conformément à l’article L. 316-3 de ce code.
Dans un arrêt du 23 juin 2000, Diaby1, le Conseil d’État a considéré que lorsque la loi prescrit qu’un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Peu importe d’ailleurs, que l’intéressé ait ou non présenté une demande de titre2.
Cette solution a été rappelée dans un avis du 28 novembre 2007, Mme Zhu3, dans lequel le Conseil affirme que l’étranger ne peut faire l’objet d’une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l’article L. 511-1 du CESEDA, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Enfin, l’arrêt du 26 novembre 2012, Ahmed4 prévoit aussi que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
Au regard de cette jurisprudence bien établie, de plus en plus d’arrêtés préfectoraux prévoient un alinéa selon lequel l’intéressé n’a droit à la délivrance d’aucun titre de plein droit.
En l’espèce, le Conseil d’État réaffirme une exception jurisprudentielle à l’éloignement des étrangers : « Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français ».
Il en résulte donc que le moyen tiré de ce que l’étranger devait – ce qui suppose une obligation – bénéficier d’un titre de séjour est opérant à l’appui d’un recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette solution semble a priori justifiée puisqu’il serait possible de considérer que l’autorité administrative est dans une situation de compétence liée lorsque les textes prévoient l’attribution de plein droit d’une carte de séjour. Toutefois, il sera nécessaire d’apporter des tempéraments sur cette affirmation, car l’attribution de certains titres de séjour de plein droit semblent aussi laisser un large pouvoir d’appréciation à l’Administration, comme on l’observera.
Mais si le Conseil d’État se conforme à la jurisprudence administrative, il va plus loin, puisqu’il se prononce aussi sur l’opérance du moyen tiré de ce que l’étranger pouvait – ce qui suppose une faculté – bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du CESEDA.
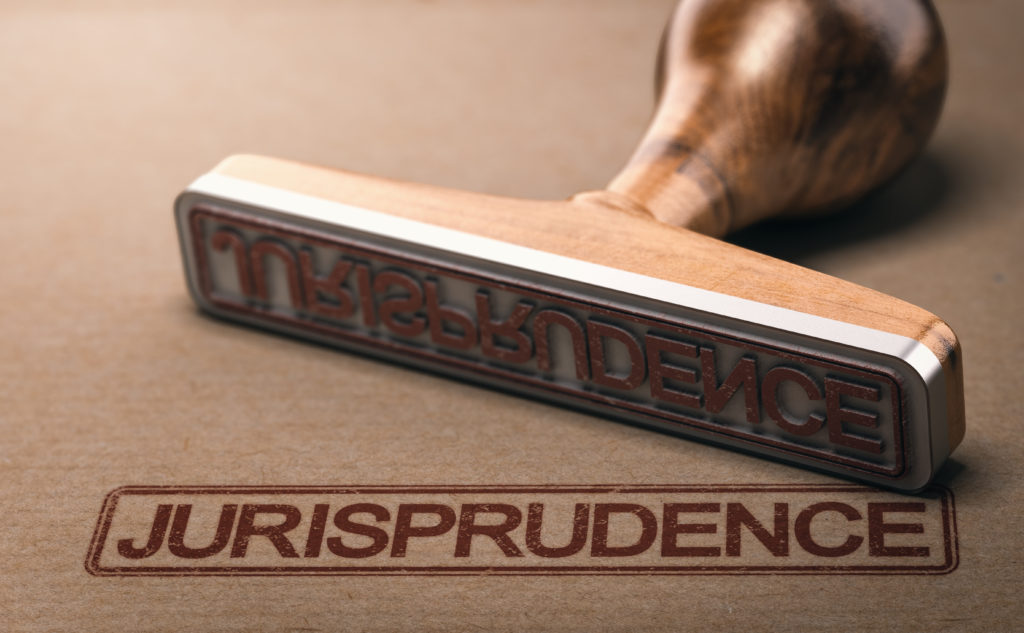
II – La faculté d’attribution d’un titre de séjour : un moyen inopérant
Il ressort de l’avis du Conseil d’État du 28 novembre 2007, Mme Zhu, que le préfet n’a pas d’obligation de vérifier si l’étranger peut obtenir un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition que celle de laquelle il a été saisi. Toutefois, il peut le faire à titre gracieux5. Ainsi, « si les dispositions de l’article L. 313-14 du code permettent à l’Administration de délivrer une carte de séjour “vie privée et familiale” à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l’Administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article »6.
La jurisprudence avait donc déjà apporté une réponse quant à l’invocabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du CESEDA à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article. Mais la solution apportée par le Conseil d’État le 29 juillet 2020 est différente. Il s’agissait de l’invocabilité de ce moyen à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
Dans l’arrêt Ahmed7, le requérant invoquait l’existence d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 313-14 du CESEDA. Pour le Conseil d’État, s’agissant d’un titre ne devant pas être attribué de plein droit et laissant un large pouvoir d’appréciation à l’Administration, le magistrat n’a pas commis d’erreur de droit en ne vérifiant pas si cette demande aurait pu donner lieu à la délivrance d’un titre de séjour. Cette jurisprudence va donc dans le sens de l’affaire soumise à notre examen, mais diffère, en ce qu’en l’espèce, aucune demande de titre de séjour n’avait été présentée.
Dans la mesure où le préfet « peut » délivrer à l’étranger un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du CESEDA, il dispose d’une compétence discrétionnaire. La seule contrainte à son égard est celle de devoir saisir la commission des titres dans l’hypothèse où l’étranger justifie de plus de 10 ans de résidence habituelle sur le territoire. Le préfet ne dispose donc pas d’une compétence liée.
Il en résulte que le juge administratif opère sur la décision de refus d’un titre de séjour au titre de l’article L. 313-14 du CESEDA, un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, aux termes de l’avis du 28 novembre 2007, Zhu, si le législateur a prévu que la commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l’Administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des conditions humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’Administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a porté sur l’un ou l’autre de ces points.
L’arrêt du Conseil d’État du 6 décembre 2013, Ndong B.8 quant à lui précise que dès lors que le préfet n’est pas en situation de compétence liée, il peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour, examiner d’office si l’étranger peut prétendre à un titre sur le fondement d’une autre disposition, s’il remplit les conditions qu’elle prévoit ou lui délivrer, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle, le titre qu’il demande ou un autre titre.
Ce pouvoir discrétionnaire du préfet est renforcé par la subjectivité d’une telle décision d’attribution ou de refus d’attribution d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 313-14 du CESEDA. En effet, il appartient à l’étranger de démontrer ces motifs exceptionnels et notamment de justifier de ses années de présence en France. Or bien souvent, les étrangers en situation irrégulière ne sont pas connus de l’Administration française, n’ont pas de contrat d’habitation à leur nom ou de documents officiels permettant de démontrer leur présence en France. Habituellement, les documents fournis par les requérants se résument en des justificatifs de transports et des lettres envoyées par l’Assurance maladie, documents insuffisants aux yeux de la jurisprudence9.
III – L’articulation avec le moyen tiré de la méconnaissance de l’alinéa L. 313-11, 7°, du CESEDA
Si la jurisprudence en l’espèce n’apparaît pas exceptionnelle au regard de la jurisprudence du Conseil d’État, elle peut poser des difficultés lorsqu’on met en parallèle les dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA et celles de l’article L. 313-11, 7°, du même code.
L’article L. 313-11, 7°, du CESEDA prévoit l’attribution d’un titre de séjour de plein droit : « À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Cette disposition est donc le pendant de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH). S’agissant d’un titre de plein droit, un étranger ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, lorsqu’il peut bénéficier de ses dispositions.
Pourtant, on peut observer l’existence d’un lien implicite entre les articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du CESEDA. Les avocats défendant les étrangers ayant fait l’objet d’un refus de titre ou d’une obligation de quitter le territoire ont d’ailleurs tendance à soulever à la fois la méconnaissance de l’article L. 313-11, 7°, et la violation de l’article L. 313-14 du CESEDA. En l’espèce, devant la cour administrative d’appel, c’est ce que soutenait l’avocat de la requérante.
La circulaire Valls10, laquelle n’a certes pas le caractère de lignes directrices invocables à l’encontre de la décision individuelle de refus d’admission exceptionnelle au séjour11, démontre aussi ce lien, puisque selon ses termes, « les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l’objet d’un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française ». Elle indique alors qu’au titre de l’article L. 313-11, 7°, du CESEDA, la vie privée et familiale s’apprécie au regard de la réalité des liens personnels et familiaux établis en France par les intéressés, de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité. Elle implique aussi une bonne capacité d’insertion dans la société française, ce qui suppose, sauf cas exceptionnels, une maîtrise orale au moins élémentaire de la langue française.
En ce qui concerne l’appréciation des liens personnels pour l’application de l’article L. 313-11, 7°, du CESEDA, le Conseil d’État prend en compte les liens privés. Ainsi, dans l’affaire Sulley12, il a considéré qu’en se bornant à se placer sur le seul terrain de l’atteinte à sa vie familiale et professionnelle, alors que le requérant avait insisté sur le développement, l’ancienneté et la stabilité de ses relations sociales, notamment d’ordre amical et artistique, en France, la cour administrative d’appel de Bordeaux a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point. En effet, l’intéressé résidait en France depuis 1997, soit depuis 11 ans à la date de l’arrêté litigieux et les pièces du dossier faisaient ressortir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels en France.
La difficulté qui ressort de ces développements est alors que l’article L. 313-14 du CESEDA dispose que l’étranger doit invoquer les motifs exceptionnels. Pourtant, les motifs d’admission exceptionnelle sont très imprécis et incomplets. Il s’agit habituellement de la durée du séjour, de la volonté d’intégration sociale et des liens personnels en France. La différence avec les dispositions de l’article L. 313-11, 7°, du CESEDA et l’application qui en est faite par le Conseil d’État n’est donc pas évidente. Ainsi, l’appréciation de l’intensité des liens familiaux par le juge se rapproche beaucoup de celle des circonstances exceptionnelles prévues à l’article L. 313-14 du CESEDA.
Les conséquences de cette imprécision sont importantes, puisque si l’on considère que l’étranger peut bénéficier des dispositions de l’article L. 313-11, 7°, du CESEDA, il ne pourra faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, alors que cela sera possible dans le cas où on considère qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA.
Or la raison pour laquelle l’étranger pouvant bénéficier du titre prévu à l’article L. 313-11, 7°, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire est qu’il s’agit dans ce cas, d’un titre attribué de plein droit. Pourtant, cette attribution « automatique » ne l’est pas en réalité. Dans la plupart des cas, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve qu’il entre dans l’une des catégories prévues par l’article L. 313-11 du CESEDA. Mais certaines de ces catégories, et tel est le cas de l’alinéa 7°, sont déterminées de manière très large et l’Administration n’est en réalité pas liée. Son pouvoir d’appréciation demeure très large. Il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit par exemple d’un mineur entré en France au titre du regroupement familial. Dans ce cas, le critère est bien objectif.
Finalement, l’Administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire et donc d’une marge d’appréciation plus ou moins étendue pour décider de délivrer ou non le titre sollicité. La marge d’appréciation est réduite lorsque l’étranger se trouve dans la situation prévue et réglementée par les textes et que ceux-ci fixent avec une relative précision les conditions à remplir pour obtenir la délivrance d’un titre (visiteur, étudiant, membre de famille, etc.). Au contraire, la marge d’appréciation est maximale lorsque l’intéressé ne se trouve dans aucune des situations lui permettant d’obtenir une carte de séjour, ou lorsqu’il ne remplit pas l’une des conditions prévues par les textes (régularisation exceptionnelle prévue à l’article L. 313-14 du CESEDA).
Aucun critère objectif n’est posé par l’article L. 313-11, 7°, du CESEDA, ni en ce qui concerne la durée du séjour, ni en ce qui concerne les liens familiaux ou sociaux. Par conséquent, la qualification de titre « de plein droit » concernant la catégorie prévue à l’article L. 313-11, 7°, du CESEDA n’est en réalité qu’en leurre. Elle n’a pas de sens, puisque dans les faits, il revient à l’Administration d’apprécier l’intensité des liens personnels et familiaux de l’intéressé et ce, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
En réfléchissant sur le fondement de la présente affaire, la difficulté sur ce point est prégnante. Pour le comprendre, il convient de revenir sur le jugement rendu en première instance, puis sur l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel.
Le jugement du tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande d’annulation de l’arrêté, en considérant notamment que, au visa de l’article 8 de la CESDH, si la requérante faisait valoir qu’elle résidait en France depuis 2007, soit depuis 10 ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle était la mère de quatre enfants nés sur le territoire français, elle ne justifiait pas, par les pièces qu’elle versait au dossier, de la continuité de son séjour en France depuis 2007. Pourtant, la cour administrative d’appel au visa cette fois-ci, de l’article L. 313-14 du CESEDA, avait estimé que la requérante produisait au dossier « de très nombreux documents démontrant qu’elle réside en France depuis l’année 2007, dont des lettres de l’aide médicale d’État, des lettres de solidarité transport, des certificats de scolarité de ses enfants, de très nombreuses pièces médicales constituées d’ordonnances, de feuilles de soins, de comptes rendus radiographiques et de factures attestant notamment que l’appelante fait l’objet d’un suivi à l’Hôpital Bichat depuis son arrivée en France. Par suite, l’ensemble du dossier constitué par la requérante permettant d’établir sa présence sur le territoire national depuis plus de 10 années à la date de la décision attaquée ».
Ainsi, la présence sur le territoire pendant plus de 10 ans n’est plus contestée. La difficulté est alors que la cour administrative d’appel a décidé d’annuler l’arrêté sur le fondement de l’article L. 313-14 du CESEDA. Or on l’a vu, le Conseil d’État considère que le moyen tiré de ce que l’étranger pouvait bénéficier d’un titre de séjour au soutien d’un recours contre une obligation de quitter le territoire est opérant en ce qui concerne un titre de plein droit et inopérant, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour. Pourtant, si l’on regarde la situation de la requérante, il serait possible de considérer qu’elle pouvait prétendre à ce titre de plein droit, dans la mesure où elle est mère de quatre enfants nés sur le territoire français et qu’elle justifiait de 10 ans de présence. Si en première instance, le tribunal administratif relevait que les enfants vivaient avec leur père et que la requérante ne démontrait pas participer à leur éducation et à leur entretien, la cour administrative d’appel n’a pas retenu cette appréciation et a affirmé que la requérante produisait notamment les certificats de scolarité des enfants. Certes, cela ne permet pas de démontrer cette participation à l’éducation, mais pourrait en constituer un indice.
Cela fait donc apparaître une autre difficulté, qui est celle relative au choix des moyens par les juridictions en cas d’annulation. Alors qu’aux termes de l’arrêt du Conseil d’État du 21 décembre 2018, Société Eden13, lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, on voit qu’en l’espèce, ce choix a eu des conséquences particulièrement importantes sur la situation du requérant. Il est donc particulièrement important que les avocats soulèvent uniquement les moyens susceptibles d’être retenus par le juge ou qu’ils les hiérarchisent.
En conclusion, la solution en l’espèce n’est pas évidente et l’appréciation quant à la possibilité pour la requérante de bénéficier d’un titre sur le fondement de l’article L. 313-11, 7°, n’est pas limpide, mais aurait pu prospérer. L’analyse de cet arrêt permet d’observer la subjectivité avec laquelle la situation des étrangers est traitée. La distinction faite par le Conseil d’État entre titres de plein droit et titre sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour paraît donc superficielle, car fondée sur un présupposé inexistant : celui d’une obligation pour l’Administration d’attribuer un titre de séjour dans le premier cas, contrairement au second. Toutefois, cette solution va dans le sens d’une plus grande sécurité juridique, car elle incite les avocats à qualifier de plein droit une situation qui mérite un titre de séjour « vie privée et familiale » plutôt que d’essayer de convaincre le juge que si la préfecture avait examiné les circonstances, elle aurait pu faire usage de son pouvoir d’appréciation.
Notes de bas de pages
-
1.
CE, 23 juin 2000, n° 213584, Diaby.
-
2.
CE, 28 avr. 2004, n° 254093, Préfet de la Haute-Garonne c/ Briki.
-
3.
CE, avis, 28 nov. 2007, n° 307036, Mme Zhu.
-
4.
CE, 26 nov. 2012, n° 349827, Ahmed.
-
5.
CE, 6 déc. 2013, n° 362324, min. c/ M. Ndong.
-
6.
CE, avis, 28 nov. 2007, n° 307036, Mme Zhu.
-
7.
CE, 26 nov. 2012, n° 349827, Ahmed.
-
8.
CE, 6 déc. 2013, n° 362324, min. c/ M. Ndong.
-
9.
V. par ex. CAA Paris, 19 mai 2020, n° 18PA03599 ; TA Paris, 6 oct. 2020, n° 2010147 ; TA Paris, 6 févr. 2020, n° 1923884 ; TA Paris, 22 oct. 2019, n° 1908688.
-
10.
Circ., 28 nov. 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, NOR:INT/K/12/29185/C.
-
11.
CE, 4 févr. 2015, n° 383267, min. de l’Intérieur c/ Cortes Ortiz.
-
12.
CE, 24 avr. 2012, n° 337025, Sulley.
-
13.
CE, 21 déc. 2018, n° 409678, Sté Eden.