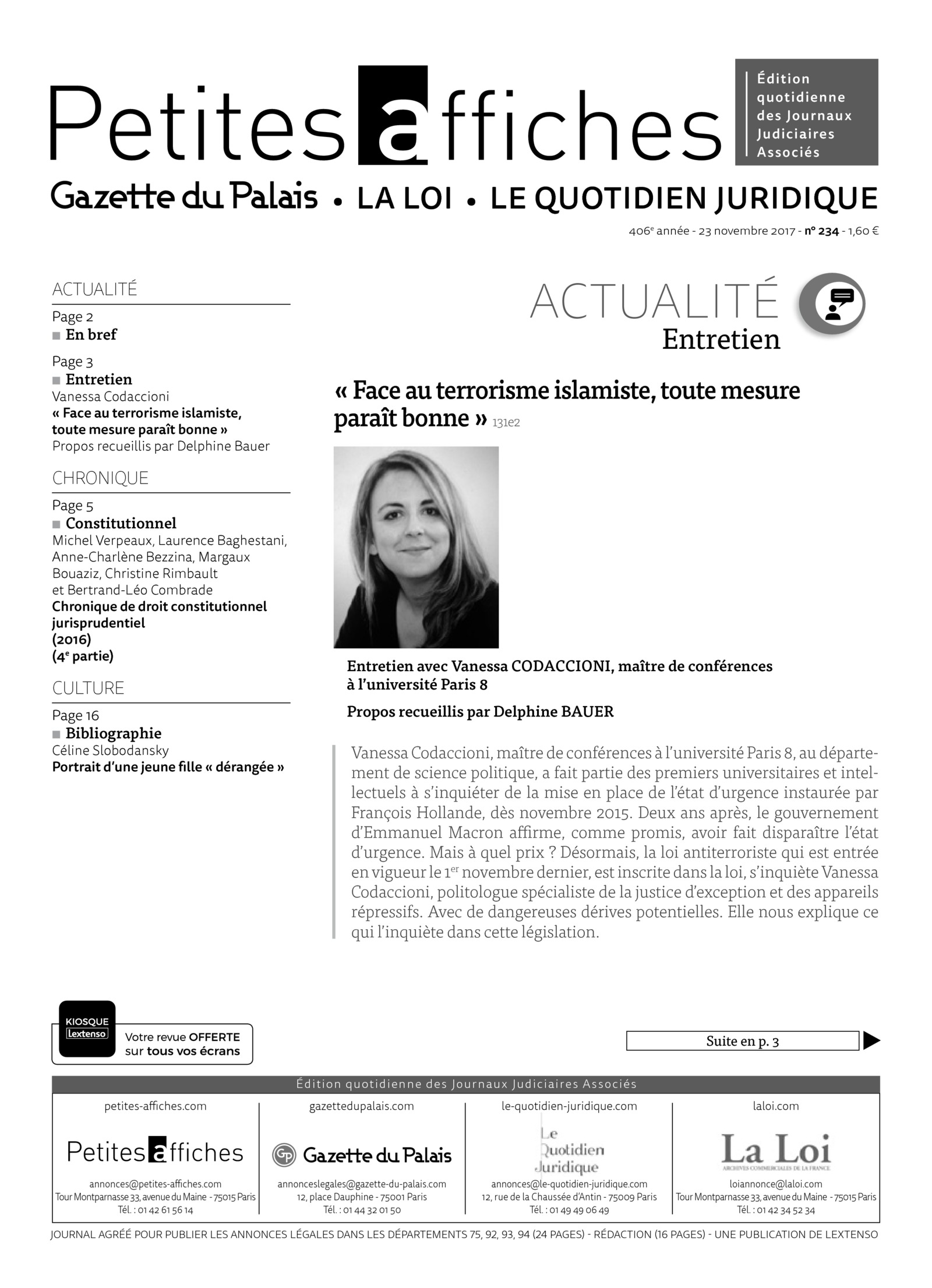« Face au terrorisme islamiste, toute mesure paraît bonne »
Vanessa Codaccioni, maître de conférences à l’université Paris 8, au département de science politique, a fait partie des premiers universitaires et intellectuels à s’inquiéter de la mise en place de l’état d’urgence instaurée par François Hollande, dès novembre 2015. Deux ans après, le gouvernement d’Emmanuel Macron affirme, comme promis, avoir fait disparaître l’état d’urgence. Mais à quel prix ? Désormais, la loi antiterroriste qui est entrée en vigueur le 1er novembre dernier, est inscrite dans la loi, s’inquiète Vanessa Codaccioni, politologue spécialiste de la justice d’exception et des appareils répressifs. Avec de dangereuses dérives potentielles. Elle nous explique ce qui l’inquiète dans cette législation.
Les Petites Affiches
Pouvez-vous dresser une courte généalogie de l’histoire de l’état d’urgence en France ?
Vanessa Codaccioni
Quand la France a décrété l’état d’urgence en 1955, il s’agissait d’un régime d’exception créé dans le cadre de la guerre d’Algérie pour ne pas proclamer l’état de siège et ainsi donner le pouvoir aux militaires. Il s’agissait également de ne pas donner une qualification militaire aux événements, car cela aurait signifié légitimer l’expression de « guerre ». Or les gouvernants considéraient qu’on ne pouvait être en guerre contre un département français. De la même manière, reconnaître la guerre aurait fait des prisonniers du FLN des prisonniers de guerre qui auraient dès lors été protégés par la Convention de Genève. Et, par exemple, on ne torture pas des prisonniers de guerre… De Gaulle a ensuite remobilisé l’état d’urgence en 1961-1963, puis plus récemment Chirac en Nouvelle Calédonie en 2004, et en 2005, lors des révoltes urbaines en banlieue. Mais ici l’état d’urgence ne s’appliquait que sur une partie du territoire.
LPA
Comment expliquer qu’en 1955, lors du vote de l’état d’urgence lié à l’Algérie, 230 députés avaient voté contre, alors que seuls 6 s’y sont opposés en 2015 ? Assiste-t-on à une banalisation de la répression ?
V. C.
La gauche gouvernementale a profondément changé. Avant elle soutenait l’égalité de toutes et de tous devant la justice et la loi, et la primauté du droit commun sur l’exception. Mais cette gauche s’est progressivement ralliée à l’idéologie sécuritaire. Dès les années 90, elle a estimé qu’elle ne pouvait plus laisser la sécurité à la droite voire à l’extrême droite seules. On est loin des discours de Robert Badinter sur la loi anti-casseurs ou contre les tribunaux militaires. Autre facteur : les politiques ont plus tendance à écouter la population civile qui se trouve être très favorable à ces mesures. Le ou la politique qui ose contester ces lois paraîtrait comme laxiste, voire insensée. La gauche gouvernementale a ainsi définitivement perdu l’un de ses fers de lance, la lutte contre la répression et les mesures d’exception, qui furent auparavant des causes, des forces mobilisatrices. Aujourd’hui, la gauche et la droite sont capables de proposer, à quelque chose près, les mêmes projets de lois !
LPA
Vous soulignez une dimension discriminatoire dans ces lois. Que voulez-vous dire ?
V. C.
Dans le cas des lois antiterroristes actuelles, comme dans toute mesure d’exception, il existe une dimension discriminatoire : ces mesures ciblent des groupes précis, pré-déterminés, ici les musulmanes et les musulmans, qui sont mis en état d’infériorité juridique. Il y a ainsi un profilage anti-communautaire qui favorise l’acceptation de ces mesures par une partie de la population. Avez-vous remarqué qu’à partir du moment où les mesures de l’état d’urgence ont concerné des militants écologistes, on a commencé à entendre des critiques concernant l’état d’urgence, notamment sur les assignations à résidence ?
LPA
Comment expliquer la décision de l’état d’urgence en 2015 ? En sortira-t-on un jour ?
V. C.
J’ai du mal à croire que la décision a été prise dans l’immédiateté. Il y a toujours eu des attentats dans l’histoire de la Ve République. Pourtant, personne n’a jamais décrété l’état d’urgence, ni en 1985 ou en 1986, alors que la France subissait des vagues d’attentats, ni dans les années 1990. Actuellement, les hommes/femmes politiques ont plutôt tendance à regarder ce qu’on a fait pendant la guerre d’Algérie, qui est un moment particulier dans les usages de l’exception, dans cette lutte contre l’ennemi intérieur, ou sous Vichy, comme le montre l’exemple de la déchéance de nationalité. Donc il y a ce phénomène de réactualisation de mesures passées. Mais aujourd’hui, avec l’inscription de cette loi dans le droit commun, le processus est quasiment irréversible. Il faudrait une nouvelle loi pour supprimer ce qui a été voté.
LPA
Doit-on craindre le flou de la définition de « terrorisme » de la loi qui vient d’être adoptée ?
V. C.
C’est terrible ! Les gens croient qu’on sait de qui on parle quand on évoque le « terrorisme », mais ce n’est pas le cas ! Dans l’après Algérie, on a créé une juridiction d’exception dont la cible était officiellement les membres de l’OAS, donc l’extrême-droite. Mais dès mai 1968, ce tribunal va inculper des militants gauchistes, puis des maoïstes, des syndicalistes, des nationalistes bretons ou corses… Les cibles de l’exception changent ainsi très vite, et ce qui est considéré comme terrorisme aussi. Aujourd’hui, de nombreux groupes dits « d’ultra gauche » sont perçus et traités comme des terroristes. Et je rappelle que sous Vichy, les résistants eux-mêmes étaient vus comme des terroristes. La définition du terrorisme est toujours floue, vague, élastique et sa répression finit toujours par se retourner contre ceux qui n’étaient pas initialement visés. Mais cette définition floue résulte d’une volonté délibérée de ne pas définir le terrorisme pour pouvoir élargir le filet pénal. Je suis très inquiète, je suis convaincue que cela concernera des militants écologistes, à tout le moins, les autonomistes ou les anarchistes également. Et cela peut aller plus loin.
Face au terrorisme islamiste, toute mesure paraît bonne pour les gouvernants. On entend des idées farfelues, comme la réouverture des bagnes, la déchéance de nationalité ou la création de tribunaux militaires. Il y a alors une forme d’électoralisme et d’utilisation politique des attentats. Les débats pour les présidentielles ont confirmé cette surenchère politique sur les questions sécuritaires, qui est aussi une anticipation de ce qu’attend une partie de l’opinion. C’est, avec le chômage, l’un des sujets de préoccupation majeur en France.
LPA
Comment se situe la législation de la France par rapport aux autres pays d’Europe ? Y avait-il besoin d’une loi supplémentaire ?
V. C.
Non, pas du tout. Le droit commun est largement suffisant et confère déjà beaucoup de prérogatives aux policiers, aux juges, à l’administration. Et quasiment tous les attentats déjoués l’ont été et le sont grâce au droit commun, et non grâce à l’état d’urgence. Surtout, nous avons le système antiterroriste le plus complet d’Europe. Mais à chaque attentat nos hommes et femmes politiques rajoutent une nouvelle loi et, finalement, empilent les législations les unes sur les autres.
LPA
Quelles sont les options de contestation à l’avenir ?
V. C.
Ce processus et irréversible, à moins qu’un groupe politique défavorable à cette loi soit majoritaire à l’Assemblée nationale et ne fasse voter une nouvelle loi qui annule les précédentes. Pour la juridiction d’exception créée à la fin de la guerre d’Algérie — la Cour de sûreté — la gauche a dû attendre 18 ans avant de pouvoir la supprimer, une fois arrivée au pouvoir en 1981. Mais aujourd’hui, qui va se plaindre alors que l’état d’urgence est invisibilisé, qu’on ne le voit plus, qu’il est dans le droit commun ? Par ailleurs, rien n’empêche Emmanuel Macron de déclarer à nouveau l’état d’urgence s’il l’estime nécessaire : la loi de 1955 n’a pas été supprimée. Pourtant, force est de constater qu’au lendemain des attentats de novembre 2015, critiquer l’état d’urgence était mal perçu et que nous étions peu nombreux à le faire. Mais depuis, l’opposition a grandi, notamment avec la France Insoumise, les associations de défense des droits humains, la Ligue des droits de l’homme, la CNCDH, le Syndicat des Avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature et beaucoup d’autres. Mais le vote de la loi a montré que ces résistances étaient relativement vaines : si la majorité à l’Assemblée nationale est favorable aux projets de loi, ils sont toujours votés. Aujourd’hui, il faut continuer à débattre et à convaincre la population des méfaits de cette loi, espérer que des hommes et des femmes politiques courageux expliquent en quoi cette loi est inefficace et dangereuse. On peut aussi compter sur les avocats, qui peuvent œuvrer par la défense des personnes accusées, perquisitionnées ou assignées arbitrairement. Mais il est dur de ne pas être pessimiste quand on vit dans une société de la suspicion qui a institutionnalisé le principe de précaution et la présomption de culpabilité.