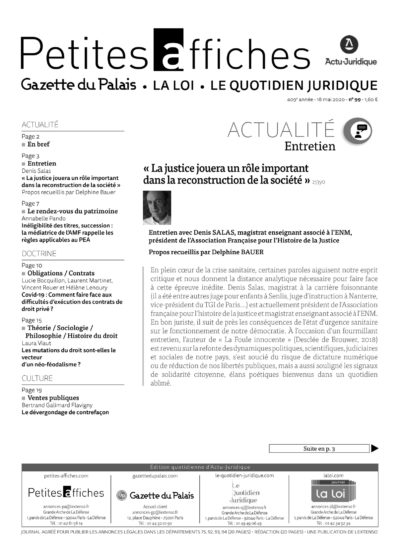Covid-19 : « La justice jouera un rôle important dans la reconstruction de la société »
En plein cœur de la crise sanitaire, certaines paroles aiguisent notre esprit critique et nous donnent la distance analytique nécessaire pour faire face à cette épreuve inédite. Denis Salas, magistrat à la carrière foisonnante (il a été entre autres juge pour enfants à Senlis, juge d’instruction à Nanterre, vice-président du TGI de Paris…) est actuellement président de l’Association française pour l’histoire de la justice et magistrat enseignant associé à l’ENM. En bon juriste, il suit de près les conséquences de l’état d’urgence sanitaire sur le fonctionnement de notre démocratie. À l’occasion d’un fourmillant entretien, l’auteur de « La Foule innocente » (Desclée de Brouwer, 2018) est revenu sur la refonte des dynamiques politiques, scientifiques, judiciaires et sociales de notre pays, s’est soucié du risque de dictature numérique ou de réduction de nos libertés publiques, mais a aussi souligné les signaux de solidarité citoyenne, élans poétiques bienvenus dans un quotidien abîmé.
Les Petites Affiches : En Suède, les débats sur la mise en place ou non d’une loi d’urgence sanitaire ont été vifs. En France, on a le sentiment que le vote d’un état d’urgence sanitaire s’est fait sans grande contestation…
Denis Salas : Sans doute l’influence culturelle a-t-elle joué. En France, nous comptons sur une longue tradition de l’État d’exception, qui débute au XIXe siècle, puisque la loi sur l’état de siège (qui transfère les pouvoirs de police de l’autorité civile à l’autorité militaire, NDLR) date de 1849. En remontant loin dans notre histoire, nous faisons face à de multiples phases d’exception, ce que n’a pas connu la Suède. Depuis ces dernières décennies, l’on peut parler d’une accélération de ces phases. Parmi cette longue tradition de recours à l’état d’urgence, il y a la loi de l’état d’urgence de 1955 dans le contexte de la guerre d’Algérie, mais aussi lors des émeutes dans les banlieues françaises de 2005, et plus récemment l’état d’urgence dans le contexte de la lutte antiterroriste, enfin aujourd’hui, devant cette pandémie ! Cela revient à dire que dans notre organisation politique, il existe une capacité d’anticipation des crises en inoculant dans la légalité une dose d’exceptionnalité afin d’immuniser le régime politique face à un péril.
LPA : Quid de la mise en place l’état d’urgence sanitaire le 23 mars dernier ?
D. S. : Il faut rappeler que les premières mesures résultaient simplement du cadre réglementaire, avec comme base le Code de la santé publique. C’est ensuite que la loi de l’état d’urgence sanitaire a été votée. Au moment où nous parlons, le Premier ministre, Édouard Philippe, a prolongé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet. Ainsi, tout comme ce qui s’est passé en 2015, la tendance à la prolongation de ces situations d’exception semble se confirmer. Si c’était le cas, cette prolongation, finalement, ne serait pas étonnante par rapport à ce que nous avons connu. Avec une différence : le déconfinement comptera à la fois des mesures contraignantes et des recommandations qui reposeront sur le civisme. À mon sens, on ne parle d’ailleurs pas assez du civisme, alors qu’il constitue un vrai pivot d’une démocratie en temps de crise. C’est – on l’oublie trop – grâce au civisme que les limitations de sortie imposées ont été acceptées par 90 % des gens. Le civisme, c’est intérioriser librement la loi commune et participer à la vie de la cité selon des conditions requises par l’intérêt général.
LPA : Vous parlez beaucoup du poids actuel de la parole scientifique dans le débat public…
D. S. : Oui, je suis très frappé par le débat qui se tient entre les décideurs politiques et le conseil scientifique sur le Covid-19. Je crois qu’il s’agit d’un épisode inédit. Aujourd’hui, le professeur Jean-François Delfraissy s’adresse directement à l’opinion, avec l’autorité de la science. Dans ses discours, nous retrouvons beaucoup d’injonctions comme « nous devons » et non « nous devrions ». C’est donc une prescription unilatérale qu’il délivre, de nature à s’imposer à la population. J’ai deux exemples en tête : le cas des aînés, autrement dit des personnes âgées, concerne 18 millions de personnes ; selon les recommandations du conseil scientifique, il aurait dû être prolongé jusqu’à l’obtention d’un vaccin… Autant dire sans limite de temps. Or le politique a refusé en laissant toute sa place au civisme. Pour la reprise des écoles, de même, le conseil scientifique avait marqué son désaccord avec la date du 11 mai. Mais là encore, le politique a imposé son point de vue : il fallait que la vie reprenne pour les élèves les plus fragilisés par l’éloignement de l’éducation collective. Manière de placer les maires et les chefs d’établissement devant leurs responsabilités.
Le noyau de l’enjeu décisionnel ne se situe pas entre législatif et exécutif mais au sein de l’exécutif. Il s’agit d’un débat entre un prescripteur médico-scientifique irresponsable politiquement et le décideur politique qui, lui, a des comptes à rendre. Ces tensions entre les deux autorités pourront très bien se poursuivre à l’avenir, puisque le retour d’une épidémie ou d’une seconde vague n’est pas exclu. Mais face à ce risque-là, le politique doit assurer la part tragique de son action c’est-à-dire décider non en fonction du bien mais du moindre mal. Il s’agit de faire la part des choses dans une balance « risques sanitaires versus risques psychosociaux ». Le confinement à durée indéterminée pour les personnes âgées voulu par les scientifiques relève presque de la discrimination, voire pourrait être jugée anticonstitutionnel en cas de recours. Ainsi le décideur politique a cherché à se démarquer du scientifique qui se présente comme un discours de vérité (annonce des chiffres des morts, des malades, des réanimés, etc.) tout en s’appuyant sur son expertise dans une matière hautement technique. Un responsable politique, lui, doit mettre en balance le risque sanitaire avec d’autres risques (maltraitance des aînés dans les EHPAD, décrochage scolaire…) qui sont hors du champ de vision des épidémiologistes.
LPA : Le secteur médical est-il particulièrement favorable au développement des fake news ? Cela pourrait-il fragiliser la démocratie ?
D. S. : Les opinions scientifiques ont envahi la sphère médiatique, avec une réelle surabondance d’avis médicaux sur des sujets variés mais aussi de vraies contradictions de points de vue. Nous l’avons vu avec les essais cliniques et la question de la chloroquine ou sur l’agenda du déconfinement. Mais le discours médico-scientifique est aussi très anxiogène, et favorise les fake news. Au début de la pandémie, nous avons été complètement désarçonnés car nous n’étions pas du tout habitués à vivre sous des contraintes sanitaires. Il nous a fallu un certain temps pour les intégrer à notre quotidien. De plus, ces mesures génèrent un contrôle policier, voire un contrôle judiciaire. D’autant que le contrôle du juge – le Conseil d’État en référé – a laissé une très large marge d’appréciation à l’exécutif. Aujourd’hui, toutes les décisions du Conseil constitutionnel sont reportées après le 30 juin. Le contrôle de constitutionnalité ne pourra donc se faire qu’après cette date. C’est oublier que le Conseil constitutionnel est le garant du temps long et de la démocratie et que même l’article 16 de notre Constitution prévoit qu’on le consulte en cas de péril imminent.
LPA : La crise sanitaire est-elle un révélateur de nos failles sociales ?
D. S. : En effet ; les violences intrafamiliales montent en puissance, les conditions de travail chez Amazon sont sanctionnées par décision de justice (le 14 avril, Amazon a été condamné en référé à mieux protéger ses salariés du coronavirus et à restreindre ses activités aux produits jugés essentiels, NDLR), et les conditions de la mortalité dans les EHPAD font l’objet de plaintes pénales. La distorsion du lien social devra être réparée par la justice, qui devra reconstruire ce lien. Nous aurons peut-être des plaintes pour « mise en danger d’autrui » qui visent des décideurs publics ou privés mais cette incrimination est très restreinte. Comme l’écrit Antonin Artaud, « les masques tombent » pendant une pandémie. Cette crise fonctionne comme un révélateur dans les deux sens, négatif et positif. Au compte du négatif, on remarque les dénonciations ou le marché noir de masques, mais en face de cela, il y a aussi les applaudissements pour remercier les professionnels de santé tous les soirs, les multiples formes de solidarités qui attestent de la vitalité de la société civile. L’État régalien n’est pas le seul acteur sur la scène publique.
LPA : Si le champ sémantique de la guerre a sans doute été surutilisé par le chef de l’État, ce que vous évoquez fait effectivement penser à ce que révèle la guerre de la nature humaine…
D. S. : Ce qui me fait le plus penser à un état de guerre, c’est la question de la mort dans les EHPAD. Les conditions dans lesquelles sont organisées les funérailles sont analogues au temps de guerre : il n’y a plus de place pour le temps de recueillement, les toilettes mortuaires sont interdites, les cercueils désinfectés ne peuvent plus être touchés … Il faut précipiter les obsèques, pour éviter les contagions. Les opérateurs funéraires privent les familles de tout espace de deuil. Cela évoque forcément la guerre et ses conséquences, où sur les zones de front il faut enterrer les cadavres localement, organiser des ossuaires et priver les familles du corps. Là aussi des plaintes ont déjà été déposées en justice, car les familles ne comprennent pas ce qui s’est passé, comment leur aieul.le a pu mourir, être contaminé.e sans que les proches le sachent… Cette mort dérobée devra être éclairée, non pour punir mais pour savoir. Pour ces familles, le sens de la judiciarisation est davantage la vérité due que la sanction attendue.
LPA : La justice va être fortement impactée par la crise sanitaire, tant au niveau des engorgements potentiels, que de sa numérisation ou encore du travail de résilience qu’elle va permettre à la société. Sera-t-elle un vrai pilier de l’après ?
D. S. : La justice aura un rôle important à jouer dans la reconstruction des liens sociaux aussi fragilisés. Nous allons voir apparaître un schéma de justice transitionnelle, au sens où il faudra réparer nos blessures. Des plaintes ont déjà été déposées, par exemple, concernant la pénurie de masques ou de tests. Il est légitime de déterminer la part de responsabilité des autorités comme nous l’avions fait jadis dans l’affaire du sang contaminé. Au niveau des conseils de prud’hommes aussi, la justice va être surchargée par les cas de licenciements et les demandes indemnitaires. En somme, il y aura un contentieux transitionnel dans un but de vérité et de réparation que seule l’enquête judiciaire et le débat contradictoire peuvent assurer. Sauf si nous créons une commission « vérité » comme on le fait parfois en cas de crise grave ce qui n’est pas dans notre tradition politique.
LPA : Dans quelle mesure, le fonctionnement même de la justice va-t-il être modifié ?
D. S. : Après une crise aussi importante, la justice ne pourra plus être la même ! Cela est peu abordé, mais l’agenda du monde judiciaire va être bouleversé. Aux affaires en cours, s’ajoutera le contentieux généré par la crise dans tous les secteurs de la société civile. Et cela prendra du temps. La numérisation des dossiers va s’accélérer. Il faudra vraisemblablement utiliser plus encore les écrans (visioconférences, Skype…) sans oublier l’usage du téléphone qui a permis à des avocats confinés de plaider. Toutes ces technologies sont déjà inscrites dans la pratique judiciaire, mais beaucoup de ces dispositifs sont aujourd’hui discutés. Si aucun procès ne se tient actuellement en cour d’assises, c’est que le présentiel est indispensable à la tenue du débat contradictoire. Bien que le numérique permette d’accélérer la cadence et fluidifier les échanges je ne souhaite pas voir ces pratiques s’inscrire dans la durée, mais plutôt revenir à une discussion vivante autour du juge. C’est le sens de cette phase transitionnelle dont je parlais : certes, il faut avancer mais pas à n’importe quel prix car l’acte de juger implique la coprésence.
LPA : Peut-on s’inquiéter de la réduction de nos libertés individuelles après le déconfinement ? Quid de la question du tracking ?
D. S. : On pourrait voir le pouvoir biopolitique (notion formée par Michel Foucault pour parler d’une forme de pouvoir portant sur la vie des populations, comme c’est le cas lors des épidémies, NDLR) s’accentuer, avec le risque d’une dictature numérique. Mais si l’on parle de tracking, en France, l’application Stop-Covid doit être téléchargée obligatoirement pour être efficace ce qui n’est pas prévu en l’état. On a craint sans doute les atteintes aux libertés et à la vie privée. Avec le risque d’une nouvelle vague, la possibilité de faire appel à cet outil peut déboucher sur une forme de surveillance numérique. À mes yeux, le gouvernement a fait le bon choix en ne pressant pas le débat sur le tracking. Par ailleurs, quel contrôle y attacher ? Quelle autorité aurait la main sur les données ? Il était urgent de temporiser les débats. En fait, c’est une autre démarche, un autre vocabulaire qui apparaît : chaque malade sera testé puis un « bureau du suivi » sera chargé d’enquêter avec son aide pour retrouver les « cas contact » c’est-à-dire les personnes de son entourage qu’il faudra tester à leur tour pour couper les chaînes de transmission. Cela me semble plus raisonnable.
LPA : En parlant de « longue durée », peut-on craindre, comme ce fut le cas lors du dernier état d’urgence de 2015, de voir se pérenniser des mesures censées être ponctuelles ?
D. S. : C’est en effet ce que je crains, car nous avons un précédent récent. Après les attentats de 2015, le gouvernement nous a rassurés en nous disant : « Pas d’inquiétude. Ce sont des mesures exceptionnelles ». Finalement devant la permanence du risque terroriste, elles ont été transposées dans le droit commun pour une partie d’entre elles (assignation à résidence, perquisitions administratives…). Je crains qu’on observe la même chose avec les pandémies. Nous pouvons transposer dans le droit commun des mesures exceptionnelles qui concernent cette fois toute la population à la fois menacée et menaçante. On nous dira – et on l’entend déjà – qu’on vivra désormais durablement avec ce risque épidémique et qu’il faut s’armer pour y faire face. Comment dire non devant le risque d’une nouvelle pandémie ? Ainsi nos libertés individuelles seraient réduites à la portion congrue pour notre bien. Faisons plutôt confiance à notre démocratie et à ses piliers : le débat parlementaire, la liberté d’informer et de critiquer, mais aussi le contrôle du juge pour contenir un dévoiement de la démocratie comme on le voit en Chine et dans certains pays européens.