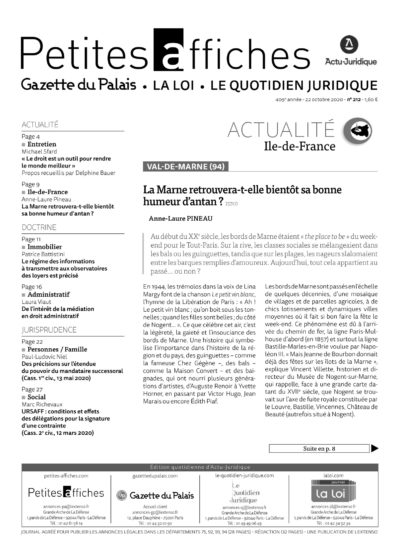Me Michael Sfard : « Le droit est un outil pour rendre le monde meilleur »
Avocat israélien spécialisé dans la défense des droits de l’Homme depuis plus de 20 ans, Michael Sfard a représenté, au cours de sa carrière, des dizaines de militants israéliens et palestiniens, notamment devant la Cour suprême. Son dernier livre Le mur et la Porte, publié en 2017 en Israël et en France aux éditions Zulma Essai en février dernier, plonge le lecteur dans plus de 50 ans de batailles judiciaires pour les droits de l’Homme en Israël et en Palestine.
Michael Sfard, dans la droite lignée de ses modèles Felicia Langer ou Avigdor Feldman, qu’il cite à l’envi, vient d’une famille de survivants de la Shoah. Est-ce là que s’ancre sa détermination à toute épreuve pour défendre ceux qu’il estime être les plus vulnérables dans cette démocratie imparfaite née d’une utopie que constitue Israël ?
À travers plus de 600 pages – qui ne doivent pas rebuter les lecteurs, car les batailles judiciaires se lisent comme des feuilletons, avec de multiples rebondissements –, Michael Sfard aborde les grands points qui symbolisent les tensions inhérentes à la société israélienne : le mur, les colonies, les déportations forcées, la question sécuritaire ou encore celles des permis de déplacement.
Militant, Michael Sfard l’est sans hésiter. Mais face à un sujet aussi délicat que le conflit israélo-palestinien, l’avocat apporte un récit détaillé, pointu, ultra-documenté, faisant de nombreuses références à des décisions qui ont émaillé l’histoire judiciaire du pays et marqué l’actualité internationale, à l’instar de l’affaire Natsheh, marquant la réduction des déportations d’opposants palestiniens ou celle de la colonie d’Eron Moreh à qui la Haute Cour avait interdit l’accaparement de terres en 1980.
Livrant un essai qui dépasse le seul domaine du droit pour aborder les questions d’éthique ou la philosophie du droit, il ne cesse de s’interroger. Quelle valeur accorder au combat individuel vis-à-vis du combat collectif ? Quelle validité accorder au droit international vis-à-vis du droit national ? Comment ne pas penser la responsabilité également comme individuelle, Michael Sfard faisant référence au tikkun olam (concept issu de la philosophie juive qui recouvre en grande partie la conception de la justice sociale juive) ? L’avocat, en « relayant que l’opposition est possible », ne devient-il pas un agent du blocage au changement ?, se demande-t-il également.
Et s’il critique la politique de son gouvernement, Michael Sfard s’inquiète également de l’avenir des militants de la paix dans un contexte de « droitisation » mondiale, en témoigne l’arrivée au pouvoir de Donald Trump ou encore Jair Bolsonaro. Mais pour lui, « l’une des principales arènes de la lutte pour améliorer la société et donc l’humanité [reste] le tribunal ».
Entretien avec un avocat mondialement reconnu pour ses engagements, qualifié, selon le New York Times, d’« avocat de gauche le plus influent d’Israël », et accroché, plus que jamais, à ses idéaux de justice.
Les Petites Affiches : Dans les pages introductives du Mur et la Porte, vous vous demandez si le changement social peut avoir lieu par des démarches judiciaires. Après plus de 20 ans d’exercice, avez-vous pu apporter une réponse à cette question ?
Michael Sfard : Il m’est impossible de répondre simplement oui ou non, ma réponse est nécessairement plus complexe. De manière générale, je ne pense pas que le litige soit forcément la roue motrice d’un changement social majeur. Je pense que le litige a presque toujours un rôle dans les changements sociaux, mais pas un rôle essentiel, plutôt comme s’il se trouvait sur le siège passager. Pour autant il est un outil de soutien important pour un mouvement en faveur du changement. Cependant, il existe des cas exceptionnels, les cas que j’appelle des « échecs du marché », où les mécanismes réguliers qui fournissent du changement social ne fonctionnent pas. Par exemple, quand la majorité veut quelque chose, mais que la minorité a davantage de pouvoir, alors le processus démocratique est bloqué. L’arène judiciaire, de la même façon, en étant professionnelle, indépendante et non assujettie aux votes, peut fournir un changement dont le législateur est empêché. Mais même dans cet exemple, l’agent du changement le plus important, ce n’est pas le litige, c’est la volonté populaire. Le litige est simplement le chemin par lequel les fruits sont récoltés. Il y a très peu de cas où le droit et l’éthique du droit ne sont pas questionnables. C’est par exemple le cas de la torture, que je donne dans le livre : pas un juge, juriste ou magistrat, qui a été éduqué dans une tradition libérale, ne peut trouver une raison de légitimer la torture ou l’esclavage… Mais ce sont des cas très rares, les plus extrêmes.
LPA : Vous le montrez, les avocats qui vous ont inspiré, ont suscité énormément d’incompréhension. Dans votre pays, êtes-vous critiqué pour vos prises de position ?
M.S. : Il s’est produit un changement énorme au cours de la dernière décennie. Le gouvernement israélien a changé son attitude envers les gens comme moi, mais également s’est mis à plaquer à terre les réactions de la rue. Si vous m’aviez interviewé 10 ou 12 ans auparavant, je pense que mes critiques sur mon pays ou sur la politique qu’il mène n’auraient pas été aussi virulentes. Il y aurait eu un moment dans l’interview, où j’aurais dit, malgré tout : l’une des choses bonnes en ce qui concerne mon pays, c’est que je peux librement exprimer mes opinions, que je suis respecté pour être critique et dans l’opposition et qu’il y a vraiment de la place pour les gens comme moi dans la société israélienne. Ce n’est malheureusement plus du tout le cas ! Les raisons pour lesquelles les Palestiniens ont été ciblés ces dernières années, on les connaît. Mais il apparaît un phénomène nouveau, c’est que les activistes juifs sont devenus également des cibles. Nous sommes actuellement l’objet d’une forme d’acharnement. Le débat ne porte plus sur l’éthique, des valeurs, des idéaux, les problèmes en eux-mêmes mais sur la déligitimisation. Il ne porte plus sur les raisons pour lesquelles nos détracteurs pensent que nous avons tort, mais il remet en question nos motivations.
LPA : Que disent vos détracteurs ?
M.S. : On est accusés d’être des traîtres ou des agents de forces étrangères, nos fonds sont ciblés. En réalité, il devient de plus en plus difficile de parler des problèmes en eux-mêmes, ce qui relève d’une véritable stratégie. Si vous regardez le portefeuille des cas gérés par mon cabinet, cela vous donne un très bon aperçu de leur victoire. Il y a dix ans, 100 % de mes dossiers portaient sur les façons d’obtenir réparation pour des victimes de la politique ou des pratiques israéliennes dans les territoires occupés ou en Israël. Si vous comparez ce chiffre à la situation d’aujourd’hui, 40 % de mes dossiers portent sur la manière de défendre les défenseurs des droits humains eux-mêmes ! Notre travail consiste, désormais, à protéger l’espace qui leur permet d’agir, à faire en sorte que des activistes étrangers puissent rentrer en Israël, à repousser les poursuites judiciaires lancées par les activistes de l’aile droite, à préserver leur capacité d’opérer. Mais la même chose se produit également sur les agendas de n’importe quel directeur d’ONG en Israël. De plus en plus de leur temps est consacré à se défendre. Donc oui, c’est une stratégie et elle fonctionne. Alors pourquoi a-t-elle été décidée ? Il y a toujours eu une minorité qui nous soutenait, une petite minorité, certes, mais nous avions proportionnellement plus d’influence que ce que nous représentions dans la société. Nous avions un impact parce que la communauté des défenseurs des droits de l’Homme en Israël fournit des informations de qualité, très professionnelles, importantes et crédibles, à la communauté internationale et au public israélien, qui enrichissent le débat sur les conflits ponctuels se produisant en Israël. Et c’est quelque chose dont le gouvernement ne veut pas. Afin de stopper ce mouvement, les représentants de l’État ont le choix entre deux options. La première serait de voter des lois comme en Russie et d’interdire carrément nos actions. Mais cela exigerait un énorme prix politique, à la fois en interne mais aussi face à la scène internationale. À la place, ce qu’ils font, c’est qu’ils nous déligitimisent auprès du public israélien et ciblent nos faits. Et ce faisant, ils espèrent réduire notre capacité d’action. Mais parallèlement, il y a aussi un effort de légiférer pour aboutir à une restriction de notre travail. Des lois ont déjà été adoptées qui nous imposent des sanctions sur certains discours politiques. Par exemple, la loi boycott, qui permet les déportations ou le refus de l’entrée sur le territoire à des activistes non israéliens, a permis récemment de déporter Omar Shakir (directeur de recherche sur Israël et la Palestine pour l’ONG Human Rights Watch) que je représente. Les autres lois jouent sur d’autres types de discours. Petit à petit, notre champ d’action se réduit.
LPA : Dans votre livre, vous parlez d’une société qui se droitise en Israël, mais ailleurs dans le monde également.
M.S. : Je pense que la société israélienne a toujours souffert d’un dédoublement de personnalité. Et je l’écris dans le livre, je pense qu’elle possède cette dualité en elle depuis sa conception : elle porte une aspiration véritable, profonde, libérale des valeurs démocratiques, en même temps qu’une aspiration véritable, profonde, nationaliste, chauvine, et même raciste à certains égards. Elle est aussi obsédée par l’idéologie sécuritaire, ce qui peut tout à fait être expliqué par le chaos de l’histoire juive. Et ces deux caractères ont joué une sorte de combat rituel à l’intérieur même de la société israélienne. Ce que l’on voit ces dix dernières années, c’est que le statu quo qu’on avait dernièrement, a été réduit à néant. Je crois que le « bad guy » en nous, Israéliens, est devenu plus puissant. Mais nous sommes encore au cœur de la bataille et ce n’est pas fini. Ainsi, je ne sais pas quelles sont nos options, mais il y en a une que nous n’avons pas : celle d’abandonner. Moi, privilégié, homme, juif, ashkénaze, venant d’une famille aisée, je peux partir. Mais pas mes clients. Si quelqu’un prenait ma licence professionnelle, là se poserait la question de ce que je peux encore apporter à mes clients. Mais en tout état de cause, notre camp ne peut pas cesser de se battre.
Par ailleurs, cette droitisation et ce mouvement vers plus d’autocratisme, qui émerge au sein du gouvernement israélien, n’est pas unique à mon pays, mais c’est un mouvement global. Espérons que cette tendance sera inversée bientôt, peut-être dès novembre prochain (avec l’élection américaine).
LPA : Avez-vous des contacts avec des activistes à travers le monde ? Voyez-vous des points communs dans vos luttes ?
M.S. : Oui, absolument. Je suis de plus en plus en contact avec des activistes dans le domaine du droit, avec des avocats en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne… Et bien sûr ceux de Palestine, de Gaza ou de Cisjordanie.
Dans le livre, je me réfère au mouvement des droits civiques aux États-Unis, au mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud… Bien sûr, il est dangereux de plaquer littéralement un combat sur un autre, mais il y a beaucoup de choses à apprendre de juridictions qui font face à des problématiques similaires. Les fissures de la société civile, c’est quelque chose qui arrive dans bien d’autres pays. Et apprendre d’autres expériences est très important. Par exemple, la politique de Benjamin Netanyahou devient très « poutiniste », en termes de gestion des voix dissonantes. Alors, on peut regarder ce qui se passe en Russie pour nous donner une idée de là où il veut en arriver, constater les réactions suscitées par les ONG internationales et nous organiser au mieux en fonction.
LPA : La question sécuritaire semble tout balayer sur son passage. Vous évoquez les déportations, les spoliations de terrains, etc. Les victoires sont rares mais vous remarquez des changements positifs comme la baisse des déportations ou le quasi-arrêt des tortures. Malgré tout, la peur des attaques contre le territoire israélien est omniprésente…
M.S. : « Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse, au contraire, l’est à sa façon », disait Tolstoï dans Anna Karénine. Partout, la misère est vue comme différente. En Hongrie, l’afflux de réfugiés a généré une énorme peur. En Amérique, les années 1960-1970 ont été marquées par la lutte contre le communisme. Et en Afrique du Sud, les blancs avaient peur de se faire expulser par les noirs. Les hégémonies, toujours, tentent de se stabiliser par la peur, pour conformer les masses à une attitude passive. Je ne dis pas que la peur sécuritaire d’Israël n’est pas fondée. Pas du tout. Il existe un sérieux et authentique problème sécuritaire en Israël, qu’il ne faut absolument pas minimiser. Mais cela n’autorise pas pour autant à résoudre le conflit palestinien en se passant du droit international et du respect des droits humains les plus basiques.
LPA : Dans les débats concernant les problèmes liés à l’occupation, le droit est-il votre meilleur allié ou votre pire ennemi, sachant que vos adversaires en font également une utilisation très précise et intelligente ?
M.S. : J’ai écrit que chaque avancée positive réalisée par un avocat des droits de l’Homme n’importe où dans le monde avait pour effet de renverser une avancée négative permise par un autre avocat. Le droit peut être un magnifique bouclier et une épée douloureuse. La loi est comme le tofu : elle peut avoir n’importe quel goût. Cela dépend de ce que l’on fait en soi. Mais l’idée de l’État de droit est une belle idée : que des règles générales nous gouvernent, que l’on accepte tous et qu’on participe à créer, c’est superbe. C’est une belle idée, que nous devrions chérir. Mais le contenu des normes peut être horrible ou, au contraire, véhiculer les valeurs les plus nobles. Je fais partie d’un mouvement qui cherche à tirer la loi vers le haut, en en faisant la puissante protectrice des nobles valeurs, plutôt qu’un outil au service de ceux qui veulent dominer et exclure. Le droit est un outil pour rendre le monde meilleur. Mais je sais, et je le sais très bien, que ça peut être le contraire.
LPA : Ressentez-vous parfois des moments de désespérance ?
M.S. : Oui, il y a des moments comme cela. Mais quand mes avocats juniors, qui exercent au sein de mon cabinet, ressentent la même chose, je leur demande : si l’on monte dans une voiture détériorée et qu’on est sur une falaise, faut-il pour autant lever le pied du frein ? On ne sait jamais quel impact exact on peut avoir sur les choses. Peut-être que sans nous, la détérioration aurait été plus rapide. Et on fournit définitivement, à défaut d’un changement social profond, un remède à quelqu’un dans le besoin, sur une base individuelle. Ce qui, en soi, est suffisant pour continuer à faire ce que nous faisons. Et à la fin, il existe ce poème en hébreu, qui dit : « L’aurore vient toujours après les moments les plus sombres de la nuit ». On ne sait jamais comment l’histoire peut évoluer. Parfois on a le sentiment que le changement est si loin… alors qu’il est si proche. Personne n’aurait parié, même un mois avant que Nelson Mandela soit libéré, que l’Apartheid allait prendre fin. Personne n’aurait deviné que le mur de Berlin allait tomber, deux semaines avant que ça n’arrive. Et personne n’a imaginé le Printemps arabe. Les choses se produisent et elles ont leur propre moyen d’être créées, sous la surface. Ce que je crois, c’est que nous créons les fissures sous la surface, que l’on ne voit pas jusqu’au moment où elles convergent et que les choses s’ouvrent. Donc on doit se lever tous les matins, en pensant que c’est peut-être le grand jour. C’est comme un rituel religieux.
LPA : Vous dites que l’occupation est le cœur du problème, malgré les condamnations internationales. Que peut faire la communauté internationale ?
M.S. : J’espère et je crois qu’à un moment, l’occupation prendra fin. Non, je reformule : s’il y a une chose dont je suis sûr, c’est que l’occupation s’effondrera. Ce n’est pas une question, c’est une certitude. Ce genre de situation ne peut pas se maintenir pour l’éternité. Il y a une instabilité élémentaire quand des millions de personnes sont assujetties et n’ont pas de droits. C’est comme une force physique qui s’exerce constamment. Cela finira. Les deux questions sont : quand ? Et cela prendra-t-il fin dans une tragédie ou calmement ? Moi je fais en sorte que cela se termine le plus rapidement possible, et le plus calmement possible. Et dans le but d’y arriver, la loi internationale doit jouer un rôle déterminant. Tout essai pour régler le problème, non pas sur la base de la justice, telle que la justice a été codifiée dans le droit international, ne sera pas une solution viable à la résolution du conflit. Le droit international affirme que les Palestiniens ont le droit à leur autodétermination. Puis ils choisiront de quelle façon : par la création d’un État, par l’autonomie, ou une fédération, c’est à eux de choisir. Pour ce faire, la communauté internationale, a l’obligation – et ce n’est pas une affaire interne à Israël – de faire ce qu’elle peut pour maintenir la loi internationale dans cette région. Cela signifie qu’elle ne peut pas tolérer les abus frontaux faits aux droits humains les plus fondamentaux, consécutifs au droit post Seconde Guerre mondiale. J’ai par exemple été très heureux de constater que la France a été l’une des forces majeures pour exiger que l’Europe ne se contente pas d’une condamnation si Israël continue d’annexer des parties de la Cisjordanie mais plutôt impose des sanctions. C’est quelque chose qui est très important car l’annexion est une violation des règles internationales imposées à la suite du second conflit mondial. Et cela aura des implications dans d’autres conflits dans le monde. Nous devons faire en sorte que la communauté internationale s’exprime d’une seule voix et exige d’Israël d’écouter les principes des lois internationales. Activistes, Palestiniens ou Israéliens, c’est notre rôle de fournir des informations fiables, crédibles sur les pratiques du pays sur le terrain, afin de défendre les droits des Palestiniens, et de faire ce que l’on peut pour convaincre l’opinion publique israélienne que la situation doit changer ! Je suis impliqué dans un groupe intitulé : « A land for all », qui défend l’idée d’une confédération sur le modèle américain, où les Israéliens et les Palestiniens pourraient vivre là où ils veulent et auraient chacun leur propre nationalité, en partageant des institutions communes.