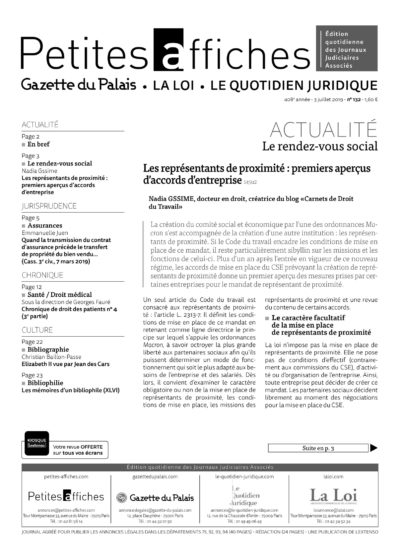Chronique de droit des patients n° 4 (3e partie)
Cette chronique est assurément placée sous le double signe de la variété et des recoupements interdisciplinaires.
La gynécologie-obstétrique fait l’objet de nombreux développements. Rodolphe Bigot, dans son panorama jurisprudentiel en matière de responsabilité civile, met en lumière des décisions de la Cour de cassation relatives à la faute caractérisée d’un gynécologue n’ayant pas décelé un handicap de l’enfant à naître pendant la grossesse (Cass. 1re civ., 5 juill. 2017), à l’intervention tardive d’un praticien ayant procédé en urgence à une césarienne à l’issue de laquelle le nourrisson a présenté des séquelles irréversibles (Cass. 1re civ., 22 juin 2017) et au préjudice moral des parents lié à la stérilité de leur fille exposée pendant la grossesse aux effets néfastes d’un médicament, le Distilbène (Cass. 1re civ., 11 janv. 2017 et Cass. 2e civ., 8 juin 2017).
Cécile Manaouil, en conclusion de son article sur « les violences gynécologiques et obstétricales », doute de l’utilité de nouvelles règles en la matière : « Plutôt que de vouloir légiférer contre les violences obstétricales et modifier le Code de déontologie médicale, il faudrait déjà connaître et appliquer la législation et la règlementation existante ». C’est aussi à propos d’une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 avril 2018, rendue à propos des suites d’un accouchement difficile ayant entraîné de graves troubles neurologiques au nouveau-né, qu’Audrey Margraff, dans son commentaire, met en avant une sorte de rétroactivité in mitius civile au profit du médecin « fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins conformes à des recommandations émises postérieurement ».
Les grandes affaires sanitaires de ces dernières années sont aussi au rendez-vous de cette chronique, que ce soit en matière civile (affaire du Médiator, Cass. 1re civ., 20 sept. 2017 et affaire du Distilbène, Cass. 1re civ., 11 janv. 2017 et Cass. 2e civ., 8 juin 2017) traitées par Rodolphe Bigot ou en matière pénale (affaire AZF, CA Paris, 31 oct. 2017) abordée par Mikaël Benillouche.
Ce dernier évoque aussi dans son panorama de responsabilité pénale, notamment l’épilation au laser qui est un acte médical (Cass. crim., 27 févr. 2018) et les compléments alimentaires pouvant relever « de pratiques commerciales trompeuses liées aux allégations nutritionnelles fallacieuses » et aux « allégations de santé non autorisées » (Cass. crim., 20 mars 2018).
Enfin, Jacqueline Flauss-Diem s’intéresse au périlleux équilibre auquel le juge anglais est confronté entre préceptes religieux et intérêt d’un patient, déficient mental.
Bonne et intéressante lecture !
Georges FAURÉ
I – Droit des « personnes patientes »
II – Expertise et droit des patients
III – Responsabilité et droit des patients
A – L’appréciation de la faute du professionnel de santé eu égard à des recommandations émises postérieurement aux faits
B – Responsabilité civile : panorama législatif et panorama jurisprudentiel
1 – Panorama législatif
2 – Panorama jurisprudentiel
a – Les frontières de la responsabilité et de la solidarité
Précisions sur l’origine du dommage ouvrant droit à l’indemnisation par la solidarité nationale. Un arrêt du 24 mai 2017 précise les frontières indemnitaires pour les patients, en particulier la notion de dommage imputable à un acte de soins ou de dommage médical susceptible de donner lieu à l’indemnisation par la solidarité nationale1. La Cour de cassation a tout d’abord rappelé les conditions de l’indemnisation par la solidarité nationale, en vertu de l’article L. 1142-1, II, du CSP (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009). Elle a déduit, sur le ton d’un principe, que « pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale, soit qu’il résulte de son aggravation ; que le fait que l’évolution favorable de l’état de santé d’un patient se trouve retardée par un échec thérapeutique ne caractérise pas un tel dommage », lequel est né à la suite d’une entorse de la cheville lors d’une mauvaise chute. La blessure a dégénéré. Une instabilité chronique s’est installée dans l’articulation. Pour y remédier, le patient a subi en 2006 une ligamentoplastie puis, en raison de la persistance de douleurs, une seconde intervention en 2008. Elle aurait permis de diminuer la tension du transplant et entraîné une réduction des douleurs. Dans le cadre de la procédure de règlement amiable, le patient a vainement invoqué avoir subi un accident médical non fautif. Il a donc assigné l’Oniam afin d’être indemnisé au titre de la solidarité nationale. La cour d’appel a accueilli sa demande en retenant l’existence d’un dommage imputable à un acte de soins. La haute juridiction a réfuté ce raisonnement et a jugé que « le retard dans l’évolution favorable de l’état de santé du patient, consécutif au fait que l’intervention chirurgicale, réalisée conformément aux règles de l’art, n’avait pas permis de remédier aux douleurs qu’il présentait et ne les avait pas non plus aggravées, ne caractérisait pas un dommage directement imputable à un acte de soins ».
Les subtilités théoriques du droit de la santé ne sont pas toujours au service de la protection des personnes en la matière. La réparation des conséquences des risques sanitaires, en particulier ceux résultant du fonctionnement du système de santé, est enfermée dans un mécanisme d’indemnisation étriqué, au profit de son débiteur l’Oniam, et par le jeu des conditions d’ouverture, ici l’origine du dommage, provoqué en l’espèce par un acte médical. À ce titre, une précision est apportée. La Cour de cassation délimite la notion d’acte médical non fautif, auquel elle n’entend pas relier le dommage caractérisé par un patient dont l’évolution favorable de l’état de santé se trouve retardée par un échec thérapeutique. Elle propose une interprétation resserrée de la notion d’accident médical, condition imposée par le texte, ce qui conduit en définitive à exclure l’échec thérapeutique. Pour bénéficier de la réparation au titre de la solidarité nationale, le dommage résultant d’un accident médical non fautif doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, tantôt en ayant un caractère distinct de l’atteinte initiale, tantôt en étant la conséquence de son aggravation. De ce point de vue, l’affirmation n’est pas nouvelle. Elle n’est qu’une application de la loi, figée à l’article L. 1142-1, II, du CSP, lequel écarte toute indemnisation dès lors que le dommage n’est que la conséquence de l’évolution prévisible de l’état de santé antérieur du patient. Toutefois, cet état antérieur du patient soulève régulièrement des difficultés. Tantôt il s’agit de savoir si le dommage est bien dû à l’acte médical lui-même, auquel cas s’ouvre la porte de l’indemnisation. Tantôt il s’agit de savoir si le dommage est bien dû à l’état antérieur du patient, auquel cas la porte de l’indemnisation demeure fermée. Cela renvoie à la condition d’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, mais aussi cela vient délimiter la notion de dommage médical. La jurisprudence l’a déjà énoncé par le passé, l’échec thérapeutique ne constitue pas un dommage médical réparable. Selon les magistrats du quai de l’horloge, n’est donc pas susceptible de réparation le dommage, qu’ils retiennent sans doute implicitement comme étant indirect, le fait que l’évolution favorable de l’état de santé d’un patient se trouve retardée par un échec thérapeutique. La qualification retenue reposera à nouveau pour beaucoup sur les épaules de l’expert, qui aura à dessiner la frontière ténue entre échec thérapeutique et accident médical non fautif. Le temps est peut-être venu d’envisager un système prenant en charge toute personne ayant subi un dommage corporel à l’occasion d’un accident, quel qu’il soit, à l’instar de celui mis en place depuis 1973 en Nouvelle-Zélande. Il a aboli l’action en responsabilité civile pour dommage corporel et confié l’indemnisation des victimes à un système d’assurance sociale généralisée2. La doctrine contemporaine constate à présent que « l’audace qui était nécessaire pour mener à bien une telle réforme est à la mesure du succès que le régime d’indemnisation continue de rencontrer en Nouvelle-Zélande »3. S’il existe bien, en droit français, un système d’indemnisation détaché de toute responsabilité, il demeure parcellaire. L’indemnisation de l’aléa thérapeutique, indépendante de toute responsabilité, relève de la solidarité nationale via l’Oniam si, et seulement, si certaines conditions, souvent judiciarisées, sont réunies.
Le difficile aiguillage dans l’indemnisation des dommages résultant d’infections nosocomiales (et l’indemnisation des victimes par ricochet). Un arrêt du 8 février 2017 révèle à nouveau les méandres de l’indemnisation des infections nosocomiales, dans leur répartition entre responsabilité civile et solidarité nationale4. À l’origine du drame, un patient atteint d’une artérite a été opéré à trois reprises sur une période de 5 mois par un praticien spécialisé en chirurgie vasculaire et endocrinienne, dans une clinique privée : deux pontages fémoro-poplités des membres-inférieurs les 15 mars et 2 juillet 2007, et une thrombectomie de l’un des pontages le 17 juillet 2007. Puis, et semble-t-il, en continuant à fumer malgré les mises en garde à cet égard5, le patient a présenté une infection nosocomiale. La prise en charge de cette infection a été assurée par le praticien jusqu’à l’admission du patient dans un CHU et à la réalisation, les 19 et 26 octobre 2007, d’une amputation fémorale bilatérale ayant entraîné un déficit fonctionnel de 70 %. Le patient a sollicité une expertise en référé mais est décédé le 5 avril 2010. Ses ayants-droit ont assigné la clinique en responsabilité, puis l’Oniam en intervention forcée et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours. À son tour, la clinique a appelé en garantie le praticien en invoquant une faute de ce dernier dans la prise en charge de l’infection. En premier lieu, la cour d’appel avait écarté l’action en responsabilité contre la clinique, élément contesté par les demandeurs au pourvoi. A néanmoins été rejeté ce moyen, au motif que « dès lors qu’était applicable l’article L. 1142-1-1, 1°, la responsabilité de la clinique ne pouvait être engagée qu’en cas de faute ». Or les juges du fond n’avaient retenu aucune faute à son encontre. En second lieu, l’autre moyen a trouvé un meilleur accueil et ainsi conduit à la cassation partielle. L’indemnisation du préjudice d’accompagnement des victimes par ricochet ne pouvait être mise à la charge de l’Oniam, selon la cour d’appel, ce qu’ont réfuté les ayants-droit dans leur pourvoi. La haute juridiction admet qu’il procède de l’article 1142-1-1 un régime « distinct de celui prévu par l’article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte ». Les victimes par ricochet peuvent donc solliciter une indemnisation en application de l’article L. 1142-1-1 du CSP même si la victime directe n’est pas décédée. En effet, s’agissant des infections nosocomiales, deux situations peuvent générer le concours de l’Oniam. Il s’agit, d’une part, de son domaine de compétence subsidiaire prévu par l’article L. 1142-1, II du CSP créé par la loi du 4 mars 2002. Dans ce cas, l’office ne peut intervenir qu’à une double condition. Non seulement l’infection nosocomiale doit avoir eu pour le patient des « conséquences anormales au regard de son état de santé » et correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (APIPP) supérieur à 24 %, mais encore aucune responsabilité d’un professionnel de santé ne doit avoir été établie ; les victimes par ricochet étant exclues de l’indemnisation si la victime directe est en vie. Il s’agit, d’autre part, du domaine de compétence de l’Oniam à titre principal, conféré par la loi du 30 décembre 2002 au sein de l’article L. 1142-1-1 du CSP. Est ainsi de son ressort tout dommage d’une certaine gravité par suite de l’infection, caractérisé par un taux d’APIPP supérieur à 25 % ou le décès du patient ; le texte gardant sous silence le sort des victimes par ricochet. Ces textes ne sont pas simples à articuler pour les praticiens, ni pour les magistrats.
Le présent arrêt réaffirme la solution visant à rejeter toute action dirigée contre un professionnel, ou une clinique, en l’absence de faute qui lui serait imputable. La responsabilité du professionnel de santé était tout d’abord totalement exclue du champ d’application de la compétence directe de l’Oniam pour les infections générant les plus graves dommages6, par le juge administratif depuis 20117, puis par le juge judiciaire depuis 2013. Ce n’est qu’en 2016 que ce dernier a permis à la victime d’agir – et le recours subrogatoire des tiers payeurs – à l’encontre d’un établissement de santé dès lors qu’une faute lui était imputable, assouplissant ainsi sa jurisprudence8. Avec un arrêt du 8 février 2017, les magistrats du quai de l’horloge convergent avec ceux du Palais royal9, par une politique des petits pas. C’était déjà avec quelques mois de retard sur le Conseil d’État10 qu’en 2011, la Cour de cassation s’était prononcée sur l’étendue de l’indemnisation des victimes par ricochet11. À ce titre, elles n’ont pas vocation à être indemnisées en cas de survie de la victime directe puisque la réparation porte uniquement sur les « préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants-droit »12.
L’articulation de ces dispositions devenait délicate avec celles de l’article L. 1142-1-1, ne donnant aucune précision sur la réparation des ayants-droit. Habituellement, les victimes par ricochet se voient ouvrir les portes de l’indemnisation dans le droit commun de la responsabilité, peu importe que la victime directe soit décédée ou non. Au contraire de cette interprétation large, le maintien d’une lecture stricte, par référence implicite à l’article L. 1142-1, II, aurait continué de fermer la voie indemnitaire, sous l’emprise de l’Oniam, des victimes par ricochet dans cette même situation, en leur refusant toute indemnisation de leur préjudice d’accompagnement. Pour cette raison, la doctrine est fortement légitime à conclure que « les deux textes relatifs à la compétence de l’Oniam en matière d’infections nosocomiales sont donc indépendants l’un de l’autre et obéissent à des conditions qui leur sont propres. Cette lecture, plus protectrice des victimes, permet d’harmoniser le traitement des proches du patient, que la réparation soit due par l’assureur du responsable ou par l’Oniam »13. Désormais, en application de l’article L. 1142-1-1 du CSP, les victimes par ricochet peuvent obtenir réparation de la part de l’Oniam.
Répartition possible entre le responsable et l’Oniam de l’indemnisation d’une perte de chance liée à un défaut de surveillance et de l’accident médical non fautif. Par arrêt du 22 novembre 2017, la Cour de cassation permet à un patient de bénéficier d’une réparation intégrale en lui accordant la possibilité de cumuler la compensation partielle qui lui a été octroyée à raison de l’aléa thérapeutique subi avec l’indemnisation relative à la perte de chance de réduire les conséquences dommageables de cet accident médical non fautif, générée par la faute de surveillance postopératoire de la clinique14. Par des motifs clairs, elle décide « qu’ayant ainsi mis en évidence la survenue d’un accident médical non fautif répondant aux conditions de gravité fixées par les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1 du CSP, dont la probabilité de réalisation était faible et dont les conséquences auraient été susceptibles d’être limitées en l’absence de faute, la cour d’appel a pu en déduire que la part des préjudices subis par M. X, non réparée sur le fondement de la perte de chance, devait être mise à la charge de la solidarité nationale » (1er moyen, 5e attendu).
b – Le fait générateur
Les exigences d’intensité et d’évidence de la faute caractérisée d’un gynécologue en présence d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse. Un arrêt du 5 juillet 2017 apporte quelques précisions sur la qualification d’une faute caractérisée15. La doctrine avait pu se risquer à la définir en proposant que « pourrait être qualifié de faute caractérisée tout acte ou omission constitutif d’un manquement d’une certaine gravité ou d’une évidence impardonnable, commis sans malignité ou conscience du danger de la part de son auteur »16. En l’espèce, une femme enceinte dont la grossesse était suivie par un gynécologue libéral a consenti, le 1er mars 2007, à la réalisation d’un prélèvement sanguin en vue de l’analyse des marqueurs sériques maternels et de l’évaluation du risque d’une anomalie chromosomique. L’examen a mis en évidence un risque égal à 1 sur 372 que l’enfant soit atteint d’une telle anomalie, le médecin s’étant borné à indiquer à la future mère que les résultats étaient bons. Mais l’enfant est né le 9 août 2007 en présentant une trisomie 21. Après l’échec de la procédure de règlement amiable, les parents ont assigné le praticien en responsabilité des préjudices subis à la suite de la naissance du dernier enfant, en invoquant l’existence de manquements du praticien à son obligation d’information sur le résultat de l’examen et d’une erreur dans l’interprétation de son résultat, ainsi que l’insuffisance des examens réalisés. La cour d’appel, en 2016, a relevé qu’il avait manqué à son obligation d’information sur les résultats de l’examen prescrit pendant la grossesse en se limitant à annoncer à la future mère qu’ils étaient bons. Les juges du fond ont néanmoins décidé que cette absence d’information ne pouvait s’analyser en une faute caractérisée. Rapport d’expertise à l’appui, ils ont retenu qu’une amniocentèse est proposée dans le cas d’un risque estimé à 1 sur 270, qu’il n’existait pas, dans le cas de la future mère, d’autres signes en faveur d’une trisomie 21 et que, même s’il avait été procédé à un calcul de risque intégré, celui-ci aurait donné un résultat inférieur à 1 sur 1 000. Par conséquent, ils ont considéré que si le praticien avait manqué à son obligation d’information sur les résultats de l’examen, il ne pouvait cependant lui être reproché de ne pas avoir proposé d’amniocentèse à l’intéressée. La haute juridiction rejette le pourvoi effectué par la mère, rappelant que la cour d’appel a énoncé, à bon droit, qu’était applicable à l’instance « l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles soumettant, en son alinéa 3, la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé à l’égard des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, à l’exigence d’une faute caractérisée, et qu’une telle faute devait répondre à des exigences d’intensité et d’évidence », conditions non réunies en l’espèce.
Dans une autre affaire, finalisée par un arrêt du 3 mai 2018, l’enfant était venu au monde atteint de trisomie 21 avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. L’application de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, transposant l’article 1er, I, de cette loi, a été écartée17. Après la naissance de leur enfant, les parents, non informés des résultats de l’analyse réalisée plusieurs mois auparavant qui concluaient à un risque accru de trisomie, ont assigné en réparation la gynécologue prescriptrice et le gynécologue-obstétricien sur le fondement de la perte de chance de solliciter une interruption volontaire de grossesse. En rejetant le pourvoi formé par les médecins condamnés au fond, la Cour de cassation a reconnu, primo, la carence fautive de la gynécologue ayant prescrit le dépistage prénatal qui ne pouvait prétendre son impossibilité d’accéder aux résultats, secundo, celle du gynécologue-obstétricien qui ne pouvait se contenter de l’absence de réponse au test pour fonder son diagnostic et qui aurait dû en vérifier le résultat. En définitive, « le médecin prescripteur d’une analyse biologique ou génétique doit s’assurer personnellement de son résultat. Sous l’empire de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, outre l’exclusion de l’indemnisation du préjudice de vie et la limitation des préjudices réparables, une faute caractérisée des gynécologues aurait dû être démontrée »18, avec les exigences d’intensité et d’évidence confirmées par un arrêt du 5 juillet 2017.
La prise en compte d’avis émis après l’acte médical pour apprécier l’existence de la faute du gynécologue-obstétricien. Par un arrêt du 5 avril 201819, la haute juridiction retient, à propos des suites d’un accouchement difficile, et au visa de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du CSP, qu’« un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et qu’il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés »20. Jusqu’à présent, la jurisprudence entendait que l’appréciation de la conformité des soins se fasse au regard des données acquises de la science à la date des soins21. La Cour de cassation ouvre désormais aux juges du fond, pour cette appréciation du comportement fautif de l’obstétricien, la possibilité « de se référer à des données apparues postérieurement au jour où les soins ont été pratiqués »22.
Les conditions de la défectuosité d’un contraceptif. La Cour de cassation a pris, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux insérée aux articles 1245 et suivants du Code civil, une décision favorable aux victimes, dans un arrêt du 26 septembre 201823. Par suite de l’absorption d’une pilule contraceptive, selon l’expertise, une jeune femme est décédée d’une embolie pulmonaire. La première chambre civile a censuré l’arrêt d’appel ayant mis hors de cause le producteur en retenant que « le contraceptif ne peut être considéré comme défectueux, dès lors que la notice l’accompagnant comporte une mise en garde contre le risque thromboembolique et l’évolution possible vers une embolie pulmonaire ». La haute juridiction a ainsi jugé « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant les mentions figurant dans la notice, la gravité du risque thromboembolique encouru et la fréquence de sa réalisation excédaient les bénéfices attendus du contraceptif en cause et si, par suite, les effets nocifs constatés n’étaient pas de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l’article 1245-3 du Code civil, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »24. Participent au faisceau d’indices permettant de retenir la défectuosité d’un produit, en l’espèce un contraceptif féminin, non seulement la gravité du risque encouru, mais encore la fréquence de sa réalisation. Les juges du fond ne peuvent se contenter de l’existence des seules mentions relatives au risque encouru figurant dans la notice. La doctrine convient donc que « le fait que le producteur, à travers la notice, précise que le produit est potentiellement défectueux n’enlève en rien à sa défectuosité »25.
c – Le lien de causalité
L’article 1239 du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 retient que « la responsabilité suppose l’existence d’un lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage. Le lien de causalité s’établit par tout moyen ». Le législateur aurait déjà pris un certain retard en n’ayant pas pris acte des difficultés générées par certains contentieux lors de la rédaction du projet. À l’écriture de l’alinéa 2 de l’article 1239, il ne s’est aucunement préoccupé, par exemple, de la place de la certitude scientifique dans l’administration de la preuve26. Par ailleurs, en présence d’une pluralité de responsables, les articles 1240 et 1265 du projet sont à lire de concert.
L’apport de la CJUE dans la preuve de la causalité en présence d’une incertitude scientifique. Par un arrêt du 21 juin 2017, la CJUE a admis la preuve par présomptions du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de la sclérose en plaques. La causalité peut être désormais caractérisée à l’aide de la réunion de plusieurs indices. Deviennent ainsi des éléments probants suffisants, en dépit de toute certitude scientifique, la conjonction, d’une part, de la proximité temporelle entre vaccination et déclenchement de la maladie en l’absence d’antécédents médicaux et, d’autre part, de l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations27. En 2003, la Cour de cassation avait refusé que les victimes puissent prouver le lien de causalité entre l’administration de ce vaccin et la survenance postérieure de la maladie28. À l’instar du juge administratif29, par un revirement, elle a admis en 2008, à titre de principe, la preuve du lien causal par des présomptions graves, précises et concordantes30, tout en reléguant l’appréciation des éléments de preuve au pouvoir souverain des juges du fond31, ce qui fut source de divergences dans l’interprétation de l’article 4 de la directive du 25 juillet 1985 et donc de disparité des solutions devant les différentes cours d’appel. Pour y mettre fin, la Cour de cassation a donc été amenée à poser deux questions préjudicielles à la CJUE32, laquelle a livré une leçon importante, une contribution substantielle33 même, en matière de causalité34.
Primo, sur le fondement des principes de l’autonomie procédurale des États concernant les modalités d’administration de la preuve et d’effectivité des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union – car l’exigence d’une preuve certaine provenant de la recherche médicale pourrait rendre « impossible la mise en cause de la responsabilité du producteur »35 –, la CJUE a retenu que l’article 4, ayant trait à la seule charge de la preuve, « ne s’oppose pas à un régime probatoire national » où le lien de causalité entre la vaccination et la maladie ainsi que la défectuosité du vaccin pourront désormais être établis par un système de preuve indiciaire. La CJUE emprunte ainsi le même cheminement que la Cour de cassation. Mais elle ne permet pas l’adoption d’un système de présomption de droit pour établir ce lien causal, s’éloignant alors de la solution simplificatrice et facilitatrice pour les victimes et retenue en 2007 par le Conseil d’État dès que le patient est soumis à un vaccin obligatoire. Les indices prédominants de la causalité sont ainsi mis en exergue par la CJUE, en particulier les éléments « liés à la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie ainsi qu’à l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec cette maladie, de même que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations, paraissent a priori constituer des indices dont la conjonction pourrait, le cas échéant, conduire une juridiction nationale à considérer qu’une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle en vertu de l’article 4 de la directive n° 85/374 »36. La doctrine relève ainsi que la CJUE confirme les indices déjà employés par les juridictions françaises tout en en rajoutant un nouveau qui sera utile dans l’action de groupe désormais ouverte aux dommages consécutifs à des produits de santé, « celui de la multiplicité des cas identiques »37.
Secundo, si la CJUE admet les présomptions de fait, elle n’accueille pas favorablement la présomption de droit qui permet pourtant de transférer le risque de l’incertitude sur les fabricants du vaccin tout en améliorant le droit à indemnisation des victimes38. La Cour entend ainsi ne pas dénaturer la répartition de la charge de la preuve telle qu’établie par l’article 4 puisqu’avec un régime probatoire assis sur des présomptions « l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis »39.
En définitive, si la victime doit rapporter la preuve du lien de causalité et qu’« il ne peut y avoir inversion de la charge de la preuve »40, les présomptions de fait restent admises, mais il n’y a pas d’automaticité du lien de causalité dès lors que les indices – la proximité temporelle, l’absence d’antécédents, la multiplicité des cas identiques – sont présents41. La CJUE a donc donné un bel élan aux juridictions nationales et à la Cour de cassation en particulier, pour mettre fin aux distorsions entre les deux ordres de juridiction42, l’invitant ainsi à reprendre le contrôle de la qualification du lien de causalité, à tout le moins de sa motivation. Certes, les magistrats du quai de l’Horloge ne sont pas totalement guidés dans la méthode pour la solution de ce contentieux embarrassant43. Ils devront donc affiner les critères, par exemple en s’appuyant sur certains modèles de droit comparé qui quantifient l’incertitude et retiennent à cet effet « pour établi, en l’absence de certitude, ce qui paraît plus probable qu’improbable, ou probable à un degré suffisant »44. Puisque la causalité scientifique et ses enchaînements logiques sont relégués au second plan, la causalité juridique gagne son autonomie, ce qui est le plus à même de servir l’équité45, d’autant que la solution concerne le droit de la responsabilité dans son ensemble46.
Vaccin contre l’hépatite B et maintien de l’appréciation souveraine des juges du fond en droit interne sur le défaut et le lien de causalité. L’arrêt analysé ci-dessus de la CJUE du 21 juin 201747 ayant affirmé que la directive n° 85/374/CEE48 n’interdisait pas à un système national admettant la preuve du lien entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques par un faisceau d’indices graves, précis et concordants mais s’opposait à l’établissement d’une liste d’indices factuels dont la conjonction serait systématiquement nécessaire et suffisante pour prouver ce lien, prend sa suite procédurale immédiate en droit interne français dans trois arrêts rendus le 18 octobre et le 20 décembre 2017 par la Cour de cassation49. Celle-ci n’a pas saisi la perche qui lui était tendue par la CJUE, en maintenant les juges du fond dans leur pouvoir d’appréciation souveraine, laquelle reste donc décisive dans l’établissement du défaut de sécurité du vaccin, au sens de la directive, comme du lien de causalité entre celui-ci et le dommage, en l’espèce la sclérose en plaques. La haute juridiction a ainsi rejeté le pourvoi des victimes alléguant le caractère défectueux du vaccin contre l’hépatite B et son lien éventuel avec la maladie en cause. En d’autres termes, elle écarte la responsabilité des fabricants de vaccin. La Cour de cassation adopte une motivation assez vague dans le premier arrêt50 et confirme, dans le deuxième, que « la concomitance entre la vaccination et l’apparition de la maladie comme l’absence d’antécédents neurologiques personnels et familiaux, prises ensemble ou isolément, ne constituaient pas de telles présomptions permettant de retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccins administrés et la maladie »51. Elle n’a donc pas sauté le pas comme elle a pu le faire le 20 septembre 2017 pour l’affaire dite du Médiator où la réunion des éléments factuels et probants paraît, certes, avoir atteint un degré plus élevé (cf. infra). La doctrine salue néanmoins le progrès dans l’analyse probatoire du défaut mais regrette qu’« en prescrivant aux juges du fond d’apprécier si les éléments de preuve ayant servi à établir le lien de causalité permettent de prouver le caractère défectueux du vaccin, la Cour de cassation continue à entretenir une regrettable confusion entre la preuve de la causalité et celle de la défectuosité. Rechignant ainsi à analyser le défaut du vaccin en lui-même, elle est encore loin de lui donner sa pleine autonomie »52. Dans le troisième arrêt, une patiente avait reçu, en 1994, plusieurs injections du vaccin contre l’hépatite B, puis un rappel, le 7 février 1997. Le même mois, elle a présenté des troubles conduisant au diagnostic de la sclérose en plaques. Imputant cette pathologie au vaccin, la patiente alors mineure, et sa mère, ont assigné le fabricant en réparation du préjudice subi. La Cour de cassation a écarté à nouveau, le 20 décembre 2017, la responsabilité du producteur, jugeant que la cour d’appel « a estimé souverainement que l’absence de facteur de risque personnel et familial et d’éventuelles autres causes de la maladie chez Mme X, la rareté de la survenance de la sclérose en plaques chez l’enfant et le critère de la proximité temporelle entre l’apparition des premiers symptômes et la vaccination de l’intéressée ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes, de sorte que l’imputabilité de la survenance de la sclérose en plaques dont celle-ci était atteinte à la vaccination n’était pas établie »53. Enfin, par un riche arrêt en date du 14 novembre 2018, la première chambre civile a censuré partiellement l’arrêt d’appel ayant retenu un manquement du pédiatre de nature à engager sa responsabilité alors qu’il relevait parallèlement l’absence de preuve d’une imputabilité de la maladie – ici une forme rare de leucodystrophie touchant les enfants – à l’injection du vaccin contre l’hépatite B et de lien entre le défaut d’information et la survenance du dommage54. La haute juridiction décide que « c’est donc à tort que la juridiction du fond a retenu qu’indépendamment de toute réalisation d’un risque, la violation du droit à l’information du patient et de ses parents justifie une réparation, même en l’absence de dommages corporels causés par l’intervention du médecin. Sans lien de cause à effet, le manquement au devoir d’information en tant que fait générateur ne permet pas d’engager la responsabilité (…). À bien y regarder, en l’espèce, pour la survenance du syndrome et la perte de chance dont il est demandé réparation, ce n’est pas l’existence des dommages ni celle des faits générateurs qui pose problème mais bien celle du lien de causalité entre les deux »55.
Le Mediator et les présomptions graves, précises et concordantes. La Cour de cassation, par un arrêt du 20 septembre 201756, remet l’affaire dite du Mediator en pleine lumière en consacrant la responsabilité du laboratoire Servier et en reconnaissant l’existence de présomptions graves, précises et concordantes de nature à apporter la preuve d’un lien de causalité entre la prise du médicament incriminé et une insuffisance aortique. Le producteur a épuisé nombre de stratégies procédurales pour échapper à la condamnation, jusqu’en cassation. L’approche assouplie de la preuve du lien de causalité, devenue classique dans le contentieux de la vaccination contre l’hépatite B à compter de 200857, a dernièrement été validée par la CJUE58. La Cour de cassation accueille ainsi dans « une hypothèse nouvelle»59 la conception assouplie de la preuve du lien de causalité entre le défaut d’un produit ou médicament – d’une nature différente d’un vaccin – et le dommage, délaissant ainsi son exigence sévère d’une preuve scientifiquement avérée pour reconnaître la responsabilité du fabricant60. La maladie contractée par la patiente n’étant en quelque sorte pas imputable à une autre cause connue parmi les indices relevés par les juges, elle est considérée comme étant imputable au Mediator, ce qui facilite l’indemnisation des patients. Plus de 20 ans après la CJUE61, la haute juridiction s’est ensuite prononcée, pour la première fois et de manière restrictive, sur le texte confus relatif à l’exonération pour risque de développement, en jugeant que « le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu’il ne prouve, selon le 4° de l’article 1386-11, devenu 1245-10 du Code civil, que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ». Elle a encore précisé que « la date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie », par référence, selon l’avocat général, au « produit même qui a causé le dommage » (C. civ., art. 1245-15)62. La notion de « mise en circulation » serait donc à géométrie variable, selon le contexte de chacune des dispositions dans laquelle elle s’insère et afin d’en garantir la mise en œuvre de manière efficiente. En l’espèce, aucune exonération de responsabilité ne pouvait être retenue. L’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés à cette patiente entre 2006 et 2009, permettait de déceler l’existence du défaut du Mediator. Le risque y relatif était déjà expressément dénoncé et mis en évidence par des études internationales ayant conduit au retrait du médicament en Suisse en 1998, puis à sa mise sous surveillance dans d’autres pays européens et à son retrait en 2003 en Espagne, puis en Italie. Dans un autre arrêt rendu le 22 novembre 2017 – le patient s’était vu prescrire du Mediator entre 2003 et 2009 et avait présenté en 2009 une insuffisance mitrale ayant conduit à la pose d’une prothèse mécanique en 2011 – la Cour de cassation a réitéré son refus d’accorder l’exonération63. Ces décisions anticipent ainsi le projet de réforme de la responsabilité qui envisage, en matière de produits de santé à usage humain, d’anéantir la faculté d’exonération pour risque de développement.
Infection nosocomiale et lien de causalité avec ses suites dommageables indirectes. Par un arrêt du 6 juin 2018 rendu à la suite du pourvoi d’un patient ayant contracté, lors d’une intervention chirurgicale, une infection nosocomiale, lequel a été ensuite traité par antibiotique puis atteint de divers troubles, la première chambre civile a dû se prononcer sur l’engagement de la responsabilité du centre chirurgical64. Le dommage, n’étant pas lié directement à l’infection nosocomiale mais de manière plus immédiate au défaut de contrôle du traitement antibiotique, rendait plus difficile l’approche de la causalité. Au visa de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du CSP retenant la responsabilité de plein droit des établissements médicaux pour les dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils établissent une cause étrangère, la Cour de cassation a jugé que « la mise en œuvre du traitement antibiotique à l’origine des troubles avait été rendue nécessaire par la survenue de l’infection nosocomiale dont le centre chirurgical est tenu de réparer l’ensemble des conséquences, au titre de sa responsabilité de plein droit, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l’égard des praticiens et de l’hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection »65. À cet effet, elle précise que « certes, les troubles trouvent leur origine de la prise d’un traitement antibiotique, mais que celle-ci a été rendue nécessaire, en amont, par l’infection nosocomiale contractée au sein des locaux du centre chirurgical. L’infection nosocomiale apparaît alors comme une cause à l’origine du fait dommageable dont résulte le dommage (…). Ce qu’on impute au centre chirurgical, c’est bien l’infection en tant que cause du traitement dont le défaut de contrôle est à l’origine des troubles. Il n’y a donc, pour la haute juridiction, qu’un seul et même dommage dont l’origine se trouve à la fois dans la survenue de l’infection nosocomiale et dans l’absence de contrôle du traitement antibiotique. Sans le dire explicitement, la Cour de cassation semble faire ici application de la théorie de l’équivalence des conditions. Elle retient, en tout cas, une conception souple du lien de causalité »66.
d – Le préjudice
e – Les causes d’exonération de la responsabilité civile médicale
f – L’assurance de responsabilité civile médicale
C – Responsabilité pénale : panorama jurisprudentiel
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-16890 : Bull. civ. I, n° 124 ; Revue Droit & Santé 2017, n° 79, p. 675, note Véron P. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 338, note Girer M.
-
2.
Tunc A., « Vis Responsabilité civile », 2018, Encyclopædia Universalis : « Des lois de 1972 et 1973 ont instauré un système qui apporte au problème des accidents corporels une réponse globale. Un organisme – l’Accident Compensation Commission, légèrement réorganisé en 1981 et devenu l’Accident Compensation Corporation – reçoit la triple mission de promouvoir la prévention des accidents, d’assurer l’indemnisation des victimes et de permettre ainsi leur rééducation personnelle et professionnelle. D’autre part, la protection accordée aux victimes est indépendante de la source de leur dommage : “à dommage égal, indemnités égales”. Tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont donc couverts de tous les dommages corporels accidentels et des maladies professionnelles. Mais sont couvertes de la même manière les victimes d’accidents de la circulation, d’accidents médicaux, chirurgicaux ou dentaires et d’accidents divers (chute d’un arbre, etc.). L’indemnisation comporte le remboursement intégral des frais médicaux et autres occasionnés par l’accident, la compensation à 80 p. 100 du revenu perdu, et une indemnité pour le dommage physiologique subi par la victime. L’action en responsabilité civile pour dommage corporel est entièrement éliminée. Ce système fonctionne à la satisfaction générale. Il constitue la seule réponse rationnelle au problème des accidents. Le bilan de l’expérience est nettement positif ».
-
3.
Knetsch J., Le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation. Analyse en droits français et allemand, thèse, Lequette Y. et Katzenmeier C. (dir.), 2011, universités Panthéon-Assas et Cologne, n° 627, in fine.
-
4.
Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 15-19716 : JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, comm. 114, note Bloch L. ; Bacache M., « Infection nosocomiale : entre responsabilité et solidarité nationale », JCP G 2017, doctr. 1174 ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 335, note Girer M.
-
5.
Cet arrêt évoque aussi la faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son dommage.
-
6.
Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-20433 ; Cass. 1re civ., 9 avr. 2014, n° 13-16165.
-
7.
CE, 21 mars 2011, n° 334501.
-
8.
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-16117.
-
9.
CE, 9 déc. 2016, n° 39-0892.
-
10.
CE, 30 mars 2011, n° 32-7669.
-
11.
Cass. 1re civ., 13 sept. 2011, n° 11-12536, inédit.
-
12.
CSP, art. L. 1142-1, II.
-
13.
Bacache M., « Infection nosocomiale : entre responsabilité et solidarité nationale », JCP G 2017, doctr. 1174 in fine ; Dans le même sens, RGDM n° 66, mars 2018, p. 336, note Girer M.
-
14.
Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-24769, inédit : RGDM n° 66, mars 2018, p. 348, note Girer M.
-
15.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21147, inédit : JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, comm. 281.
-
16.
Morlet L., « La faute caractérisée en droit de la responsabilité civile », in Responsabilité civile et assurances. Études offertes à Hubert Groutel, 2006, LexisNexis, p. 291 et s., spéc. p. 312, n° 50.
-
17.
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-27506 : Bull. civ. I, n° 443.
-
18.
Douville T., « Analyse biologique ou génétique : le médecin prescripteur ne peut se contenter du silence du laboratoire », LEDA juin 2018, n° 111f4, p. 2 ; Comp. Hacene A., « Enfant né handicapé : obligation pour le médecin de demander les résultats des tests prescrits », Dalloz actualité, 22 mai 2018 : « S’il n’est pas question ici de faute caractérisée dans la mesure où l’article L. 114-5 précité qui l’exige n’est pas applicable, il n’en demeure pas moins que les fautes imputables aux médecins dépassent clairement “la marge d’erreur habituelle d’appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal”. Bien que le protocole entre laboratoires et médecins prévoyait que seuls les résultats démontrant un risque seraient transmis, on comprend la sévérité des juges face à deux professionnels restés totalement passifs quant à toute vérification concrète d’un éventuel risque de trisomie 21. L’inexécution de ces obligations est à l’origine du préjudice de perte d’une chance pour les parents d’avoir pu exercer librement leur choix de garder ou non cet enfant ».
-
19.
V. supra, dans cette chronique, le commentaire de cette décision par Audrey Margraff.
-
20.
Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-15620 : Bull. civ. I, n° 389.
-
21.
Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 98-19295 : Bull. civ. I, n° 176 ; RDSS 2000, p. 730, obs. Dubouis L.
-
22.
Hacene A., « Responsabilité du praticien : conformité de l’acte médical aux recommandations émises postérieurement », Dalloz actualité, 15 mai 2018.
-
23.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-21271 : Bull. civ. I, n° 866.
-
24.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-21271 : Bull. civ. I, n° 866.
-
25.
Hacene A., « Produits défectueux : insuffisance de la prise en compte des seules mentions figurant dans la notice », Dalloz actualité, 24 oct. 2018.
-
26.
Brun P. et Quézel-Ambrunaz C., « Preuve de la causalité et incertitude scientifique : la contribution substantielle de la CJUE », RLDC 2017/151, n° 6339, p. 21 et s., spéc. p. 25.
-
27.
CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15, Cts WW c/ Sanofi-Pasteur, pt 41 : Viney G., « La preuve du lien entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques », JCP G 2017, 908 ; D. 2017, p. 1807, note Borghetti J.-S. ; JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, focus 19, note Bloch L. ; JCP E 2017, 1419, note Grynbaum L.
-
28.
Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13063 : Bull. civ. I, n° 188.
-
29.
CE, 9 mars 2007, n° 267635.
-
30.
Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-20317 : Brun P. et Quézel-Ambrunaz C., « Vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaques : ombres et lumières sur une jurisprudence instable », RLDC 2008/52, n° 3102 ; Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 08-12781 ; Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-21314.
-
31.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-11073 : Bull. civ. I, n° 176 ; JCP G 2009, 308 ; RTD civ. 2009, p. 735, obs. Jourdain P. ; Gaz. Pal. 24 nov. 2009, n° H5422, p. 47, note Grynbaum L. ; Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-16097 ; Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 09-16556 : JCl. Responsabilité civile et Assurances 2011, comm. 24 ; JCP G 2011, 79, note Borghetti J.-S. ; RTD civ. 2011, p. 134, obs. Jourdain P.
-
32.
Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-18118.
-
33.
Brun P. et Quézel-Ambrunaz C., « Preuve de la causalité et incertitude scientifique : la contribution substantielle de la CJUE », RLDC 2017/151, n° 6339, p. 21 et s., spéc. p. 25.
-
34.
Bacache M., « Causalité scientifique et juridique : la réponse de la Cour de justice », JCP G 2017, doctr. 1174 ; Jeauneau A., « Vaccination contre l’hépatite B : la Cour de justice livre sa conception de l’articulation de la science et du droit », LPA 5 janv. 2018, n° 130q4, p. 11.
-
35.
CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15, pt 31.
-
36.
CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15, pt 41.
-
37.
Bacache M., « Causalité scientifique et juridique : la réponse de la Cour de justice », JCP G 2017, doctr. 1174.
-
38.
D. 2012, p. 112, note Radé C. ; RLDC 2004/1, p. 13, note Hocquet-Berg S. ; Contra Bacache M., « Causalité scientifique et juridique : la réponse de la Cour de justice », JCP G 2017, doctr. 1174.
-
39.
CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15, pt 52.
-
40.
Grynbaum L., « Épilogue sur la preuve de la causalité par présomptions en matière de vaccination contre l’hépatite B : la causalité juridique consacrée par la Cour de justice », JCP E 2017, 1419.
-
41.
Grynbaum L., « Épilogue sur la preuve de la causalité par présomptions en matière de vaccination contre l’hépatite B : la causalité juridique consacrée par la Cour de justice », JCP E 2017, 1419.
-
42.
CE, 5 mai 2010, n° 324895 ; CE, 9 févr. 2011, n° 319497 ; CE, 5 nov. 2014, n° 363036.
-
43.
Viney G., « La preuve du lien entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques », JCP G 2017, 908.
-
44.
Brun P. et Quézel-Ambrunaz C., « Preuve de la causalité et incertitude scientifique : la contribution substantielle de la CJUE », RLDC 2017/151, n° 6339, p. 26, in fine : « Le juge est libre, dans l’appréciation de la preuve du lien de causalité, désespérément libre ; pour le dire dans des termes plus exacts, la liberté de son raisonnement tendant à la reconnaissance d’un lien de causalité n’est pas bridée par l’absence de certitude scientifique ».
-
45.
Leduc F., « Le lien de causalité », JCl. Responsabilité civile et Assurances 2016, dossier 11 ; Dans le même sens, Bacache M., « Causalité scientifique et juridique : la réponse de la Cour de justice », JCP G 2017, doctr. 1174 : « il est légitime et juste de ne pas faire peser sur les seules victimes potentielles les risques de l’incertitude relative à l’innocuité du produit dont le fabricant tire profits ». Contra D. 2017, p. 1807, note Borghetti J.-S.
-
46.
Viney G., « La preuve du lien entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques », JCP G 2017, 908.
-
47.
CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15, Cts WW c/ Sanofi-Pasteur.
-
48.
Dir. n° 85/374/CEE, 25 juill. 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux : JOCE L 210, 7 août 1985, p. 29.
-
49.
Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 14-18118, Sté MSD vaccins ; Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 15-20791, T. c/ Sté Sanofi Pasteur Europe : « Vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques : la Cour de cassation rejette l’action des victimes », JCP E 2017, act. 774 ; RDSS 2017, p. 1140, note Peigné J. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 344, note Girer M. – Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 15-12882, inédit : RGDM n° 66, mars 2018, p. 350, note Girer M. – Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-11267, inédit : RGDM n° 66, mars 2018, p. 350, note Girer M.
-
50.
Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 15-20791, T. c/ Sté Sanofi Pasteur Europe : « Vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques : la Cour de cassation rejette l’action des victimes », JCP E 2017, act. 774 ; RDSS 2017, p. 1140, note Peigné J. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 344, note Girer M.
-
51.
Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 14-18118, Sté MSD vaccins.
-
52.
Jourdain P., « Vaccination contre l’hépatite B : la Cour de cassation écarte la responsabilité des fabricants », RTD civ. 2018, p. 140.
-
53.
Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 15-12882, inédit : RGDM n° 66, mars 2018, p. 350, note Girer M. – Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-11267, inédit : RGDM n° 66, mars 2018, p. 350, note Girer M.
-
54.
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, nos 17-27980 et 17-28529 : Dalloz actualité, 11 déc. 2018, obs. Hacene A.et Kebir M.
-
55.
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, nos 17-27980 et 17-28529 : Dalloz actualité, 11 déc. 2018, obs. Hacene A.et Kebir M.
-
56.
Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19643 : Bull. civ. I, n° 972 ; JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, comm. 280 ; JCl. Responsabilité civile et Assurances 2017, étude 12, note Bloch L. ; Viney G., « Le Mediator et l’exonération de responsabilité pour risque de développement », D. 2017, p. 2284 et s. ; RDSS 2017, p. 1132, note Peigné J. ; RGDM n° 66, mars 2018, p. 340, note Girer M.
-
57.
Elle avait admis en 2008, à titre de principe et sous forme d’un revirement, la preuve du lien causal par des présomptions graves, précises et concordantes (cf. supra) : Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-20317 : Brun P. et Quézel-Ambrunaz C., « Vaccination contre l’hépatite B et sclérose en plaques : ombres et lumières sur une jurisprudence instable », RLDC 2008/52, n° 3102 ; Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 08-12781 ; Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-21314.
-
58.
CJUE, 21 juin 2017, n° C-621/15 : D. 2017, p. 1807, note Borghetti J.-S.
-
59.
Viney G., « Le Mediator et l’exonération de responsabilité pour risque de développement », D. 2017, p. 2284 et s., spéc. p. 2286.
-
60.
Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13063 : Bull. civ. I, n° 188 ; D. 2004, p. 898, note Serinet Y.-M. et Mislawski R. ; D. 2004, p. 1344, obs. Mazeaud D. ; D. 2003, p. 2579, chron. Neyret L. ; RTD civ. 2004, p. 101, obs. Jourdain P.
-
61.
CJCE, 29 mai 1997, n° C-300/95, Commission des Communautés européennes c/ Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord : D. 1998, p. 488, note Penneau A.
-
62.
Extrait de l’avis de l’avocat général Sudre J.-P., D. 2017, p. 2280.
-
63.
Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, nos 16-23804 et 16-24719 : RGDM n° 66, mars 2018, p. 349, note Girer M.
-
64.
Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, nos 16-23804 et 16-24719 : RGDM n° 66, mars 2018, p. 349, note Girer M.
-
65.
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-18913 : Bull. civ. I, n° 560.
-
66.
Hacene A., « Infection nosocomiale, cause du traitement dont la mise en œuvre est à l’origine du préjudice », Dalloz actualité, 23 juill. 2018.