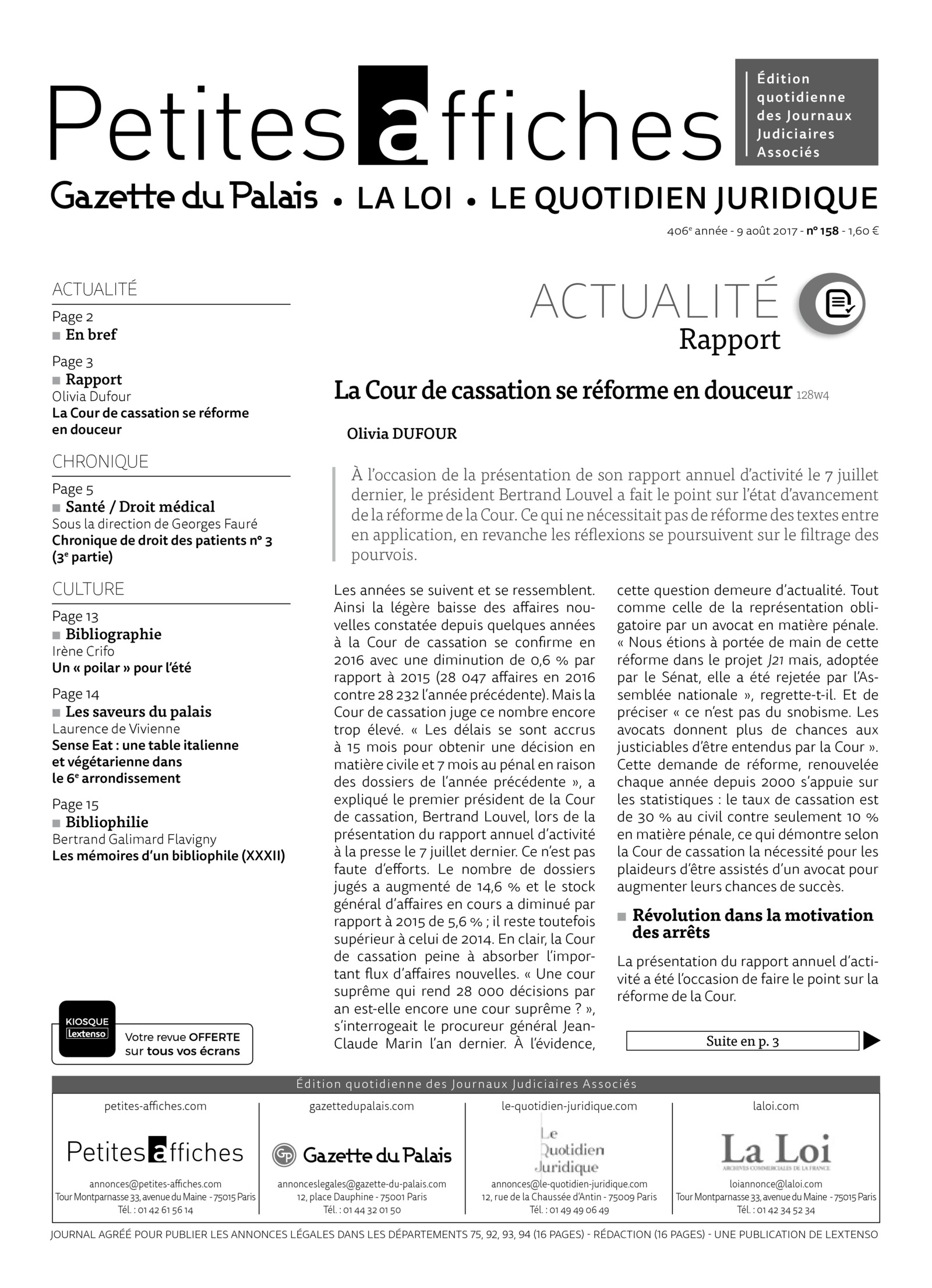Chronique de droit des patients n° 3 (3e partie)
I – Droit des « personnes patientes »
II – Expertise et droit des patients
III – Responsabilité et droit des patients
3. Responsabilité pénale : panorama législatif et jurisprudentiel
L’année 2016 a été marquée par quelques lois ainsi que des décisions importantes concernant le droit pénal des patients, qu’il s’agisse de la Cour européenne des droits de l’Homme, de la chambre criminelle et même des juridictions de fond.
La peine incompressible d’un détenu atteint d’un trouble mental
La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle que tout détenu doit pouvoir bénéficier d’une possibilité effective de pouvoir être libéré. L’existence d’une peine incompressible constitue donc une violation de l’article 3 de la Convention1.
En l’occurrence, le requérant se trouvait dans une situation où, en raison du risque de récidive qu’il présentait, il était réputé ne pouvoir bénéficier ni d’un élargissement, ni d’une libération conditionnelle. Toutefois, aucune évaluation de ses besoins thérapeutiques et des possibilités de traitement existantes n’avait été menée. Plus encore, aucune forme de traitement susceptible de faciliter sa réinsertion ne lui avait été proposée. Ces phénomènes combinés conduisaient à une persistance du risque de récidive. En effet, l’administration d’un traitement au requérant constituait, en pratique, une condition préalable à la possibilité pour lui de progresser sur la voie de l’amendement et de réduire son risque de récidive. Le requérant avait sollicité à plusieurs reprises une grâce et était finalement sorti pour décéder du cancer dont il était atteint, dans sa famille.
La Cour rappelle que les États disposent, s’agissant de la façon dont une peine perpétuelle doit pouvoir prendre fin d’une large marge d’appréciation (§ 110). La Cour procède, comme elle l’a déjà fait précédemment, également, à une analyse afin de vérifier que la peine est non effectivement compressible2.
Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour a estimé que la peine perpétuelle n’était donc pas de facto compressible même si de jure le détenu aurait pu bénéficier plus tôt d’une grâce.
L’application rétroactive de la détention de sûreté
L’arrêt de la Cour européenne du 7 janvier 2016 concernant la détention de sûreté en Allemagne a l’apparence d’un revirement en ce qu’il admet l’application rétroactive de cette mesure3. En effet, la Cour européenne des droits de l’Homme avait statué en sens inverse il y a quelques années 4. Dans cette dernière décision ainsi que dans d’autres5, la Cour avait considéré que cette mesure constituait une peine au sens de l’article 7 de la Convention et sachant qu’elle était à la fois nouvelle et plus sévère, elle ne pouvait donc pas rétroagir.
En l’occurrence, le requérant, condamné plusieurs fois pour des infractions violentes et sexuelles, a été placé en rétention de sûreté une fois sa peine d’emprisonnement purgée, en raison d’une déviance sexuelle et de troubles de la personnalité mis à jour par une expertise médicale. Sa détention a été prolongée à plusieurs reprises. Toutefois, un examen plus poussé du droit positif allemand permet de constater que la dernière prolongation résultait de la nouvelle forme de détention de sûreté instaurée par une loi du 5 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er juin 2013 et votée à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 4 mai 2011 ayant déclaré inconstitutionnel l’ancien dispositif. En vertu du dispositif nouveau, le détenu est placé dans un centre spécifique où il reçoit un traitement complet destiné à soigner son trouble mental. Cette solution est donc spécifique à l’Allemagne et ne constitue donc pas un revirement puisque les circonstances de droit ont évolué.
S’agissant de la France, longtemps un parallèle a été fait entre la détention de sûreté allemande et la rétention de sûreté. Or le législateur semble avoir renoncé à modifier ou supprimer la détention de sûreté alors même que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a indiqué à deux reprises les difficultés liées à ce dispositif dont le caractère curatif est loin d’être établi6.
La lutte contre l’anorexie mentale
Le droit pénal participe à la lutte contre l’anorexie mentale (articles 19 et 20 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé).
Les dispositions nouvelles incriminent les agences et les entreprises qui exposent, emploient ou réclament des mannequins filiformes.
Ainsi, l’article L. 2133-2 du Code de la santé publique interdit de retoucher la photographie d’un mannequin afin d’affiner ou d’épaissir sa silhouette sans mentionner cette falsification. Le non-respect du présent article est puni de 37 500 € d’amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité. Faire varier la peine en fonction de la dépense consacrée à la publicité est judicieux et aura certainement un effet dissuasif.
Les articles L. 7123-2-1 et L. 7123-27 du Code du travail incriminent quant à eux l’emploi d’un mannequin qui ne possède pas un certificat médical attestant d’un état de santé compatible avec l’exercice de son métier. Ce certificat est établi notamment au regard de l’indice de masse corporelle. Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s’assurant, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, de ne pas respecter cette obligation est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Le texte instaure donc une discrimination légale à l’embauche fondée sur l’apparence. Il s’agit d’une cause d’irresponsabilité pénale instaurée par la loi7 qui impose de commettre dans une telle hypothèse l’infraction de discrimination8. Bien évidemment, le texte ne se cantonne pas au seul recours au droit pénal et contient d’autres dispositions afin de lutter contre le fléau de l’extrême minceur, souvent présentée dans la société actuelle, comme un gage de beauté.
En revanche, le législateur a renoncé à incriminer l’apologie ou la provocation à l’anorexie ou la provocation à la maigreur excessive malgré un amendement (n° 1052) déposé en ce sens. Un tel délit aurait permis de lutter contre les articles ou blogs pro ana qui influencent une partie de la jeunesse. Adopté par l’Assemblée nationale, cet amendement a finalement été rejeté par le Sénat. En effet, les sites et blogs en question permettraient aux anorexiques de s’exprimer et d’échanger. Pénaliser ces échanges les auraient davantage enfermés dans leur maladie… L’argument paraît fort peu convaincant, mais il est vrai que l’effectivité d’une telle incrimination aurait été délicate compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible d’accéder à des sites ou des blogs étrangers soumis à une réglementation admettant de telles pratiques.
Les salles de « shoot »
Les salles de « shoot » ont été légalisées, à titre expérimental, par l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Elles sont instaurées à partir des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411-8 L. 3411-9 du Code de la santé publique, désignés par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné. Est désormais ouverte, dans des locaux distincts de ceux habituellement utilisés dans le cadre des autres missions, « une salle de consommation à moindre risque, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la Santé ».
Ces espaces sont destinés à accueillir des usagers majeurs de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques.
Le texte crée deux types de causes d’irresponsabilité pénale fondées sur l’autorisation de la loi9.
Ainsi, dans ces espaces, les usagers sont autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées dans un cahier des charges. La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une salle de consommation à moindre risque ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants.
Plus encore, le professionnel intervenant à l’intérieur de la salle de consommation à moindre risque et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l’usage illicite de stupéfiants.
Une évaluation du dispositif est mise en place à partir de rapports établis annuellement. L’expérimentation aura une durée maximale de six ans.
Appréciation du péril en cas de non-assistance à personne en danger
La Cour de cassation rappelle que la conscience du péril s’apprécie concrètement pour déterminer les conditions de l’infraction de non-assistance à personne en danger10.
En l’occurrence, le témoin assisté a averti les sapeurs-pompiers pour qu’ils portent secours au compagnon de sa mère, qui, transporté à l’hôpital, est décédé des suites de lésions évoquant un accident vasculaire cérébral, dans un contexte d’altération de l’état général et de dénutrition. Il a été reproché au témoin assisté d’avoir déclenché tardivement les secours alors qu’il avait constaté plusieurs heures auparavant que la victime gisait sur le sol, déjà inconscient. Le témoin assisté a indiqué qu’il pensait que la victime dormait, en raison d’un état d’ébriété dont il était coutumier. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif de non-lieu en considérant « que la conscience de l’existence d’un péril imposant l’assistance prescrite par l’article 223-6, alinéa 2, du Code pénal s’apprécie concrètement, en tenant compte, notamment, de l’absence de connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l’ambiguïté de la situation dont elle a été témoin ».
Tout dépend donc des circonstances de l’espèce et des connaissances médicales des personnes susceptibles de prévenir les secours pour déterminer si le délit a, ou non, été commis.
Volonté de tuer ou de porter atteinte à l’intégrité physique
Au stade de l’instruction, la Cour de cassation n’a d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement. Ainsi, il appartient à la juridiction d’instruction de considérer si un individu qui utilise un couteau pour porter volontairement et avec force des coups en des zones vitales a ou non l’intention de tuer11. En l’espèce, les blessures subies auraient pu entraîner la mort des victimes si les interventions chirurgicales n’avaient pas eu lieu en urgence. Ainsi, les deux poumons d’une victime ainsi qu’un rein et le foie de la seconde ont été atteints. Dès lors, force est de constater le rôle essentiel joué par l’expertise médicale dans une telle situation. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’intention de tuer se déduit des circonstances de fait et notamment des zones atteintes. L’intention homicide s’induit de ces circonstances12.
Recherche de la cause d’un décès lors d’une garde à vue
Les juridictions veillent à ce que des investigations poussées soient effectuées afin de déterminer les causes d’un décès, lorsque celui-ci survient alors que la victime se trouve à la disposition de la justice13.
En l’occurrence, à la suite d’un accident de la circulation, survenu la veille, dans lequel elle se trouvait impliquée, la victime a été placée en garde à vue. Le lendemain, elle a été retrouvée morte dans la chambre de sûreté. Une instruction pour recherche des causes de la mort a eu lieu. Finalement, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer confirmée en appel. Le pourvoi formé contre la décision a été rejeté par la Cour de cassation. En effet, selon la haute juridiction, les investigations et expertises médicales avaient permis de déterminer « formellement et sans équivoque possible » la cause, naturelle et non traumatique, du décès de la victime, elle en a déduit que l’État n’avait pas failli dans les recherches des causes de la mort.
En effet, il résulte des expertises et contre-expertises qui ont été ordonnées au cours de l’instruction pénale que le décès est dû à une cause naturelle, à savoir une ischémie cardiaque brutale chez une personne fragilisée par son alcoolisme, une hypertension sévère soignée épisodiquement et une myocardite chronique et ne peut être rattaché à une cause d’origine traumatique en lien avec l’accident ou imputable à des violences. Toutefois, le gardé à vue aurait pu bénéficier d’un examen médical ordonné par l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République.
Les essais cliniques sur le banc des accusés
Après le décès d’un homme lors d’un essai thérapeutique au mois de janvier 2016, les autorités publiques n’ont pas tardé à réagir pour réformer la réglementation.
Un test d’une molécule mise au point par le laboratoire privé portugais Bial a été mené au sein du centre de recherche Biotrial, situé à Rennes. Le test, agréé par le ministère de la Santé, a plongé l’un de ses patients en état de mort cérébrale. Quatre autres personnes ayant participé à ces essais ont désormais des lésions cérébrales.
Cet accident a touché des patients volontaires qui s’étaient portés candidats pour cet essai clinique qui était en phase 1. Au total, 90 personnes ont ingéré cette molécule à doses variables. 128 volontaires sains de 18 à 55 ans devaient participer à l’essai thérapeutique. Le test a débuté le 7 janvier, les premiers symptômes sont apparus le dimanche 10 janvier et l’essai a été interrompu le 11 janvier.
Le procureur de la République de Paris a décidé au mois de juin de mettre en mouvement l’action publique en ouvrant une information judiciaire à l’issue de l’enquête afin de déterminer si des fautes de nature pénale ont contribué de manière certaine au décès et blessures des victimes ou si les faits s’inscrivent dans le cadre d’un aléa scientifique. Cette affaire ne fait donc que commencer.
Quoi qu’il en soit, la réglementation des essais cliniques a depuis lors été modifiée par ordonnance. Le II de l’article 216 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé autorisait le gouvernement à légiférer par ordonnance afin de prendre les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet « d’adapter la législation relative aux recherches biomédicales, définies au titre II du livre Ier de la première partie du Code de la santé publique, au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, d’adapter cette législation aux fins de coordonner l’intervention des comités de protection des personnes mentionnés à l’article L. 1123-1 du même code et de procéder aux modifications de cette législation lorsque des adaptations avec d’autres dispositions législatives sont nécessaires ». L’ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne a été adoptée sur le fondement de cette disposition. L’article 6 de l’ordonnance modifie le chapitre VI du titre II du livre Ier du Code de la santé publique afin d’adapter les dispositions pénales au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il s’agit, d’une part, d’étendre les sanctions pénales aux essais cliniques de médicament et, d’autre part, de sanctionner le défaut de renseignement de la base de données de l’Union européenne.
Dangerosité et terrorisme
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale contient une disposition intéressant le droit pénal des patients. Ainsi, en matière de terrorisme, l’article 720-5 du Code de procédure pénale déroge désormais au dispositif existant pour les criminels de droit commun. En effet, lorsque la cour d’assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans ou qu’aucune des mesures d’aménagement des peines ne peut être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines, sur l’avis d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d’évaluer s’il y a lieu de mettre fin à l’application de ladite décision de la cour d’assises, ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel, qu’à certaines conditions.
Ainsi, il faut que le condamné ait subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans. Il est également nécessaire qu’il manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale. La réduction de la période de sûreté ne doit pas être susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. L’avis des parties civiles lors de la décision de condamnation doit être recueilli. Enfin, il est nécessaire d’ordonner l’expertise d’un collège de trois experts médicaux chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné. Il s’agit d’experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation.
Une telle évaluation semble délicate et vise tout particulièrement les détenus radicalisés antérieurement à leur passage à l’acte. Cette disposition atteste de la volonté du législateur de prendre en compte ce phénomène et de faire dépendre la sortie de l’incarcération d’une déradicalisation ou – à tout le moins – de l’établissement d’une moins grande dangerosité du détenu. La difficulté tient au fait que l’entourage du détenu à la sortie pourra également être criminogène et conduire à une nouvelle radicalisation du condamné. C’est pourquoi le législateur a également adopté la possibilité de prononcer des mesures de surveillance post-carcérale…
Mikaël Benillouche
IV – Procédure et droits des patients
Enquête et vie privée du patient. (Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-24015, Sté Garantie mutuelle des fonctionnaires c/ M. X, FSPBI ; CEDH, 18 oct. 2016, n° 61838/10, Vukota-Bojic c/ Suisse)
1. La surveillance du patient – Deux arrêts précisent utilement les conditions de validité des enquêtes diligentées par les compagnies d’assurance à l’encontre des victimes assurées. Ces enquêtes ne sont pas rares en pratique. De fait, les assureurs y recourent lorsqu’ils ont des raisons de douter de la sincérité des déclarations des patients assurés, et qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de recourir à un autre mode de preuve. Pour vérifier la réalité des dommages invoqués, les assureurs n’hésitent donc pas à faire appel aux services d’entreprises privées d’investigation, en leur confiant des missions de surveillance ou de filature. Des détectives privés sont ainsi mandatés pour détecter d’éventuelles fraudes à l’assurance, qui sont ensuite consignées, le cas échéant, dans des rapports d’observation. Parfois encore, ce sont des huissiers de justice qui sont sollicités pour dresser des constats de telles fraudes. Tantôt, l’assureur prend directement attache auprès de l’huissier de justice, en lui réclamant la rédaction d’un constat non contradictoire. Tantôt, l’assureur saisit le juge par voie de requête et lui demande la désignation d’un huissier sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Le constat est alors dressé au titre des mesures d’instruction in futurum. Dans ces hypothèses, un rapport d’enquête privée ou un constat d’huissier peut être dressé. L’assureur le produira en justice pour contester l’existence ou l’étendue du préjudice invoqué par le patient. C’est ainsi que le conflit s’instaure entre le professionnel, qui refuse de garantir, et l’assuré, qui réclame en retour l’indemnisation de son préjudice tiré de la violation de sa vie privée.
2. Les moyens de défense du patient – Techniquement, deux moyens de défense s’offrent principalement au patient confronté au rapport, ou au constat, qui l’accable. L’étude de la jurisprudence démontre qu’en la matière, les patients présentent fréquemment des défenses au fond. Ce faisant, ils se contentent de s’opposer, sur le fond, aux conclusions de la pièce adverse14. En effet, en présentant une défense au fond, le patient ne demande pas au juge de déclarer « irrecevable » la pièce produite par l’assureur. Il lui demande simplement de « débouter » ce dernier de sa prétention, ce qui est autre chose. De la sorte, le patient contestera les méthodes ou les conclusions du détective ou de l’huissier, en établissant le plus souvent une atteinte intolérable à sa vie privée.
Par ailleurs, pour se défendre, le patient peut préférer soulever, non pas une défense au fond, mais une fin de non-recevoir, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile. Au premier abord, ce moyen de défense peut sembler plus efficace que la défense au fond. Il faut dire, en effet, que la fin de non-recevoir vise radicalement à écarter la pièce des débats. Et l’on se plaît parfois à rappeler les termes de l’article 122, qui définit la fin de non-recevoir comme un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, « sans examen au fond ». Disons-le nettement, cette précision légale est trompeuse. À notre sens, et quoi que l’on écrive parfois, la fin de non-recevoir implique toujours un examen au fond, certes plus ou moins approfondi selon les hypothèses. Trois exemples suffisent à s’en convaincre : la fin de non-recevoir de l’action en justice tirée de la violation d’une clause de conciliation implique un examen au fond des conditions de validité de la stipulation ou du contrat qui la contient15 ; la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir implique un examen au fond de la capacité de jouissance de celui qui agit ; la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée implique un examen, indispensable pour contrôler au fond l’identité des parties, de la cause et de l’objet du litige. Bref, il ne faut pas croire que la fin de non-recevoir permet d’esquiver les débats au fond. À la vérité, l’article 122 du Code de procédure civile, dont le libellé est certes perfectible, interdit simplement qu’un débat sur le fond se tienne après que l’action, la demande ou l’acte visé a été déclaré irrecevable. Ce qui ne signifie pas que le débat au fond n’a pas eu lieu, avant le prononcé de l’irrecevabilité.
En conséquence, lorsque le patient soulève l’irrecevabilité du rapport du détective, ou du constat d’huissier, au titre de la fin de non-recevoir, il ne faut pas s’étonner qu’un débat s’instaure sur le fond. Chacun sait, du reste, que la liste des fins de non-recevoir n’est pas limitativement fixée par la loi16. Si bien que les patients ont le loisir de solliciter l’irrecevabilité de la pièce versée par l’assureur, en expliquant au juge des raisons de fond, non visées expressément par la loi, qui justifient selon eux que l’on écarte la pièce des débats. Par exemple, les patients peuvent invoquer l’estoppel au titre de la fin de non-recevoir, en tentant de démontrer qu’au fond, l’assureur s’est contredit à leur détriment17. Ils peuvent, tout autant, demander à ce qu’une pièce soit écartée des débats, en raison d’une atteinte illégitime portée à leur vie privée. Le cas échéant, la pièce sera alors « non admise » aux débats. En définitive, que le patient soulève une défense au fond ou qu’il soulève une fin de non-recevoir, le débat au fond aura lieu.
3. Le contrôle de proportionnalité – Ce débat au fond, qui se tient donc, implique un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte à la vie privée du patient, d’une part, et le droit à la preuve de l’assureur, d’autre part. Rappelons en effet que le droit à la preuve a été plusieurs fois consacré par la Cour de cassation. La haute juridiction autorise ainsi chaque plaideur à verser aux débats la pièce « indispensable à l’exercice de son droit à la preuve », à condition toutefois que cette production soit « proportionnée aux intérêts antinomiques en présence18 ». Le conflit d’intérêts est ici manifeste : le patient entend naturellement protéger son intimité, quand l’assureur entend lutter contre les fraudes à l’assurance. Partant, la Cour de cassation se trouve contrainte d’opérer un délicat contrôle de proportionnalité, dont dépend l’issue du litige19. Dans un important arrêt du 31 octobre 2012, la première chambre civile a par exemple décidé que « les atteintes portées à la vie privée (du patient), sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé, n’étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés20 ». On comprend que le contrôle de proportionnalité implique une étude de fond, circonstanciée, des techniques d’investigation menées à l’insu des patients. En la matière, il est donc souvent question de circonstances. Il est affaire de singularités. Le juge, et au premier chef la Cour de cassation, s’interrogera in concreto sur les méthodes de l’enquête, qui ne saurait être trop inquisitoire.
4. La Cour de cassation : un juge du fond ? Faut-il alors regretter que la Cour de cassation procède à ce type de contrôle de proportionnalité ? En clair, la Cour de cassation serait-elle progressivement devenue un juge du fond ? On relèvera immédiatement l’existence d’un texte nouveau – qui ne saurait passer inaperçu –, et qui ouvre possiblement la voie à une modification substantielle de nos institutions judiciaires. Ce texte est l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire, qui dispose désormais que la Cour de cassation « peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie21 ». Qu’on se le dise : la Cour de cassation peut désormais statuer au fond, à tout le moins à chaque fois qu’elle l’estime nécessaire ! À suivre la loi nouvelle, rien ne s’oppose donc plus à ce que, techniquement, la Cour de cassation procède au contrôle de proportionnalité. D’où la mutation institutionnelle22.
5. L’objectivisation du contrôle de proportionnalité – Reste que ce contrôle, pratiquement difficile à opérer, mériterait d’être objectivisé autant que possible par la Cour de cassation, afin d’éviter que l’issue de chaque procès ne devienne trop incertaine. À tout le moins, et puisqu’il lui est officiellement permis de statuer au fond, la haute juridiction se doit de préciser les circonstances de l’enquête qui la conduisent à écarter la pièce des débats ou à débouter l’assureur de sa demande de réduction ou d’exclusion de sa garantie. Il en va de la sécurité juridique des assureurs, qui doivent connaître les limites des investigations autorisées, comme de celle des patients, qui doivent savoir où débute et s’arrête leur vie privée. Or, c’est tout l’intérêt d’un récent arrêt, rendu le 22 septembre 2016 par la Cour de cassation, que de préciser quelque peu les choses23.
Cet arrêt est riche à plusieurs égards. Il énonce d’abord que « l’assureur a l’obligation d’agir dans l’intérêt de la collectivité des assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime était fondée ». C’est rappeler que les intérêts en présence ne sont pas, uniquement, ceux de l’assuré et de l’assureur : la collectivité des assurés se trouve tout autant concernée. C’est également juger, implicitement mais nécessairement, que les enquêtes diligentées par les assureurs ne sont pas illicites en leur principe24. Au contraire, et bien qu’elles soient « par elles-mêmes de nature à porter atteinte à la vie privée », ces enquêtes s’avèrent souvent légitimes, sinon inévitables25. En l’occurrence, la victime d’un accident de la circulation présentait diverses lésions : un hématome et un traumatisme crânien modéré. En dépit de la nomination d’un expert judiciaire, des doutes sérieux persistaient sur l’étendue de ces préjudices corporels. De fait, l’expert avait fait état de discordances entre les plaintes de la victime et les bilans médicaux normaux. Dans ces circonstances, objectives, on comprend que l’assureur ait décidé de confier une mission d’investigation à un détective, pour vérifier le degré de mobilité et d’autonomie de l’intéressé.
Ensuite, et surtout, l’arrêt du 22 septembre 2016 a le mérite de s’attacher aux faits objectivement relatés dans le rapport d’enquête. Pour les besoins du contrôle de proportionnalité, la Cour de cassation se réfère rigoureusement aux « nécessités de l’enquête », c’est-à-dire à son objet. Au fond, à quoi sert une enquête diligentée par un assureur à l’endroit d’un patient ? Précisément à contrôler l’existence ou l’étendue d’un préjudice, rien de plus. La Cour vérifie donc si les faits de surveillance ou de filature présentaient bien, ou non, un lien avec l’objet de l’enquête. Or, dans l’affaire rapportée, la Cour reproche à l’assureur d’avoir méconnu cet objet. Le détective avait espionné le patient, mais aussi sa mère et des proches ! Le rapport faisait notamment état des déplacements des personnes se rendant ou sortant du domicile du patient. L’immixtion dans la vie privée est, à raison, jugée disproportionnée, car elle outrepassait de toute évidence le but, c’est-à-dire l’objet de l’enquête. Ainsi que le professeur Gwendoline Lardeux l’a déjà souligné, désormais, « l’objet de l’enquête est le critère principal d’appréciation de la licéité des investigations26 ». Voici un critère précieux, qu’il faudra à l’avenir savoir exploiter27.
6. Qu’en dit la Cour européenne des droits de l’Homme ? – Enfin, il faut signaler un important arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 18 octobre 201628. Cette affaire concernait une patiente, de nationalité suisse, victime d’un accident de la circulation. Cette patiente avait fait l’objet de plusieurs enquêtes diligentées par un assureur. Un détective privé avait recueilli des informations, à l’issue de filatures conduites dans l’espace public. L’assureur entama ensuite un procès. Il produisit le rapport d’enquête et obtint la diminution du montant des prestations offertes à l’intéressée. La Cour de Strasbourg, qui condamne la Suisse, déclare toutefois la surveillance de la patiente illicite, car contraire à son droit à la vie privée29.
La Cour européenne des droits de l’Homme exige, en effet, des États qu’ils encadrent soigneusement l’ingérence dans la vie privée des patients. Or, en l’occurrence, les dispositions suisses « étaient insuffisamment précises. En particulier, elles n’indiquaient pas à quel moment et pendant quelle durée la surveillance pouvait être conduite ni ne prévoyaient des garanties contre les abus, par exemple des procédures à suivre lorsque les compagnies stockent, consultent, examinent, utilisent, communiquent ou détruisent des informations. Il en avait résulté un risque d’accès et de divulgation non autorisés d’informations30 ».
Quelle est la portée de cette importante décision en droit français ? La législation française est-elle suffisamment précise pour échapper à la censure de la Cour européenne des droits de l’Homme ? À l’analyse, la portée est incertaine.
Pour le comprendre, il faut être attentif au visa posé par la Cour de Strasbourg, tiré de l’article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ce texte impose que l’ingérence dans la vie privée soit « prévue par loi ». Cette exigence de précision légale ne vise toutefois que la seule ingérence opérée par « une autorité publique31 ». Or, précisément, dans son arrêt du 18 octobre 2016, la Cour européenne indique bien que l’assureur est regardé comme une entité publique en droit suisse. Autrement dit, l’arrêt concerne les enquêtes diligentées par les assurances sociales, et ne concerne pas directement celles diligentées par les assurances privées. Il n’est pas sûr, conséquemment, que le raisonnement de la Cour serait identique concernant les enquêtes sollicitées par les assureurs français, qui sont des entreprises privées.
Gaëtan Guerlin
Notes de bas de pages
-
1.
CEDH, 26 avr. 2016, n° 10511/10, Murray c/ Pays-Bas : Dr. pén. juill. 2016, comm. 120, note Peltier V.
-
2.
V. CEDH, 13 nov. 2014, n° 40014/10, Bodein c/ France.
-
3.
CEDH, 7 janv. 2016, n° 23279/14, Bergmann c/ Allemagne : Dr. pén. avr. 2016, comm. 70.
-
4.
CEDH, 17 déc. 2009, n° 19359/04, M. c/ Allemagne : Juris-Data n° 2009-021374.
-
5.
CEDH, 13 janv. 2011, n° 17792/07, Kallweit c/ Allemagne ; CEDH, 13 janv. 2011, n° 20008/07, Mautes c/ Allemagne ; CEDH, 13 janv. 2011, nos 27360/04 et 42225/07, Schummer c/ Allemagne ; CEDH, 14 avr. 2011, n° 30060/04, Jendrowiak c/ Allemagne ; CEDH, 24 nov. 2011, n° 4646/08, O. H. c/ Allemagne.
-
6.
Voir en dernier lieu l’avis rendu le 5 nov. 2015, http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2015/11/joe_20151105_0257_0059.pdf.
-
7.
C. pén., art. 122-4, al. 1er.
-
8.
C. pén., art. 225-3.
-
9.
C. pén., art. 122-4, al. 1er.
-
10.
Cass. crim., 22 juin 2016, n° 14-86243.
-
11.
Cass. crim., 27 juill. 2016, n° 16-83012.
-
12.
Cass. crim., 5 févr. 1957 : Bull. crim. 1957, n° 110.
-
13.
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-23428.
-
14.
CPC, art. 71 : « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »
-
15.
Si la clause de conciliation n’est pas valable au fond, l’irrecevabilité de l’action ne sera pas prononcée. Lire, par ex., Guerlin G., « Rédacteurs de clause de conciliation, dites qui ? quand ? quoi ? où ? », obs. sous Cass. com., 29 avr. 2014, n° 12-27004 : LEDC juin 2014, n° 91, p. 1.
-
16.
Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19423.
-
17.
Sur le succès, relatif, de ce moyen de défense, lire Chainais C., Ferrand F. et Guinchard S., Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, 33e éd., 2016, Dalloz, nos 375 et s. Voir aussi, récemment, Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 15-25427.
-
18.
Cass. 1re civ., 5 avr. 2012, n° 11-14177 : D. 2012, p. 1596, note Lardeux G. ; RTD civ. 2012, p. 506, note Hauser J.
-
19.
V. not. Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12403 : RGDA avr. 2016, n° 113h0, p. 201, note Schulz R. ; LEDA mai 2016, n° 64, p. 2, note Béguin-Faynel C. ; LEFP avr. 2016, n° 53, p. 2, note Douville T. ; RTD civ. 2016, p. 320, note Hauser J. ; Dalloz actualité, 14 mars 2016, note Kilgus N. ; Aint-Pau J.-C., D. 2016, p. 884 : « Vu l’article 9 du Code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du Code de procédure civile ; Attendu que le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».
-
20.
Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, n° 11-17476 : Gaz. Pal. 12 janv. 2013, n° 113p2, p. 6, note Frouin C. ; Dalloz actualité, 16 nov. 2012, note De Ravel d’Esclapon T. ; D. 2013, p. 227, note Dupont N. ; RTD civ. 2013, p. 117, note Fages B. ; RTD civ. 2013, p. 86, note Hauser J. ; Revue des droits et libertés fondamentaux 2012, chron. n° 30, Vial G.
-
21.
Cette modification substantielle des pouvoirs de la Cour de cassation a été réalisée le 12 octobre 2016 à l’Assemblée nationale, lors de l’adoption définitive du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (v. art. 38 de « petite loi », n° 824).
-
22.
Sur ce contrôle controversé, v. not. Gautier P.-Y., « La substitution, par présupposé, de la “balance des intérêts”, au syllogisme judiciaire », in Bléry C., Raschel L. (dir.), 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile, 2016, Dalloz, Thèmes & Commentaires, p. 113 ; Mazeaud D., « Proportionnalité à la une ! », JCP G 2016, 1028.
-
23.
Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-24015 : Gaz. Pal. 4 oct. 2016, n° 276f4, p. 33, obs. Berlaud C. ; JCP G 2016, 1028, Mazeaud D. ; JCP G 2016, 1136, note Lardeux G. ; Dalloz actualité, 10 oct. 2016, note De Ravel d’Esclapon T. ; RGDA nov. 2016, n° 113x1, p. 572, obs. Pélissier A.
-
24.
Il n’en va pas de même en droit du travail, la Cour de cassation étant réticente à autoriser les enquêtes diligentées par un employeur à l’encontre d’un salarié. V. par ex. Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-11412 : AJCA 2016, p. 296, note Bretzner J.-D. où la Cour décide que le rapport d’un détective privé est « un moyen de preuve illicite pour caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès ».
-
25.
V. Lardeux G., « Droit à la preuve vs droit à la vie privée : vers la maîtrise du contrôle de proportionnalité », JCP G 2016, 1136 : « si les compagnies d’assurance ont recours à de telles enquêtes, c’est parce que les seuls autres modes de preuve possibles – les certificats médicaux – sont rarement probants du fait, soit de la complaisance des médecins voire des experts judicaires (dans l’espèce ayant mené à l’arrêt du 31 octobre 2012, le mensonge de ce dernier était avéré), soit des mensonges et autres simulations de la victime ».
-
26.
Lardeux G., art. préc.
-
27.
Pour une analyse approfondie des critères de lieu, de durée et de modalités de l’enquête, lire aussi Pélissier A., art. préc., qui propose utilement un « guide âne », à destination des assureurs.
-
28.
CEDH, 18 oct. 2016, n° 61838/10, Vukota-Bojic c/ Suisse (disponible en anglais uniquement), Dalloz actualité, 3 nov. 2016, note Soudain T.
-
29.
L’arrêt est prononcé par six voix contre une, la lecture de l’opinion dissidente du juge Dedov D. étant particulièrement stimulante.
-
30.
Communiqué de presse, CEDH 335 (2106), p. 3. Lire surtout le considérant 66 de l’arrêt : « the expression “in accordance with the law” within the meaning of Article 8 § 2 requires, firstly, that the measure should have some basis in domestic law. It also refers to the quality of the law in question, requiring it to be accessible to the person concerned, who must, moreover, be able to foresee its consequences for him. It must also be compatible with the rule of law ».
-
31.
CEDH, art. 8, § 2 : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi ».