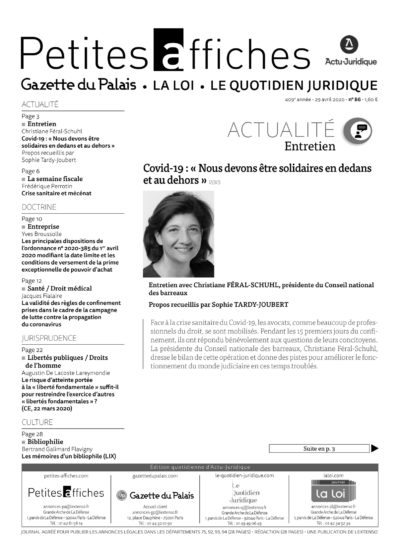La validité des règles de confinement prises dans le cadre de la campagne de lutte contre la propagation du coronavirus
La « lutte contre les épidémies » s’incorpore légalement à la politique de santé publique. Récemment, le gouvernement français a pris une série de mesures réglementaires dans le cadre d’une vaste campagne de lutte contre la propagation du Covid-19, imposant notamment des restrictions aux rassemblements de personnes, communément appelées « confinement ». On appréciera la validité de ces règlements, tant au regard du droit interne que du droit international.
En droit interne, les arrêtés ministériels, qui trouvent une base légale dans le Code de la santé publique, se présentent comme des règlements d’application de la loi. À côté, les décrets du Premier ministre sont des règlements autonomes fondés sur les circonstances exceptionnelles générées par la crise sanitaire. Au-delà, on soutiendra que ces mesures répondent à une obligation positive à la charge de l’État au regard de l’impératif de protection de la santé publique, découlant de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. Cette thèse est confortée au regard de l’évolution des règles de la responsabilité de la puissance publique en matière de risque sanitaire.
En droit international, on soutiendra tout d’abord qu’il eût été souhaitable que soit visé le règlement sanitaire international sur lequel s’appuie la déclaration du 30 janvier 2020 de l’OMS. Dans l’ensemble, les mesures réglementaires adoptées par le gouvernement face à la crise sanitaire nous paraissent en phase avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, que l’on envisage leur compatibilité avec l’article 11 de la convention protégeant la liberté de « réunion pacifique » ou avec l’article 2 protégeant le droit à la vie.
La force du droit à la protection de la santé depuis son inscription comme principe dans le préambule de la Constitution de 1946 tend, en dehors des situations de crise sanitaire grave, à laisser au second plan les prescriptions pouvant être imposées aux populations dans un but de prévention sanitaire. Or les prérogatives des autorités publiques en matière de prévention sanitaire sont anciennes, ce dont témoigne un lointain antécédent tenant dans « l’arrêt du Conseil du Roi du 14 septembre 1720 ordonnant l’isolement de la ville de Marseille où s’était déclarée une épidémie de peste » ; encore avait-il fallu attendre que la moitié des habitants de Marseille soit décimée pour agir1 ! De nos jours, la prévention sanitaire est ancrée dans les structures de « l’Administration générale de la santé », à travers notamment l’existence de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (CSP, art. L. 1417-1). La politique de santé publique a reçu une définition légale très large, lui faisant englober plusieurs composantes, dont « la lutte contre les épidémies » et « la prévention des maladies » (CSP, art. L.1411-1).
Cette politique de santé publique, dans son volet de prévention, met nécessairement en œuvre des mesures restreignant les libertés individuelles et collectives. Elles peuvent avoir un caractère permanent, telles les obligations de vaccination (CSP, art. L.3111-6 et s.), ou un caractère exceptionnel et temporaire, comme c’est le cas dans le cadre de la lutte contre les épidémies. C’est dans ce dernier cas de figure que se situent les actuelles mesures de confinement destinées à cantonner l’expansion de l’épidémie liée au virus « Covid-19 ».
À partir du 14 mars 2020, le gouvernement français a pris une série de mesures réglementaires dans le cadre d’une vaste campagne de lutte contre la propagation du coronavirus, imposant notamment des restrictions croissantes aux rassemblements de personnes, et popularisées sous le terme de « confinement » à objectif sanitaire.
Dans les autres pays européens des restrictions aux rassemblements d’ampleurs variées ont été adoptées, allant de l’interdiction de rassemblements au-delà de 1 000 personnes à la prohibition générale de tout rassemblement.
En France, les mesures réglementaires intervenues avant l’instauration par le législateur de l’état d’urgence sanitaire, présentent les particularités suivantes :
-
elles s’appuient sur un effort de motivation dans le contenu de certains de ces règlements, respectant l’obligation de motiver fixée par le législateur (CSP, art. L3131-1). Ainsi les arrêtés du 15 mars 2020 et du 19 mars 2020 complétant celui du 14 mars 2020 mentionnent un élément de motivation en ces termes : « Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus » ;
-
elles font référence dans les visas précédant le dispositif de ces règlements, à la fois à des normes de droit écrit et à la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles.
On appréciera la validité de ces premiers règlements, s’agissant des mesures restreignant la liberté de circulation, de réunion et de manifestation, tant au regard du droit interne (I) que du droit international (II).
I – La validité des règlements sanitaires en droit interne
Si certains règlements sont pris en application de la loi, le statut du décret du 16 mars 2020 mérite discussion (A). Une assise renforcée peut être proposée, en justifiant de l’existence d’une obligation positive à la charge de l’État consistant à mettre en œuvre des mesures de protection de la santé (B).
A – Règlements autonomes ou d’application des lois ?
Une série de règlements, comportant des mesures graduées et progressivement aggravées, sont intervenus dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :
-
l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2020 pris par le ministre des Solidarités et de la Santé dispose qu’« afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020 » ;
-
l’article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dispose qu’« afin de prévenir la propagation du virus Covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements [pour des motifs strictement délimités], dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes ». Ces mesures exceptionnelles avaient été annoncées à la population par le président de la République dans son allocution du 16 mars courant ;
-
le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention de la 4e classe réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population, édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020.
Au-delà, une étape législative a été engagée. Un projet de loi délibéré en Conseil des ministres le 18 mars dernier autorise la déclaration d’un « état d’urgence sanitaire », permettant notamment de restreindre certaines libertés sur tout ou partie du territoire métropolitain et en outre-mer « en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en jeu, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». L’instauration de l’état d’urgence sanitaire « donne pouvoir au Premier ministre de prendre par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire ». Il est ajouté que « ces mesures sont proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu [et] il est mis fin sans délai aux mesures (…) dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires ». Cette loi a été adoptée définitivement par le Parlement le 22 mars 2020.
Les arrêtés ministériels précités trouvent une base légale dans le Code de la santé publique, dont l’article L. 3131-1 prévoit qu’« en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la Santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles ». C’est une exception à la règle qui veut que « les ministres n’aient en principe, pas de pouvoir réglementaire général, sauf en qualité de chef de service pour l’organisation de la bonne marche de leur administration ou si un texte leur attribue ce pouvoir »2. Il s’agit donc là de règlements d’application de la loi bien qu’ils ne soient pas adoptés par l’une des deux autorités exécutives suprêmes de l’État.
En ce qui concerne le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, il vise « le Code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 » et « les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19 ». L’article L. 1311-1 du Code de la santé publique prévoit que « sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’État, pris après consultation du Haut conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière (…) de prévention des maladies transmissibles (…) ».
On peut estimer qu’inclure les restrictions de circulation et de rassemblement dans le champ d’application de ce cadre légal semble aller au-delà des intentions du législateur qui ne paraît envisager que des injonctions ou des recommandations possibles en matière sanitaire, telles que le recours aux vaccinations. La fragilité de cette base juridique n’a pas échappé au gouvernement, puisque dans l’économie générale du projet de loi pour faire face à l’épidémie de Covid-19, il est indiqué que, « pour les catastrophes sanitaires très graves, comme celle du Covid-19, il est créé un régime d’état d’urgence sanitaire qui permet de fonder toute mesure réglementaire ou individuelle limitant certaines libertés afin de lutter contre l’épidémie »3.
On observera que, exerçant sa fonction consultative, le Conseil d’État, dans son avis rendu sur ce projet de loi4, « propose de préciser que ces mesures réglementaires peuvent inclure l’interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile dans la zone géographique qu’elles déterminent ». Il reconnaît ainsi que la future loi est appelée à combler un vide juridique en la matière, tout du moins si l’on s’en tient au droit écrit.
En accord avec l’opinion émise par Dominique Rousseau5, on soutiendra que le visa renvoyant à la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles nous paraît plus pertinent. Le Conseil d’État dans l’avis précité, admet que « la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles a pu fonder le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 pris par le Premier ministre sur le fondement de ses pouvoirs de police générale », tout en estimant que « l’existence d’une catastrophe sanitaire rend utile un régime particulier de l’état d’urgence pour disposer d’un cadre organisé et clair d’intervention en pareille hypothèse »6. On en déduira qu’il appliquerait le cas échéant cette théorie s’il était saisi d’un éventuel recours pour excès de pouvoir contre le décret précité, lequel est antérieur à la loi proclamant l’état d’urgence sanitaire. Dans ce sens, se prononçant sur un référé-liberté intenté par des syndicats de médecins réclamant la mise en place d’un confinement total, la haute juridiction retient que « le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire, en particulier en cas de circonstances exceptionnelles, telle une épidémie avérée, comme celle de Covid-19 »7.
L’appel à cette théorie produit l’effet voulu consistant à assouplir les règles de compétence permettant au titulaire du pouvoir réglementaire d’adopter des mesures relevant normalement du domaine de la loi8. Donc le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 peut se passer d’une base légale expresse et s’apparenter à un règlement autonome de l’article 37 de la Constitution.
Mais, au-delà de la validation de l’édiction directe de prescriptions restreignant les droits des personnes par le titulaire du pouvoir réglementaire, grâce au recours à une théorie dégagée par la jurisprudence, ne peut-on invoquer un devoir des autorités centrales de veiller à la mise en œuvre d’un principe constitutionnel en la matière ?
B – L’accomplissement d’une obligation positive à la charge de l’État ?
Cette thèse peut s’appuyer sur un socle constitutionnel, mais est encore plus nettement confortée par l’état actuel du droit de la responsabilité de la puissance publique.
Un premier constat s’impose : « Le texte constitutionnel français ne mentionne pas la santé publique, à la différence de nombreux engagements internationaux et régionaux liant la France aux instruments de protection des droits de l’homme »9. Mais en s’appuyant sur l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le juge constitutionnel a validé « les restrictions apportées par le législateur à la propagande ou à la publicité en faveur des boissons alcoolisées », en estimant que le but poursuivi – « éviter un excès de consommation d’alcool, notamment chez les jeunes » – renvoie à un impératif de protection de la santé publique, qui est érigé en objectif à valeur constitutionnelle10. Le juge constitutionnel a en outre posé que « la protection de la santé emporte une obligation d’agir du législateur et des ministres concernés »11.
Convenons que les actuelles normes de « confinement » sont bien tournées vers la réalisation de cet objectif de rang constitutionnel. Comment alors se concilie, d’une part la « garantie à tous » de « la protection de la santé » proclamée à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, couplé à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, et d’autre part les autres droits et libertés, dont en particulier la liberté d’aller et venir ainsi que le droit d’expression collective des idées et des opinions ? Les bases juridiques peuvent paraître ici ténues, la doctrine constatant que « les normes de santé avaient un impact faible dans le contentieux constitutionnel »12. Mais un fondement jurisprudentiel peut être avancé. Le Conseil constitutionnel, faisant de la protection de la santé un objectif d’intérêt général, a validé des restrictions à l’exercice du droit de grève dans le secteur des matières nucléaires13. L’invocation de l’objectif de protection de la santé a aussi abouti à justifier que des limites soient apportées à l’exercice de la liberté d’entreprendre ainsi que celui du droit de propriété14. Or restreindre les déplacements sur la voie publique touche aux libertés d’aller et venir, de réunion et de manifestation, qui, tout comme celle précitées, s’entendent comme des « droits fondamentaux de second rang » dans la jurisprudence constitutionnelle, lesquels « s’identifient essentiellement à partir de leur caractère ni général, ni absolu ».
Au-delà, les règles de la responsabilité de la puissance publique en matière de risque sanitaire viennent conforter la thèse de l’obligation positive. Dans le contentieux né de l’exposition d’ouvriers aux poussières d’amiante, la responsabilité pour faute de l’État a été retenue, « dans la mesure où les pouvoirs publics ne pouvaient ignorer que l’exposition professionnelle aux fibres d’amiante présentait des risques sérieux pour la santé et qu’ils n’ont apporté aucun élément permettant d’établir que la législation et la réglementation qu’ils ont prises étaient adaptées au risque encouru. L’État n’a donc pas satisfait à ses obligations en matière de protection de la santé publique »15. La haute juridiction a confirmé cette approche, l’État étant condamné à réparer le préjudice subi par les travailleurs exposés aux poussières d’amiante, pour sa carence en n’ayant entrepris avant 1977 aucune recherche « afin d’évaluer les risques pesant sur [ces travailleurs], ni pris de mesures aptes à éliminer, ou tout du moins, à limiter les dangers liés à une telle exposition »16. Dans le même sens, des patients obtiennent l’engagement de la responsabilité pour faute de l’État en réparation des conséquences dommageables qu’ils ont subies du fait de l’absorption du Mediator, en raison de « l’abstention de prendre les mesures adaptées, consistant en la suspension ou le retrait de l’autorisation de mise sur le marché de la molécule ». Pour la Cour, la décision de retrait du Mediator aurait dû intervenir « au plus tard » le 7 juillet 1999, et non 10 ans après, « les préjudices trouvant directement leur cause dans cette faute ». Seule une exonération partielle de la responsabilité de l’État est retenue par le juge d’appel faisant suite à un arrêt de cassation, du fait des « agissements fautifs des laboratoires Servier à partir du 7 juillet 1999 »17.
Le recours par les autorités exécutives de l’État à la « mise en confinement » de la population dans l’actuelle campagne de lutte contre la propagation de ce virus apparaît donc comme une solution pour s’exonérer de sa responsabilité du fait de préjudices subis par les malades atteints du Covid-19, si elle devait être soulevée.
Il reste que, s’agissant d’une pandémie à l’échelle mondiale, et au regard des engagements internationaux de la France, il convient d’examiner la compatibilité des mesures adoptées vis-à-vis du droit international.

II – La validité des règlements sanitaires en droit international
Elle peut s’envisager au regard du droit onusien (A), mais aussi et surtout au regard de la convention européenne des droits de l’Homme (B).
A – L’analyse au regard du droit onusien
Certains des règlements nationaux précités se réfèrent, parmi les éléments de motivation précédant leur dispositif, à la déclaration du 30 janvier 2020 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle « l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ». La notion d’« urgence de santé publique de portée internationale » (USPPI) est précisée dans le règlement sanitaire international (2005), ou RSI (2005). Selon ce texte, il appartient « au directeur général de l’OMS de déclarer en dernier ressort une USPPI et d’énoncer les recommandations temporaires pour faire face à la situation, en se basant sur l’avis du comité d’urgence, sur les informations fournies par les États parties, les experts scientifiques et sur une évaluation pour la santé humaine, du risque de propagation internationale de la maladie et du risque d’entraves aux voyages internationaux ». Selon le RSI (2005), une USPPI « s’entend d’un événement extraordinaire dont il est déterminé qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque international de propagation de maladies et qu’il peut requérir une action internationale coordonnée ».
Cette procédure a été appliquée dans le contexte de l’épidémie liée au Covid-19, qui a vu la déclaration du directeur général de l’OMS être précédée par la consultation du comité d’urgence. On note qu’« à la première réunion, les membres de ce comité ont exprimé des divergences sur la question de savoir si l’évènement constituait ou non une USPPI » cette qualification n’ayant pas été retenue à ce stade. Ce n’est qu’au cours de la deuxième réunion tenue le 30 janvier 2020 que « le comité est convenu que la flambée épidémique remplit désormais les critères d’une USPPI ». Le directeur général a alors « émis cet avis en tant que recommandations temporaires au titre du RSI » en appui à sa déclaration (OMS, déclaration sur la deuxième réunion du comité d’urgence du règlement sanitaire international (2005) concernant la flambée de nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV)).
La coordination internationale impulsée par ces recommandations porte principalement sur « le partage systématique des informations et des recherches ». Par ailleurs, le comité d’urgence de l’OMS déclare que « tous les pays doivent être prêts à prendre des mesures pour endiguer l’épidémie, notamment par une surveillance active, un dépistage précoce, l’isolement et la prise en charge des cas, la recherche des contacts et la prévention de la poursuite de la propagation de l’infection par le 2019-nCoV ».
Comme le rappelle l’OMS, le règlement sanitaire international « est un instrument juridique international qui a force obligatoire pour 196 pays dans le monde »18. La même force juridique peut-elle être accordée à une déclaration du directeur général de l’OMS, visant à l’appliquer ? Une réponse négative s’impose, car une déclaration internationale ne s’apparente pas à une directive à portée sanitaire, qui aurait une valeur réglementaire. On butte ici sur un obstacle déjà perçu par la doctrine qui admet que « le droit international de la santé est en effet un soft law, c’est-à-dire un droit en formation »19.
Il restera à apprécier l’effectivité des recommandations partielles attachées à la déclaration d’USPPI à l’échelle mondiale. Celles relatives à la coordination internationale ont été suivies d’effets, au regard des échanges importants entre les experts scientifiques et à des manifestations d’entraide internationale. Mais le respect intégral dû au droit international de la santé devra aller au-delà, car en tant que droit de solidarité, il suppose qu’un effort particulier soit réalisé par la communauté internationale en faveur des pays les moins avancés, lorsqu’un seuil élevé de propagation du virus les atteindra.
Concernant les règlements pris par les autorités exécutives en France, on soutiendra qu’il eût été souhaitable que soit visé le règlement sanitaire international sur lequel s’appuie la déclaration du 30 janvier 2020 de l’OMS et les recommandations partielles qui lui sont liées. Sur cette base, pourrait être réalisée le moment venu une évaluation objective des résultats de la campagne de lutte contre la propagation de l’épidémie menée dans notre pays.
S’il peut être tiré parti de l’action internationale de l’OMS en dégageant des paramètres d’analyse d’une politique publique, la prise en compte des effets directs produits par la convention européenne des droits de l’Homme nous replace sur un terrain plus strictement juridique.
B – L’analyse au regard de la convention européenne des droits de l’Homme
Selon que l’on conteste des mesures réglementaires prises dans le cadre de la campagne de lutte contre la propagation du Covid-19 en arguant du caractère excessif des restrictions imposées aux mouvements de personnes, ou au contraire de l’insuffisance de ces mesures pour une protection optimale de la santé de la population, on invoquera dans un cas la violation de l’article 11 de la convention, et dans l’autre celle de son article 2. Le premier défend la liberté de « réunion pacifique », le second le droit à la vie.
1 – Les restrictions apportées à la liberté de « réunion pacifique »
La liberté de manifestation et la liberté de réunion, qui s’incorporent dans la liberté de « réunion pacifique » énoncée dans l’article 11, § 1, de la convention européenne des droits de l’Homme, à côté de la liberté d’association, forment des droits conditionnels qui connaissent des limitations possibles qualifiées d’ingérence de l’État. Celles-ci ne sont admises que strictement par la Cour européenne des droits de l’Homme au regard des conditions posées à l’article 11, § 2, de la CEDH qui dispose : « L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État ».
La jurisprudence de la Cour EDH a retenu une interprétation étroite de ces hypothèses de limitations en disposant que « l’interdiction d’accéder à une région pourtant soumise à l’état d’urgence » était constitutive d’une atteinte à la liberté de réunion pacifique et d’association20.
Dans ce contexte, les mesures réglementaires intervenues dans le cadre de la campagne de lutte contre la propagation du coronavirus, s’analysent comme des « restrictions » à cette liberté. L’ingérence de l’État est-elle justifiée dans un tel cas ?
Il convient d’examiner si les critères permettant des restrictions à la liberté de réunion pacifique sont réunis :
Qu’en est-il du premier critère suivant lequel les restrictions doivent être « prévues par la loi » ? Constatons tout d’abord que cette base légale s’entend au sens large, incluant les « sources secondaires » constituées notamment par des règlements nationaux. La série de décrets et arrêtés ministériels que nous étudions entre donc dans ce cas de figure.
Mais le juge européen a construit progressivement une méthode qui ne se borne pas à rechercher l’existence de dispositions pertinentes en droit interne. Dans ce sens, la Cour EDH retient, pour justifier l’ingérence de l’État, une exigence de qualité de la norme. En clair cela signifie, si l’on transpose la jurisprudence de la Cour :
-
que la norme doit être accessible au public, la Cour considérant que « le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné »21. Les règles de publication des règlements nationaux incluant une édition du Journal officiel de la République française sur support électronique répondent à cette exigence ;
-
que les motifs des restrictions fixées dans la norme nationale doivent être suffisamment précis pour éviter « des doutes concernant la crédibilité du motif formel invoqué par les autorités »22. Cette jurisprudence peut s’appliquer en cas de recours contre le décret établissant une amende, sur la base desquelles sont verbalisés les contrevenants aux règles de confinement. Une faille a pu être soulevée à ce stade. Le Conseil d’État, statuant en juge des référés, décelant sur ce plan des imperfections dans les règlements établissant le confinement de la population française, a prononcé une injonction, adressée « au Premier ministre et au ministre de la Santé, [leur intimant] de prendre dans les quarante-huit heures les mesures suivantes :
-
préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé,
-
réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs à proximité du domicile », compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne du confinement,
-
évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation ;
-
-
et encore, que la norme doit prévoir des garanties efficaces contre des atteintes arbitraires au droit substantiel pertinent. La voie de droit formée par le recours pour excès de pouvoir, mais aussi et surtout celle du référé-liberté (CJA, art. L.521-2), ouvertes contre les règlements en cause, satisfont cette exigence ».
On peut donc admettre que, sous réserve des corrections exigées par le juge des référés, l’intervention des règlements sanitaires en question constitue une réponse satisfaisante à l’exigence selon laquelle les restrictions doivent être « prévues par la loi », selon l’interprétation donnée par la Cour EDH.
Venons-en au second critère selon lequel la norme nationale porteuse de restrictions aux libertés doit contenir des dispositions constituant clairement des « mesures nécessaires à la protection de la santé ». Cette condition apparaît pleinement remplie, en raison de la corrélation étroite entre le contenu des règlements et les sources du droit invoquées, renvoyant systématiquement au Code de la santé publique.
Reste à franchir le « test de proportionnalité » exigé dans la jurisprudence de la Cour EDH, en application de la condition faisant référence à « des mesures nécessaires », posée dans l’article 11, § 2. Celle-ci a pu estimer que l’imposition d’une amende administrative pour participation à une manifestation non autorisée quoique pacifique, s’entend comme un cas de violation de l’article 1123. D’où cette interrogation : l’instauration d’une amende par le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 frappant notamment les personnes outrepassant l’interdiction des rassemblements sur la voie publique ne constitue-t-elle pas une mesure excessive ? Il nous semble que la sanction demeure proportionnée au regard du but sanitaire poursuivi. Elle l’est d’autant plus, si on la compare à l’échelle des infractions frappant en droit français les personnes participant à des manifestations interdites ou à des attroupements, lesquelles ont été aggravées par la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019.
Ajoutons que la thèse de la compatibilité avec la convention européenne des droits de l’Homme peut être encore étayée, en invoquant tout à la fois :
-
la nature subsidiaire de la mission de la Cour EDH, qui rappelle dans ce sens que « c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne » (Varoğlu Atik et autres c/ Turquie, id., § 39) ;
-
la théorie jurisprudentielle, selon laquelle les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour apprécier le lien entre les faits répréhensibles et l’exercice de la liberté de manifestation.
2 – Le respect du droit à la vie
L’article 2, § 1, de la convention pose que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Peut-on invoquer valablement comme moyen à l’appui d’un recours, une carence de l’État à prendre les dispositions appropriées pour protéger efficacement la population de la contagion du coronavirus, en concluant à la violation de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’Homme ?
En droit interne, on note que « le droit au respect de la vie, rappelé par l’article 2 de la convention, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative »24. Le référé-liberté est donc rendu possible, or cette procédure d’urgence est une voie de recours particulièrement efficace.
Devant le prétoire européen, un tel recours peut aisément franchir la barre de la recevabilité en raison du degré de mortalité des patients atteints du Covid-19. Ainsi l’article 2 a été déclaré applicable au cas de pertes de vies humaines à la suite d’un séisme25.
Sur le fond, on doit prendre en compte la portée large de cet article reconnue par la jurisprudence, qui englobe l’existence d’obligations positives de l’État, incluant l’adoption de « mesures préventives adaptées » afin de « garantir l’effectivité du droit à la vie » ; cette position a été affirmée par la Cour EDH à propos des vaccinations26.
Il reste que la Cour EDH n’a pas jusqu’ici, à notre connaissance, sanctionné un État pour défaillance dans la mise en œuvre de mesures de prévention sanitaire couvrant son territoire tout entier. Les cas de violation de l’article 2 se rencontrent davantage à une échelle plus circonscrite. Ainsi l’absence de mesures de protection adaptées puis d’enquête effective concernant le décès de plusieurs enfants dû aux conditions de vie dans un foyer de placement a pu être constitutive d’une violation de l’article 227. Au contraire, alors qu’un État n’a pu faire face à un évènement tragique, le juge européen, refusant de « mettre à la charge des États un fardeau excessif et insupportable », dédouane la puissance publique « eu égard à l’imprévisibilité du comportement humain »28.
Il nous semble donc que, pas plus qu’un moyen concluant à la violation de l’article 11 de la convention, l’invocation du non-respect de l’article 2 n’aurait de chance de prospérer devant le juge européen, tout comme devant les juridictions nationales chargées d’appliquer la convention européenne des droits de l’Homme.
En définitive, qu’on juge celles-ci trop gravement attentatoires aux droits des personnes ou qu’au contraire on les estime insuffisamment sévères pour protéger la santé de la population, les restrictions apportées à la libre circulation et aux rassemblements de personnes par des règlements nationaux intervenus dans le cadre de la campagne de lutte contre la propagation du Covid-19 nous paraissent difficilement contestables, que ce soit au regard du droit national, ou au regard du droit européen des droits de l’Homme. Déjà le Conseil d’État statuant en référé a écarté les principales conclusions des syndicats de médecins requérants en retenant qu’il n’apparaît pas que le Premier ministre ait fait preuve d’une carence grave et manifestement illégale en ne décidant pas un confinement total de la population sur l’ensemble du territoire »29.
Notes de bas de pages
-
1.
V. Delmas E., « Pouvoir politique et catastrophe sanitaire : la “publication” des épidémies de peste dans la France moderne », Parlement(s), Revue d’histoire politique 2017/1, n° 25, p. 31et s.
-
2.
Oberdorff H. et Kada N., Les institutions administratives, 9e éd., 2019, Sirey, p. 36.
-
3.
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 18 mars 2020.
-
4.
CE, avis, 18 mars 2020, n° 399873, commission permanente.
-
5.
Coronavirus : « La théorie des circonstances exceptionnelles permet une extension des pouvoirs de l’exécutif », Le Monde, 15 mars 2020.
-
6.
CE, avis, 18 mars 2020, n° 399873.
-
7.
CE, ord., 22 mars 2020, n° 439674, Syndicat des jeunes médecins.
-
8.
CE, ass., 16 avr. 1948, Laugier : Lebon, p. 161 ; S. 1948, p. 36, concl. Letourneur.
-
9.
Gründler T. « Le juge et le droit à la protection de la santé », RDSS 2010, p. 841, hal-01674384.
-
10.
Cons. const., 8 janv. 1991, n° 90-283 DC, loi Évin : Lebon, p. 11 ; RJC I-417 ; Pouvoirs n° 58, p. 137, chron. constit. Avril P. et Gicquel J.
-
11.
Cons. const., 29 juill. 1991, n° 91-296 DC, loi portant diverses mesures d’ordre social.
-
12.
V. Bioy X., « Le traitement contentieux de la santé en droit constitutionnel », RDSS 2013, numéro Hors-Série, « Constitutions et santé », p. 45.
-
13.
Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-117 DC, Matières nucléaires, cons. 4.
-
14.
Cons. const., 8 janv. 1991, n° 90-283.
-
15.
CAA Marseille, 18 oct. 2001, n° 00MA01665, ministre de l’Emploi et de la Solidarité c/ Cts T.
-
16.
CE, ass., 3 mars 2004, nos 241150, 241151, 241152 et 241153 : D. 2004, p. 973.
-
17.
CAA Paris, 4 août 2017, nos 16PA00157 et 16PA03634.
-
18.
OMS, Dossiers et reportages – Qu’est-ce que le règlement sanitaire international ?, www.who.int/ihr.
-
19.
Bélanger M., « Une nouvelle branche du droit international : le droit international de la santé, Études internationales », 13 (4), p. 611–632, https://doi.org/10.7202/701420ar.
-
20.
CEDH, 10 juill.1998, n° 26695/95, Sidiropoulos c/ Grèce, § 47.
-
21.
CEDH, 26 avr. 1979, n° 6538/74, Sunday Times c/ Royaume-Uni.
-
22.
CEDH, 15 oct.2015, n° 60259/11, Gafgaz Mammadov c/ Azerbaïdjan.
-
23.
CEDH, 3 oct. 2013, n° 21613/07, Kasparov et a. c/ Russie.
-
24.
CE, ord., 22 mars 2020, n° 439674, Syndicat des jeunes médecins, consid. 5.
-
25.
CEDH, 17 nov. 2015, nos 14350/05, 15245/05 et 16051/05, M. Özel et a. c/ Turquie.
-
26.
V. not. : CEDH, gde ch., 10 mai 2001, n° 25781/94, Chypre c/ Turquie, § 219.
-
27.
CEDH, 18 juin 2013, n° 48609/06, Nencheva et a. c/ Bulgarie.
-
28.
CEDH, 19 nov. 2013, n° 1774/10, Sipal c/ Turquie, § 62.
-
29.
CE, ord., 22 mars 2020, n° 439674, Syndicat des jeunes médecins, consid. 9.