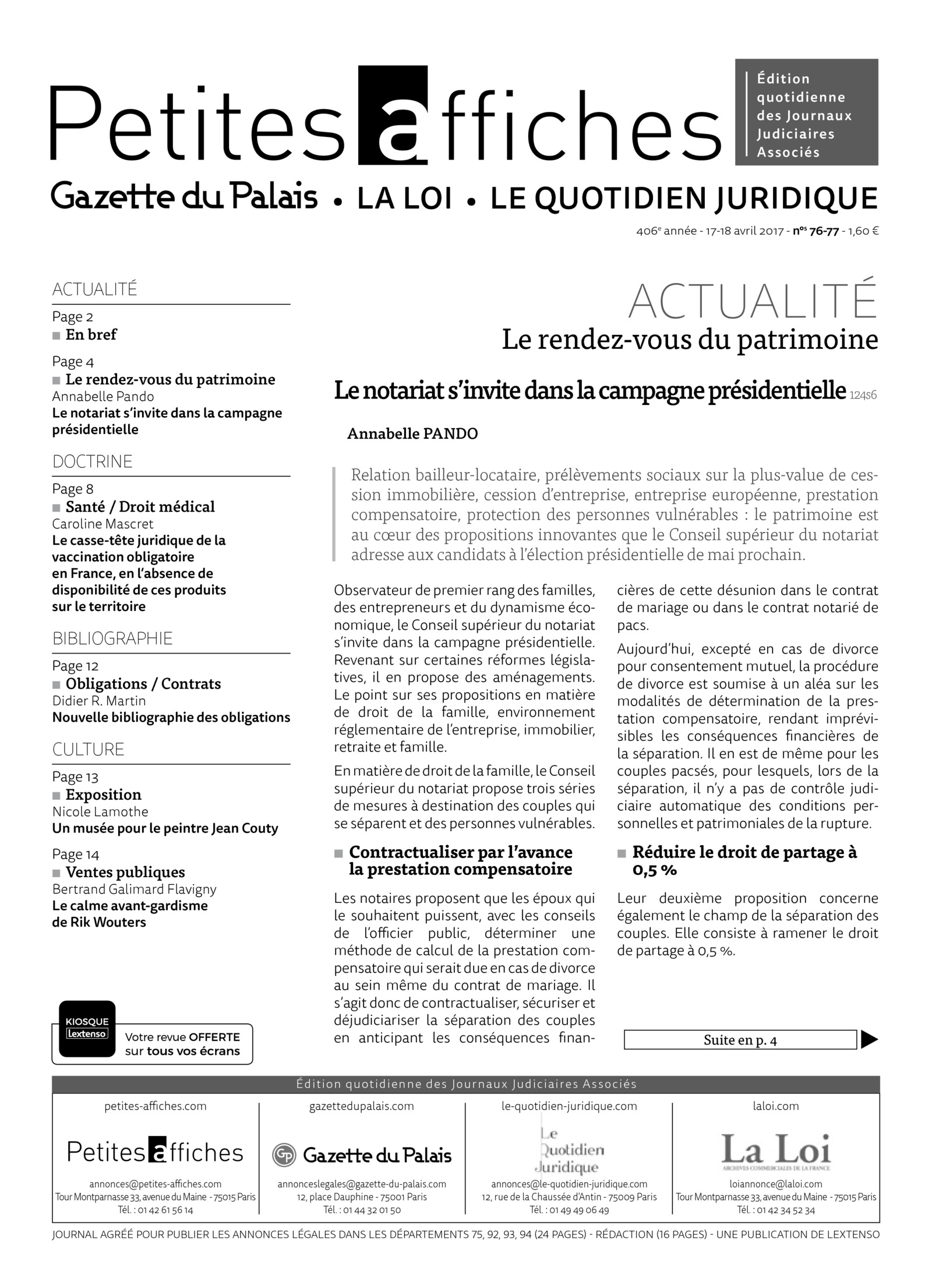Le casse-tête juridique de la vaccination obligatoire en France, en l’absence de disponibilité de ces produits sur le territoire
Le Conseil d’État vient d’intimer au ministre de la Santé de mettre à la disposition des professionnels de santé dans un délai de 6 mois des vaccins contenant les seules valences antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique, alors que ces vaccins ne sont plus disponibles en France en tant que tels, mais accompagnés d’autres valences non obligatoires. Au regard de l’arsenal législatif existant, cette décision du Conseil d’État semble difficilement réalisable.
Depuis plusieurs années, certaines associations militent contre la vaccination, combat puissamment relayé par les résaux sociaux. Certains vaccins sont particulièrement visés, notamment ceux recommandés par les autorités sanitaires, mais non obligatoires (pour exemple, cas du vaccin contre la rougeole).
En France, la politique de vaccination obligatoire vise seulement trois vaccins : un vaccin antidiphtérique, un vaccin antitétanique et un vaccin antipoliomyélitique1. Or aucun de ces trois vaccins n’est commercialisé en tant que tel en France, ces trois vaccins étant accompagnés d’autres valences. En effet, à décharge des laboratoires pharmaceutiques, c’est l’État lui-même, via le comité technique des vaccinations2, qui a encouragé la commercialisation de vaccins dits hexavalents, évitant ainsi la multiplication des injections vaccinales chez l’enfant, le calendrier vaccinal français recommandant la vaccination contre la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b et l’hépatite B.
Les partisans de la non-vaccination, afin d’échapper à l’obligation vaccinale édictée par le Code de la santé publique, avaient demandé au ministre de la Santé de mettre à leur disposition ces trois vaccins obligatoires, mais sans les autres valences. Le ministère n’ayant pas répondu à leur demande, ces personnes ont attaqué la décision implicite de rejet du ministre, au motif qu’en l’absence sur le marché de ces trois valences disponibles sans autres ajouts, on ne pouvait les obliger à soumettre leurs enfants à d’autres vaccinations non imposées par le législateur, et auxquelles elles n’auraient pas consenti librement3.
Il existait également un autre motif de contestation, sur lequel nous ne nous attarderons pas, les associations attaquant la présence d’adjuvants dans ces vaccins, en l’espèce l’aluminium et le formaldéhyde, ce motif ayant été rejeté par les juges pour absence d’élément sérieux sur l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité de la personne.
L’arrêt du conseil d’État du 8 février dernier est intéressant à plus d’un titre. Il ne se contente pas d’annuler la décision de refus du ministère, mais lui rappelle ses obligations en matière vaccinale, tout en lui offrant des pistes d’actions qui, en fin de compte, si elles existent bien dans les textes, sont malheureusement difficilement applicables dans la pratique.
Les juges reconnaissent que si les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du CSP exigent trois vaccinations pour les enfants (antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique), dont l’exécution relève de la responsabilité des titulaires de l’autorité parentale, cette obligation s’arrête à ces trois seuls vaccins, et le ministère ne peut exiger, sur le plan du droit, de soumettre les enfants à d’autres valences non obligatoires.
De fait, l’État se trouve alors dans une impasse juridique, du fait que ces trois vaccins ne sont pas disponibles en France. Le seul vaccin qui pouvait satisfaire à ces obligations vaccinales ayant été suspendu en 2008 en raison de complications allergiques (DT Polio Mérieux de Sanofi Pasteur).
Dans la décision du 8 février, les juges enjoignent au ministère de « faire usage des pouvoirs qu’il détient en vue d’assurer la mise à disposition du public des vaccins permettant de satisfaire aux seules vaccinations obligatoires », et non pas « se borner à rappeler les laboratoires à leurs obligations ». Et lui intime de remédier à cette situation dans un délai de 6 mois.
Ce sont des termes très durs et une appréciation sévère de la haute juridiction envers la politique du ministère de la Santé menée face à cette « crise » de la vaccination, qui avait débutée par une « concertation citoyenne » en 2016.
Ainsi, les juges viennent faire la leçon aux dirigeants et lister les pouvoirs que détiendrait l’État afin de remédier à cette crise et à cette absence de produits.
Or nous allons voir que la situation n’est pas si simple que les juges le laissent supposer. S’il existe bien en France une réglementation face à l’approvisionnement des médicaments (I), celle-ci n’est pas adaptée au contexte vaccinal actuel. La seconde piste évoquée par les juges liée à l’exercice de prérogatives de puissance publique dont disposeraient le ministère n’est pas plus satisfaisante (II).
I – La réglementation française en matière d’approvisionnement de médicaments
Cette réglementation a été adoptée en deux temps. Une première mise en place à partir de 2012, dans le sillon de l’affaire Mediator et de la loi de sécurité sanitaire4, dite loi Bertrand, du nom du ministre en charge à l’époque de ce portefeuille. Puis un approfondissement de la réglementation par la loi de modernisation de notre système de santé en janvier 20165, dite loi Touraine.
A – La mise en place d’une réglementation en matière d’approvisionnement des médicaments
En 2011, suite à plusieurs « affaires » de rupture de stocks de médicament, affaires largement relayées par les médias nationaux, la loi dite Bertrand 6 avait mis en place plusieurs dispositions afin d’essayer d’assurer auprès des professionnels de santé un approvisionnement continu des médicaments. À l’époque, ces ruptures affectaient directement les officines, dans la mesure où la chaine de médicaments en ville fonctionne de façon constante en « flux tendu ». Six ans après cette loi, circuit ville et hôpital sont tous deux touchés par ce phénomène.
La loi avait défini la rupture d’approvisionnement en tant qu’incapacité pour une pharmacie d’officine ou une pharmacie à usage intérieur de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures. Le texte ajoutait que ce délai pouvait être réduit à l’initiative du pharmacien en fonction de la compatibilité avec la poursuite optimale du traitement du patient.
Les nouveaux articles L. 5124-17-1 et L. 5124-17-2 du CSP prévoyaient un système d’astreinte pour répondre aux besoins urgents en médicaments en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les grossistes répartiteurs sur leur territoire de répartition, et disposant que les grossistes répartiteurs assuraient l’approvisionnement continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients sur leur territoire de répartition.
Le décret issu de la loi7 introduisait de nouvelles obligations pesant sur les entreprises pharmaceutiques exploitantes8.
Celles-ci devaient désormais assurer un approvisionnement approprié et continu de tous les grossistes répartiteurs, et donc justifier une gestion de stocks individuels au regard de la couverture des besoins des patients en France. Si l’exploitant anticipait une rupture d’approvisionnement, il devait en informer l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), en précisant les délais de survenue, les stocks disponibles, les modalités de disponibilité ainsi que les délais provisionnels de remise à disposition des médicaments, et à défaut les spécialités substituables au produit manquant.
L’exploitant avait l’obligation d’informer tous les 3 mois l’Agence régionale de santé (ARS) des approvisionnements d’urgence effectués, en mentionnant chaque destinataire ainsi que les quantités fournies. Enfin, un bilan trimestriel de ces approvisionnements d’urgence était adressé à l’ANSM, chronologiquement pour chaque médicament avec mention des quantités fournies et des destinataires.
La mise en place de centres d’appel d’urgence était une obligation supplémentaire pesant sur les exploitants, pour le signalement des ruptures par les pharmacies d’officine et les hôpitaux. Ces centres devaient être organisés de manière à prendre en charge à tout moment les ruptures de médicaments et à permettre la dispensation effective de la spécialité manquante. C’était à l’exploitant de prendre les dispositions pour faire connaitre ces numéros d’appel auprès des pharmaciens, celui-ci devant également assurer la traçabilité des appels. Ces mesures sont toujours en vigueur.
Face aux difficultés persistantes d’approvisionnement, la loi de modernisation de la santé de janvier 2016 est venue renforcer les moyens de lutte contre les ruptures d’approvisionnement, tout en conservant les dispositions adoptées en 2011.
B – Le renforcement des mesures destinées à lutter contre les ruptures d’approvisionnement
Un nouveau chapitre Ier quater « Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments » fait son entrée dans le Code de la santé publique. La nouvelle loi identifie les médicaments pour lesquels les ruptures sont le plus préjudiciable, en définissant les « médicaments d’intérêt thérapeutiques majeurs », pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou présentant une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie9. Un arrêté en date du 27 juillet 2016 liste ces classes thérapeutiques.
Les laboratoires sont désormais dans l’obligation d’identifier les médicaments d’intérêt thérapeutiques majeurs qu’ils exploitent et dont l’indisponibilité auraient des conséquences graves et immédiates, notamment concernant les vaccins dont la liste devait être fixée par arrêté. Au jour de l’arrêt du Conseil d’État, cette liste n’avait pas encore été adoptée. Pour tous ces produits, un plan de gestion des pénuries (PGP) sera établi sous la responsabilité des laboratoires (création de stocks de sécurité, enregistrement de sites alternatifs de fabrication, identification de spécialités équivalentes à l’étranger10). La liste des médicaments concernés sera transmise à l’ANSM tous les ans et les PGP tenus à la disposition de l’Agence sur demande.
En cas de risque de rupture de stock, le laboratoire mettra en place, après accord de l’agence, des solutions alternatives permettant de faire face à la situation en mettant en œuvre son plan et en prenant des mesures d’accompagnement et d’information des professionnels de santé et des patients, par l’intermédiaire des associations de patients11.
Enfin, le décret12 précise la rupture d’approvisionnement au regard de la définition de 2011, ajoutant que la rupture est établie si la demande du professionnel n’a pas été honorée auprès de deux entreprises exerçant une activité de distribution de médicaments, toujours dans un délai de 72 heures.
À compter du 20 juillet, les laboratoires disposaient d’un délai de 6 mois pour mettre en place leur PGP.
Le manquement à ces obligations est passible de sanctions financières13.
Cependant, force est de reconnaître que ces mesures à disposition du gouvernement, afin de pallier les ruptures de stock, si elles seront utiles dans le futur pour certains médicaments, ne sont en aucun cas adaptées à la situation d’espèce sur les vaccins. En effet, rappelons ici qu’aucun laboratoire ne commercialise actuellement un vaccin trivalent (antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique). Or la réglementation sur les ruptures d’approvisionnement n’oblige les laboratoires à gérer les ruptures que des médicaments qu’ils exploitent. Il faut ici rappeler que c’est l’État lui-même qui a encouragé la commercialisation de vaccins dits hexavalents. Les « pouvoirs » que détiendrait l’État « en vue d’assurer la mise à disposition du public des vaccins permettant de satisfaire aux seules vaccinations obligatoires » ne résident donc aucunement dans la nouvelle réglementation en matière d’approvisionnement de médicaments, contrairement à ce qu’avancent les juges du Conseil d’État.
Outre la piste juridique relative à la réglementation sur l’approvisionnement, les juges, dans la décision commentée, rappellent au ministre certaines prérogatives de puissance publique qu’il pourrait mettre en œuvre dans ce contexte de pénurie vaccinale.
II – La mise en œuvre de certaines prérogatives de puissance publique face à la pénurie vaccinale
Les juges avancent deux dispositions dont pourraient faire usage le ministère afin de pallier la pénurie de vaccins. L’adoption d’une licence d’office (A) et le recours aux prérogatives de la nouvelle Agence nationale de la santé publique (B).
A – Le régime de la licence d’office
Si l’intérêt de la santé publique l’exige, et en cas d’absence d’accord amiable avec le titulaire du brevet, en cas de qualité ou qualité insuffisante, ou de prix anormalement élevé, ou de pratiques déclarées anticoncurrentielles par le juge, l’État peut soumettre un produit de santé : médicament, dispositif médical, dispositif médical de diagnostic in vitro, produit thérapeutique annexe, à une licence d’office14.
Cette licence permet de demander, par toute personne qualifiée, l’octroi d’une licence d’exploitation. À l’heure actuelle, l’État n’a jamais utilisé ce pouvoir de « confiscation » de brevet à un industriel, et aucune licence d’office n’a jamais été attribuée en France pour un produit de santé. De surcroît, la production des vaccins étant une opération très délicate, due à la manipulation de produits vivants (virus), peu d’industriels sont capables d’effectuer cette opération. Sauf en définitive ceux qui possèdent les chaînes de fabrication adéquates, et qui produisent déjà les vaccins. De plus, si la soumission à une licence d’office est possible en théorie pour un médicament chimique, pour un vaccin, cela est impossible au regard du délai de 6 mois. Un vaccin met beaucoup plus de temps à être fabriqué qu’un simple composant chimique. On peut également s’interroger sur l’intérêt financier de cette opération pour un prestataire privé, pour toucher finalement une partie infinitésimale de la population. En outre, le prix de ces vaccins risque d’être assez bas, au regard des prix des autres vaccins fixés par le comité économique des produits de santé (moins de trente euros).
Le rationnel qui préside à la licence d’office n’est donc pas du tout adapté au contexte vaccinal. Le système de la licence d’office a en partie été imaginé afin de sanctionner un industriel, qui abuserait d’une situation de monopole. Or en France, les vaccins visés par le recours ne sont plus disponibles en France car aucun industriel ne les fabrique.
Cette disposition permet seulement de proposer à un tiers compétent la possibilité de produire le médicament. À aucun moment cette licence n’est assimilable à une obligation de production.
B – L’acquisition de vaccins par l’Agence nationale de la santé publique
Demeure la dernière disposition invoquée par le Conseil d’État : le recours à la nouvelle Agence nationale de la santé publique, créée par l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016, qui reprend les missions de l’ex-EPRUS (Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires) et peut, à la demande du ministre, acquérir, fabriquer, importer, distribuer des produits répondant à des besoins de santé publique, thérapeutique ou diagnostique, qui font l’objet notamment d’une rupture ou d’une cessation de commercialisation, d’une production en quantité insuffisante ou lorsque toutes les formes nécessaires ne sont pas disponibles, en bénéficiant le cas échéant, d’une licence d’office15. Or on a rarement vu une telle situation, dans laquelle l’État est donneur d’ordre en matière de fabrication de médicament, fonctionner. Demeure l’importation. Cette possibilité semble cependant restreinte, alors que, comme nous l’avons dit précédemment, le vaccin DT Polio Mérieux a été suspendu en 2008, et qu’aucun pays dans le monde ne réalise la vaccination avec le vaccin DTP seul, sans combinaison à d’autres valences.
Les juges de la haute juridiction ont posé un ultimatum au ministère de la Santé, lui intimant de prendre des mesures permettant, dans un délai de 6 mois, de mettre à disposition de la population des vaccins correspondant aux seules vaccinations obligatoires.
Cette décision semble relever de l’impossible, et apparaît difficilement réalisable, du moins sur le plan juridique, au vu de ce que nous avons expliqué précédemment, et contrairement à ce qu’avance le Conseil d’État.
Reste la réponse politique. Deux possibilités s’offrent au ministère. Soit le ministre de la Santé décide d’abandonner l’obligation vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Ce qui risque d’apparaître comme un désastre au regard de la santé publique et la dictature d’une minorité (2 % de la population refuserait la vaccination). Soit, au contraire, l’État décide d’étendre l’obligation vaccinale à certains autres vaccins, fortement recommandés par le comité technique des vaccinations et actuellement commercialisés. Ce qui aurait l’avantage de régler la mise à disposition de la population d’un vaccin avec les seules trois valences obligatoires.
En revanche, ces deux mesures nécessiteraient une modification législative. Au regard du calendrier législatif actuel, cela semble difficilement réalisable dans un délai de 6 mois.
Notes de bas de pages
-
1.
CSP, art. L. 3111-2 et CSP, art. L. 3111-3.
-
2.
En France, la politique vaccinale est la prérogative du ministre de la Santé. Cependant les recommandations vaccinales présentées chaque année sous la forme du calendrier vaccinal, s’appuient sur l’expertise du groupe de travail nommé comité technique des vaccinations. Par la loi de politique de santé de 2004, le comité technique des vaccinations était rattaché à la commission des maladies transmissibles du haut conseil de la santé publique. Le CTV a été supprimé par un arrêté du 7 juin 2016, et ses compétences transférées à la haute autorité de santé.
-
3.
CE, 8 févr. 2017, n° 397151.
-
4.
L. n° 2011-2012, 29 déc. 2011, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
-
5.
L. n° 2016-41, 21 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé.
-
6.
Article 47 de la loi 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
-
7.
D. n° 2012-1096, 28 sept. 2012, relatif à l’approvisionnement en médicaments à usage humain.
-
8.
Rappelons ici que la réglementation française distingue le laboratoire titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du laboratoire exploitant l’AMM, le titulaire de l’AMM pouvant assurer l’exploitation du médicament, ou seulement une partie. On entend par opérations d’exploitation du médicament la vente, la publicité, l’information, la pharmacovigilance, le stockage. D’une façon générale, les obligations ou modalités administratives pèsent en France sur l’exploitant. Cette différenciation effectuée entre le laboratoire titulaire et exploitant est spécifique à la réglementation française, le droit européen ne reconnaissant que le titulaire de l’AMM.
-
9.
CSP, art. L.5111-4.
-
10.
CSP, art. R.5124-49-5.
-
11.
CSP, art. L.5121-32.
-
12.
D. n° 2016-993, 20 juill. 2016, relatif à la lutte contre les ruptures d’approvisionnements de médicaments.
-
13.
CSP, art. L. 5423-8.
-
14.
CPI, art. L. 613-16.
-
15.
CSP, art. L.1413-4, ex-CSP., art. L.3135-1.