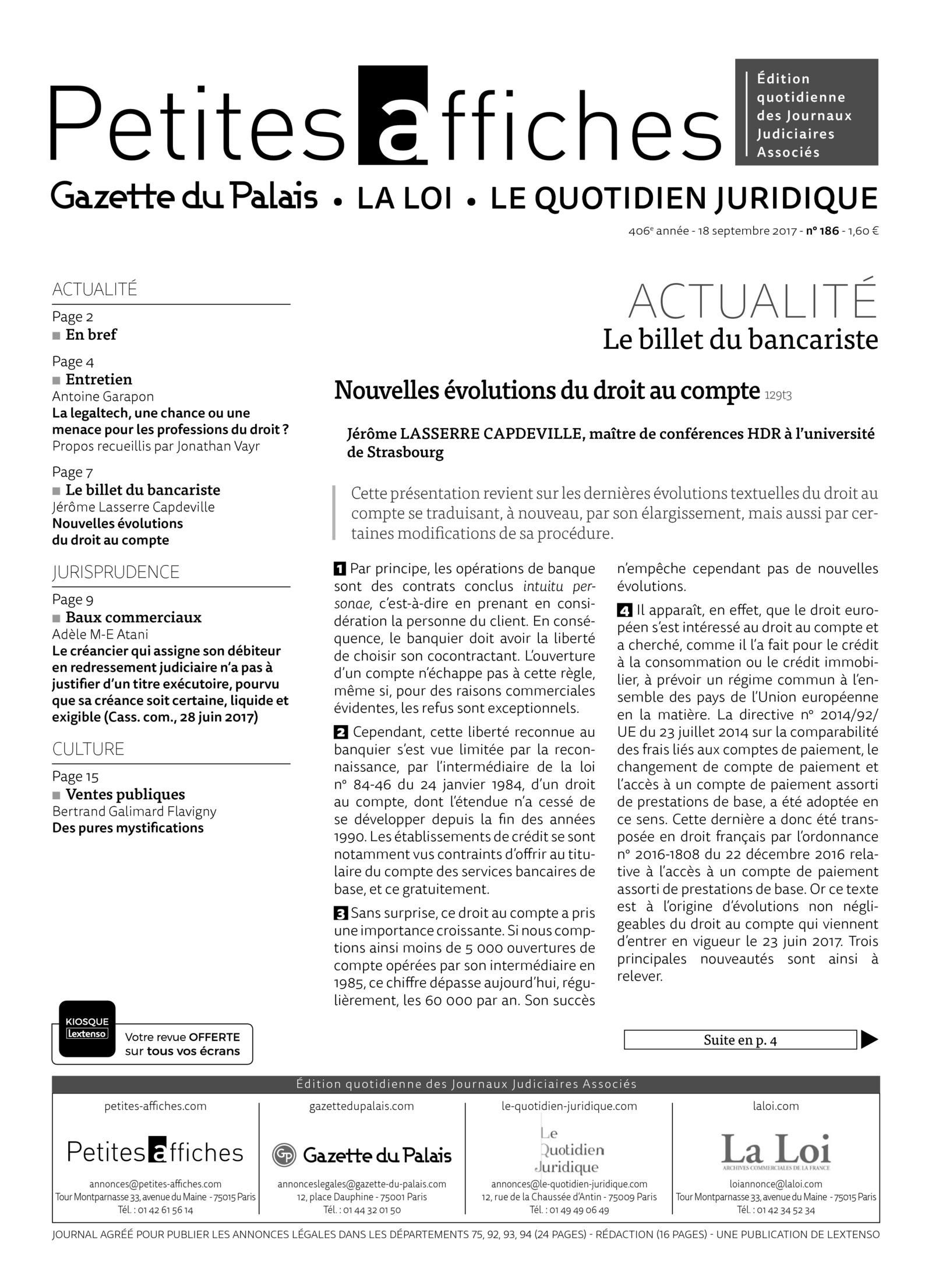Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible
L’arrêt ci-après de la Cour de cassation le déclare haut et fort : « Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible ». Par suite, il serait vain de croire que, faute de signification, le jugement ayant fixé l’indemnité d’éviction ne peut pas être pris en considération au titre du passif exigible, pour caractériser la cessation des paiements du débiteur.
Cass. com., 28 juin 2017, no 16-10025, PB
Cet arrêt de la Cour de cassation concerne l’ouverture d’une procédure collective à la demande d’un créancier, dans le cas particulier d’une créance née en matière de baux commerciaux.
L’arrêt a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2017.
En l’espèce, la bailleresse (la société La Lilloise) fait valoir le défaut de signification d’une décision la condamnant à payer une indemnité d’éviction aux locataires (les consorts X) pour contester l’admission de leur demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Plus précisément, un jugement en date du 22 novembre 2007 avait condamné La Lilloise à payer une indemnité d’éviction aux consorts X ; sur l’appel des consorts X, la cour d’appel de Pau a rendu un arrêt confirmatif.
Saisie par suite, la cour d’appel d’Agen (arrêt du 2 novembre 2015) déclare non avenu, faute d’avoir été signifié dans les 6 mois de sa date, l’arrêt confirmatif, et, annule conséquemment tous les actes d’exécution forcée qui avaient été diligentés. Elle accueille par ailleurs la demande de mise en redressement judiciaire de la société La Lilloise.
La bailleresse critique cette décision : son argumentaire se structure essentiellement autour des incidences qu’elle attache au défaut de signification de la décision. Entre autres arguments, le pourvoi critique la régularité de la décision de la cour d’appel d’Agen. Cet arrêt devrait, selon la société La Lilloise, être regardé comme rendu en violation notamment des articles 478 (qui déclare non avenu le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date), 500 et suivants du Code de procédure civile car, faute de signification, l’instance ayant précédé l’arrêt anéanti subsiste, de sorte que seul le juge saisi de cette instance peut en déclarer l’extinction. L’affaire devrait donc, selon cette société, suivre son cours devant la cour d’appel de Pau afin de constater l’extinction de l’instance.
Les incidences supposées du même défaut de signification de la décision sont invoquées pour critiquer surtout l’admission de l’ouverture de la procédure collective sollicitée par le créancier. Selon le pourvoi, les juges du fond ont injustement déduit l’existence de la créance au profit des demandeurs (les consorts X) du jugement du 22 novembre 2007. Plus précisément, il aurait fallu, selon le pourvoi, s’assurer de l’existence des conditions d’ouverture de la procédure collective sollicitée, sans se référer, de quelque manière que ce soit, au jugement de 2007, faute de caractère exécutoire ou d’une exécution provisoire prononcée.
Une telle lecture et autres argumentations développées autour des incidences de la signification préalable à partir de la décision n’ont pas convaincu : le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui énonce dans un attendu ferme que « le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible ». En l’espèce, les juges du fond avaient clairement énoncé l’objet de la demande des consorts X : ils ne demandaient pas l’exécution du jugement du 22 novembre 2007 (ayant fixé l’indemnité d’éviction à la charge de la société) mais l’ouverture d’une procédure collective. Les hauts magistrats estiment donc que la cour d’appel a relevé, à bon droit, que « par suite de l’annulation de l’arrêt confirmatif, ce jugement avait retrouvé son plein effet, ce dont il résultait que la créance des consorts X sur la société La Lilloise était certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n’ait pas été signifié ». Ladite créance pouvait donc être prise en considération, dans l’estimation du passif exigible afin de caractériser la cessation des paiements exigée pour l’ouverture de la procédure collective sollicitée (le redressement judiciaire du débiteur).
Dans cette affaire, aucune partie ne conteste véritablement le fait que, dans la mesure où les locaux faisaient l’objet d’un bail commercial, le bailleur doit, en cas de refus de renouvellement et à défaut d’un motif légitime (voir les motifs classiques des articles 145-17 et suivants du Code de commerce : reprise des locaux pour habitation, démolition de l’immeuble en raison de son caractère insalubre ou dangereux notamment), verser une indemnité d’éviction au locataire titulaire d’un tel bail.
En fait, l’argumentation de la bailleresse se fonde sur le rôle joué par la décision du 22 novembre 2007 (la condamnant au versement de l’indemnité d’éviction) dans l’admission de la demande ultérieure d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
On sait que l’article L. 631-5 du Code de commerce prévoit que « lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance »1. Lorsque la demande s’appuie sur l’inexécution d’un accord de conciliation en effet, seuls les créanciers parties à l’accord peuvent assigner en redressement ou en liquidation judiciaire.
L’habilitation des créanciers trouve en tout cas son origine dans la logique traditionnelle des procédures collectives conçues initialement comme des procédures principalement axées sur le paiement : l’idée était en effet de saisir les biens du commerçant qui compromet le crédit, un besoin essentiel du commerce, et d’organiser une bonne liquidation de son patrimoine au profit de ses créanciers2. Face à la menace d’impayé qui pèse sur le recouvrement de leurs créances, il semble logique d’autoriser les créanciers à mettre promptement en œuvre les moyens susceptibles de contribuer au règlement de leurs créances, le redressement ou la liquidation judiciaire selon les cas. Aujourd’hui, il est certain que la nouvelle logique des procédures collectives (orientées non plus exclusivement, ou plus exactement principalement, vers le paiement mais davantage vers la prévention et le traitement des défaillances d’entreprises)3 impacte sensiblement ce fondement traditionnel de la faculté d’agir des créanciers. Le législateur n’a pas supprimé ce moyen de droit au profit des créanciers, mais on doit rapprocher l’habilitation ainsi mise en place de la nouvelle conception spécifique des procédures collectives qui ne fait pas du règlement des créances leur objectif central.
En premier lieu et au plan plus processuel, les modalités de cette saisine sont rigoureusement règlementées (ce qui restreint en définitive la recevabilité d’une telle habilitation qui pouvait a priori paraître générale).
L’assignation du créancier doit avoir pour seul objet l’ouverture d’une procédure collective, de redressement ou de liquidation. L’article R. 631-2 du Code de commerce l’affirme clairement, « la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de tout autre demande, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ». Il ressort d’une telle règle que le but de cette habilitation ne saurait devenir, entre les mains des créanciers, une arme contre le débiteur aux abois : il ne s’agit pas d’en faire une action en recouvrement de créance, une sorte de voie d’exécution forcée déguisée. L’objet spécifique de l’assignation conduit ainsi à faire primer l’usage de l’habitation principalement pour le redressement de l’entreprise ; non vers le règlement des créances qu’il pourrait permettre. Comme on le constate, l’habilitation d’un créancier à demander l’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une plénitude de prérogatives à son profit ; on a affaire à un droit soumis à l’influence juridique de cette procédure collective. En conséquence, le tribunal sollicité par un créancier demandant le redressement judiciaire du débiteur, ne peut ouvrir ladite procédure que si ses conditions caractéristiques sont réunies.
En second lieu donc, la même rigueur s’observe également sur le fond. La procédure collective étant au service de l’entreprise, tout créancier qui décide d’assigner en redressement judiciaire doit établir la condition essentielle classique de ces procédures : l’état de cessation des paiements du débiteur. Le créancier doit prouver que l’actif disponible du débiteur (liquidités et autres actifs ne nécessitant pas un important temps de réalisation) ne permet pas de faire face à son passif exigible, à ses dettes échues ; étant entendu que le défaut de paiement de la créance ne peut, à lui seul, caractériser l’existence d’une telle situation.
Selon l’article R. 631-2 du Code de commerce, « L’assignation d’un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur ». La nature et le montant de la créance (qu’elle soit civile ou commerciale) sont des indications qui vont permettre au tribunal d’apprécier l’état de l’entreprise, de savoir si la situation du débiteur manifeste les conditions d’ouverture de la procédure sollicitée, comme dans cette affaire, d’établir si elle est telle qu’un plan de redressement est concevable4. Dans cette démarche d’appréciation de l’état de cessation des paiements, le tribunal saisi peut désigner un juge enquêteur afin de se faire une idée exacte de la situation financière, économique et sociale du débiteur5. À cet égard, l’admission ici de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pouvait apparaître assez banale si cette solution n’impliquait pas également de se prononcer sur l’incidence du jugement ayant condamné le débiteur à payer l’indemnité d’éviction. Fallait-il en tenir compte dans l’appréciation de la situation économique du débiteur alors que le jugement n’a pas été notifié dans les 6 mois de son prononcé ?
La règle semble a priori claire : un jugement par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est considéré comme non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date6. Une telle décision serait frappée de caducité ou de péremption ; la nature de la sanction ne fait pas l’unanimité en doctrine. La procédure peut, en tout cas, être reprise après réitération de la citation primitive. Pour certains, la caducité pour défaut de notification régulière à partie du jugement dans les 6 mois de son prononcé permet de « déjouer les manœuvres d’un demandeur, qui, après avoir obtenu par surprise la condamnation de son adversaire défaillant, spéculerait sur le temps pour espérer la disparition des éléments de preuve que ce dernier pourrait invoquer contre lui »7. La règle est certes protectrice des intérêts du défaillant et la partie qui s’en prévaut ici a estimé qu’elle pourrait lui être bien utile : selon elle, le jugement de condamnation de 2007 est dépourvu de force exécutoire, faute pour l’arrêt d’appel de Pau de constater l’extinction d’instance. On pressent aisément l’espoir que fait naître chez le plaideur une telle position : la procédure pourra être reprise afin d’obtenir une éventuelle décision contraire. Le débiteur ne se tient pas en plaideur battu, du moins pas définitivement.
Mais dans cette décision, les juges du fond et la Cour de cassation par la suite semblent contourner cette conséquence de caducité. Si l’on doit admettre que la caducité de l’article 478 du Code de procédure civile s’abat bien sur le jugement et sur tout son contenu, une telle incidence n’est que du point de vue de l’objet de la première demande qui est la condamnation de la bailleresse à payer une indemnité d’éviction ; l’analyse est inapplicable à la demande d’ouverture de la procédure collective. À l’égard de cette dernière, le jugement retrouve nécessairement son « plein effet ». La créance qui en est issue peut donc être prise en considération dans l’estimation du passif exigible, pour caractériser l’état de cessation des paiements du débiteur. L’admission de cette sorte de « retour à la vie » ou d’existence relative du jugement peut sembler quelque peu péremptoire. En réalité, ce qui semble susciter un certain sentiment d’insatisfaction dans le raisonnement avancé, c’est l’affirmation catégorique selon laquelle par suite de l’annulation de l’arrêt confirmatif, le jugement « avait retrouvé son plein effet, ce dont il résultait que la créance des consorts X sur la société La Lilloise était certaine, liquide et exigible, peu important que ce jugement n’ait pas été signifié ». Certes, on retrouve déjà une position explicite de la Cour de cassation prenant clairement parti pour l’inapplication des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile aux arrêts de la Cour de cassation. Cette solution se justifie, on peut en être convaincu, par la vocation très particulière de la haute juridiction qui n’est pas de rejuger les affaires, mais d’examiner les décisions rendues par les juridictions du fond afin de contrôler leur conformité à la loi lato sensu. Cette circonstance particulière explique que l’attention se fixe davantage sur les points de droit émergeant du litige plutôt que sur l’appréhension des faits, l’analyse de leur constitution. En arrière fond des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile se trouve sans doute le respect du principe d’égalité des armes : protéger le défendeur en évitant toutefois de surprotéger le demandeur gagnant qui attendrait trop longtemps pour notifier la décision, faisant ainsi éventuellement perdre au premier des moyens pour critiquer le jugement. Si la Cour régulatrice veille au respect du droit et non des faits, l’analyse minutieuse de quelque imperfection dans l’élaboration de ceux-ci (éléments relevant du domaine du fait tels que pièces, moyens de preuve ou de fait…) n’est en général pas de son ressort. La chose est classiquement entendue, même si la frontière entre les éléments relevant du domaine du fait et ceux relevant du droit se révèle parfois délicat. Mais quoi qu’il en soit de cette complexité, à l’égard des décisions des juridictions du fond dont la mission est de rejuger les affaires, il semble nécessaire de souligner (démarche rendue nécessaire par cette mission) l’élément ou les éléments qui orientent dans la direction d’une lecture, en un certain sens, ajustée des dispositions a priori générales de l’article 478 du Code de procédure civile. L’interprétation de la sanction suppose davantage une conciliation : d’un côté, protéger les intérêts du défendeur en reconnaissant le caractère non avenu du jugement à défaut de notification à partie ; de l’autre, s’ouvrir aussi à l’éventualité qu’un tel jugement ne soit dénué de tout intérêt. C’est une interprétation audacieuse.
Il faut rappeler que le défendeur ne peut utiliser la voie de l’appel8 aux fins de constatation de non avenu du jugement9, dès lors que l’appel « tend à faire réformer ou annuler » par la cour d’appel un jugement du premier degré10. Or l’enjeu n’est pas mince : ce qui est en cause, c’est la connaissance exacte que le défendeur a pu avoir du procès dirigé contre lui. Les juges semblent s’accorder sur le fait que l’exception11 de jugement non avenu que pourrait opposer le défendeur défaillant12, affectée par de nouvelles considérations, ne peut en définitive produire ici l’effet essentiel escompté (l’inexistence, la caducité, la péremption ou la prescription13 du jugement non signifié). En clair, le jugement confronté à la demande d’ouverture d’une procédure collective est susceptible de faire écho dans l’appréhension des faits.
Assurément, une modification est intervenue en l’espèce dans la demande du locataire : il n’est plus question de la condamnation de la bailleresse au paiement de l’indemnité d’éviction mais de l’ouverture d’une procédure collective à son égard. Cette nouvelle topographie reçoit un examen plus attentif des liens entre la première et la deuxième demande. Les juges opèrent une « dissection » dans les contenus et perspectives juridiques en discussion. Le jugement n’a certes pas de force exécutoire (pour ce qui concerne le paiement de l’indemnité d’éviction), mais il conserve toute sa pertinence dans l’appréciation globale de la nouvelle procédure. L’économie très particulière des procédures collectives concentre désormais l’analyse sur leurs conditions d’ouverture (état économique et financier du débiteur) ; non sur les modalités de connaissance ou d’ignorance de leur origine (le contenu du jugement semble une simple information dans l’ensemble de la réflexion). Plus précisément, l’idée semble être, face à l’irrégularité alléguée, de trancher méthodiquement en faveur du but des procédures collectives si on veut leur donner une pleine efficacité. Comme on l’a dit plus haut, l’objet de l’assignation du créancier d’ouvrir une procédure collective doit être regardé comme étant au service de l’entreprise, afin d’en assurer le sauvetage ou d’en organiser la liquidation. Dans cette configuration, il semble appartenir de toute évidence aux juges du fond, sous réserve toutefois du respect du contradictoire14, de tenir compte des éléments d’ordre financier, économique, social… nécessaires à l’exacte appréciation des conditions de la procédure sollicitée15. Or la solution consiste à soutenir ici qu’au regard de cette demande d’ouverture de la procédure, la créance résultant du jugement est recevable comme élément entrant en ligne de compte dans cette qualification de la situation financière du défendeur. L’autorité du jugement semble même très grande puisqu’on n’observe aucun retour sur son contenu : l’analyse ne donne pas le sentiment d’une certaine hésitation ou tergiversation sur les trois conditions essentielles de la créance énoncées. La créance du locataire qui participe à l’admission de la procédure est dite certaine liquide et exigible. Or d’où peuvent lui venir de telles qualités sinon du respect de l’autorité16 du jugement prononcé ?
On s’aperçoit ainsi que la logique d’inexistence comme sanction du jugement non avenu semble bousculée par cette sorte de « puissance politique » de la procédure collective : l’esprit et la finalité particulière de ces procédures (importance centrale de l’entreprise, de l’avenir de l’activité économique), la nécessité de cristalliser promptement la situation du débiteur sous une forme définie…, poussent à certaines interprétations hardies telles que celles-ci où l’on cherche à contenir la sanction de l’article 478 du Code de procédure civile dans des limites moins rigoristes, compatibles avec une vision plus globale. La logique du droit des entreprises en difficulté ne saurait souffrir des virtualités indécises de la sanction du jugement non avenu. C’est dire dans ces circonstances qu’il est vain ou trop prématuré en tout cas de s’incliner devant le ton impératif de « jugement non avenu ». Il n’est, dès lors, pas étonnant que la nature juridique de cette sanction soit difficile à cerner. Le jugement non avenu présente-t-il un visage multiple ? Tantôt inexistant ou périmé tantôt susceptible, dans certaines circonstances, de produire effet dans l’analyse processuelle ?
Notes de bas de pages
-
1.
C. com., art. L. 640-5, pose les mêmes règles pour la procédure de liquidation judiciaire.
-
2.
V. Ripert G., Cours de droit commercial, 1944-1945, Les cours du droit, p. 577.
-
3.
D’où l’expression plus moderne de « droit des entreprises en difficulté » à la place du classique « droit des faillites ».
-
4.
Il faut rappeler que la procédure de redressement judiciaire « est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif », C. com., art. L. 631-1.
-
5.
Ce juge pouvant d’ailleurs se faire assister de tout expert de son choix, C. com., art. L. 621-1, al. 4.
-
6.
CPC, art. 478.
-
7.
V. obs. Perrot R., ss Cass. 2e civ., 2 mars 2000, n° 97-11736 : Bull. civ. II, n° 37, p. 27 : RTD civ. 2000, p. 637 (inapplication des dispositions de CPC, art. 478 aux arrêts rendus par la Cour de cassation).
-
8.
L’idée est souvent partagée en doctrine que le juge de l’exécution a la compétence de principe pour déclarer non avenu un jugement à l’occasion de la contestation des mesures d’exécution entreprises contre le défaillant. Il faut alors supposer que cette procédure d’exécution est entreprise après notification du jugement au-delà du délai de 6 mois. Mais il est arrivé à la jurisprudence d’admettre cette compétence en dehors de toute procédure d’exécution, v. extraits de l’arrêt rendu au visa des articles 478 et 542 du CPC et de l’article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, Cass. 2e civ., 11 oct. 1995, n° 93-1432 : Bull. civ. II, n° 233 : « Attendu que, M. X, non comparant en première instance, a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire d’un tribunal d’instance qui l’avait condamné en sa qualité de caution à payer à la société DIAC une certaine somme d’argent, demandant à la cour d’appel de dire non avenue cette décision qui ne lui aurait pas été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois ; Qu’examinant cette demande, l’arrêt retient que la signification du jugement avait été régulièrement faite à M. X et déboute en conséquence celui-ci de son action ; Qu’en statuant ainsi, alors que seul le juge de l’exécution était compétent pour se prononcer sur cette demande, la cour d’appel a violé les textes ».
-
9.
La jurisprudence considère qu’un tel appel est irrecevable : Cass. 2e civ., 11 oct. 1995, n° 93-14326 : Bull. civ. II, n° 233 ; RTD civ. 1996, p. 707, obs. Perrot R. ; Cass. com., 20 mars 1978, n° 76-12874 : Bull. civ. IV, n° 93, affirmant que la constatation de la péremption d'un jugement ne constitue ni une annulation ni une infirmation.
-
10.
Le fait de former appel a ainsi été considéré comme valant une renonciation du défendeur défaillant au bénéfice des dispositions protectrices de CPC, art. 478 : Cass. 2e civ., 10 juill. 2003, n° 99-15914 : Bull. civ. II, n° 245 – Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-17882 : Bull. civ. II, n° 419.
-
11.
La procédure pouvant être reprise, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’une exception de procédure, et non une fin de non-recevoir : CA Toulouse, 28 mars 1995, Mme Kirch c/ Epx Mascarell : D. 1996, Somm., p. 137 ; en tant que telle, elle doit être soulevée avant toute défense au fond – Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n° 99-17875 : Bull. civ. II, n° 171.
-
12.
Ce qui serait envisageable dans le cas où la partie protégée serait intimée à la suite de l’appel interjeté par l’autre partie contre le jugement. C’est l’hypothèse qui se présente ici puisque les consorts X ont interjeté appel contre le jugement devant la cour d’appel de Pau.
-
13.
L’interprétation de ce terme « non avenu » est en effet diverse tant en doctrine qu’en jurisprudence ; l’expression qui semble davantage renvoyer aux effets d’une sanction que contenir le sens d’un concept autonome a été parfois rapprochée de l’inexistence (CA Dijon, 18 janv.1980 : JCP G 1980, II 19460 ; RTD civ. 1981, p. 214, obs. Perrot R.) ; ou de la caducité, de la péremption…).
-
14.
Notamment les dispositions CPC, art. 16 : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
-
15.
Étant entendu qu’en principe, le moyen tiré du caractère non avenu du jugement ne peut être soulevé d’office par le juge saisi d’un recours contre ce jugement. Seul le défendeur (que les dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile cherchent à protéger) peut invoquer le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire ou par défaut, le défaut résultant dans cette dernière hypothèse de la non remise à personne de l’assignation. La partie défaillante n’est pas recevable à invoquer le caractère non avenu d’un jugement qui ne lui fait pas grief : Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 11-23256 : Bull. civ. II, n° 149.
-
16.
Or le jugement n’a force de chose irrévocablement jugée que s’il n’est plus susceptible d’aucune voie de recours, article 500 du Code de procédure civile : « À force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».