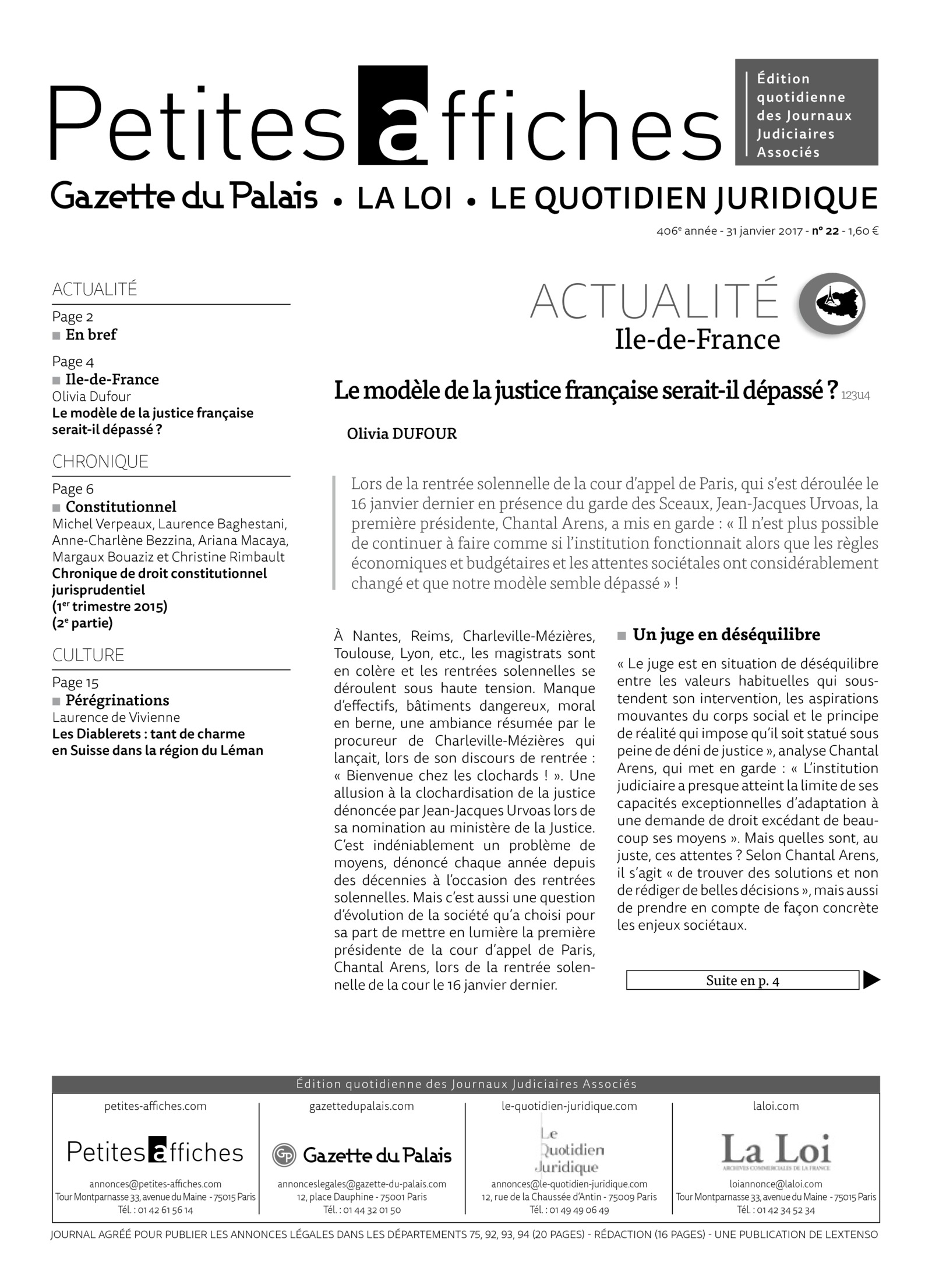Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (1er trimestre 2015) (2e partie)
La chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel est ouverte à l’ensemble des décisions susceptibles d’intéresser le droit constitutionnel dans sa dimension contentieuse considérée de la manière la plus large. C’est ainsi que le contentieux électoral est intégré dans la présente chronique qui est divisée en quatre parties correspondant aux thèmes principaux du droit constitutionnel contemporain qui intègre aussi bien les questions institutionnelles que les problèmes de hiérarchie des normes et la place des droits et libertés.
Afin d’être plus réactive, cette chronique est désormais trimestrielle et celle présentée ci-dessous couvre les mois de janvier à mars 2015.
I – Les sources du droit constitutionnel et les normes de référence
A – Les normes de la Constitution
1 – La compétence du législateur (…)
2 – Le contrôle du domaine de la loi et du règlement
3 – La Constitution numérotée (…)
4 – La Déclaration de 1789 (…)
5 – Les droits garantis par le Préambule de 1946
6 – Les PFRLR
7 – La Charte de l’environnement (…)
8 – Les objectifs de valeur constitutionnelle
B – Normes constitutionnelles non invocables dans le cadre de la QPC
C – L’articulation entre le droit interne et les normes internationales et européennes
II – Le procès constitutionnel
A – Les acteurs du contentieux constitutionnel (…)
B – La procédure devant le Conseil constitutionnel
La décision SEN Yonne n° 2014-4909 du 23 janvier 2015 est la quatrième QPC1 d’une série sui generis, celle des « QPC électorales ». Comme toute innovation prétorienne, la QPC électorale s’est forgée sur le fait. À chaque application, un nouvel élément du régime juridique – si le terme est adapté – de la procédure est apparu.
La QPC électorale est née lors des précédentes élections sénatoriales. Directement posée au Conseil constitutionnel (un mémoire avait été joint sans les formes), elle semblait pouvoir installer une telle pratique. En effet, à l’issue du contentieux des législatives qui suivirent, toutes les QPC électorales furent posées directement auprès du Conseil (c’est également la particularité du scrutin qui le veut), jouant à la fois le rôle de mémoire en défense et de mémoire de QPC. L’on pouvait être surpris de l’absence de filtrage de la QPC qui plaçait ce faisant le Conseil constitutionnel en unique (et dernier) arbitre. L’on pouvait être également surpris que cette QPC – indéniablement liée au litige – ne fusse jugée sérieuse uniquement par le Conseil constitutionnel qui se trouvait amené à se prononcer sur la constitutionnalité de la base légale du litige qu’il aura à appliquer in fine.
Aujourd’hui, il n’est pas certain que l’on doive se réjouir que les éléments du régime de la QPC électorale aient (encore) changé. Dans l’espèce étudiée le Conseil constitutionnel fut saisi dans des conditions inédites. Contestant le refus d’enregistrement de sa candidature aux élections sénatoriales de l’Yonne (dans les conditions fixées par l’article L. 160 du Code électoral) auprès du tribunal administratif (TA) de Dijon, M. Villiers avait soumis au même tribunal une QPC formulée à l’encontre de l’article LO 135 du Code électoral. Trahissant toute sa perplexité devant l’affaire, le TA, par une ordonnance de son président – tout en rejetant la requête au fond – transmit au Conseil d’État (le 18 septembre 2014) la requête sur le fond (doublée du mémoire) alors que selon les dispositions de l’article LO 160 du Code électoral, le Conseil constitutionnel est, dans ce cadre, seul juge de cassation des affaires jugées par le TA. Le Conseil d’État se trouvait donc incompétemment saisi du litige électoral, mais il l’était plus logiquement de la QPC dont il est en effet le « filtre naturel ». Néanmoins, étant donné que le TA dans le cadre de l’article LO 160 du Code électoral dépend, en cassation, du Conseil constitutionnel, il ne constitue donc pas une « juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation » au sens de l’article 23-1 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État était donc incompétemment saisi des deux questions. Il considéra néanmoins, par une décision du 7 novembre 2014, que, dès lors qu’au fond, la décision du TA ne pouvait être contestée en cassation qu’auprès du Conseil constitutionnel, il ne lui appartenait pas d’examiner la QPC au sens de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
On aurait pu penser que la lettre de ce texte se trouvait enfin respectée si le Conseil d’État n’avait pas immédiatement poursuivi que « par suite, il y a lieu (…) de transmettre (…) au Conseil constitutionnel » ! S’il est en effet le juge de cassation naturel de la requête sur le fond, il semblait pourtant qu’à bien relire les dispositions de l’article 23-1, le Conseil constitutionnel ne le soit pas de la QPC.
On note que le Conseil d’État se garde bien d’examiner les trois conditions de transmission, préservant ainsi à la QPC électorale tout son impressionnisme initial. Partant, il inaugure une nouvelle procédure dite de « transmission »2 différant du « renvoi » au sens de l’article 23-4 de la loi organique ; la première se matérialise par le simple envoi d’une requête présentée par erreur à un juge incompétent, lorsque la seconde doit remplir chacune des trois conditions d’examen (et de filtrage) posées par le texte organique. Il s’agit là d’une réelle inégalité procédurale qui ne dit pas son nom.
Tout bonnement incompétent à opérer tant l’examen sur le fond que la transmission de la QPC, on aurait pu attendre du Conseil d’État qu’il le déclare. Sa bienveillance à l’égard de la requête était d’ailleurs on ne peut plus superflue en présence d’une voie de droit alternative et d’un requérant déterminé qui, sans attendre la décision du Conseil d’État (saisi par erreur ou par audace par le tribunal administratif de Dijon) avait d’ailleurs presque immédiatement contesté, dans les formes cette fois-ci, devant le Conseil constitutionnel le 8 octobre 2014, l’élection des deux sénateurs de l’Yonne.
Il convient de remarquer également au passage que la « transmission » d’une QPC électorale semble violer le texte, déjà fort nouvellement arrangé, du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs qui s’était déjà montré fort clément – et fort contradictoire par rapport au texte organique qui aurait gagné à être respecté dans une logique de hiérarchie des normes – à l’égard de la nouvelle procédure. L’alinéa premier de l’article 16-1 du règlement intérieur dispose en effet que la QPC est soulevée « à l’occasion d’une procédure en cours devant lui [le Conseil constitutionnel] ». Il suffira sûrement de modifier à nouveau le texte pour l’adapter aux nouvelles exigences des transmissions qui suivent un recours infondé !
Le Conseil constitutionnel a considéré qu’il était saisi valablement de la QPC en ces termes ambigus : « le mémoire distinct (…) présenté (…) devant le tribunal administratif de Dijon (…) enregistré le 7 novembre 2014 ». Le TA de Dijon n’ayant jamais renvoyé au Conseil constitutionnel ce mémoire, l’on ne saurait déterminer précisément si le Conseil constitutionnel s’en remet aux écritures du requérant ou bien à la transmission du Conseil d’État.
On ne peut pas même se réjouir de l’arrivée de nouveaux « filtres » dans le contentieux des QPC électorales puisque l’on remarque qu’à chaque niveau les juges n’exercent, dans ce cas, aucun examen des conditions de recevabilité organiques.
On n’a pas fini d’en apprendre sur la QPC électorale…
C – Les techniques contentieuses (…)
D – L’autorité et les effets des décisions du Conseil constitutionnel
EADS et le Conseil constitutionnel : initiation au délit d’initié
Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC, M. John L. et a. [Cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour manquement d’initié]. Un feuilleton judiciaire, de multiples rebondissements, tous les éléments étaient présents pour faire de l’affaire EADS une grande décision marquant le début d’un cycle et la fin d’un autre.
Il convient de replanter rapidement le décor afin de découvrir tous les apports de l’affaire. Le 4 mars 2014, mettant en cause la CNOSOB (l’équivalent de notre AMF ou plutôt de notre ancienne COB) et les frasques d’un avocat italien, la Cour européenne des droits de l’Homme rend un arrêt contre l’Italie et renouvelle ainsi l’interprétation du principe non bis in idem. Ce principe latin remontant aux écrits d’Ulpien signifie littéralement qu’il est impossible d’être puni deux fois pour une même chose. Principe fondateur du droit pénal, le non bis in idem dispose des avantages d’un droit fondamental et a les inconvénients d’un principe de procédure.
Dans cette affaire, le non bis in idem imposait à l’Italie de mettre fin au système de cumul des poursuites administratives et pénales pour un même fait ; combinaison lourde s’il en est, qui n’est pourtant pas l’apanage de l’Italie puisque, précisément, la France l’utilise presque à l’identique.
Les passions judiciaires eurent d’ailleurs tôt fait de se déchaîner dans l’Hexagone. Le tribunal de grande instance de Paris (et particulièrement sa 11e chambre, spécialisée dans les affaires financières) eut à juger à quelques mois d’intervalles les affaires EADS3, Oberthur4, Pechiney5 ou encore Altran6 qui présentaient toutes une configuration – ou du moins une structure – proche : ces affaires entendaient attirer l’attention des juges sur la récente affaire italienne et, partant, sur la nécessité d’étendre le principe non bis in idem afin d’empêcher toute combinaison entre les poursuites financières et pénales. À chaque fois, les avocats de la défense avaient tenté une QPC et ce n’est qu’après deux premiers échecs que – à la suite d’une amélioration considérable des mémoires – deux d’entre elles passèrent avec succès l’étape du TGI d’abord puis celle de la Cour de cassation.
Les trois QPC ont été transmises au Conseil constitutionnel les 19 décembre 2014 et 4 février 2015 par la Cour de cassation. Sur le fondement de la conception européenne du non bis in idem, les requérants entendaient contester la constitutionnalité du dispositif de cumul des poursuites (et des peines) entre le délit et le manquement d’initié ; cumul qui était rendu possible par la combinaison de l’article 6 du Code de procédure pénale (CPP) avec les articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du Code monétaire et financier (CMF). Un tel cumul apparaissait, pour la défense, contraire tant au principe de nécessité des peines (article 8 de la Déclaration de 1789), qu’à la présomption d’innocence (article 9) et au principe de proportionnalité. Les requérants invoquaient également des critiques à l’encontre de l’article 6 du Code pénal, mais la solution de conformité semblait acquise d’avance.
Par une décision de non conformité partielle, le Conseil constitutionnel s’est prononcé de manière mesurée sur le non bis in idem. Il a tenté de consolider l’équilibre instable propre aux « exceptions françaises » – au titre desquelles il faut désormais compter l’adage latin. En évitant l’effet domino (I), il a été soucieux de ne pas produire d’effet papillon (II).
I. De l’effet domino…
L’argumentation des différentes requêtes, toute en finesse, avait été soigneusement travaillée afin de contourner l’obstacle constitutionnel du « non déjà jugé » au sens de l’article 23-2 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel du 7 novembre 1958. Il était en effet acquis que, de jurisprudence constante – et réaffirmée peu avant7 – le Conseil constitutionnel, depuis 19898, admettait la constitutionnalité du cumul des poursuites tout en limitant – par un seuil de proportionnalité – le cumul des peines qu’il induit. Rendue à propos de l’ancienne COB, la décision de 1989 renseignait sur le sens constitutionnel du système français de cumul des poursuites : se fondant sur l’absence d’identité de « cause juridique » (c’est-à-dire de droit applicable ou encore de fondement social) des deux poursuites, le Conseil constitutionnel estimait qu’un même fait pouvait mériter d’être poursuivi deux fois, par deux ordres de juridiction. Cet équilibre constitutionnel reposait en réalité sur celui déjà trouvé historiquement par le Conseil d’État en matière disciplinaire9 – même si le non bis in idem est un principe général du droit10 – et qui s’inspire lui-même de la jurisprudence acquise en matière pénale11.
Il convient, avant d’étudier l’apport de la décision EADS, de résumer le sens des jurisprudences convergentes de la Cour de cassation, du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel sur la portée du principe non bis in idem.
Les sanctions administratives peuvent se cumuler aux sanctions pénales, sous réserve d’une proportionnalité de la sanction globale, qui suppose un certain dialogue entre les juges et qui préserve les droits du condamné12. Néanmoins, ce cumul plafonné – qui n’est autre que la mouture de droit public du non bis in idem – n’est valable qu’au stade de la sanction qui clôt les doubles poursuites. Ces dernières, si elles relèvent de juridictions d’ordres différents ou encore si elles ne poursuivent pas le même but, peuvent se cumuler : c’est le principe d’indépendance des procédures dans lequel on peut voir une prolongation de celui de séparation des autorités administratives et judiciaires13.
Dans ce théâtre de jurisprudences harmonisées, le droit européen – tant de l’Union que des droits de l’Homme – a joué le rôle du trouble-fête.
Plus conciliante, la Cour de justice de l’Union européenne, se fondant sur les textes de l’article 54 de la Convention de Schengen14 et de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, admet le cumul des poursuites, dès lors qu’il n’existe pas de consensus européen sur cette question15. La Cour européenne des droits de l’Homme, de son côté, a toujours été plus hostile au système. Longtemps fluctuante sur l’identification de l’idem16, la Cour s’est ensuite fixée sur une jurisprudence totalement inverse à celle des juges français17 et cela en vertu de l’article 4 du protocole n° 7 annexé à la Convention18 en combinaison avec l’article 6 de cette dernière. La jurisprudence est – en résumé – la suivante : il y a violation du non bis in idem dès lors que sont poursuivies deux fois les mêmes personnes pour les mêmes faits, dès lors que les deux poursuites relèvent de la « matière pénale » au sens de la Convention – c’est-à-dire tout le domaine punitif, sanctions administratives incluses19. Ces mêmes faits sont donc les mêmes faits matériels, indépendamment de leur qualification par le droit. Le plus choquant se trouve sûrement dans le fait que la Cour, pour parvenir à cette interprétation, ne tient aucun cas des réserves formulées par les États à l’encontre du texte du protocole (dont l’Italie et la France) au motif que ces réserves ne sont pas assez précises.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu l’arrêt Grande Stevens que la Cour de cassation, pour renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, qualifia de changement de circonstances de droit (pour les articles du Code monétaire et financier).
Implicitement, il faut également considérer que le Conseil constitutionnel a tenu compte de cette jurisprudence pour réévaluer la constitutionnalité des textes. Le Conseil a d’ailleurs entendu préciser la version applicable pour chaque texte critiqué (cons. 5 et 6).
À l’occasion de l’examen des articles L. 465-1 et suivants du Code des marchés financiers (CMF) relatif au délit d’initié réprimé par le juge pénal et L. 621-15 et suivants du même code relatif au manquement d’initié réprimé par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, le Conseil constitutionnel avait le choix de réaffirmer sa jurisprudence constante ou de l’adapter aux exigences européennes.
Il ne fit ni l’un ni l’autre.
En effet, en la matière, les doubles poursuites pouvaient apparaître particulièrement choquantes. Les plaidoiries devant le Conseil avaient permis de dégager l’identité très marquée des infractions poursuivies, la lourdeur astronomique des sommes requises (qui résultait de l’évolution de la législation) et l’étrange déconnexion de jugement entre deux poursuites qui avaient les mêmes éléments d’identification. La Commission des sanctions de l’AMF et le parquet financier pouvaient ainsi en arriver à des solutions différentes après qu’une instruction – voire une enquête – relativement identique ait été menée.
Le cas de la double poursuite en matière financière était idéal pour un revirement mesuré que le Conseil choisit d’opérer par un enrichissement de sa jurisprudence sans pour autant la remettre en cause.
Pour ne pas affaiblir la jurisprudence relative à la proportionnalité de peines – fondée sur la branche « proportionnelle » de l’article 8 de la Déclaration de 1789 – le Conseil constitutionnel n’a pas suivi la motivation de la requête qui consistait à y attacher le non bis in idem (ce qui aurait été susceptible de remettre en cause le cumul des poursuites, des qualifications et des sanctions), il s’est fondé sur la branche « nécessité » des peines de l’article 8 de la Déclaration à qui il a donné une nouvelle jeunesse. En se fondant sur cette nécessité, le Conseil constitutionnel a créé une jurisprudence encadrant le cumul des poursuites qui s’ajoute à la jurisprudence relative au cumul des sanctions.
Afin de censurer le cumul des poursuites en matière de délit et de manquement d’initié, le Conseil constitutionnel a créé quatre conditions au cumul des poursuites :
-
les deux infractions ne doivent pas avoir la même qualification, c’est-à-dire les mêmes éléments constitutifs notamment. La comparaison de la définition du délit d’initié et du manquement d’initié a conduit le Conseil à relever que les articles L. 465-1 et L. 621-15 du CMF tendent à réprimer les mêmes faits ;
-
les deux infractions ne doivent ensuite pas protéger les mêmes intérêts sociaux, ce qui rendait là encore les articles L. 465-1 (qui se rapporte aux « infractions relatives à la protection des investisseurs ») et L. 621-1 (lié à « la protection de l’épargne investie » dans les instruments financiers) trop proches ;
-
en troisième lieu, le Conseil a estimé que les deux poursuites ne devaient pas être sanctionnées par le même « type » de punitions. Le cumul des sanctions des délits et manquements d’initiés conduisait en effet à un cumul d’amendes lourd (puisque la peine d’emprisonnement possible en matière pénale est marginalement utilisée en présence régulière de personnes morales responsables) ;
-
enfin, les deux poursuites ne doivent pas relever du même ordre de juridiction (ce qui était encore une fois le cas des deux infractions).
Ce conditionnement du cumul préserve habilement la quasi-totalité des configurations permises par le droit français. Par exemple, les procédures disciplinaires sont préservées par l’existence d’ordre de juridiction autonome (et d’un intérêt social qui peut paraître différent), enfin, les sanctions fiscales le sont également avec les deux éléments susmentionnés. En conservant dans les quatre critères du cumul des poursuites la différence de qualification et d’intérêt social, le juge constitutionnel était assuré de ne pas faire souffrir le droit français au-delà de la censure du doublon des délits et manquements d’initié.
II. … à l’effet papillon
L’effet papillon désigne, dans le cas d’actions causales en séries, les conséquences décuplées en fin de chaîne d’une minuscule action produite en début de chaîne.
Soucieux de la solidité de son édifice, le Conseil constitutionnel a utilisé à nouveau dans la décision ses (super) pouvoirs de modulation des effets de l’inconstitutionnalité.
Il faut, pour comprendre la complexité de la solution des effets, se replacer dans la configuration des doubles poursuites et sanctions déclarées inconstitutionnelles dans le cadre de la décision.
Le passage sur l’inconstitutionnalité de la décision est rédigé clairement (cons. 28), puisque ce n’est pas tant la définition du délit d’initié ou celle du manquement qui souffre du vice de contrariété à la nécessité des peines quadruplement balisée, mais c’est bien la combinaison des deux infractions qui est critiquée (et censurée !).
En matière de déclaration d’inconstitutionnalité relative aux infractions, la jurisprudence relative aux effets du Conseil constitutionnel est assez clairement fixée : le juge préfère – en règle générale – s’en remettre aux effets de l’abrogation à la date de lecture de la décision afin de ne pas laisser subsister dans l’ordre juridique une infraction inconstitutionnelle. Le cas d’une inconstitutionnalité née de la combinaison de deux infractions est inédit et le Conseil constitutionnel lui a donné une solution originale. Soucieux de ne pas priver de base légale les affaires pendantes (alors qu’on l’a connu moins précautionneux pour créer un vide juridique dommageable20), le Conseil a préféré s’en remettre à une abrogation avec effet différé afin de laisser le soin au législateur de solutionner cette inconstitutionnalité « combinatoire ». Il convient d’ajouter que si l’abrogation par le Conseil constitutionnel d’un seul des deux dispositifs avait pu solutionner le problème né de leur cumul, cette solution aurait néanmoins eu l’inconvénient de conduire le Conseil constitutionnel à « choisir » l’infraction à sacrifier (entre le délit et le manquement d’initié), alors même que ce n’était pas l’une ou l’autre des infractions en elle-même qui était inconstitutionnelle. Au titre de ses pouvoirs, lorsqu’il utilise la modulation des effets de l’abrogation, le Conseil constitutionnel a la possibilité de proposer un sursis à statuer de chaque affaire pendante jusqu’à l’adoption de la loi nouvelle21 qui peut, à ce stade, éviter l’injustice par le maintien de l’inconstitutionnalité autant qu’elle ne crée pas de vide juridique. Néanmoins, là encore, la solution pouvait paraître délicate en l’espèce du fait de la multiplicité des affaires concernées – directement et moins directement – par le cumul des poursuites. Il ne faut d’ailleurs pas omettre que la solution de gel des procédures est applicable devant les juridictions (l’AMF semblait moins concernée par cette possibilité).
On le comprend, le juge constitutionnel était susceptible par une simple inconstitutionnalité de déstabiliser toutes les poursuites en cours et d’avoir ainsi des conséquences décuplées – un effet papillon !
Aussi, le Conseil constitutionnel – que l’on peut estimer, pour cette fois, fondé à rechercher une solution « de bric et de broc » au vu de la complexité de la situation – a eu recours au pouvoir de « quasi législation » autrement qualifié de « réserves transitoires » par lequel il ne fait rien d’autre que de proposer une législation applicable à la période d’incertitude – liée à l’abrogation différée – qu’il créée. Appliquée plusieurs fois depuis lors – essentiellement en matière fiscale, matière connue pour sa complexité – cette solution « de crise » est justifiée par le Conseil constitutionnel (dans ses écritures « officielles » qui accompagnent les décisions) par la balance entre les différents intérêts en présence et l’incomplétude des outils ordinaires (abrogation à la date ou avec effet différé). N’ayant jamais défini les critères du recours à cette technique – ni ses limites, ce qui semble le plus douteux – le Conseil constitutionnel a jusqu’à présent fait une utilisation parcimonieuse du dispositif qui l’a néanmoins conduit à « créer » déjà deux régimes fiscaux de transition (pour pallier la petite rétroactivité potentielle de la loi à venir). En l’espèce, il a interdit aux juges judiciaires et à l’AMF toute double poursuite future en fixant un critère d’antériorité (la première poursuite peut aller jusqu’à son terme mais la seconde devra tomber). Cette réserve transitoire ne l’a donc pas conduit à créer un régime mais à imposer cette fois-ci une marche à suivre aux affaires en cours. Ainsi, ne pourront être engagées ni continuées les poursuites pour délit d’initié si toutefois des poursuites pour manquement étaient en cours ou déjà terminées et inversement (cons. 36).
La quasi-législation est ainsi entrée dans les mœurs du Conseil constitutionnel et a pris ici un nouveau tournant puisqu’elle permet au juge, par une réserve d’interprétation, d’imposer à d’autres juges l’abandon de procès en cours. En plus du report des effets de l’abrogation, le Conseil constitutionnel peut donc – au titre de son pouvoir exceptionnel prévu par l’article 62 de la Constitution de se préoccuper des effets passés de l’acte – proposer une législation de carence, en chargeant en fin de chaîne le législateur de mettre fin à cet arrangement approximatif avec l’ordre naturel des choses !
E – Les actes susceptibles de contrôle
La décision du 26 mars 2015, n° 2015-460 QPC, Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et a., a permis au Conseil constitutionnel d’exercer classiquement son contrôle des conditions d’examen des QPC.
Saisi par le Conseil d’État de deux QPC (le 21 janvier 2015), l’une portant sur l’article L. 310-1 du Code de sécurité sociale (CSS) et l’autre sur l’article L. 380-2 du même code, le Conseil constitutionnel eut à déterminer, pour la deuxième QPC, de quelles « phrases » il pouvait être valablement saisi.
En effet, la question – concernant la conformité au principe d’égalité devant les charges publiques de l’affiliation aux cotisations dues par les personnes affiliées au régime général d’assurance maladie, en ce qu’elles sont assises sur l’ensemble des revenus de la personne et en ce qu’elles assurent une exonération de cotisation pour certains contribuables dont le montant des revenus est inférieur à un seuil – fut tout d’abord circonscrite par le Conseil constitutionnel, au vu des griefs formulés, aux seuls premier et deuxième alinéa de l’article. On a déjà eu l’occasion de l’écrire, cette circonscription de l’objet du litige est classique et très fréquente de la part du Conseil constitutionnel qui y voit un moyen d’éviter tout « procès fait à la loi » dans le cadre de la QPC qui conserve ainsi son caractère subjectif.
Affinant toujours plus son examen, le Conseil constitutionnel distingua deux « paquets » de textes : un premier paquet contenant les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 2 et un second paquet de texte contentant les première et dernière phrases du deuxième alinéa et le premier alinéa. Les deux groupes de dispositions ne posaient pas les mêmes problèmes de recevabilité.
Il convient de s’arrêter un temps sur la QPC ainsi « disséquée ».
Elle permet de prendre l’ampleur des modifications législatives des dispositions codifiées qui font d’un article de code, le réceptacle de multiples rédactions. Pour être précis – du fait de la condition de non déjà jugé fixée par la loi organique – le Conseil constitutionnel n’a donc d’autre choix que de refaire « l’historique » des dispositions codifiées alinéa par alinéa et ligne après ligne.
Le premier groupe de dispositions (deuxième et troisième phrases de l’alinéa 2) avait été inséré dans l’article du code par la loi du 21 décembre 2006 qui n’est jamais entrée en vigueur faute de décret d’application. Si cette absence de décret d’application n’a pas semblé gêner le Conseil d’État qui a transmis la QPC, le Conseil constitutionnel a rappelé une jurisprudence acquise22 qui veut qu’une disposition de loi non entrée en vigueur – fût-ce du fait de l’absence de décret d’application – est insusceptible d’avoir causé un quelconque grief au requérant (condition que le Conseil dégage de la condition d’applicabilité au litige de l’article 23-2 autant que de la formulation de l’article 61-1 de la Constitution).
Enfin, le second groupe de dispositions (premier alinéa et première et dernière phrases de l’alinéa 2) avait déjà été jugé par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif d’une précédente décision. Restait donc à avérer un changement des circonstances de droit ou de fait pour contourner le blocage posé par l’article 23-2 de la loi organique, que le Conseil constitutionnel a trouvé dans la modification successive des rédactions de l’article. Sa jurisprudence en matière de modification législative n’est pas fixe puisqu’il peut tantôt considérer que la modification de la législation conduit à un changement de circonstances ou qu’au contraire, ce changement suffit à considérer que la disposition n’est plus celle déjà jugée dans les motifs et le dispositif d’une précédente décision23. Dans le cas où un changement de circonstances est avéré – comme en l’espèce – le Conseil constitutionnel entend examiner que le changement est d’une importance suffisante pour que le texte soit modifié « substantiellement ». Il s’est en l’espèce appuyé sur l’extension du revenu fiscal de référence à de nouvelles catégories de revenus, ce qui a élargi l’assiette de la cotisation, pour examiner à nouveau la constitutionnalité de l’article.
ACB
III – Les institutions constitutionnelles
A – Les pouvoirs politiques : le pouvoir exécutif
Cons. const., 27 févr. 2015, n° 2014-450 QPC, M. Pierre T. et a. Deux militaires, MM. Pierre T. et Michaël G., ont saisi la juridiction administrative des sanctions de mise aux arrêts qui leur ont été infligées par l’autorité et ont contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ces mesures devant deux tribunaux administratifs différents, celui de Châlons-en-Champagne et celui de Nîmes. C’est en appel qu’ils ont soulevé une QPC contre l’article L. 4137 2 du Code de la défense en tant qu’il prévoit la sanction des arrêts. La même disposition prévoit aussi que « Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger. En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement. Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État ». Dans sa décision 450 QPC, le Conseil a déclaré conforme à la Constitution du e) du 1° de l’article L. 4137-2 du Code de la défense.
Dans cette décision, Renaud Denoix de Saint-Marc a jugé nécessaire de ne pas siéger, en application de l’article 4 du Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, selon lequel « Tout membre du Conseil constitutionnel qui estime devoir s’abstenir de siéger en informe le président » (al. 1), comme il l’avait fait pour la décision n° 432 QPC du 28 novembre 2014 du Conseil constitutionnel, M. Dominique de L. La raison en est qu’il avait présidé, en qualité de vice-président du Conseil d’État, la commission de révision du statut général des militaires qui s’était intéressé à la question des incompatibilités entre les fonctions électives et le statut de militaire. Le rapport de cette commission, rendu public le 29 octobre 2003, est à l’origine de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
Le Conseil constitutionnel a opéré une lecture restrictive du renvoi effectué par le Conseil d’État dans ses décisions nos 384984 et 385056 du 17 décembre 2014 qui a renvoyé la QPC relative aux dispositions de l’article L. 4137-2 du Code de la défense « en tant qu’il prévoit la sanction des arrêts » ; « que le Conseil constitutionnel n’est ainsi pas saisi des dispositions de l’avant-dernier alinéa de cet article aux termes desquelles les arrêts peuvent être « assortis d’une période d’isolement » ; que, par suite, la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur le e) du 1° de l’article L. 4137-2 du Code de la défense ».
Le renvoi par le législateur à un décret peut constituer une incompétence négative mais, dans le cadre du contrôle a posteriori, il est de jurisprudence constante que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit24.
L’examen de l’éventuelle incompétence pose la question du lien entre la compétence du législateur en matière de protection des droits et des libertés. Sur ce point, l’article 34 dispose que la loi « fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux militaires ». Ces droits sont compris comme étant les droits et libertés constitutionnellement garantis mais dans les limites inhérentes aux obligations particulières attachées à l’état militaire. La conciliation des droits et des libertés et des autres exigences constitutionnelles est exacerbée en matière militaire. Si les militaires sont des citoyens, ils sont, dans le cadre de leurs fonctions, astreints à des obligations particulières et plus contraignantes que celles des autres agents publics. Le Conseil a rappelé dans cette décision le partage des compétences au sein du pouvoir exécutif.
I. Le rôle de l’exécutif dans la conduite des affaires militaires
Ce sont les articles 5 et 15, 20 et 21 rappelés au considérant 6 de la décision 450 QPC qui constituent le fondement d’un tel partage. Selon les deux premiers articles, le président de la République est le chef des armées, il assure, par son arbitrage, la continuité de l’État et il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Les deux articles 20 et 21 donnent au Gouvernement la compétence de disposer de la force armée et font du Premier ministre le responsable de la défense nationale. En dehors de la question de la déclaration de guerre, qui est autorisée par le Parlement, et de l’engagement des forces armées à l’étranger qui requiert l’autorisation du Parlement au-delà de quatre mois, en application de l’article 35 modifié en 2008 de la Constitution, le Conseil déduit de la combinaison de ces articles, que « le Gouvernement décide, sous l’autorité du président de la République, de l’emploi de la force armée ; que le principe de nécessaire libre disposition de la force armée qui en résulte implique que l’exercice par les militaires de certains droits et libertés reconnus aux citoyens soit interdit ou restreint » (cons. 6). Ce considérant avait déjà été formulé dans la décision précitée n° 432 QPC (cons. 9). Dans les deux décisions, séparées seulement de quelques semaines, le rapport hiérarchique entre les deux têtes de l’exécutif est bien marqué par la référence à l’autorité présidentielle, quelle que soit la période considérée, qu’elle soit de concordance ou de discordance de majorités présidentielle et parlementaire, le Conseil constitutionnel ne faisant pas de distinction entre ces situations.
II. Les nécessaires et possibles restrictions des droits et libertés des militaires
Les contraintes de l’état militaire ont été rappelées dans la décision 450 QPC par ce qui n’est qu’une lecture de certains articles du Code de la défense. Ce ne sont pas celles qui sont en cause dans la QPC, mais elles servent de toile de fond à l’examen du e) du 1° de l’article L. 4137-2 du Code de la défense. Ce qui signifie que ces contraintes ne sont pas intangibles et qu’elles pourraient évoluer, dans le sens d’une aggravation ou dans le sens, contraire, d’une diminution. Pour le Conseil constitutionnel, le seul élément à prendre en compte serait de savoir si ces dispositions restreignent de manière excessive les droits et les libertés des militaires ou si, au contraire, trop laxistes, elles seraient de nature à empêcher les autorités exécutives d’exercer les compétences que la Constitution leur donne dans la conduite des affaires militaires. C’est ainsi que, selon l’article L. 4111-1 du Code de la défense : « L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité ». Quant à l’article L. 4121-1 du même code, il dispose que : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre ». Ce qui se rapproche le plus des attributions militaires du président de la République et du Premier ministre est contenu au premier alinéa de l’article L. 4121-5 affirmant que : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ». Il en découle une restriction à la liberté d’aller et venir puisque les militaires peuvent appelés à servir sur l’ensemble du globe.
Ce cadre étant posé, il faut se demander si les libertés et les droits invoqués par les deux militaires requérants ont été méconnus par la disposition législative contestée. Le Conseil répond tout d’abord que le grief tiré de la violation de la liberté individuelle est inopérant car la sanction disciplinaire prévue n’entraîne pas une privation de liberté. L’intervention du juge judiciaire n’est donc pas nécessaire, mais le commentaire de la décision opéré par le Conseil constitutionnel signale que cette compétence pourrait s’avérer nécessaire pour examiner « le jour venu » les dispositions législatives relatives aux arrêts assortis d’une période d’isolement, ce qui n’était pas le cas dans l’espèce considérée. Les arrêts, pas plus que l’assignation à résidence d’un étranger, ne constituent des mesures de privation de liberté25.
Reste alors la restriction à la liberté d’aller et venir. Celle-ci, après avoir été assez longtemps confondue avec la liberté individuelle, est désormais une composante de la liberté personnelle, garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits26. C’est à une forme de contrôle de proportionnalité que procède le Conseil comme à propos de toute forme de sanction, qu’elle ait ou non le caractère de punition. Par sa rédaction du e) du 1° de l’article L. 4137-2 du Code de la défense qui range la sanction des arrêts parmi les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sans en définir plus précisément les modalités d’application, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Le Conseil conclut ainsi son examen pour des raisons qui tiennent aux garanties procédurales offertes par d’autres dispositions du Code la défense et du Code de justice militaire. L’article L. 311-13 de ce dernier pose une limite de soixante jours à la durée maximale de la sanction des arrêts. Quant à l’article L. 4137-1 du Code de la défense, il institue les garanties procédurales applicables lorsqu’une procédure de sanction est engagée, en prévoyant que l’intéressé « a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ».
La liberté d’aller et venir est nécessairement atteinte par une sanction de mise aux arrêts. Ce n’est que parce qu’elle concerne des militaires, dans la décision 450 QPC, du fait des limites inhérentes aux obligations particulières attachées à l’état militaire, que cette liberté n’est pas atteinte d’une manière telle que le législateur, en renvoyant au décret le soin d’en préciser les modalités d’application, n’a pas méconnu sa compétence.
MV
B – Les pouvoirs politiques : le Parlement et la procédure législative
C – Le pouvoir juridictionnel (…)
D – Le pouvoir financier (…)
E – Les collectivités décentralisées
1 – La délégalisation d’outre-mer
2 – Le contrôle des lois du pays
3 – La libre administration et l’égalité devant le suffrage applicables aux EPCI
4 – La libre administration et les élections locales
F – La régulation des élections et des référendums
1 – Le rejet des requêtes : l’absence de portée suffisante du vice et autres florilèges de moyens infondés
2 – Du constat de manœuvres à la réformation des résultats : un juge électoral renforcé
3 – Le rappel bienveillant des principes constitutionnels du droit électoral
IV – Les droits et libertés
A – Les libertés
1 – Liberté individuelle, respect de la vie privée (…)
2 – Liberté d’entreprendre, liberté contractuelle
B – Le droit de propriété
C – Le principe d’égalité
1 – Principe d’égalité devant la loi
2 – Principe d’égalité devant les charges publiques
3 – Principe d’égal accès aux emplois publics (…)
D – Le droits sociaux (…)
E – Les principes du droit répressif
1 – Principes de légalité, nécessité et individualisation des délits et des peines
2 – Droits de la défense et respect des garanties procédurales (…)
F – Les garanties des droits
1 – Le droit à un recours juridictionnel effectif et les principes d’impartialité et d’indépendance
2 – Le principe de sécurité juridique
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Pour les précédents, voir les décisions Cons. const., 12 janv. 2012, n° 2011-4538 SEN (Sénat, Loiret) ; Cons. const., 18 oct. 2012, n° 2012-4563/4600 AN (AN, Hauts-de-Seine, 13e Circ.) ; Cons. const., 18 oct. 2012, nos 2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 AN (AN, Val-de-Marne, 1re Circ.) et Cons. const., 15 févr. 2013, nos 2012-4580/4624 AN (AN, Français établis hors de France, 6e Circ.).
-
2.
Ce sont les termes utilisés par les Commentaires aux cahiers du Conseil constitutionnel.
-
3.
TGI Paris, 11e ch. corr., 3 oct. 2014, affaire dite EADS.
-
4.
TGI Paris, 11e ch. corr., 20 nov. 2014, affaire dite Oberthur.
-
5.
TGI Paris, 11e ch. corr., 26 sept. 2014, Procureur de la République c/ al, affaire dite Péchiney bis.
-
6.
TGI Paris, 11e ch. corr., 4 juin 2014, affaire dite Altran.
-
7.
Cons. const., 24 oct. 2014, n° 2014-423 QPC, M. Stéphane R. et a.
-
8.
Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC : Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier : Rec. Cons. const., 1989, p. 71.
-
9.
CE, sect., 9 juill. 1948, M. Archambault : Lebon, p. 323.
-
10.
CE, 23 avr. 1958, Cne du Petit-Quevilly.
-
11.
En droit pénal, le Non bis in idem n’interdit en effet pas le cumul des qualifications v. CPP, art. 6 et CPP, art. 368.
-
12.
V. CE, 21 juin 2013, n° 345500, M. El Dirini.
-
13.
CE, sect., 19 févr. 1943, Grandgirard : Lebon, p. 143.
-
14.
Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, art. 54.
-
15.
CJUE, 26 févr. 2013, n° C-617/ 10, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson.
-
16.
V. par ex. la succession des affaires CEDH, 23 oct. 1995, n° 328C, Gradinger c/ Autriche et CEDH, 30 juill. 1998, n° 25711/94, Oliveira c/ Suisse.
-
17.
CEDH, 10 févr. 2009, n° 14939/03, Sergue Zolotoukhine c/ Russie.
-
18.
Protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 22 novembre 1984, art. 4.
-
19.
CEDH, 8 juin 1976, nos 5100/71 ; 5101/71 ; 5102/71 ; 5354/72 et 5370/72, Engel et a. c/ Pays-Bas.
-
20.
Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, M. Gérard D. : Rec. Cons. const., p. 233.
-
21.
Cons. const., 28 mai 2010, n° 2010-1 QPC, consorts L. : Rec. Cons. const., p. 91.
-
22.
Cons. const., 10 févr. 2012, n° 2011-219 QPC.
-
23.
Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, loi portant création d’une couverture maladie universelle.
-
24.
Cons. 4, v. supra.
-
25.
V. Cons. const., 9 juin 2011, n° 2011-631 DC, loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, cons. 73, a contrario.
-
26.
Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, cons. 2.