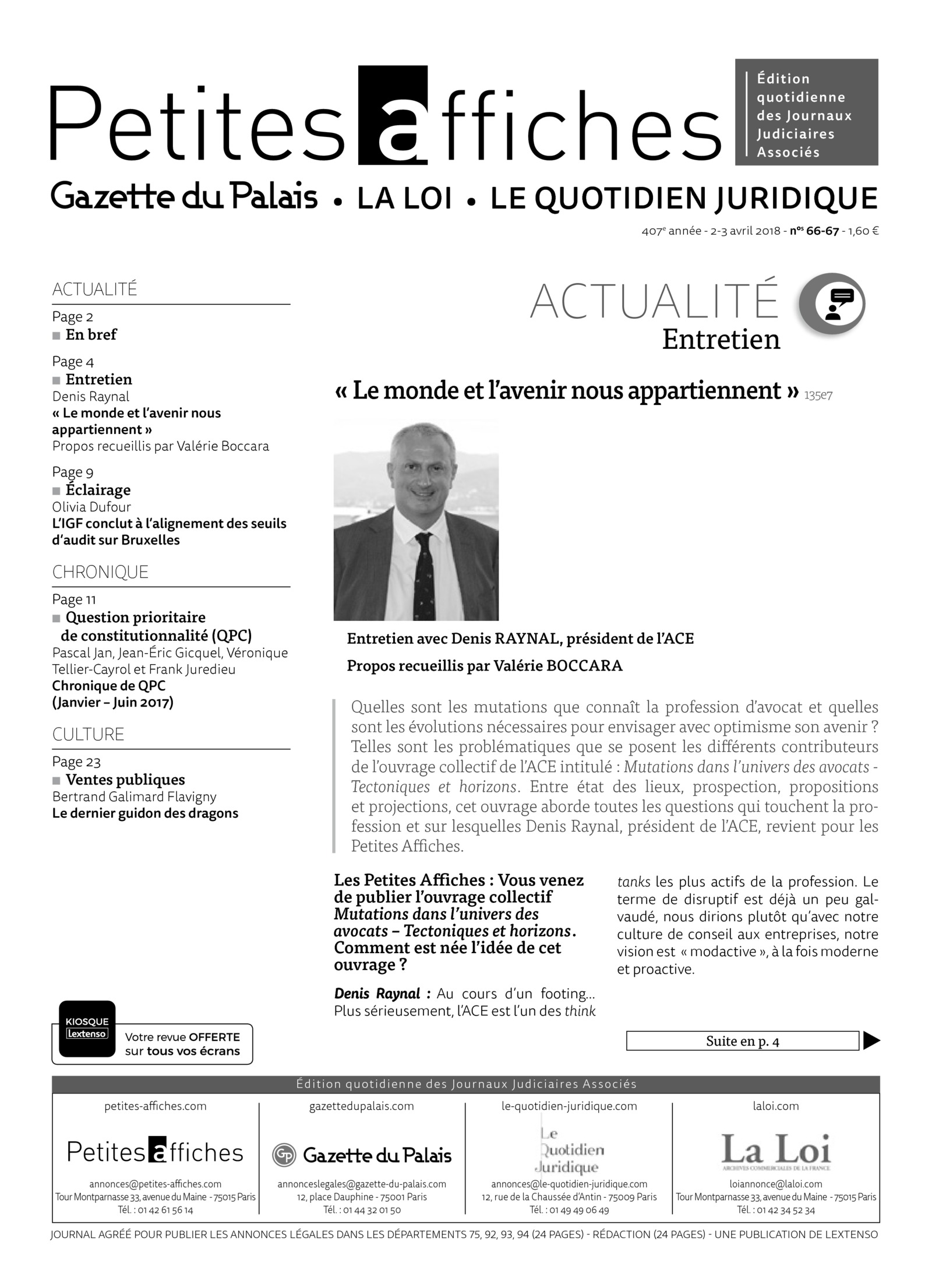Chronique de QPC (Janvier – Juin 2017)
La présente étude porte sur les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) traitées par le Conseil constitutionnel entre le 1er janvier et le 31 juillet 2017. Cette chronique placée sous la responsabilité du professeur Pascal Jan (professeur – IEP Bordeaux) a été rédigée par Jean-Éric Gicquel (professeur – Rennes 1), Véronique Tellier-Cayrol et Frank Juredieu (maîtres de conférences – Tours).
Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a « seulement » rendu 36 décisions QPC, soit près d’un quart de décisions de moins par rapport au précédent semestre. De fait, la période étudiée retrouve des niveaux traditionnels mais néanmoins importants, compte tenu de la très lourde charge exercée par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’organisation de l’élection présidentielle du printemps 2017. En revanche, et c’est un fait notable, pour la première fois depuis 2010, on assiste à un véritable déséquilibre dans les transmissions des QPC, 27 provenant de la juridiction administrative contre 8 pour la Cour de cassation. Mais il serait imprudent d’en tirer des conclusions définitives d’autant que, comme on le soulignera par la suite, les saisines de la juridiction judiciaire ont été plus « performantes » que celles émanant du Conseil d’État. Les requérants, comme on a pu le relever dans les dernières chroniques, sont autant les personnes morales (20) que les personnes physiques (15) ce qui confirme une nouvelle fois l’absence de monopole des lobbies et entreprises dans le déclenchement du contrôle de constitutionnalité a posteriori, même si les recours des entreprises sont toujours aussi nombreux. Toutefois, contrairement aux périodes passées – et cela explique en partie le déséquilibre dans l’origine des recours ci-dessus indiqués – la plupart des saisissants individuels, comme des personnes morales d’ailleurs a contesté des dispositifs fiscaux ou financiers et très peu sollicité le juge constitutionnel pour critiquer l’inconstitutionnalité de dispositions pénales, en dehors des dossiers en lien avec les lois sécurité (renseignement, état d’urgence). Il en résulte une dénonciation des principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques bien plus prononcée pour ce premier semestre 2017.
Au cours de la période étudiée, le juge constitutionnel a prononcé 2 non-lieu à statuer, rendu 17 décisions de conformité, 5 décisions de conformité assorties d’une réserve, 8 décisions de non-conformité totale et 4 de non-conformité partielle. Pour la première fois, le ratio conformité/non-conformité montre une « embellie » des invalidations, particulièrement totales. Jusqu’à présent, on pouvait soutenir que les parlementaires intégraient la contrainte constitutionnelle dans leur activité législative. Les élus remplissaient incontestablement un rôle de vigie constitutionnelle, ce dont on se félicitait dans les précédentes chroniques. Cette appréciation est-elle remise en cause par les données chiffrées du premier semestre 2017 ? La réponse est assurément positive et doit alerter. En effet, hormis la décision n° 2017-635 qui concernait une disposition de la loi sur l’état d’urgence dans sa rédaction de 1955, toutes les autres invalidations intéressent des dispositions législatives adoptées par le Parlement après la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : deux dispositions adoptées en 2016, deux en 2013, deux en 2011 et une en 2009. S’agissant des décisions de non-conformité partielle, le constat n’est pas meilleur. Sur les quatre décisions recensées dans cette catégorie, toutes sont postérieures à l’entrée en application de la QPC. Dernière précision qui, cette fois-ci est de nature à rassurer les citoyens quant au respect de leurs droits, le Conseil constitutionnel s’est montré intransigeant dans le respect par la loi des principes et règles qui s’appliquent au droit des sanctions et des droits de la défense (DDHC, art. 8 et 16). Il conviendra d’établir s’il s’agit là d’un concours de circonstances lié au hasard des recours ou, au contraire, d’une tendance lourde qui démontrerait que le législateur dans son activité récente s’est montré moins sourcilleux sur le respect des droits fondamentaux des personnes.
Par ailleurs, comme à chaque fois, le Conseil constitutionnel est amené à se prononcer à la demande des justiciables relayée par les juridictions suprêmes sur des textes emblématiques. Les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence ont motivé des requêtes mais le juge constitutionnel ayant très largement examiné par le passé les principales dispositions de la loi de 1955 modifiée à plusieurs reprises depuis 2016, son intervention s’est limitée à des dispositifs plutôt secondaires bien qu’il ait décidé de relever d’office « le grief tiré de ce qu’en prévoyant que la décision de prolonger une assignation à résidence au-delà de 12 mois est prise après autorisation du juge des référés du Conseil d’État, les dispositions contestées méconnaîtraient l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui garantit notamment le droit à un recours juridictionnel effectif ». Le premier semestre de l’année 2017 était celui de l’organisation de l’élection présidentielle et des élections législatives. De façon assez inattendue, le juge constitutionnel a été sollicité par le mouvement politique « En Marche ! » pour statuer sur les conditions de propagande pendant la campagne électorale. En effet, ce mouvement contestait la constitutionnalité de l’article L. 167-1 du Code électoral qui définit les critères présidant à la répartition des temps d’antenne entre les partis et les groupements politiques en vue des élections législatives. L’association En Marche ! ayant vu son leader remporter l’élection présidentielle, elle contestait sa quasi éviction dans l’accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision, conséquence de sa non-existence lors des scrutins nationaux antérieurs. De façon assez surprenante, même si l’on peut comprendre le souci du juge de prendre en compte la réalité des rapports de force entre les partis au vu des dernières élections nationales (présidentielle), le Conseil constitutionnel a considéré que « d’une part, les dispositions contestées fixent à 3 heures pour le premier tour et une 1 h 30 pour le second tour les durées d’émission mises à la disposition des partis et groupements représentés à l’Assemblée nationale par un groupe parlementaire, quel que soit le nombre de ces groupes. Elles limitent en revanche à 7 minutes au premier tour et 5 minutes au second tour les temps d’antenne attribués aux autres partis et groupements dès lors qu’ils sont habilités conformément au second alinéa du paragraphe III de l’article L. 167-1 du Code électoral. D’autre part, pour l’ensemble des partis et groupements relevant du paragraphe III de l’article L. 167-1 du Code électoral, les durées d’émission sont fixées de manière identique, sans distinction selon l’importance des courants d’idées ou d’opinions qu’ils représentent. Ainsi, les durées d’émission dont peuvent bénéficier ces partis et groupements peuvent être significativement inférieures à celles dont peuvent bénéficier les formations relevant du paragraphe II de l’article L. 167-1 du Code électoral et ne pas refléter leur représentativité. Dès lors, les dispositions contestées peuvent conduire à l’octroi de temps d’antenne sur le service public manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques. Les dispositions contestées méconnaissent donc les dispositions du troisième alinéa de l’article 4 de la constitution et affectent l’égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée »1.
I – Le procès constitutionnel
Les décisions intéressant stricto sensu l’office du juge deviennent de plus en plus rares, ce qui s’explique par l’intériorisation des décisions portant sur cette question par les conseils des justiciables et par les juridictions suprêmes elles-mêmes. De plus en plus régulièrement, le Conseil redessine le champ des QPC, le Conseil d’État et la Cour de cassation refusant, visiblement, de restreindre les questions prioritaires transmises au juge constitutionnel. On est en droit de s’interroger sur la « politique » des juges suprêmes qui semblent réticentes à circonscrire au plus près les questions de constitutionnalité. L’encadrement des interventions ne soulève guère de difficultés, le déport des membres non plus. On doit par ailleurs se féliciter du rendu des décisions dans le respect du quorum tel que le fixe l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui dispose que « les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal ».
S’agissant du champ des droits et libertés garantis par la constitution au sens de l’article 61-1 et des dispositions législatives susceptibles d’être examinées, seule une décision apporte des précisions utiles sur le périmètre de l’article 61-1 de la constitution. Dans la décision n° 2017-637 QPC, l’association requérante reprochait aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 332-1 du Code du sport de confier des pouvoirs de police à une personne privée, en violation de l’article 12 de la déclaration de 1789. Cette disposition, très peu sollicitée dans le cadre du contrôle a priori, ne l’avait jamais été dans le cadre de la QPC. Selon cet article de la déclaration des droits de 1789, « la garantie des droits de l’Homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Le juge constitutionnel interprète cette disposition comme autorisant « la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la “force publique” nécessaire à la garantie des droits »2. La question de l’invocabilité de l’article 12 sur le fondement de l’article 61-1 de la constitution était posée. La réponse positive du Conseil constitutionnel ne faisait cependant guère de doute au regard de la rédaction même de la disposition constitutionnelle et de son interprétation par la doctrine qui considère : « la force publique est-elle indispensable pour que les autres dispositions de la déclaration de 1789 puissent s’appliquer et donc devenir concrètes. Parmi celles-ci, on doit évidemment faire référence à l’article 16 de la déclaration de 1789, qui définit la garantie des droits comme l’élément essentiel d’une société démocratique »3. Dans le cas d’espèce soumis au jugement du Conseil constitutionnel, ce dernier reprend en le modifiant à la marge son considérant tiré de la décision de 2011 précitée en considérant qu’il en résulte « l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la “force publique” nécessaire à la garantie des droits ».
Pascal Jan
II – La jurisprudence
A – QPC transmise par la Cour de cassation
1 – Procédures collectives
Application des procédures collectives aux agriculteurs
Cons. const., 28 avr. 2017, n° 2017-626 QPC, Sté La Noé père et fils. La décision du 28 avril 2017 peut sembler décevante : saisi d’une QPC mal dirigée, le Conseil constitutionnel n’a pas eu la possibilité de répondre au problème juridique soulevé, pourtant pertinent. Cette décision mérite toutefois de figurer dans les colonnes de cette chronique car elle offre un éclairage intéressant sur la technique de la QPC.
En l’espèce, la société La Noé, exerçant une activité maraîchère, a été mise en redressement judiciaire. Le tribunal saisi de la procédure a retenu une durée du plan de redressement de 15 ans en application de l’article L. 626-12 du Code de commerce qui prévoit une durée dérogatoire (15 ans au lieu de 10 ans) lorsque le débiteur est un agriculteur. En appel, la décision du tribunal a toutefois été contestée sur le fondement de l’article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime selon lequel, pour l’application des dispositions relatives au redressement et la liquidation judiciaire, l’agriculteur s’entend de toute personne physique exerçant des activités agricoles. Prenant acte de cette différence de traitement entre personnes physiques et personnes morales, la société Noé a soulevé une QPC sur le fondement du principe d’égalité devant la loi, laquelle a été transmise au Conseil constitutionnel par un arrêt de la chambre commerciale du 2 février 20174.
La difficulté à laquelle se trouvait confronté l’auteur de la QPC dans cette affaire était de déterminer quelle disposition créait la rupture d’égalité. D’un côté, l’article L. 626-12 prévoit un régime propre au débiteur agriculteur mais ne définit pas ce dernier terme et donc n’oppose pas explicitement exploitants agricoles personnes physiques et personnes morales. D’un autre côté, l’article L. 351-8 du Code rural et de la pêche exclut les personnes morales de la qualification d’agriculteur tout en laissant à d’autres dispositions le soin de prévoir un régime dérogatoire à ce statut d’agriculteur. Pour résoudre cette difficulté, il convenait de se référer aux conditions classiques d’application du principe d’égalité.
Ainsi que le souligne le Conseil constitutionnel, l’article L. 351-8 du Code rural, invoqué par l’auteur de la QPC, « ne crée aucune différence de traitement entre les agriculteurs personnes physiques et les agriculteurs personnes morales » puisqu’il « se borne à préciser dans quel sens doit être entendu le terme “agriculteur” » pour l’application des dispositions relatives aux procédures collectives (§ 6). La différence de traitement ne pouvait être examinée qu’à l’aune de l’article L. 626-12 du Code commerce : c’est en effet ce texte qui prévoit un régime dérogatoire pour une catégorie particulière de professionnels, à savoir les agriculteurs, créant ainsi les conditions d’une éventuelle violation du principe d’égalité. Puisqu’il n’était pas saisi de cette disposition, le Conseil constitutionnel ne pouvait toutefois l’examiner.
Quelle décision dès lors prendrait le Conseil constitutionnel s’il était saisi d’une QPC fondée sur l’article L. 626-12 du Code de commerce ? Même si l’exercice de divination est toujours périlleux, on peut pronostiquer, sans trop de risque, l’inconstitutionnalité de la disposition. La durée plus longue du plan pour les agriculteurs est liée à certaines spécificités de l’activité agricole, particulièrement, l’importance des investissements matériels que doit assumer l’agriculteur et la durée des cycles de production5, souvent longs et dépendants des aléas météorologiques. Or ces contraintes sont les mêmes pour tous les agriculteurs, qu’ils aient la qualité de personne physique ou exercent sous la forme d’une société d’exploitation. La dérogation de l’article L. 626-12 du Code de commerce est liée à la nature de l’activité agricole, non à la structure choisie par l’agriculteur de sorte que la différence de traitement entre personnes physiques et personnes morales ne découle pas d’une différence de situation. On cherchera en vain dans les travaux parlementaires une volonté du législateur de discriminer les sociétés d’exploitation au profit des agriculteurs physiques. La différence de traitement est, en vérité, le résultat des multiples interventions législatives qui ont fait perdre aux dispositions relatives aux agriculteurs une partie de leur cohérence. La grande loi des procédures collectives du 25 janvier 1985 avait pour champ d’application les seules personnes morales. Jugeant utile d’y inclure les agriculteurs personnes physiques, le législateur est intervenu, de nouveau, en 1988 et c’est à cette occasion que la notion d’agriculteur a été définie par l’actuel article L. 351-8 du Code rural. Comme le souligne le commentaire officiel, sa rédaction limitée aux seuls agriculteurs personnes physiques se justifiait par le fait que les agriculteurs, personnes morales, étaient déjà soumis à la loi du 25 janvier 1985. Lorsqu’en 1994, le législateur a décidé d’augmenter la durée du plan applicable aux agriculteurs, il a omis de modifier la définition de l’agriculteur. C’est cet oubli malencontreux qui est à l’origine de la QPC, justifiée en son principe, mais malheureusement fondée sur le mauvais texte.
Franck Juredieu
2 – Procédure pénale
Huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes
Cons. const., 21 juill. 2017, n° 2017-645 QPC, M. Gérard B. Principe essentiel de la procédure, la publicité des débats6 revêt un caractère d’ordre public dont la méconnaissance emporte la nullité de la procédure. Le respect de ce principe, garanti par de nombreux textes tant nationaux qu’internationaux, est contrôlé par le juge judiciaire, le juge constitutionnel ou encore le juge européen. La Cour européenne des droits de l’Homme le traduit ainsi : « il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous »7.
Cette règle n’est cependant pas absolue : par exception, l’article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoit que « le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande », dans les procès pour viol, tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé. C’est cette exception que conteste le justiciable devant le Conseil constitutionnel. L’auteur de la question estime que cette disposition méconnaît le droit à un procès équitable sur trois aspects : atteinte au principe de publicité, au principe d’égalité et à celui de la présomption d’innocence.
L’atteinte au principe de publicité ne peut être niée. Mais, comme le rappelle le Conseil (§ 4), si la publicité est la règle, des circonstances particulières peuvent nécessiter, pour un motif d’intérêt général, le huis clos. D’une part, ces circonstances particulières sont expressément indiquées par le législateur. Ce dernier a en effet strictement circonscrit les infractions pour lesquelles la victime partie civile pouvait exiger le huis clos. Il s’agit, depuis une loi du 23 décembre 1980, du viol et des tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, et depuis une loi du 13 avril 2016, de la traite des êtres humains et du proxénétisme aggravé. D’autre part, le huis clos est bien justifié par un motif d’intérêt général qu’il faut, a priori paradoxalement rechercher dans la protection de la vie privée des victimes. La spécificité de la situation de la victime de telles infractions réside, lors des débats, dans l’exposition d’éléments éminemment personnels comme l’existence d’agressions sexuelles antérieures, son orientation sexuelle, l’historique de ses relations, les avis des experts, etc. Comme le relève le Conseil, la divulgation de ces éléments au cours de débats publics « affecterait la vie privée de la victime en ce qu’elle a de plus intime ». Or il faut éviter que les victimes de ces faits particulièrement graves ne renoncent à les dénoncer à cause de ce principe de publicité. En protégeant, grâce au huis clos, l’intimité de la vie privée de la partie civile afin de faciliter la dénonciation des infractions, le législateur poursuit donc un objectif d’intérêt général justifiant une atteinte au principe de la publicité (§ 5).
C’est d’ailleurs ce caractère intime qui explique le choix discrétionnaire accordé à la partie civile. Elle peut – en exigeant le huis clos – vouloir éviter une nouvelle souffrance, une « victimisation secondaire », ou elle peut – en maintenant la publicité des débats – vouloir donner un retentissement particulier au procès.
Avec cette décision du 21 juillet 2017, le Conseil constitutionnel rejoint la position de la Cour de cassation et la Cour européenne : la chambre criminelle avait en effet depuis longtemps admis la conformité à la Convention européenne de cette dérogation au principe de la publicité8 et la Cour européenne a reconnu que l’article 306 du Code de procédure pénale entrait bien dans le champ des restrictions à la publicité des débats énumérées à l’article 6, § 1, de la convention9.
S’agissant de la violation du principe d’égalité, le Conseil constitutionnel l’écarte en reprenant l’argumentation justifiant l’atteinte au principe de publicité. Le principe d’égalité n’est pas violé dans la mesure où la différence de traitement est justifiée par l’objectif poursuivi par le législateur : la protection de la vie privée des victimes afin que celles-ci ne renoncent pas à dénoncer les faits. De plus, il ajoute que cette différence de traitement ne porte pas atteinte au respect des droits de la défense (§ 7).
Quant au dernier grief, le requérant estimait que les dispositions contestées, en qualifiant la partie civile de « victime » avant toute décision définitive de condamnation de l’accusé, allaient à l’encontre de la présomption d’innocence. Il peut en effet paraître injustifié de considérer, avant même l’ouverture du procès, le plaignant comme « victime » alors qu’il faut attendre un jugement définitif pour être coupable ou innocent. Pourquoi ce statut de victime est-il accordé dès le début de la procédure ? Tout comme la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie, la qualité de victime ne peut être véritablement reconnue qu’à l’issue du procès. On retrouve ici la critique d’Hervé Henrion à propos de la rédaction de l’article préliminaire du Code de procédure pénale : « le législateur a manqué à cet endroit de cohérence dans l’écriture des dispositions préliminaires, en évoquant successivement la “victime” (§ II) puis la personne “présumée innocente” (§ III). La lettre de l’article préliminaire rompt la progression dialectique du doute en défaveur de cette dernière. Par conséquent, il aurait été conforme à la présomption d’innocence, interdisant tout préjugement, d’opposer la “victime présumée” au “présumé innocent” »10. Il peut être envisagé de ne lui reconnaître cette qualité qu’au prononcé de la décision sur la réalité de l’infraction et, en attendant, d’employer les termes de « plaignant », « partie civile », « personne s’estimant lésée par une infraction », « victime présumée »11.
La question reste délicate, comme le montre Mme Giudicelli-Delage : « Il ne peut y avoir de victime alléguée, de victime prétendue ou de présumée victime dès lors que s’impose la figure de la victime intime. Ce faisant, se fait jour le risque entre victime et accusé, d’une fragilisation de la présomption d’innocence. Non seulement parce que, face à ce qui n’est qu’une “présomption”, s’affirme une victimation incontestable (…), mais aussi parce que le statut conféré emporte, au bénéfice de la victime, des obligations à la charge des autorités policières ou judiciaires qui ne trouvent pas leur pendant à l’égard de l’accusé »12.
Le Conseil apporte ici sa contribution au débat, en considérant que les termes « victime partie civile » désignent la partie civile « ayant déclaré » avoir subi les faits poursuivis. Il ne s’en déduit pas une présomption de culpabilité de l’accusé (§ 9) ; le grief est donc écarté.
Véronique Tellier-Cayrol
3 – Droit pénal
Délit de communication irrégulière avec un détenu
Cons. const., 24 janv. 2017, n° 2016-608 QPC, Mme Audrey J. Le texte soumis au Conseil constitutionnel13 punissait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de « communiquer par tout moyen avec une personne détenue en dehors des cas autorisés par les règlements ».
La justiciable à l’origine de la QPC avait été interpellée pour avoir communiqué par gestes avec son compagnon alors qu’il comparaissait devant la cour d’assises. L’une des parties intervenantes, Me William Julié, avait été condamnée à 2 000 € d’amende pour avoir envoyé quelques textos à son client détenu, textos concernant l’organisation de l’audience de la personne détenue.
Plusieurs atteintes étaient invoquées : atteintes à la liberté de communication et au droit au respect de la vie privée, au principe de la légalité, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. De plus, la disposition contestée était entachée d’incompétence négative en ce qu’elle renvoie au pouvoir règlementaire le soin de préciser les cas autorisés.
C’est sur ce dernier grief, « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres » (§ 7), que le Conseil constitutionnel déclare la phrase « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue » contraire à la constitution. Très classiquement, il constate que « s’il est possible au législateur de fixer les règles relatives à la communication avec les détenus compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, il s’en est remis en l’espèce au pouvoir règlementaire pour déterminer la portée du délit de communication irrégulière avec une personne détenue. Il en résulte que le législateur, qui n’a pas fixé lui-même le champ d’application de la loi pénale, a méconnu les exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines » (§ 6).
La réaction du législateur n’a pas tardé : la loi du 28 février 2017 a introduit un nouvel alinéa 2 à l’article 434-35. Est désormais puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende « le fait, pour une personne se trouvant à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l’intérieur de l’un de ces établissements, y compris par voie des communications électroniques ». La loi précise ensuite que le texte réserve « les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145-4 du Code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire »14. Disposition plus sévère puisque intervenant après une abrogation immédiate, elle ne s’applique que pour les faits commis après le 2 mars 2017 (date d’entrée en vigueur de la loi). C’est ainsi que la cour d’appel d’Amiens n’a pu que relaxer le prévenu partie intervenante dans cette QPC (et condamné en première instance) dans une décision du 24 avril 201715.
La question n’est pas pour autant définitivement réglée. D’une part, s’agissant du droit de communication, le débat porte actuellement sur l’autorisation éventuelle des téléphones portables bridés proposée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan. D’autre part, s’agissant de la nouvelle rédaction de l’article 434-35 du Code pénal, et dans la mesure où le Conseil ne s’est pas prononcé sur les autres éventuelles atteintes à la liberté de communication, au droit au respect de la vie privée, auxquelles on peut ajouter le principe de nécessité16, il faut s’attendre à de nouvelles QPC.
Véronique Tellier-Cayrol
B – QPC transmise par le Conseil d’État
1 – Droit administratif et droit pénal
Lutte contre le terrorisme
Cons. const., 10 févr. 2017, n° 2016-611 QPC, M. David P. ; Cons. const., 16 mars 2017, n° 2016-624 QPC, M. Sofiyan I. ; Cons. const., 7 avr. 2017, n° 2017-625 QPC, M. Amadou S. et Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-635 QPC, M. Émile L. En matière de lutte contre le terrorisme, le quasi-monopole dont bénéficiait jusqu’ici le droit pénal spécial n’est plus. Les dispositions législatives accordant des prérogatives importantes aux autorités administratives – impliquant en conséquence la compétence de la juridiction administrative et l’application de règles de droit administratif – n’ont cessé de s’empiler depuis quelques années. On pensera principalement à celles issues a) des lois du 13 novembre 2014 établissant l’interdiction de sortie du territoire et l’interdiction administrative du territoire et du 24 juillet 2015 relative aux services de renseignement et naturellement, b) celles en lien avec l’établissement, les prorogations et les modifications du régime de l’état d’urgence depuis le 14 novembre 2015. Pour autant, le recours aux modalités du droit pénal n’a pas été remisé. Cela se traduit par une extension parallèle des incriminations propres à la matière terroriste. Tout ceci conduit le Conseil constitutionnel à manier périodiquement les concepts de droit administratif et de droit pénal17.
Soulignons, avant d’aller plus loin, que la classique distinction entre la prévention et la répression des atteintes à l’ordre public ou plus précisément entre la prévention de la commission d’infractions et la répression d’infractions commises – essentielle puisque fondant la répartition de compétences entre les autorités juridictionnelles administratives et judiciaires – n’est guère adaptée au regard des spécificités du droit de l’antiterrorisme. Compte-tenu de « la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme »18, il est essentiel d’identifier, le plus précocement possible, tout agissement matériel (et non une simple intention, on y reviendra) susceptible d’être perçu comme relevant d’un projet d’action terroriste. Bref, comme l’a admis le Conseil constitutionnel, il faut être en capacité de cibler le « comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d’exécution »19. On mesure bien sûr les dérives potentielles de cette démarche prédictive.
En interpellant un individu, en le plaçant en détention provisoire puis en le condamnant à une peine de prison avant qu’il ne passe à l’acte, on évite ce « risque de souffrances et de perte de vies humaines »20 provoqué par un attentat. La mise en place d’infractions-obstacles participe depuis la loi du 22 juillet 1996 à cette politique de prévention pénale du terrorisme. On songera ici à l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT)21 – bref, en réalité une « association de terroristes » – devenue l’incrimination délictuelle la plus souvent retenue par les juges. Que l’on soit face à une répression d’une incrimination ne change pas la perspective générale à savoir que l’autorité judiciaire agit, en prononçant des peines d’emprisonnement (de 10 ans maximum accompagnée de possibilités de remises de peines pour une AMT délictuelle) pleinement dans une approche anticipatrice. Ainsi, la prévention des actes terroristes se déploie-t-elle autant dans une logique de droit pénal que de droit administratif.
C’est ainsi qu’une nouvelle incrimination a été instituée par la loi du 13 novembre 2014 22, à savoir l’entreprise terroriste individuelle. Comme tout virus mortel, des variantes de terrorisme surgissent avec le temps. Révélée avec l’affaire Merah en 2012, la posture du « loup solitaire » se déploie dans une dimension individualiste et ne se détecte plus grâce à des signaux classiques (tel le passage formateur sur une terre de Djihad – d’abord en Afghanistan puis désormais en Irak et Syrie).
La réponse apportée par le législateur afin de lutter contre cette nouvelle forme de terrorisme a pour objectif de remonter le plus loin possible dans le chemin criminel (l’iter criminis). Si l’intention délictueuse ou criminelle ne peut être incriminée car cela va à l’encontre du principe de nécessité des délits et des peines comme le rappelle le Conseil (§ 6), il est cependant possible de réprimer de « simples actes préparatoires » (§ 18) à la commission d’un acte délictueux ou criminel.
Reste que si l’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme est facilement caractérisable23, ce qui explique qu’elle soit devenue la « clé de voûte des procédures en matière de terrorisme »24, il en va différemment de l’entreprise terroriste individuelle en raison de son complexe montage juridique. Il n’est pas étonnant qu’elle soit peu sollicitée par les magistrats.
D’abord, cette nouvelle infraction doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle « ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Le Conseil, malgré les difficultés concrètes rencontrées au quotidien par les juges de l’antiterrorisme et, par exemple, les incertitudes de l’affaire dite du Tarnac25, est resté fidèle à sa jurisprudence fixée en 198626, en estimant qu’il n’y a pas méconnaissance du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines puisque cette notion est énoncée « en des termes d’une précision suffisante » (§ 10). Pourtant la doctrine pénaliste s’accorde sur le fait que cette définition tautologique de l’acte terroriste est des plus médiocres27. Le Conseil n’en a cure. C’est sans doute lié à la considération qu’il n’a « pas vraiment une culture de pénaliste et raisonne selon ses propres canons qui sont très fortement marqués par le droit public »28.
Quoi qu’il en soit, un cumul de conditions a ensuite été institué afin de pouvoir qualifier l’acte préparatoire : le fait de détenir, de rechercher (on y reviendra) de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui doit être accompagné d’un des faits matériels suivants : « a) recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ; b) s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ; c) consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ; d) avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ».
Le Conseil a assorti sa déclaration de constitutionnalité (finalement partielle29) d’une réserve d’interprétation à double entrée, aux termes de laquelle : d’une part, « la preuve de l’intention de l’auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste ne saurait sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires » (§ 16) et d’autre part, que les « faits matériels doivent corroborer cette intention »30.
La portée de ces réserves est limitée puisqu’il s’agit simplement de faire respecter les règles classiques de droit pénal. L’intention criminelle (ici la volonté « de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ») représente l’élément moral liant l’acte matériel et son auteur. Autrement dit, il faut ici faire abstraction des faits matériels31 pour caractériser l’intention de passer à l’acte terroriste. Celle-ci devra l’être par d’autres éléments factuels (par exemple, par des contacts répétés avec des individus « connus défavorablement » des services de police, de renseignement et de l’autorité judiciaire ou par la tenue de propos indiquant une intention de commettre un acte terroriste). Reste que ces faits matériels énoncés dans l’article 421-2-6 du Code pénal, qui « doivent corroborer cette intention » de passer à l’acte32, risquent de peser lourd dans l’intime conviction du juge.
Constatons que cette incrimination censée lutter contre les loups solitaires risque de tomber dans l’ineffectivité à l’égard d’individus s’inscrivant pleinement dans cette démarche, c’est-à-dire à l’égard de véritables solitaires n’ayant aucune relation avec les radicalisés et le milieu délinquant classique et recourant, avec des moyens matériels limités et sans formation préalable, à des actions peu sophistiquées (attaques à l’arme blanche ou à la voiture-bélier). Il est alors quasiment impossible de détecter en amont leur intention de passer à l’acte et d’agir en conséquence.
Pour autant, le juge constitutionnel n’a pas été entièrement satisfait de la formulation retenue par le législateur. Il a jugé que le fait de « rechercher » des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ne matérialise pas en soi, faute de circonscrire les actes pouvant constituer une telle recherche, « la volonté de préparer une infraction » (§ 17). Le terme encourt la censure pour méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines. Soit. Mais indépendamment de la difficulté de savoir ce que l’on entend par « des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui » (il est à noter que dans l’affaire à l’origine de la QPC, l’intéressé avait été poursuivi pour détention de trois bouteilles d’eau vides scotchées ensemble33), on relèvera que le fait d’en détenir ou de s’en procurer ne fonde pas nécessairement une volonté de préparer une infraction. Par exemple, la détention dans son domicile d’eau oxygénée, d’acétone et d’acide chlorhydrique n’est pas, en soi, répréhensible. À partir de quel moment estimera-t-on qu’on est passé au stade de la fabrication d’un puissant explosif (le TATP – Tripéroxyde de triacétone) ? On reste ici, et c’est le fond du problème, « à des comportements parfois faiblement substantiels et très équivoques qui, au demeurant, ne traduisent pas tous un même degré d’engagement dans un projet terroriste »34.
On le constate, la création de nouvelles incriminations dans le domaine du terrorisme s’avère malaisée. Que le Conseil ait dans la décision David P. du 10 février 2017 jugé contraire à la constitution l’article 421-2-5-2 du Code pénal incriminant la consultation habituelle de « sites djihadistes » – pour aller vite35 – renforce cette impression.
Afin de lutter contre l’incitation et la provocation au terrorisme sur le réseau internet, une incrimination autonome a été instituée, après quelques vicissitudes, par le législateur36. Il s’agit de réprimer la consultation de « manière habituelle » de sites de propagande djihadiste. L’agissement n’est pas en soi dangereux pour la société mais seulement inquiétant. Si la pensée et la représentation psychologique d’un crime ne peuvent être réprimées, le législateur a estimé que la consultation assidue de tels sites constitue la première étape dans la préparation d’un acte terroriste. Le comportement de l’intéressé n’est pas perçu comme équivoque.
Cette incrimination a été jugée contraire à la constitution. Reste qu’avant d’en décider ainsi, le Conseil s’est implicitement prononcé sur son utilité même à la lueur de l’arsenal législatif – minutieusement détaillé – mis à la disposition des autorités administrative et judiciaire afin, d’une part, de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, d’autre part, de contrôler de tels sites. Or dès lors qu’il « ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement »37, il n’est pas censé se prononcer sur l’opportunité d’un texte. C’est au législateur de prendre ses responsabilités et de veiller à ne pas adopter de dispositions inutiles sous le coup de l’émotion ou seulement pour donner l’impression d’agir. Au juge, il incombe exclusivement de se prononcer sur la question de savoir si la règle législative est, ou non, conforme à la constitution. C’est ce que le Conseil a fait seulement dans un second temps.
Il a considéré, à juste titre, que l’incrimination portait une atteinte à la liberté de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée (§ 16). Certes, le législateur avait prévu que celle-ci n’était pas caractérisée « lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice ». Reste que manifester de la curiosité morbide de manière répétitive n’est pas, quoi qu’on pense d’une telle attitude, de nature à considérer que, ipso facto, l’intéressé « ait la volonté de commettre des actes terroristes » et ne peut constituer la preuve « que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services » (§ 14). Le Conseil, extrêmement vigilant sur les restrictions pesant sur la liberté de communication des pensées et des opinions, notamment sur internet38, ne pouvait que prononcer la censure.
Constatons, pour terminer sur cet aspect, que l’article invalidé à compter de la date de publication de la décision (soit le 10 février 2017) est réapparu, tel Lazare, sous une forme légèrement modifiée dans la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. Sans insister sur le fait que son insertion en commission mixte paritaire39 est constitutive d’un vice de procédure pour méconnaissance des règles relatives au droit d’amendement (mais la querelle est close puisque le Conseil n’a pas été saisi dans le cadre de la saisine a priori et qu’un moyen de légalité externe n’est pas invocable dans une QPC), il est désormais prévu, aux côtés de la présence d’un nouveau motif légitime de consultation (lorsqu’elle « s’accompagne d’un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ») que l’incrimination n’est caractérisée que si celle-ci « s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service ». Toute la difficulté résidera dans le fait que le comportement sur internet de l’intéressé ne suffira pas à démontrer une telle orientation. Il pourra, au mieux, l’étayer. Ce faisant, la différence avec l’incrimination d’entreprise individuelle terroriste devient des plus subtiles. Le nombre de condamnations finalement prononcées risque d’être symbolique.
Quittons maintenant les versants préventifs du droit pénal pour rejoindre ceux du droit administratif.
En application du 3°, de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955, présent dès le stade de la version originelle du texte, le préfet peut « interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ». À la suite des nombreuses décisions du préfet de police de Paris interdisant le séjour de militants radicaux, antifascistes voire de journalistes dans certaines rues et arrondissements de Paris lors des journées de manifestations contre la loi dite El Khomri40, le Conseil a été conduit à se prononcer sur la constitutionnalité de ce dispositif.
Une analogie peut ici être établie avec les assignations à résidence décidées, au titre de l’article 4 de la loi du 3 avril 1955, afin d’éviter les troubles en novembre 2015 durant la COP 21. Toute la question était alors de savoir si cette prérogative pouvait être sollicitée à l’égard d’altermondialistes alors qu’aucun lien direct avec les événements tragiques du 13 novembre 2015 ayant conduit à l’instauration de l’état d’urgence ne pouvait être établi. Le Conseil d’État41, suivi en cela implicitement par le Conseil constitutionnel42, a estimé que l’assignation à résidence peut être décidée dès lors qu’existent seulement des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Il n’y a ainsi nul besoin d’exciper d’une menace terroriste pour solliciter cet instrument. Notons toutefois qu’afin d’éviter que les règles particulières de l’état d’urgence ne prévalent systématiquement sur les dispositions de droit commun, le Conseil a jugé que les restrictions imposées aux réunions publiques par la loi du 3 avril 1955 ne peuvent avoir pour « effet de régir les conditions dans lesquelles sont interdites les manifestations sur la voie publique »43.
Pour revenir aux interdictions de séjour qui, en l’espèce, ont tout de même porté indirectement atteinte au droit de manifester, le Conseil n’a pas, dans sa décision M. Émile L. du 9 juin 2017, abordé frontalement cet aspect. Afin d’invalider ce mécanisme, il s’est contenté d’observer que son régime juridique était insuffisamment encadré par le législateur. En premier lieu, une interdiction de séjour peut être prononcée sans pour autant qu’existent de raison sérieuse de penser que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Il suffit que l’on reproche à l’individu de chercher « à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ». Ceci est assez vague et largement indéterminé. En second lieu, alors que la loi du 3 avril 1955 prévoit qu’un assigné est astreint à résider dans un lieu d’habitation pour une plage horaire déterminée ne pouvant excéder douze heures par vingt-quatre heures, le régime de l’interdiction de séjour brille par son laconisme. Comme le souligne le Conseil « le législateur n’a soumis cette mesure d’interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n’a encadré sa mise en œuvre d’aucune garantie » (§ 6). En conséquence, la conciliation qui doit logiquement être assurée par le législateur entre, d’un côté, les inévitables atteintes aux droits et libertés et, de l’autre, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public est apparue déséquilibrée. Elle devrait l’être davantage avec la nouvelle rédaction issue de la loi du 11 juillet 2017.
Enfin, dans la décision M. Sofiyan I. du 16 mars 2017, le Conseil a abordé de nouveau le régime des assignations à résidence. Il avait eu précédemment l’occasion de juger que primo elles cessent de produire effet à la date de cessation de l’état d’urgence et que secundo elles peuvent faire l’objet d’un renouvellement exprès si, en cas de prorogation de l’état d’urgence, leur prolongation apparaît justifiée44. Il s’agissait ici pour les sages de se pencher sur leur durée maximum.
L’article 4 de la loi du 3 avril 1955 modifié prévoit que la durée d’une telle mesure ne peut en principe excéder 12 mois (consécutifs ou non) et qu’au-delà, le renouvellement est effectué par période de 3 mois. On est face ici à des individus dont le nombre est limité (13 au 2 juin 201745) et qui sont placés dans une sorte de zone grise. Leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public sans pour autant être de nature à fonder des poursuites judiciaires46.
Par une réserve d’interprétation détaillée, le Conseil a indiqué qu’un renouvellement au-delà de 12 mois n’est possible uniquement si a) « le comportement de la personne en cause constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » ; b) « l’autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémentaires » (la jurisprudence du Conseil d’État s’avérant à ce sujet difficile à suivre47) et c) : « que soient prises en compte dans l’examen de la situation de l’intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie » (§ 17).
Alors que le législateur avait prévu que le ministre de l’Intérieur présente la demande d’autorisation de prolongation au juge administratif des référés du Conseil d’État – une disposition sur laquelle ni le justiciable ni ses conseils n’avaient trouvé à redire tant les attributions de la juridiction administrative dans le contentieux relatif à l’état d’urgence sont regardées comme incontournables – le Conseil constitutionnel a relevé d’office le grief de méconnaissance du droit à un recours juridictionnel garanti par l’article 16 de la déclaration de 1789. Dit rapidement, il a été reproché au législateur de prévoir un mécanisme au sein duquel une mesure d’assignation à résidence peut faire l’objet d’une contestation classique en recours pour excès de pouvoir devant un tribunal administratif puis devant le Conseil d’État alors que parallèlement, le juge administratif des référés du Conseil d’État s’est, en accordant l’autorisation de renouvellement, déjà prononcé sur son bien-fondé. En attribuant « au Conseil d’État statuant au contentieux la compétence d’autoriser, par une décision définitive et se prononçant sur le fond, une mesure d’assignation à résidence sur la légalité de laquelle il pourrait ultérieurement avoir à se prononcer comme juge en dernier ressort » (§ 11), le législateur a méconnu le principe d’impartialité et le droit à exercer un recours juridictionnel effectif.
Jean-Éric Gicquel
2 – Droit électoral
Pluralisme des courants d’idées et d’opinions
Cons. const., 31 mai 2017, n° 2017-651 QPC, Association en Marche ! Assurément, 2017 restera une année remarquable dans l’histoire de la Ve République. Réhabilitant la vulgate gaulliste de la rencontre d’un homme avec le peuple, la victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle a provoqué une véritable « débipolarisation » de la vie politique française. Encore fallait-il, afin que l’essai soit transformé, que son jeune parti, En Marche !, remporte les élections législatives de juin 2017. Nul besoin d’insister sur l’indispensable couplage entre les majorités présidentielle et parlementaire (le fait majoritaire) permettant alors au régime de la Ve République de déployer toutes ses virtualités présidentialistes. Reste que pour l’accès aux médias publics pendant la campagne électorale des législatives, les règles déterminées par l’article L. 167-1 du Code électoral étaient celles en vigueur dans « l’ancien monde ».
L’économie de cet article était simple. Se basant sur un critère objectif (le fait d’être ou pas, pour un parti ou un groupement représenté, par un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale48), les temps d’antenne au service public (3 heures pour le premier tour ; 1 h 30 pour le second tour) étaient divisés, à parts égales pour les seuls partis représentés au Parlement entre ceux appartenant à la majorité et ceux n’y appartenant pas. Pour les autres, les conséquences étaient terribles puisqu’ils disposaient (et à condition de présenter au moins 75 candidats) d’un temps d’antenne famélique (7 minutes au premier tour et 5 minutes au second). Mais voilà, personne n’y a jamais trouvé à redire et notamment lorsqu’en 2002, le Front national, présent au second tour de l’élection présidentielle, a vu sa capacité d’expression médiatique fondre, quelques semaines plus tard, comme neige au soleil lors des législatives.
L’éclatante victoire d’Emmanuel Macron soutenu par le parti En Marche ! (devenu LRM) a rendu le maintien du statu quo intenable. Saisi par le biais d’une QPC – dont on conçoit ici tout l’intérêt (notamment sur le fond et sur des aspects temporels49) –, le Conseil constitutionnel n’est pas resté insensible à ce brutal changement de la physionomie de la vie politique. La situation était en effet devenue ubuesque puisque, selon la décision du CSA du 23 mai 2017, le parti socialiste, dont on connaît les résultats de son candidat à la présidentielle, disposait de 80 minutes au premier tour des législatives alors qu’En Marche ! devait s’en contenter de sept…
Se fondant principalement à la fois sur l’existence du « principe du pluralisme d’idées et d’opinions » conçu comme « un fondement de la démocratie »50 (§ 5) et sur l’article 4 de la constitution de 1958 disposant, depuis 2008, que « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation », il a été estimé que « lorsque le législateur détermine entre les partis et groupements politiques des règles différenciées d’accès aux émissions du service public de la communication audiovisuelle, il lui appartient de veiller à ce que les modalités qu’il fixe ne soient pas susceptibles de conduire à l’établissement de durées d’émission manifestement hors de proportion avec la participation de ces partis et groupements à la vie démocratique de la Nation » (§ 6).
Une fois le principe affirmé, il convenait de le faire respecter en l’espèce. Si le Conseil a logiquement estimé qu’un temps d’antenne spécifique peut être garanti aux partis ou groupements politiques disposant d’une représentation parlementaire (§ 8), les règles doivent, pour les autres partis, être conçues de manière à prendre en compte l’importance des courants d’idées ou d’opinions qu’ils représentent. Or l’article L. 167-1 du Code électoral, en leur attribuant uniformément le même temps d’antenne (7 minutes au premier tour puis 5 au second) méconnaît cette exigence. Il n’y a pas besoin d’être un spécialiste avisé de la vie politique pour se rendre compte que la représentativité, en juin 2017, d’En Marche !, du Front national ou de la France insoumise, n’a pas grand-chose à voir avec celle de partis plus confidentiels tels « la France qui ose », « Caisse Claire » ou le « Parti animaliste »…
Dans l’attente d’une nouvelle rédaction de l’article L. 167-1 du Code électoral qui sera abrogé le 30 juin 2018 (§ 14) – l’abrogation immédiate étant exclue puisqu’elle aurait eu pour effet de ne plus permettre au CSA de déterminer les temps d’antenne pour les partis concernés – le Conseil constitutionnel a été conduit, par une réserve d’interprétation transitoire (qui, sauf dissolution de l’Assemblée nationale survenant avant le 30 juin 2018, ne sera effective que pour les seules législatives de 2017) à indiquer au CSA que les temps d’antenne des partis sans groupes parlementaires les plus représentatifs devaient être revus à la hausse avec comme limite maximum cinq fois les durées déterminées par l’article L. 167-1 du Code électoral51. C’est ainsi que le CSA, dans sa décision du 1er juin 2017, prenant en compte les résultats précédents obtenus aux législatives antérieures et surtout aux présidentielles précédant les législatives concernées par la réglementation du temps d’antenne (à hauteur de 60 %) ; le nombre de candidats présentés aux législatives (20 %) et les caractéristiques du débat électoral – via notamment les sondages d’opinion (20 %) – a attribué des temps d’antenne pour les deux tours plus équitables qu’auparavant (notamment 42 et 30 minutes pour En Marche ! ; 38 minutes 30 secondes et 27 minutes 30 secondes pour le Front national). En revanche, que le Parti animaliste ou Caisse claire restent, entre autres, soumis aux enveloppes temporelles minimum n’est pas de nature à porter atteinte à l’objectif d’intérêt général de clarté du débat électoral. Bien sûr tout ceci serait amené à changer si l’un de ces partis confidentiels arrivait à faire élire, en 2022, l’un de ses membres comme chef de l’État. Cela peut prêter à sourire mais qui n’en a pas de fait de même lorsque Emmanuel Macron s’est insensiblement glissé, en 2016, dans la peau d’un candidat à la présidentielle ?
Jean-Éric Gicquel
Notes de bas de pages
-
1.
Cons. const., 31 mai 2017, n° 2017-651 DC.
-
2.
Cons. const., 10 mars 2011, n° 2011-625 DC, loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
-
3.
Commentaire de l’article 12 de la déclaration de 1789 dans le Code constitutionnel et des droits fondamentaux annoté, 2017, Dalloz.
-
4.
Cass. com., 2 févr. 2017, n° 16-21032.
-
5.
V. Rev. proc. coll. 2017, comm. 54, comm. Lebel C.
-
6.
V. Piot P., Du caractère public du procès pénal, thèse, 2012, université de Lorraine.
-
7.
CEDH, 17 janv. 1970, Delcourt c/ Belgique, série A, n° 11, § 31, « Justice must not only be done, it must also be seen to be done ».
-
8.
Cass. crim., 30 oct. 1996, n° 95-83366 ; Cass. crim., 27 juin 2007, n° 06-88511 ; Cass. crim., 17 févr. 2010, n° 09-84377.
-
9.
CEDH, 7 juin 2007, n° 14524/06, Tamburini c/ France. Sur cet arrêt, v. la nuance apportée par Piot P., La Convention prévoit la possibilité de restreindre la publicité, non l’obligation de la supprimer systématiquement sans opérer la moindre mise en balance des intérêts, thèse préc., p. 292.
-
10.
Henrion H., « L’article préliminaire du Code de procédure pénale : vers une “théorie législative” du procès pénal ? », Arch. pol. crim. 2002, p. 13.
-
11.
V. Blanc A., « La question des victimes vue par un président d’assises », AJ pénal 2004, p. 432.
-
12.
Giudicelli-Delage G., « Conclusion », in La victime sur la scène pénale en Europe, 2008, PUF, p. 265, spéc. p. 271 et 272.
-
13.
C. pén., art. 434-35, al. 1er.
-
14.
L’article 145-4 prévoit la possibilité de demander l’accès au téléphone (sur cette disposition, v. Cons. const., 24 mai 2016, n° 2016-543 QPC, section française de l’observatoire international des prisons ; les articles 39 et 40 concernent le droit des personnes détenues à une correspondance téléphonique et écrite).
-
15.
CA Amiens, ch. corr., 24 avr. 2017, n° 15/01226 : JCP G 2017, 874, note Benillouche M.
-
16.
RFDC 2017/3, n° 111, p. 726, note Perrier J.-B.
-
17.
V. not. Gicquel J.-E., « Le droit de l’antiterrorisme : un droit aux confins du droit administratif et du droit pénal », JCP E 2017, 1309.
-
18.
Cons. const., 16 juill. 1996, n° 96-377 DC, loi tendant à renforcer la répression du terrorisme, Recueil Cons. Const. p. 87 et plus récemment, Cons. const., 7 avr. 2017, n° 2017-625 QPC, M. Amadou S.
-
19.
Cons. const., 10 févr. 2017, n° 2016-611 QPC, M. David P., § 13.
-
20.
CEDH, 30 août 1990, n° 12244/86, Fox, Campbell, Hartley c/ Royaume-Uni ; CEDH, 20 oct. 2015, n° 5201/11, Sher et autres c/ Royaume-Uni.
-
21.
C. pén., art. 421-2-1, AMT.
-
22.
C. pén., art. 421-2-6 ; Cons. const., 7 avr. 2017, M. Amadou S.
-
23.
La jurisprudence admet qu’une telle infraction peut être commise seulement à deux (Cass. crim., 30 avr. 1996 : Bull crim., n° 176 ; Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-83334).
-
24.
Exposé des motifs du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (Assemblée nationale, Doc. Parl. n° 2110, 9 juill. 2014, p. 4).
-
25.
Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 16-84596.
-
26.
Cons. const., 3 sept. 1986, n° 86-213 DC, loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, Recueil Cons. Const. p. 122.
-
27.
La qualification de terrorisme « comporte, à la fois des précisions inutiles ou gênantes tandis qu’elle est, à d’autres points de vue, insuffisante », Rassat M.-L., Droit pénal spécial. Infractions du Code pénal, 7e éd., 2014, Dalloz, p. 937 ; « En droit pénal, la criminalité terroriste est insaisissable » : Alix J., Terrorisme et droit pénal. Critiques des incriminations terroristes, 2010, Dalloz, n° 287.
-
28.
Drago G. et de Lamy B., « Les relations du droit pénal et du droit constitutionnel », in Saint-Pau J.-C. (dir.), Droit pénal et autres branches du droit. Regards croisés, 2012, Cujas, p. 359.
-
29.
V. infra, trois paragraphes plus bas « Pour autant, le juge constitutionnel n’a pas été entièrement satisfait… ».
-
30.
Ibid.
-
31.
Énumérés supra, trois paragraphes plus haut « Quoi qu’il en soit, un cumul de conditions a ensuite été ensuite institué afin de pouvoir qualifier l’acte préparatoire : le fait de détenir, de rechercher (on y reviendra) de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer de danger pour autrui doit être accompagné d’un des faits matériels suivants… ».
-
32.
Cela signifie donc que les faits matériels identifiés doivent avoir pour effet de renforcer la conviction de l’existence d’une intention criminelle. Le commentaire « officiel » donne l’exemple suivant, « s’il est établi que le suspect envisage de commettre un acte terroriste à travers une attaque au couteau dans un lieu public, le délit ne saurait être constitué si les seuls éléments matériels retenus contre lui sont le fait qu’il a acheté une substance explosive et qu’il a appris à conduire un aéronef ». http://www.conseil-constitutionnel.fr/, p. 17.
-
33.
Pascual J., « Terrorisme : le Conseil constitutionnel encadre la justice préventive », Le Monde 7 avr. 2017.
-
34.
Alix J., « La prévention pénale du terrorisme devant le Conseil constitutionnel », AJ pénal 2017, p. 237.
-
35.
Sur le plan légal, il s’agit de la consultation habituelle d’un « service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires ».
-
36.
Présente, dans une version quasiment identique, dans un projet de loi déposé en avril 2012, cette disposition avait été disjointe par le Conseil d’État (EDCE 2013, p. 202). Elle a ensuite été insérée par voie d’amendement – malgré la position défavorable du gouvernement – dans la loi du 3 juin 2016.
-
37.
V. encore récemment Cons. const., 26 janv. 2017, n° 2016-745, loi relative à l’égalité et à la citoyenneté.
-
38.
Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, Recueil Cons. Const. p. 107.
-
39.
Rapp., doc. Parl., nos 4466 (A.N.) et 369 (S.), 13 févr. 2017, p. 11-14.
-
40.
438 mesures édictées mais seulement 169 arrêtés effectivement notifiés aux intéressés. Rapp. Mercier, Sénat, n° 591, 28 juin 2017, p. 29.
-
41.
« Ces dispositions, de par leur lettre même, n’établissent pas de lien entre la nature du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à ce que soit déclaré l’état d’urgence et la nature de la menace pour la sécurité et l’ordre publics susceptible de justifier une mesure d’assignation à résidence » (CE, 11 déc. 2015, n° 395009, M. Cédric D.)
-
42.
« L’assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l’état d’urgence a été déclaré ; que celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu’“en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public” ou “en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique” ; que ne peut être soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone couverte par l’état d’urgence et à l’égard de laquelle “il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics” », Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527, QPC, M. Cédric D. (v. comm. LPA 27 juill. 2016, n° 118q7, p. 4).
-
43.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC, Ligue des droits de l’Homme, cons. 5.
-
44.
Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, M. Cédric D.
-
45.
Étude d’impact du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme déposé en juin 2017, p. 37.
-
46.
V. la situation et le parcours de M. D. décrits dans l’ordonnance du CE., ord., 25 avr. 2017, n° 409725, M. D.
-
47.
Tantôt il estime que les décisions prises par l’administration pendant la première période d’assignation à résidence de 12 mois (tels que le gel des avoirs, l’interdiction de sortie du territoire ou la dissolution d’une association dont l’intéressé est le président) constituent des éléments en partie nouveaux ou complémentaires et justifient donc une prolongation de 3 mois (CE, 25 avr. 2017, nos 409725 et 409677 ; CE, 7 août 2017, n° 412697) tantôt il juge que seuls les faits concomitants à la période de 3 mois doivent être pris en compte (CE, 19 juin 2017, nos 411587 et 411588).
-
48.
Il est à préciser qu’un groupe doit réunir au moins quinze membres (Règl. de l’Assemblée nationale, art. 19).
-
49.
La décision n° 2017-254 du CSA du 23 mai 2017 répartissant les temps d’antenne selon les anciennes règles est contestée le 24 mai devant le Conseil d’État. Celui décide de transmettre la QPC le 29 mai (n° 410833). Le Conseil constitutionnel tranche le 31 mai. La nouvelle durée des émissions dont disposent les partis et groupement politiques pour les législatives des 11 et 18 juin est fixée par le CSA dans sa décision n° 2017-277 du 1er juin 2017.
-
50.
Le Conseil, a consacré le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale en tant qu’objectif à valeur constitutionnelle (Cons. const., 11 oct. 1984, n° 84-181 DC, entreprises de presse, Recueil Cons. const. p. 78) puis le pluralisme des courants d’expression socioculturels (Cons. const., 18 sept. 1986, n° 86-217 DC, liberté de communication, Recueil Cons. const. p. 141) et enfin l’exigence du pluralisme des courants d’idées et d’opinions qui constitue le fondement de la démocratie (Cons. const., 11 janv. 1990, n° 89-271 DC, loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, Recueil Cons. const. p. 21).
-
51.
Soit, outre les 7 et 5 minutes minimales pour les deux tours, pas plus de 42 minutes d’augmentation pour le premier tour et 25 pour le second.