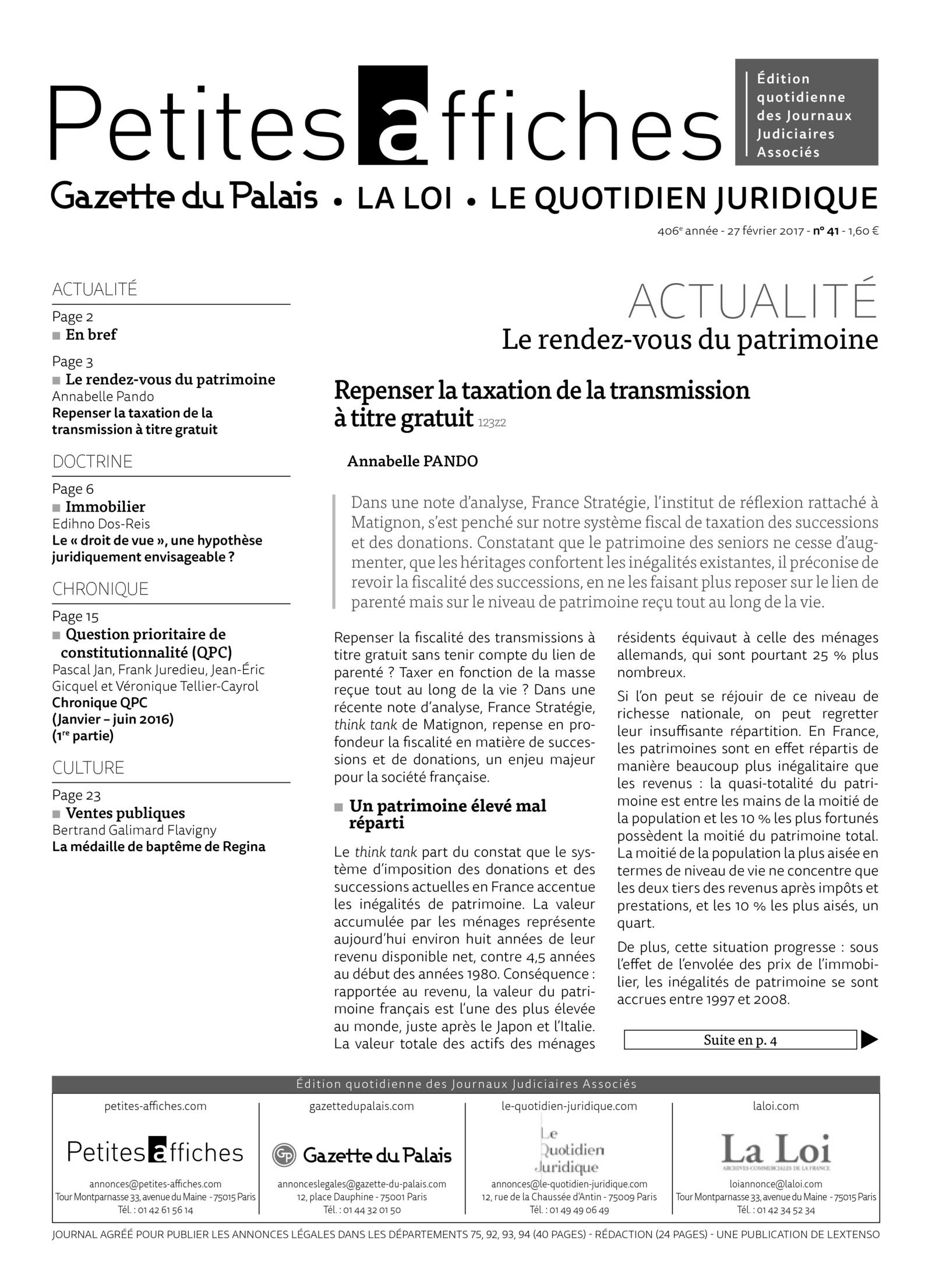Chronique QPC (Janvier – juin 2016)(1re partie)
La présente étude porte sur les questions prioritaires de constitutionnalité traitées par le Conseil constitutionnel entre le 1er janvier et le 30 juin 2016. Cette chronique, placée sous la responsabilité de Pascal Jan (professeur – IEP Bordeaux), a été rédigée par Jean-Éric Gicquel (professeur – Rennes 1), Véronique Tellier-Cayrol et Frank Juredieu (maîtres de conférences – Tours).
Introduction
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2016, le Conseil constitutionnel a rendu 34 décisions QPC, dont 15 transmises par le Conseil d’État et 19 par la Cour de cassation. Les requérants, comme on a pu le relever dans les dernières chroniques, sont autant les personnes morales que les personnes physiques, ce qui contrecarre des prédictions initiales de monopolisation de cette procédure de contrôle a posteriori des dispositions législatives par les lobbies et les entreprises. Les griefs d’inconstitutionnalité soulevés à l’occasion de ces questions prioritaires de constitutionnalité confirment une tendance : l’attrait du principe d’égalité (devant la loi, la justice et les charges publiques) et la multiplication des moyens fondés sur la violation de droits et libertés concernant la vie économique et financière : liberté d’entreprendre et son corollaire la liberté contractuelle, le droit de propriété et le principe de responsabilité. Les principes constitutionnels applicables à la matière pénale et plus généralement au droit des sanctions connaît toujours un développement important devant le Conseil constitutionnel mais pour la première fois est en forte décrue. Il conviendra de vérifier si cette tendance annonce un reflux des QPC en matière pénale, ce qui tendrait à démontrer que les dispositions législatives promulguées avant la réforme de la QPC prises en ce domaine et soupçonnées d’être inconstitutionnelles tendent à se tarir, ce dont il faut se féliciter.
Au cours de la période étudiée, le juge constitutionnel a prononcé 3 non-lieu à statuer, rendu 12 décisions de conformité, 7 de conformité assorties d’une réserve, 12 décisions de non-conformité totale et 3 de non-conformité partielle. Il s’est penché sur des textes importants comme les dispositions autorisant les perquisitions pendant l’application de l’état d’urgence ou encore l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en le validant en dépit de nombreuses opinions doctrinales et politiques contraires (délit d’opinion pour les propos négationnistes tenus sur les crimes contre l’humanité de la Seconde Guerre mondiale, disposition que la Cour de cassation refusa de transmettre en mai 2010 s’attirant les foudres du législateur qui réforma son mode d’organisation concernant le renvoi des QPC au Conseil constitutionnel).
Si le nombre de décisions QPC du Conseil constitutionnel se situe dans la moyenne observée depuis trois ans, en revanche on relève un nombre anormalement élevé d’invalidations de dispositions législatives (19) même si au cours de l’année 2015 une telle tendance se faisait jour. Dans la précédente chronique, nous relevions d’ailleurs que « le mandat du président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré s’achève sur un resserrement des contraintes qui pèsent sur la loi ». Les censures principalement dirigées contre des dispositions portant atteinte au principe d’égalité et aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de 1789 (droits de la défense et « sécurité juridique » bien que cette notion ne soit pas encore reçue en tant que telle dans la jurisprudence constitutionnelle) proviennent très majoritairement de QPC émanant du Conseil d’État. On peut y voir une intériorisation plus forte des contraintes constitutionnelles pesant sur le législateur et une assimilation plus profonde de la jurisprudence constitutionnelle par la juridiction administrative. Sous cet angle, le ratio élevé entre les transmissions et les décisions de non-conformité constitue une garantie du sérieux de la contestation pour les justiciables. À l’inverse, le rejet des QPC devant le Conseil d’État indique aux justiciables que leurs prétentions sont réellement infondées. Dès lors, les opinions qui critiquent l’absence de recours contre les rejets des QPC par les juridictions suprêmes apparaissent moins pertinentes. Au final, ces données statistiques mettent en exergue l’exigence d’une culture de la performance judiciaire, l’un des aspects de la performance constitutionnelle qui, progressivement, pénètre les sphères de l’État et l’évaluation de l’activité des pouvoirs publics1.
Le Conseil constitutionnel, présidé désormais par l’ancien Premier ministre, Laurent Fabius, et qui a accueilli deux autres nouveaux membres (Corinne Luquiens, secrétaire générale honoraire de l’Assemblée nationale, et Michel Pinault, conseiller d’État et ancien président de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers), sort renforcé de cette politique de saisine des juridictions suprêmes mais doit, pour accroître son autorité auprès des justiciables, procéder également à des ajustements procéduraux mais surtout jurisprudentiels (notamment relatifs à la portée des censures à effet différé qui ne profitent toujours pas au requérant qui a introduit la QPC).
Pascal Jan
I – Le procès constitutionnel
L’arrivée d’un nouveau président est toujours une occasion d’évolution de l’institution. Laurent Fabius n’a pas tardé à réformer les méthodes du juge constitutionnel. Outre la retransmission en temps réel des auditions QPC, ce qui retient l’attention, ce sont les modifications rédactionnelles des décisions. Parmi les changements notables, la disparition des « Considérant que… » dans les décisions n° 2016-539 et n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016. L’objectif du président du Conseil est de rendre plus lisible et accessible les décisions du juge constitutionnel aux justiciables qui, depuis 2010, peuvent le saisir de questions prioritaires de constitutionnalité : « Le Conseil a érigé l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi au rang d’objectif de valeur constitutionnelle : il paraît logique que cette exigence que nous imposons au législateur, nous nous l’appliquions à nous-mêmes. Une bonne décision de justice doit non seulement juger juste, mais parler clair. D’où notre choix, dès mai dernier, d’abandonner le traditionnel « considérant » et de passer au style direct : cette évolution permet une lecture plus fluide, plus simple, conforme aux standards des autres grandes juridictions européennes. D’où aussi le choix de remplacer désormais des formules tombées en désuétude et des termes excessivement techniques par des équivalents courants, compréhensibles par tous. Je n’ai pas constaté qu’aucune de ces évolutions que nous avons engagées ait porté atteinte à la précision et à la rigueur du raisonnement juridique »2. Cette révolution de Palais s’inscrit dans les traces d’une réflexion globale des juridictions suprêmes françaises sur l’amélioration de la rédaction de leurs décisions et de la nécessité de pouvoir se faire comprendre du plus grand nombre (il est vrai que, à la différence du Conseil constitutionnel jusqu’à présent, la Cour de cassation et le Conseil d’État statuent « au nom du Peuple français »). En avril 2012, le conseiller d’État Philippe Martin rendait public un rapport établi par un groupe de travail « sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative ». La haute juridiction administrative s’était engagée à changer la formulation de ces décisions pour les rendre plus intelligibles. Hormis quelques arrêts en 20133, ni le Conseil d’État, ni les juridictions administratives inférieures4 n’ont pourtant donné suite aux recommandations formulées dans le rapport qui constatait que : « partant du constat que ce mode de rédaction [les visas, les considérants, les phrases interminables ponctuées de points-virgules] présente d’importantes qualités, en terme notamment de rigueur et de précision du raisonnement, il ne permet peut-être plus au juge administratif de rendre compte le plus clairement possible à un public plus large, de l’application qu’il fait d’un droit toujours plus complexe »5. Il est fort à parier que le Conseil constitutionnel, qui n’a ni l’antériorité des juridictions administratives, ni n’est prisonnier d’un raisonnement éprouvé par une formation spécifique et des années de pratique contentieuse de ses membres, maintiendra dans le temps cette mutation formelle de ses décisions. Cette rédaction nouvelle ne peut être que saluée. On s’interroge toutefois sur la portée d’une telle évolution. D’une part, contrairement aux décisions des juridictions ordinaires, la motivation des décisions du Conseil constitutionnel n’avait rien d’ésotérique et d’impénétrable. D’autre part, en quoi la disparition des visas, des considérants ou encore la simplification de l’argumentation améliorent-elles la lisibilité et la compréhension des décisions du juge constitutionnel, surtout depuis qu’un effort sans précédent fut entrepris par le prédécesseur de Laurent Fabius pour communiquer et expliquer en termes clairs et concis le sens des décisions (communiqués de presse et commentaire exhaustif des décisions sur le site du Conseil). Il n’empêche, le Conseil constitutionnel prend la tête du mouvement des juridictions favorables à la rédaction des décisions en style direct. En pointe sur le sujet, la détermination du juge constitutionnel ne peut qu’encourager les juridictions administratives mais également les juridictions judiciaires à entrer « dans la danse ». D’ailleurs, la Cour de cassation n’a pas manqué, quelques semaines avant le Conseil constitutionnel, d’acter un changement de motivation de ces décisions lorsqu’elle opère un revirement de jurisprudence6 et qu’elle en limite les effets dans le temps7.
Depuis 2010, les cas d’ouverture des questions prioritaires de constitutionnalité n’ont pas évolué, hormis les précisions apportées par le Conseil constitutionnel des termes de l’article 61-1 de la Constitution et des dispositions organiques prises pour son application. Pourtant, un amendement parlementaire adossé au projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a bien failli restreindre les hypothèses dans lesquelles les justiciables peuvent soulever une QPC devant un tribunal. Partant du constat que la QPC est devenue une arme d’obstruction procédurale dans le déroulement des procès avec pour effet de retarder le règlement judiciaire des contentieux et de contribuer à l’encombrement de l’office des juges, le législateur a décidé de modifier l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel en modifiant les conditions de dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité en matière correctionnelle et contraventionnelle : « En matière correctionnelle et contraventionnelle, lorsque le moyen aurait pu être soulevé lors de l’instruction et à moins qu’il ne porte sur une disposition de procédure applicable uniquement devant les juridictions de jugement, le moyen ne peut être soulevé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ou, en cas d’appel, devant la chambre des appels correctionnels, lorsque la juridiction de jugement a été saisie par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction. En cas d’appel de l’ordonnance de renvoi, le moyen peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la juridiction d’instruction du second degré. En dehors des cas prévus à l’avant-dernier alinéa, en cas d’appel d’un jugement rendu en matière correctionnelle ou contraventionnelle, le moyen ne peut être soulevé que dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la chambre des appels correctionnels ». Lutter contre les manœuvres dilatoires dans le maniement des QPC répond assurément à un souci d’efficacité des procès. Déjà exclue des cours d’assises, la QPC le serait des tribunaux correctionnels et de police. Censurée par le Conseil constitutionnel8, la disposition paraissait contestable pour plusieurs motifs : d’une part, rien n’interdisait de déposer une QPC en toute fin d’instruction de sorte que l’effet sur le temps judiciaire était limité. D’autre part, et surtout, exclure le dépôt d’une QPC au stade de l’appel portait un coup sévère au droit des justiciables qui, précisément en appel, attendent du juge qu’il reconsidère les positions des premiers juges. Enfin, on peut s’interroger sur la conformité de cette disposition législative au regard du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789. En tout état de cause, l’invalidation a été prononcée sur un vice de procédure qui évite au Conseil constitutionnel d’argumenter au fond.
S’agissant du champ des droits et libertés garantis par la Constitution au sens de l’article 61-1 de la Constitution et des dispositions législatives susceptibles d’être examinées, le Conseil constitutionnel a réitéré sa position par laquelle il s’interdit de contrôler une disposition législative qui n’est que la transposition d’une directive (n° 2015-520 QPC). Seule une atteinte à une règle ou à un principe inhérent à l’identité constitutionnelle qui n’est pas neutralisée par une disposition constitutionnelle contraire est susceptible d’être invoquée devant le juge constitutionnel. Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel fut toutefois contraint d’opérer un tri entre les termes de la disposition contestée qui transposent une directive et ceux qui n’en relèvent pas pour déterminer sa compétence. Dans le même esprit, le juge constitutionnel a accepté de recevoir les griefs d’inconstitutionnalité dirigés contre un décret, le Conseil constitutionnel constatant sa valeur législative à la suite de sa ratification législative, établie préalablement par le Conseil d’État (sans citer l’arrêt de la juridiction administrative, Thevini, 15 mars 2015, req. n° 382754).
Comme à son habitude, et de plus en plus fréquemment, le Conseil constitutionnel restreint le champ des questions prioritaires de constitutionnalité par imprécision des juridictions de renvoi, où à la suite d’un constat de non-lieu à statuer. Relativement à ces dernières décisions, on relève trois décisions de non-lieu à statuer. Elles sont motivées essentiellement par référence aux articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 qui subordonnent la transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel à l’absence de décision de conformité relativement aux dispositions critiquées, sauf changement de circonstances de droit ou de fait9. Lorsque la décision du Conseil constitutionnel intervient postérieurement à une décision de transmission d’une QPC, le renvoi par la juridiction suprême ne souffre d’aucune critique (QPC n° 2015-522). En revanche, dans l’hypothèse la plus fréquente (décision de conformité connue des juges suprêmes) on peut s’étonner de la saisine du juge constitutionnel. Il n’en reste pas moins que les décisions de non-lieu à statuer sont rares. C’est à propos de l’une d’elle que le Conseil constitutionnel a précisé et élargi la portée de l’article 23-2 de l’ordonnance précitée (QPC n° 513-514-526). Il « juge » (le terme figure désormais dans le dispositif) que le changement des circonstances peut s’appliquer à des dispositions déclarées inconstitutionnelles (et non seulement conformes) dans une décision antérieure. Ce faisant, le Conseil constitutionnel arrête une position cohérente puisque si des changements de circonstances justifient le réexamen de dispositions jugées conformes, ce même motif peut conférer un effet utile à un réexamen de dispositions censurées par suite d’un changement de circonstances, de droit essentiellement.
Sur les méthodes juridictionnelles, le Conseil constitutionnel n’abuse pas des griefs soulevés d’office. Lors de la précédente chronique, nous nous étions interrogés sur l’intérêt de soulever d’office des moyens pour les rejeter, sans même émettre la moindre réserve. Sur ce point, deux nouvelles décisions font état de cette technique d’élargissement du contrôle de constitutionnalité. Dans la décision QPC n° 2015-523, le juge soulève d’office le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la disposition critiquée au regard du principe d’égalité et conclut à sa non-conformité. La décision d’évoquer de sa propre autorité ce moyen s’explique parfaitement au cas présent puisque le Conseil fut saisi d’un tel moyen sur une disposition similaire dans le cadre du contrôle préventif de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution (déclarée conforme). Dans la décision QPC n° 2015-517, le Conseil évoque d’office le principe de responsabilité pour valider sous réserve la disposition législative litigieuse. Cette méthode du juge, lorsqu’elle aboutit à de telles décisions, a un effet utile qui ne peut être guère contesté dans la mesure où une fois promulguée, la disposition incriminée devient intouchable sur le plan de sa constitutionnalité (sauf changement de circonstances). En revanche, elle peut toujours faire l’objet d’un contrôle de conventionnalité.
C’est ici qu’intervient un autre aspect de l’office du juge constitutionnel lorsqu’il censure une disposition législative avec effet différé. Les décisions d’inconstitutionnalité sont de plus en plus fréquentes et l’on doit s’interroger sur leur « légitimité ». Si, pour des motifs d’ordre supérieur comme les conséquences d’une disposition législative censurée au regard des exigences de sécurité et d’ordre public ou pour préserver l’application d’une liberté ou d’un objectif de valeur constitutionnelle (QPC n° 2015-511), le juge remet au législateur la copie de la loi et lui octroie un délai pour effacer l’inconstitutionnalité, l’effet différé jette un trouble sur l’effectivité de la justice constitutionnelle, l’intérêt pour le justiciable requérant et l’autorité même du Conseil constitutionnel. En effet, jusqu’à présent, le juge constitutionnel refuse de faire bénéficier le requérant à l’origine du contentieux des conséquences d’une déclaration d’inconstitutionnalité à effet différé. Il y a dans cette doctrine jurisprudentielle une sorte de déni de justice qui ne peut que saper la confiance des justiciables dans le procès constitutionnel. Il ne faut dès lors pas s’étonner que des juridictions ordinaires, et au premier chef la Cour de cassation, cherchent à déjouer de telles décisions en considérant la même disposition non conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme afin d’en faire bénéficier le requérant10.
Pascal Jan
II – La jurisprudence
A – QPC transmises par la Cour de cassation
1 – Droit social
Absence d’indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié
Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-523 QPC. La décision du 2 mars 2016 porte sur la perte de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde. Selon l’article L. 3141-26 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé payé auquel il avait droit, il reçoit une indemnité compensatrice. L’alinéa 2 ajoute : « l’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur ». L’auteur de la QPC soutenait que le régime dérogatoire de la faute lourde portait atteinte au droit au repos et au droit à la protection de la santé découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Le Conseil déclare l’inconstitutionnalité des dispositions en cause mais en retenant un autre fondement que celui invoqué par le requérant, tiré de la confrontation des articles L. 3141-26 et L. 3141-28 du Code du travail. Alors que le premier article prévoit, comme nous l’avons rappelé, une privation de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de faute lourde, le second restaure le versement de cette indemnité dans le cas spécifique où le licenciement pour faute lourde concerne un salarié d’une entreprise tenue d’adhérer à une caisse de congés payés en application de l’article L. 3141-30 du Code du travail. La différence de traitement entre ces salariés ne contrarie-t-elle pas le principe d’égalité devant la loi ? Le Conseil l’a pensé au motif d’une part que le législateur a traité différemment des personnes se trouvant dans la même situation au regard du droit à un congé payé (cons. 7), d’autre part que « la différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu’ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congé payé » (cons. 9).
Constatons que parmi les conditions classiques de mise en œuvre du principe d’égalité, l’existence d’un motif d’intérêt général justifiant la différence de traitement n’a pas été examinée par le Conseil. Il était inutile, il est vrai, de procéder à cette vérification alors que le Conseil avait déjà relevé l’absence de rapport entre la différence de traitement et l’objet de la loi l’ayant instituée. Le législateur ne pouvait méconnaître, même pour un motif d’intérêt général, le principe d’égalité devant la loi. L’absence de lien entre la différence de traitement et l’objet des dispositions contestées se trouve ainsi au cœur de la décision sans que la motivation du Conseil sur cette question convainque pleinement.
Que l’objet de l’article L. 3141-26 du Code du travail – priver le salarié de l’indemnité de congé afin de prendre en compte la gravité de la faute ayant justifié le licenciement – soit sans rapport avec la différence de traitement existant entre les salariés travaillant ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés payés ne fait guère de doute : dès lors qu’une faute lourde a été commise, il n’existe aucune raison de distinguer les salariés entre eux11.
Quant à l’article L. 3141-28 associé à l’article L. 3141-30 qui institue les caisses de congés, le Conseil précise que leur objet est de « régler de façon spécifique le régime de gestion des droits à congés payés des salariés exerçant une activité discontinue chez une pluralité d’employeurs afin de garantir l’effectivité de leur droit à congé » (cons. 8). La création de ces caisses de congés payés en 1936 répondait effectivement à un besoin particulier de protection de salariés exerçant un emploi précaire : elles permettaient à ces salariés de disposer des sommes correspondant aux congés payés et « évitaient ainsi qu’ils ne soient contraints à travailler pendant la période des congés à seule fin d’assurer leur subsistance »12. On saisit mal dès lors pourquoi le maintien de l’indemnité de congés payés pour les salariés exerçant une activité en discontinu ne s’inscrirait pas dans l’objet des dispositions contestées. La faveur accordée à cette catégorie de salariés n’assure-t-elle pas précisément l’effectivité de leur droit à congé mise à mal par la précarité de leur statut ?
La réponse à cette interrogation ne se trouve pas dans la décision mais dans le commentaire officiel : « l’obligation d’adhérer à une caisse de congés ne repose plus, depuis 1942, sur le critère de la discontinuité de l’activité exercée par le salarié, ni sur le critère exclusif d’un secteur d’activité se caractérisant par la présence de salariés de ce type. Il se déduit de cet élargissement que la discontinuité de l’activité ne constitue plus le critère exclusif de l’obligation pour un employeur de s’affilier à une caisse de congés. Ainsi, parmi les salariés tenus d’adhérer à une caisse de congés se côtoient des salariés travaillant de façon continue comme des salariés travaillant de façon non continue »13. On peut regretter que le Conseil constitutionnel n’ait pas évoqué dans sa décision la disparition de ce critère de discontinuité. Sans cette précision, l’absence de lien entre la différence de traitement et l’objet des dispositions se comprend plus difficilement14.
Plus ennuyeux pour le commentateur : le Conseil constitutionnel a sans doute amoindri la portée de sa décision en se fondant uniquement sur le principe d’égalité devant la loi sans répondre à la QPC posée. Ainsi que le souligne Jean Mouly, « le Conseil (…) interdit seulement de traiter différemment les salariés bénéficiant d’une caisse de congés payés et ceux qui n’en bénéficient pas ; mais il est loisible au législateur soit de supprimer purement et simplement cette condition d’absence de faute lourde, soit de la généraliser en l’étendant aux salariés régis pas une caisse »15. Même si l’hypothèse est peu probable, il n’est pas impossible que la même QPC soit dans l’avenir posée à nouveau devant le Conseil constitutionnel. Une réflexion mérite donc d’être menée sur le bien-fondé de cette QPC, d’autant plus que la question des effets de la faute lourde n’intéresse pas uniquement l’indemnité compensatrice de congés payés mais aussi l’importante indemnité de licenciement.
Dans l’arrêt du 2 décembre 2015 qui a renvoyé au Conseil constitutionnel la QPC, la Cour de cassation retenait le caractère sérieux de la question au motif que « l’article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail prévoit un cas de perte de jours de congés payés sans lien avec les règles d’acquisition ou d’exercice de ces droits au repos ». On peut effectivement s’étonner que le comportement fautif du salarié conduisant à son licenciement soit sanctionné par la privation d’un droit fondamental acquis en contrepartie du travail effectué durant l’exécution du contrat. À y regarder de plus près cependant, la privation de l’article L. 3141-26 ne concerne pas, en tant que tel, les congés payés ou même l’indemnité de congé payés mais bien l’indemnité compensatrice de congé. La nuance nous semble importante car si le droit aux congés payés s’inscrit parfaitement dans le cadre général du droit au repos, on ne peut sans doute pas en dire autant de l’indemnité de l’article L. 3141-26 du Code du travail.
Il importe de souligner que ce n’est pas l’application de l’article L. 3141-26 qui entraîne la perte des congés payés : ceux-ci sont perdus définitivement à la suite de la rupture du contrat de travail. L’indemnité de l’article L. 3141-26 intervient précisément pour compenser cette perte. L’appauvrissement qui résulte du non-bénéfice des congés pour le salarié oblige l’employeur à verser une indemnité compensatrice16. La somme d’argent obtenue n’équivaut pas, en d’autres termes, à une réalisation des congés payés mais constitue une forme de réparation visant à rééquilibrer les patrimoines respectifs du salarié et de l’employeur à la suite de la rupture du contrat. La différence avec l’indemnité de congé apparaît très nette, quand bien même les deux sommes d’argent obéiraient toutes deux au même régime17. Alors que l’une consiste à maintenir le niveau de vie du salarié durant la réalisation du congé d’où son lien avec le droit au repos, la seconde a pour fait générateur la perte des congés payés en raison de la rupture du contrat de travail. La première, tantôt perçue comme un élément de salaire différé18, tantôt comme un substitut de salaire19 a une nature salariale20 ; la seconde une nature purement indemnitaire. Cette discussion sur la nature indemnitaire ou salariale n’est pas sans rappeler, avec quelques nuances, celle qui a longtemps occupé la doctrine privatiste au sujet de l’indemnité de licenciement21 dont la nature indemnitaire n’est aujourd’hui guère contestée22. Elle éclaire, sous un nouveau jour, la question renvoyée par la Cour de cassation.
On peut en effet considérer que l’indemnité de l’article L. 3141-26 du Code du travail ne relève pas directement du droit au repos mais de règles différentes, relevant du droit des commutations. En provoquant son licenciement à la suite d’une faute grave, le salarié ne peut demander, pour des raisons d’ordre moral, une compensation pour un préjudice dont il est responsable. La règle est comparable à celle applicable à d’autres indemnités, particulièrement l’enrichissement injustifié pour lequel on considère également que « le créancier doit subir les effets de l’appauvrissement consécutif à un comportement imprudent ou fautif de sa part »23. Cette dimension punitive de la faute est d’ailleurs soulignée par le Conseil constitutionnel, lequel relève qu’« en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prendre en compte la gravité de la faute ayant conduit au licenciement » (cons. 8).
Si l’on ajoute à ces arguments que le droit au repos dont le requérant se prévalait n’est pas sans limite24, l’inconstitutionnalité intrinsèque de la disposition en cause était loin d’être certaine. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a préféré se fonder sur le principe d’égalité dont la non-conformité à la Constitution était plus évidente. La décision présente en tous les cas l’avantage de mettre en conformité le droit français avec le droit de l’Union européenne. Dès 2013, dans son rapport annuel, la Cour de cassation avait mis en évidence la contrariété de cette disposition avec l’article 7 de la directive 93/104/CE, du 23 novembre 1993 qui ne prévoit pas d’exception au versement de la compensation financière en cas de non-bénéfice des congés payés.
Relevons pour finir que la décision d’inconstitutionnalité concerne les salariés licenciés pour faute lourde à compter de la date de la décision ainsi que ceux qui auraient engagé une procédure contentieuse encore en cours au 3 mars 2016.
Frank Juredieu
2 – Droit de la responsabilité
Responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé pour les conséquences dommageables d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins
Cons. const., 1er avr. 2016, n° 2016-531 QPC. Dans cette décision du 1er avril 2016, le Conseil constitutionnel s’est penché sur la constitutionnalité de l’article L. 1142-1, alinéa 2, du Code de la santé publique relatif aux infections nosocomiales.
L’indemnisation des patients à la suite d’infections liées aux soins médicaux a connu une évolution notable. Avant 2002, l’action de la victime obéissait à un régime différent selon que la juridiction compétente était judiciaire ou administrative. Malgré un rapprochement certain de leur jurisprudence en faveur des victimes, le Conseil d’État et la Cour de cassation n’en ont pas moins continué de suivre un chemin différent. Le premier se fondait sur une présomption de faute25 alors que la seconde retenait une obligation de résultat à la charge du praticien « dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère »26. Face à ce régime de responsabilité à géométrie variable dont les infections nosocomiales ne constituaient qu’un élément, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a eu pour but affiché d’uniformiser le droit applicable. L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique pose ainsi un principe général de responsabilité pour faute applicable aux professionnels de santé. Mais, contre toute attente, l’alinéa 2 de cet article, relatif aux infections nosocomiales, prévoit une responsabilité sans faute pour les établissements de santé sous réserve de la preuve d’une cause étrangère. On pourrait certes souligner que cette règle uniformise le régime applicable à ces établissements en ne les distinguant pas selon leur nature privée ou publique. Mais en vérité, tout en reprenant le système suivi par la Cour de cassation, cet alinéa crée une nouvelle distinction puisqu’il exclut du régime de la responsabilité de plein droit les professionnels de santé exerçant en ville ! Oubli volontaire ou bien maladresse du législateur27 ? En tous les cas, le législateur a substitué à l’ancienne disparité tenant à la dualité d’ordres juridictionnels, une autre inégalité entre victimes. Le requérant s’est engouffré dans cette brèche en invoquant l’article 6 de la Déclaration de 1789.
En l’espèce, le requérant avait contracté une infection nosocomiale à l’occasion d’un acte médical pratiqué par un radiologue exerçant son activité à titre libéral. Après avoir assigné ce dernier ainsi que le centre de radiologie en réparation du préjudice subi, il fut confronté à la difficulté d’apporter la preuve de la faute du praticien. Dans sa QPC soulevée à l’occasion d’un pourvoi incident, le requérant soutient ainsi qu’en obligeant un patient ayant contracté une infection nosocomiale à rapporter la preuve d’une faute du professionnel de santé exerçant en ville, alors que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de diagnostics ou de soins voient leur responsabilité engagée de plein droit pour une telle infection, les dispositions contestées créent une discrimination injustifiée.
De prime abord, on est enclin à suivre l’argumentation du requérant. On peut se demander en effet s’il est justifié de poser une différence de traitement entre patients selon le lieu de survenance de l’infection nosocomiale et en définitive eu égard à la seule structure de l’exercice médical. Tout professionnel ne devrait-il pas respecter les règles d’hygiène et à ce titre se voir imposer le même régime de responsabilité ?
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 1er avril 2016, offre à ces interrogations une réponse particulièrement fournie.
Tout d’abord, le Conseil rappelle que le régime de réparation résultant d’infections nosocomiales ne se limite pas aux établissements de santé mais concerne également les professionnels de santé exerçant en ville. Il s’agit là d’une précision bienvenue compte tenu de la difficulté qu’il existe à définir la notion d’infection nosocomiale, l’étymologie du mot pouvant laisser penser que ce type d’infection se cantonne au milieu hospitalier28.
Le Conseil constitutionnel ensuite ne conteste pas l’existence d’une différence de traitement dans l’engagement de la responsabilité médicale mais considère qu’elle résulte d’une différence de situation. Le Conseil souligne à ce titre que les infections nosocomiales sont beaucoup plus nombreuses dans les établissements de santé et que ces derniers sont tenus, à la différence des praticiens exerçant en ville, de mettre en œuvre une politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d’organiser la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins. Ainsi, « le législateur a entendu prendre en compte les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués dans les établissements, services et organismes de santé et la spécificité des risques en milieu hospitalier » (cons. 7). De l’art de justifier a posteriori une disposition aux fondements incertains !
Frank Juredieu
3 – Procédure pénale
a – Ne bis in idem
b – L’action publique
B – Les QPC transmises par le Conseil d’État
1 – Droit administratif
2 – Droit fiscal
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Jan P., « La performance constitutionnelle », in Mélanges Jean Rossetto, 2016, LGDJ, p. 65.
-
2.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation/contributions-et-discours/2016/discours-de-m-laurent-fabius-a-l-occasion-de-la-rentree-solennelle-de-l-ecole-de-droit-de-sciences-po-paris-14-septembre-2016.147801.html.
-
3.
CE, 17 juill. 2013, M. et Mme A.B.
-
4.
Lettre de la justice administrative, n° 41, janv. 2016.
-
5.
Rapport, p. 6 : http://www.conseil-etat.fr/content/download/1690/5098/version/1/file/rapport_redaction_decisions_juradm_2012.pdf.
-
6.
Cass. com., 22 mars 2016.
-
7.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2016.
-
8.
Cons. const., 28 juill. 2016, n° 2016-732 DC : « S’il est loisible au législateur organique de modifier ou compléter les règles relatives à l’examen des questions prioritaires de constitutionnalités, les dispositions, qui ont été introduites par voie d’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, sont prises sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. Par conséquent, elles ne présentent pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi organique déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui sont prises sur le fondement des articles 13, 64 et 65 de la Constitution. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires ».
-
9.
« Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ».
-
10.
Cass. 1re civ., 9 avr. 2013, n° 11-27071.
-
11.
Voir en ce sens Piazzon T., « Chronique de droit privé », in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2016, Lextenso, n° 52, p. 109.
-
12.
Lawalle E., comm. sous Cass. soc., 29 mai 1990, n° 89-41675 : JCP G 20 mars 1991, II, 21651, spéc. n° 12.
-
13.
Commentaire officiel de la décision du 2 mars 2016, p. 14 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2015523QPC2015523qpc_ccc.pdf.
-
14.
En ce sens, Piazzon T., chron. préc. ; Mouly J., Dr. soc. 2016, p. 475.
-
15.
Mouly J., préc.
-
16.
Sur la notion d’indemnité, voir Le Gallou C., La notion d’indemnité en droit privé, 2007, LGDJ, t. 486.
-
17.
On peut penser que c’est essentiellement par commodité que le législateur a calqué le régime de l’indemnité compensatrice sur celui de l’indemnité de congé : il est en effet particulièrement difficile d’évaluer le préjudice résultant pour le salarié du non-bénéfice des congés payés.
-
18.
Cass. soc., 19 mars 1954 : Dr. soc. 1954, p. 409 ; Savatier J., « Les salaires d’inactivité », Dr soc. 1984, p. 711 et s., spéc. p. 713.
-
19.
Chalaron Y., « Congés payés annuels », Rép. civ. Dalloz 2005, nos 277 et s., spéc. n° 277.
-
20.
Chalaron Y., art. préc., n° 277.
-
21.
V. Mouly J., « À propos de la nature juridique de l’indemnité de licenciement », D. 2008, p. 582.
-
22.
V. cependant Icard J., « Propos hétérodoxes sur l’indemnité de licenciement », JCP S 2014, act. 393, spéc. n° 45.
-
23.
Flour J., Aubert J.-L. et Savaux E., Les obligations, t. 2, 2011, Sirey, n° 18. V. le nouvel article 1303-3 du Code civil : « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ».
-
24.
V. par exemple Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-14743.
-
25.
CE, 9 déc. 1988, n° 65087, Cohen.
-
26.
Cass. 1re civ., 9 nov. 1999, n° 98-10010.
-
27.
V. sur cette question, Alonso C., « La responsabilité du fait des infections nosocomiales : état des lieux d’un régime en devenir », RFDA 2011, p. 329.
-
28.
V. sur cette question, Vauthier J.-P. et Vialla F., « Constitutionnalité du régime de responsabilité en matière d’infection nosocomiale », D. 2016. 1064.