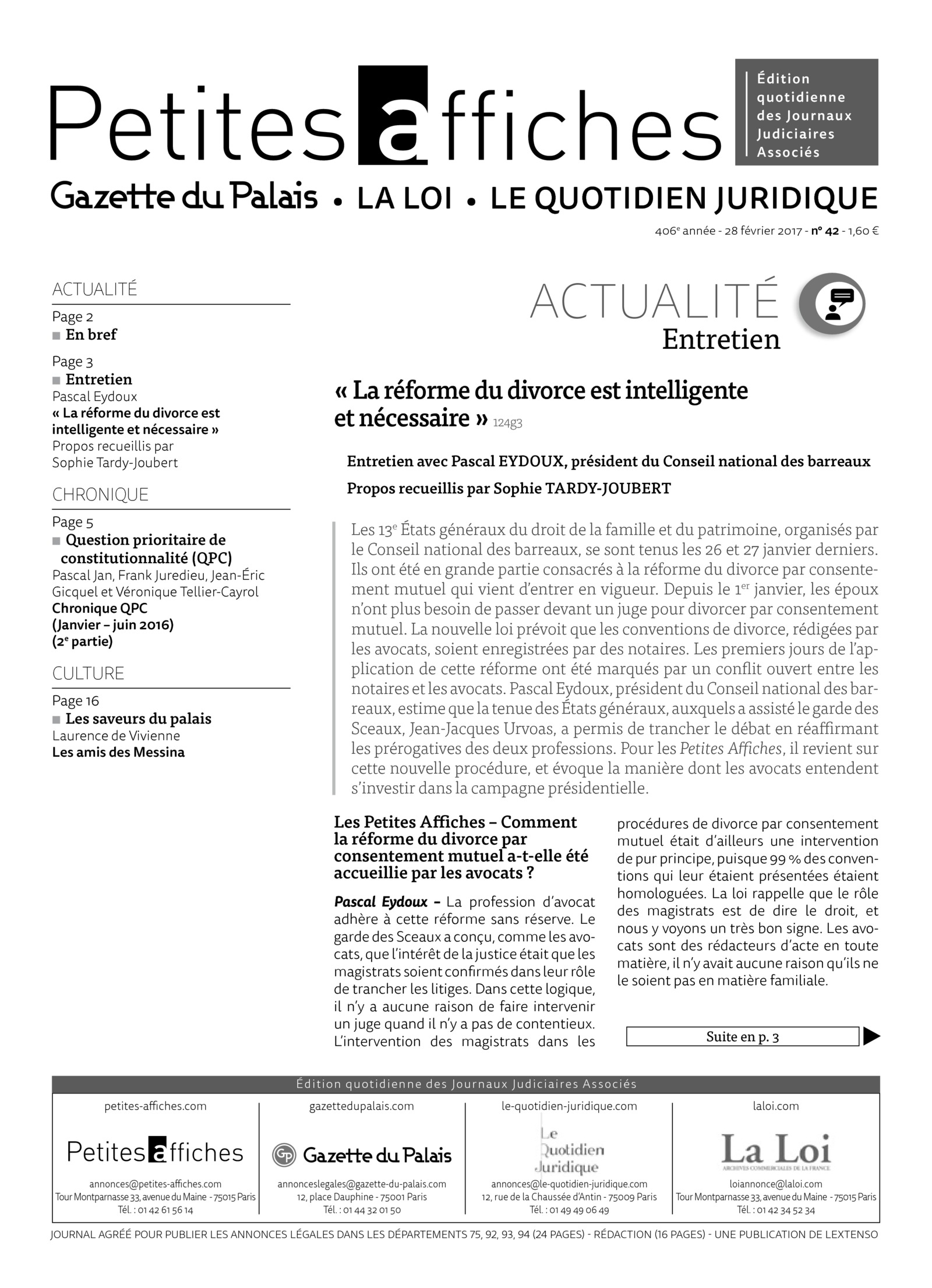Chronique QPC (Janvier – juin 2016)(2e partie)
La présente étude porte sur les questions prioritaires de constitutionnalité traitées par le Conseil constitutionnel entre le 1er janvier et le 30 juin 2016. Cette chronique, placée sous la responsabilité de Pascal Jan (professeur – IEP Bordeaux), a été rédigée par Jean-Éric Gicquel (professeur – Rennes 1), Véronique Tellier-Cayrol et Frank Juredieu (maîtres de conférences – Tours).
I – Le procès constitutionnel
II – La jurisprudence
A – QPC transmises par la Cour de cassation
1 – Droit social
2 – Droit de la responsabilité
3 – Procédure pénale
a – Ne bis in idem
Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale
Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC, M. Jérôme C. et Cons. Const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC, M. Alec W. et a. Dans sa décision du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a dégagé quatre critères permettant de rejeter le cumul de sanctions : l’identité de faits, la protection des mêmes intérêts sociaux, l’identité de nature des sanctions, l’identité d’ordre juridictionnel. Par le biais d’une réserve d’interprétation, il avait interdit la double poursuite des infractions boursières en imposant une unique poursuite, soit devant l’AMF, soit devant le juge pénal1.
S’appuyant sur cette décision, deux contribuables (J. Cahuzac et A. Wildenstein) soulevèrent une QPC en matière fiscale, soutenant que les sanctions administratives et pénales s’appliquent aux mêmes faits, protègent les mêmes intérêts sociaux, sont d’une nature et d’une sévérité équivalentes et relèvent du même ordre de juridiction. Leurs espoirs d’échapper au procès pénal sont déçus : dans ces nouvelles décisions en date du 24 juin 2016, le Conseil se prononce en faveur du cumul de sanctions pénales pour « soustraction frauduleuse » à l’impôt (CGI, art. 1741) et de sanctions administratives pour « manœuvre frauduleuse » (CGI, art. 1729).
Il procède en premier lieu à l’analyse séparée des sanctions. La majoration fiscale, sanction administrative, est assise sur le montant de l’impôt éludé, proportionnelle et variable, eu égard au taux applicable de 40 % ou de 80 % ; pour le Conseil, « les taux de majoration fixés par le législateur ne sont pas manifestement disproportionnés » (§ 10). Le juge pénal, quant à lui, peut condamner l’auteur d’un délit de fraude fiscale à une peine d’emprisonnement, à une amende2, ainsi qu’à des peines complémentaires. Là encore, le Conseil décide que « les peines instituées par le législateur ne sont pas manifestement disproportionnées » (§ 12).
En second lieu, le Conseil s’attarde sur l’application combinée des articles 1729 et 1741. D’une part, les sanctions pécuniaires infligées par l’Administration fiscale « visent à garantir la perception de la contribution commune et à préserver les intérêts financiers de l’État » ; d’autre part, les poursuites pénales « ont un caractère public qui leur confère une exemplarité et une portée dissuasive supplémentaire pour l’ensemble des personnes susceptibles de manquer frauduleusement à leurs obligations fiscales ». Il en conclut que les dispositions contestées « permettent d’assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l’État ainsi que l’égalité devant l’impôt, en poursuivant des finalités communes, à la fois dissuasive et répressive. Le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l’objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient l’engagement de procédures complémentaires dans les cas de fraudes les plus graves » (§ 20). Le cumul est ainsi permis, les procédures étant « complémentaires ».
Le Conseil pose néanmoins trois réserves d’interprétation.
Il consacre tout d’abord une certaine autorité de la chose jugée au fiscal sur le pénal : « les dispositions contestées de l’article 1741 du Code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale » (§ 13). Outre une rédaction maladroite (le motif de fond ne renvoie pas à la décision devenue définitive, mais à la décharge de l’impôt), une telle réserve semble s’opposer à la jurisprudence de la Cour de cassation. La chambre criminelle a, en effet, toujours refusé de reconnaître une autorité de la chose jugée au fiscal sur le pénal, considérant que les poursuites pénales pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt étaient, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre et que le juge répressif n’avait pas à surseoir à statuer3.
Cette réserve d’interprétation relance ainsi le débat sur le sursis à statuer du juge répressif, ce que n’ont pas manqué d’invoquer les avocats dans l’affaire Wildenstein. Ils prétendaient que le juge pénal devait surseoir à statuer en attendant la décision de Bercy : un contribuable ne peut être poursuivi et condamné par un tribunal correctionnel alors qu’il pourrait être déchargé des impôts. Le parquet national financier s’y opposait, s’appuyant sur l’utilisation du passé composé, lequel sous-entend que le contentieux fiscal ait été purgé. Dans sa décision du 26 septembre 2016, le tribunal correctionnel a refusé de surseoir à statuer. Le risque de contradiction existe alors entre un juge pénal qui condamne le contribuable avant que l’Administration ne le décharge de l’impôt.
Ensuite, le Conseil constitutionnel décide, en application du principe de nécessité des peines, que les sanctions pénales ne peuvent s’appliquer « qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt » (§ 21). Comment caractériser ces cas les plus graves ? Les juges constitutionnels indiquent que « cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ». La jurisprudence de la Commission des infractions fiscales4 donne des indications : les cas les plus graves concernent un montant minimal de fraude de 100 000 € ; la nature des agissements repose sur l’utilisation de logiciels comptables de fraude fiscale, sur l’existence d’interposition de sociétés, de comptes à l’étranger, dans des paradis fiscaux. On peut néanmoins d’une part, constater une atteinte au principe de la légalité en raison de l’imprécision des critères et d’autre part, craindre une rupture d’égalité selon les juges qui peuvent ne pas avoir la même appréciation du critère de gravité.
Enfin, en application du principe de proportionnalité des peines, le Conseil rappelle que le montant global des sanctions pénales et administratives ne doit pas excéder le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (§ 24 QPC n° 546, et § 8 QPC n° 545). Ce plafonnement du montant des sanctions cumulées n’est pas nouveau dans la jurisprudence constitutionnelle5. Comme l’ont relevé plusieurs auteurs, cette solution apparaît comme une solution de compromis peu satisfaisante : soit le cumul est admis et il n’y a pas de raison de le limiter ; soit il est exclu. Elle semble seulement justifiée au regard de la position européenne : dans son arrêt Rinas c/ Finlande du 27 janvier 2015, la Cour européenne a en effet reproché à la Finlande d’avoir des procédures pénale et fiscale indépendantes, la sanction prononcée par une autorité n’étant pas prise en considération lors du prononcé de la sanction par l’autre autorité6.
Les décisions du 24 juin posent en réalité plus de questions qu’elles n’en résolvent. On comprend dès lors que les regards se tournent vers Strasbourg. La Cour européenne7 a en effet tenu une audience en grande chambre le 13 janvier 2016, une nouvelle fois à propos de la règle ne bis in idem. Dans les deux affaires dont elle est saisie, des contribuables avaient été condamnés à la fois à une majoration d’impôt et à une peine d’emprisonnement ferme. La France, en tant que tiers intervenant, a présenté des observations écrites. Affaire à suivre donc…
Véronique Tellier-Cayrol
b – L’action publique
Subordination de la mise en mouvement de l’action publique en matière d’infractions fiscales à une plainte de l’Administration
Cons. const., 22 juill. 2016, n° 2016-555 QPC, M. Karim B. En cas de fraude en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et d’autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales prévoit que l’action publique ne peut, à peine d’irrecevabilité, être exercée qu’après le dépôt d’une plainte par l’Administration, plainte dont la recevabilité est conditionnée à l’avis conforme de la commission des infractions fiscales.
En procédure pénale, ce n’est pas la seule hypothèse pour laquelle le ministère public ne peut agir qu’après le dépôt d’une plainte. Il en est ainsi en cas de « délits privés » tels que la diffamation, l’atteinte à la vie privée ou encore le délit de chasse sur le terrain d’autrui. Dans ces situations, on comprend bien que la victime est la mieux placée pour décider des suites à donner et pour choisir d’en informer, ou non, le procureur de la République. Il n’est pas permis au ministère public de s’immiscer dans des intérêts essentiellement privés sans que la victime ne lui en donne l’autorisation.
En matière de fraude fiscale, l’explication est plus difficile à trouver. Elle tiendrait à la technicité et au degré d’expertise élevé des acteurs chargés de ce contentieux. Depuis la création du procureur national financier, on peine à comprendre le maintien de cette justification, et partant, le maintien de ce verrou fiscal8 ; et cela d’autant plus qu’il apparaît contraire à plusieurs principes constitutionnels. La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a d’ailleurs relevé dans sa décision de renvoi du 19 mai 2016, retenant le caractère sérieux de la question « en ce que l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales (…) qui subordonne les poursuites pour fraudes fiscales à une plainte préalable de l’administration fiscale sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, est susceptible de porter une atteinte injustifiée aux principes d’indépendance de l’autorité judiciaire et de la séparation des pouvoirs, en privant le ministère public de son pouvoir d’apprécier l’opportunité des poursuites au bénéfice du ministre chargé du Budget ».
L’auteur de la question invoquait également la violation du principe d’égalité devant la loi en raison du pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale. Sur ce point, la réponse du Conseil relève du postulat : « les dispositions contestées n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les auteurs présumés (sic) d’infractions contre lesquels l’Administration dépose plainte et ne méconnaissent donc pas le principe d’égalité devant la loi » (§ 8). En l’absence de motivation dans la décision, on se reportera au commentaire officiel lequel indique que « les dispositions contestées telles qu’interprétées déterminent uniquement une règle processuelle relative à la capacité du procureur de la République d’engager des poursuites ». Une règle processuelle ne peut donc pas porter atteinte au principe d’égalité ! La faculté d’évocation de la chambre de l’instruction a pourtant bien été jugée contraire au principe d’égalité9. Le commentaire officiel ajoute que les dispositions contestées « ne fixent aucune règle de sélection des personnes contre lesquelles l’Administration dépose plainte ». On pourrait justement y voir une atteinte au principe d’égalité !
La décision est plus développée – sans pour autant être plus convaincante – s’agissant du grief tiré de la méconnaissance des principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de l’autorité judiciaire.
Tout d’abord, une fois la plainte déposée, le procureur de la République dispose « librement de l’opportunité des poursuites » (§ 12). Certes, mais encore faut-il qu’une plainte soit déposée.
Ensuite, « les infractions pour lesquelles une plainte de l’Administration préalable aux poursuites est exigée répriment des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’État et causent un préjudice principalement au Trésor public ». L’Administration serait donc la mieux placée « pour apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale » (§ 13). Le procureur appréciera d’être ainsi évincé ! Par ailleurs, pour quelle raison, alors, l’escroquerie en matière de TVA ou la fraude aux contributions indirectes ne sont-elles pas des infractions soumises à l’article L. 228 ?
Enfin, « la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l’Administration qui l’exerce dans le respect d’une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l’article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d’égalité » (§ 14). Le respect d’une politique pénale déterminée par le Gouvernement n’est-il pas ce qui guide quotidiennement l’action du ministère public ? Quant au principe d’égalité, on l’a vu précédemment, il paraît difficile de le faire reposer sur le fait que le choix de porter plainte ne repose sur aucun critère objectif. Le Conseil constitutionnel reprend ici le raisonnement tenu dans ses décisions n° 545 et 546 du 24 juin, réservant la possibilité de poursuites pénales « aux cas les plus graves » (§ 21 ; cf. supra).
Véronique Tellier-Cayrol
B – Les QPC transmises par le Conseil d’État
NB : Les décisions n° 2016-535 et n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l’Homme, ont été commentées dans la précédente chronique.
1 – Droit administratif
Dérogations temporaires au repos dominical des salariés des commerces de détail à Paris
Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-457 QPC, Ville de Paris. L’article L. 3132-3 du Code du travail dispose que « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Pourtant, chacun sait que de multiples dérogations se sont accumulées au fil du temps (v. C. trav., art. L. 3132-12 à L. 3132-27-1) et que les contentieux ne manquent pas10.
Dans le cas présent, la loi du 6 août 2015 (dite loi Macron) a entendu développer le recours au travail dominical. C’est ainsi qu’aux côtés de la création des zones touristiques internationales (C. trav., art. L. 3132-24) et de la création-refonte des zones touristiques (C. trav., art. L. 3132-25) et commerciales (C. trav., art. L. 3132-25-1), l’article L. 3132-26 prévoit désormais que pour les établissements de commerce de détail (qui ne bénéficient pas d’un régime dérogatoire existant comme, par exemple, pour l’ameublement et le bricolage) où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, une autorisation peut être donnée par le maire non plus cinq fois par année civile mais douze. La décision de fixation de ces « dimanches du maire » avait été originellement attribuée au maire sauf à Paris où la compétence était exercée par le préfet de Paris. Le maintien de cette différenciation est-il conforme à la Constitution ?
On pouvait, dès le départ, en douter. Saisi en 2009, le Conseil constitutionnel avait eu l’occasion de statuer sur la procédure de classement d’une commune dans la catégorie des communes d’intérêt touristique ou thermale et de délimitation du périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente (transformées, par la loi dite Macron, en zones touristiques, v. supra). Ces mesures étaient décidées par le préfet sur proposition du conseil municipal sauf à Paris où les décisions du préfet de Paris étaient rendues sur proposition du… préfet de Paris. Le Conseil jugea qu’« aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition (…) ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l’ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille » et invalida le mécanisme11. Le Conseil n’avait pas été sensible au principal argument du Gouvernement, à savoir que « la situation particulière dans laquelle se trouve Paris par rapport à l’ensemble des autres communes de France, même les plus importantes, au regard de l’afflux touristique dont est l’objet la capitale »12.
Dans ces conditions, la délivrance des « dimanches du maire » à Paris par le préfet s’avérait des plus fragiles sur le plan juridique. Pourtant, le statu quo a été préservé lors de la discussion législative. Peut-être, faut-il y voir un effet du bras de fer, par médias et frondeurs du parti socialiste interposés, opposant vivement le ministre de l’Économie à la maire de Paris13 parallèlement réticente à l’égard des zones touristiques internationales (v. supra) dont la délimitation lui échappe totalement puisqu’elle échoit aux ministres chargés du Travail, du Tourisme et du Commerce. Incidemment, on notera que, saisi de la loi dite Macron dans le cadre du contrôle a priori14, le Conseil n’a pas cru bon de soulever d’office ce moyen. Il est vrai que cette technique procédurale n’a plus vocation à se développer lorsque la contestation porte sur une question de fond en raison de l’existence de la QPC.
Comme il fallait s’y attendre, la Ville de Paris a donc pleinement récupéré l’attribution de fixation de ses « dimanches du maire ».
Que la capitale soit placée dans une situation différente par rapport aux autres communes ne fait pas de doute. Constituant à elle seule une catégorie de collectivités territoriales, ayant la qualité de siège des pouvoirs publics, des régimes particuliers sont pleinement justifiés. On pensera principalement à l’existence d’un Conseil de Paris et d’un préfet de Paris aux compétences étendues. Encore faut-il, et on retrouve ici une approche classique du juge à l’égard de la mise en application du principe d’égalité, justifier de la présence d’une raison d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi de nature à justifier la différence de traitement. Tel n’était pas le cas dans la présente espèce.
Jean-Éric Gicquel
Incompatibilité de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC
Cons. const., 15 janv. 2016, n° 2016-516 QPC, M. Robert M. et a. L’irruption récente des nouveaux moyens de transport particulier de personnes encouragée par la révolution numérique suscite une intervention régulière du Conseil constitutionnel15. Ici, il s’agissait, pour celui-ci, de se pencher sur la constitutionnalité de l’article L. 3121-10 du Code des transports (issu de la loi du 1er octobre 2014 – loi dite Thévenoud), rendant incompatible l’exercice de l’activité de conducteur de taxi avec celui de l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Cette situation pour le moins atypique (on imagine la situation de tels « cumulards » devant choisir leur camp dans une de ces régulières échauffourées opposant chauffeurs de taxis et « VTCistes »…) concernerait cependant, selon le Gouvernement, au minimum 1 500 cas situés surtout en province16.
L’objectif de cette incompatibilité était double : astreindre les chauffeurs de taxis à utiliser pleinement leur autorisation de stationnement (communément appelée « licence de taxi » ou « plaque ») et surtout lutter contre la fraude dans le marché lucratif du transport de malades assis représentant la part majoritaire de l’activité des taxis en province17. La côte était toutefois mal taillée. D’abord, parce que le titulaire d’une autorisation de stationnement (ADS ci-après), comme le relève à bon droit le Conseil, n’exerce pas nécessairement par lui-même l’activité de conducteur de taxi (cons. 7). En effet, il est loisible, pour le titulaire d’une ADS délivrée avant la promulgation de la loi du 1er octobre 2014 de faire exploiter le taxi par un salarié ou par un locataire-gérant18. En conséquence, rien ne lui interdisait, contrairement aux autres chauffeurs de taxis, d’exercer parallèlement l’activité de conducteur de VTC.
Ensuite, si la fraude à l’assurance-maladie occasionnée par le transport des malades il y a, et personne ne le conteste19, celle-ci n’est guère occasionnée par l’activité clandestine des VTC mais surtout par des abus en tout genre (surfacturations, facturations sur des kilométrages ne correspondant pas à la réalité) et d’erreurs commises par les médecins dans la détermination du mode de transport en adéquation avec l’état du patient. Par ailleurs, le Conseil rappelle que « seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes obligatoires d’assurance maladie pour assurer le transport des malades » (cons. 7). Bref, si l’on peut accuser, à tort ou à raison c’est un autre débat, les VTC de tous les maux, les rendre responsables de la fraude à l’assurance maladie paraissait franchement dénué de pertinence.
Dans ces conditions, le juge constitutionnel en a conclu à l’inconstitutionnalité de l’article L. 3120-10 au motif que « le législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est justifié ni par les objectifs qu’il s’est assigné ni par aucun motif d’intérêt général » (cons. 7).
Que l’irrespect de la liberté d’entreprendre20 entraîne l’invalidation est à souligner. En effet, il ne fait pas de doute que le Conseil s’est progressivement montré plus vigilant à l’égard du degré de protection à lui apporter. Initialement, il sanctionnait seulement les restrictions arbitraires ou abusives au motif pris qu’elle « n’est ni générale ni absolue »21. Depuis 2001, il considère, dans une logique de resserrement de son contrôle désormais dédoublé22, « qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi »23. Reste que ce progrès était tempéré par le constat selon lequel les rares annulations prononcées étaient généralement couplées avec la méconnaissance d’un autre droit et liberté (tel le droit de propriété ou la liberté de communication24). De là à penser que la liberté d’entreprendre puisse être qualifiée de liberté-croupion, il y avait un pas qu’il était assez facile de franchir. Il en va autrement ici puisque sa méconnaissance est sanctionnée « sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief » (relatif à la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi). C’est peut-être le premier signe d’une évolution durable.
Jean-Éric Gicquel
Permis de visite et autorisation de téléphoner durant la détention provisoire
Cons. const., 24 mai 2016, n° 2016-543 QPC, Section française de l’Observatoire international des prisons.
Deux aspects pourront être retenus de cette décision.
En premier lieu, des dispositions de droit pénitentiaire relatives au régime des visites et de l’accès au téléphone des détenus ont été jugées contraires au « droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction »25 et, par ricochet, privent de garanties légales la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale. Après avoir déçu les observateurs sur la question du travail en prison26, les Sages se sont montrés ici fermes.
En étant plus précis, trois modalités sont à distinguer :
-
l’article 145-4 du Code de procédure pénale (ci-après CPP) prévoyait que, lors de la détention provisoire, la décision de refus prise par le juge d’instruction de délivrer un permis de visite à un membre de la famille du détenu pouvait être contestée devant le président de la chambre de l’instruction, celui-ci, disposant d’un délai de cinq jours pour statuer. Malgré cela, il restait muet dans le cas d’une demande présentée en l’absence d’instruction (principalement en cas de comparution immédiate) ou après la clôture de celle-ci, ou émanant d’une personne extérieure à la famille. Cette incomplétude a été sanctionnée ;
-
de son côté, l’article 39 de la loi du 24 novembre 2009 était encore plus lacunaire puisqu’il n’instituait aucune voie de recours aux décisions de refus d’accès au téléphone à une personne placée en détention provisoire. Il n’y a pas lieu d’insister sur l’évidente méconnaissance du droit d’exercer un recours effectif. Pour autant, ne faisons pas de mauvais esprit en pensant au nombre substantiel de téléphones portables introduits frauduleusement dans les établissements pénitentiaires27… ;
-
en revenant à l’article 145-4 du CPP, on a vu plus haut que la décision du juge d’instruction refusant un permis de visite à un membre de la famille pouvait, elle, être contestée. Reste qu’il n’était pas prévu que le juge d’instruction soit astreint de statuer dans un délai déterminé. Pour le Conseil, calant son raisonnement sur celui tenu dans une précédente décision relative à la restitution de biens saisis intervenue dans le cadre d’une information judiciaire28, le détenu se retrouve alors dénué de la possibilité d’intenter un recours. Il n’est pas pour autant dit que tous les mécanismes prévoyant l’intervention d’un acteur dans un délai déterminé encourent systématiquement l’invalidation. Dans les deux hypothèses, le Conseil a pris en compte le contexte global et relevé que les déficiences juridiques du CPP portent atteinte au droit de propriété pour l’un et aux droits au respect de la vie privée et de mener une vie familiale normale pour l’autre.
En second lieu, le comportement du Gouvernement est à souligner. Anticipant une vraisemblable censure, les devants ont été pris. Par le biais d’un amendement déposé par le garde des Sceaux le 31 mars 201629, les modifications nécessaires à apporter à l’article 145-4 du CPP (et implicitement à l’article 39 de la loi du 24 novembre 2009) ont été effectuées30. C’est ainsi que l’article 63 de la loi du 3 juin 2016 (avec une entrée en vigueur prévue pour le 15 novembre 2016) aménage la possibilité d’exercer des recours dans toute les hypothèses traitées supra et prévoit qu’à défaut de réponse du juge d’instruction dans un délai de vingt jours, le détenu peut saisir le président de la chambre de l’instruction. On est face ici à un bel exercice de dialogue vertueux entre le Parlement et le Conseil constitutionnel.
La conjonction des astres fut ici parfaite. Elle ne peut être qu’exceptionnelle car une telle démarche prophylactique est exigeante. Il faut déjà tout à la fois identifier, avec certitude, l’inconstitutionnalité de la disposition, être décidé à y mettre fin et s’accorder sur le libellé adéquat du correctif juridique à apporter. La réussite n’est pas toujours au rendez-vous31. Ensuite, il faut être dans le bon tempo, c’est-à-dire disposer d’un vecteur législatif adéquat. Or les choses se compliquent singulièrement. Non seulement les créneaux disponibles devant les assemblées sont limités en raison de la boulimie réformiste du Gouvernement mais il faut, en outre, éviter la censure d’un Conseil constitutionnel de plus en plus vigilant sur les aspects procéduraux lorsqu’il est saisi a priori (pour la raison évidente que ces derniers ne pourront pas ultérieurement être invoqués dans le cadre d’une QPC). Le droit d’amendement des parlementaires mais aussi des membres du gouvernement est strictement encadré ; les articles issus d’amendement dépourvus de lien avec le texte étant invalidés pour méconnaisse de l’article 45 de la Constitution de 195832. Bref, il faut savoir constamment naviguer entre Charybde et Scylla pour arriver à bon port.
Jean-Éric Gicquel
2 – Droit fiscal
Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale
Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC, M. Jérôme C. (et par prétérition Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC, M. Alec W. et a.).
Si la thématique de la déontologie était déjà à la mode sous le précédent quinquennat, il est certain que la démission de Jérôme Cahuzac de ses fonctions ministérielles en 2013 a provoqué une rupture. L’opinion publique n’aurait pas compris une absence de réaction des pouvoirs publics. L’onde de choc a touché tous les secteurs et désormais les gouvernants, les élus, les fonctionnaires et les magistrats sont astreints à des obligations détaillées de transparence et d’exemplarité. Il y a bien eu un « avant » et « après » l’affaire Cahuzac. En va-t-il de même dans le domaine fiscal et plus particulièrement sur la délicate question du cumul des sanctions fiscales et pénales ? La réponse est là négative, le Conseil constitutionnel a jugé que « l’application combinée de l’article 1729 et des dispositions contestées de l’article 1741 du Code général des impôts ne peut (…) être regardée comme conduisant à l’engagement de poursuites différentes aux fins de sanctions de faits identiques en application de corps de règles distincts et ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines » (§. 23).
Avant de traiter le fond, on pourra penser, à côté de l’ironie cinglante du vice-procureur Jean-Marc Toublanc à l’égard du dépôt de requête QPC par les avocats de Jérôme Cahuzac33, au décalage grandissant entre la vision idyllique de la QPC (permettant que « la Constitution [soit] désormais l’affaire des citoyens34») et l’émergence d’un véritable « marché » de plus en plus trusté par les grands cabinets d’avocats d’affaires35. Mais n’allons pas plus loin.
Le point de droit à examiner par le Conseil constitutionnel est relatif à la possibilité pour un contribuable d’être à la fois condamné à une amende fiscale en application de l’article 1729 du Code général des impôts (ci-après CGI) puis d’une amende assortie d’une peine de prison prononcée par le juge pénal et prévue par l’article 1741 du CGI. Autrement dit, le cumul des poursuites et des sanctions administratives (ici pécuniaires) et pénales (là pécuniaires et privatives de liberté) pour les mêmes faits est-il conforme à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 ?
Pourtant, on sait, depuis 1989, que la règle du non bis in idem, dépourvue de valeur constitutionnelle36, ne reçoit pas application au cas de cumul entre sanctions pénales et sanctions administrative et qu’un tel cumul est conforme à la Constitution37. Mais, depuis, des changements dans les circonstances de droit se sont produits. Reste qu’il n’est plus possible de raisonner sous un angle exclusivement national. Après s’être attaquée, avec succès, à la mansuétude des juridictions françaises à l’égard des lois de validation législative38, la Cour européenne des droits de l’Homme entend maintenant, grâce à l’autorité persuasive de sa jurisprudence, les convaincre de s’aligner sur sa position nettement plus restrictive de possibilité d’un tel cumul fondée sur l’article 4 du Protocole n° 7. Il y avait eu dans le passé l’arrêt Zielinski, Pradal, Gonzales et autres c/ France du 28 octobre 1999 dans le domaine des validations ; il faut désormais compter notamment sur les décisions du 10 février 2009, Sergueï Zolotoukhine c/ Russie et du 4 mars 2014, Grande Stevens et a. c/ Italie.
Nul besoin d’insister sur le fait que le Conseil constitutionnel peut difficilement faire la sourde oreille. Qu’une disposition législative jugée conforme à la Constitution par ses soins, puisse ensuite être inappliquée par les juges ordinaires en raison de son inconventionnalité ou, pire encore, provoque la condamnation de la France par la Cour de Strasbourg n’est pas souhaitable.
Un premier pas en sa direction a été accompli avec la décision John L. et a.39. L’inconstitutionnalité du cumul, pour les mêmes faits, de poursuites et de sanctions pour délit d’initié devant le juge pénal d’une part, et pour manquement d’initié devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers d’autre part, a été reconnue. Se fondant sur des critères dégagés de manière prétorienne, le Conseil a jugé que les deux sanctions ne peuvent « être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction » (cons. 28) et que, ce faisant, le principe de nécessité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 avait été méconnu. Cette brèche pouvait-elle être élargie dans l’hypothèse du cumul de sanctions administratives et pénales en matière fiscale ? Tel était l’enjeu important de la décision Cahuzac.
Le Conseil a repris son considérant de principe de sa décision John L. Il l’a cependant amputé de la condition relative à l’existence de l’ordre de juridiction. Son maintien étant intenable en l’espèce puisque si les sanctions pénales sont toujours prononcées par le juge judiciaire, il en va différemment des sanctions fiscales qui sont, en fonction de la répartition du contentieux fiscal entre les deux ordres juridictionnels, tantôt décidées par le juge administratif, tantôt par le juge judiciaire. Donc, dans ce domaine, « le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts » (par. 8).
Reste que le Conseil a dû se comporter tel un funambule pour admettre la constitutionnalité du cumul des sanctions prévues par l’article 1729 du CGI (fixant, pour aller vite, une majoration de 40 % (ou de 80 %) en cas de manquement délibéré en matière de déclaration dans le cas d’inexactitudes ou d’omissions ou de manœuvres frauduleuses) et l’article 1741 du CGI (rendant celui qui s’est frauduleusement soustrait – ou tenté de le faire – à l’établissement ou au paiement des impôts passible d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans). Rajoutons, avant de poursuivre, que les Sages ont profité de cette QPC pour écarter la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui jugeait constamment, au nom du principe d’indépendance des procédures pénale et fiscale, qu’un contribuable déchargé de l’impôt par le juge de l’impôt pouvait néanmoins être condamné pour fraude fiscale par le juge pénal. Ce n’est désormais plus possible à condition que le contribuable ait été déchargé pour un « motif de fond » (par. 13) ce qui réserve le cas, on l’a compris, des motifs de procédure.
Pour reprendre le fil, on pouvait en effet raisonnablement estimer, à la lueur de son paragraphe de principe (v. supra) et de la méthode d’examen sollicitée dans l’affaire John L.40, que les deux dispositions du CGI : a) répriment les mêmes faits ; b) protègent les mêmes intérêts sociaux ; et c) aboutissent au prononcé de sanctions de nature similaire (même s’il est vrai que seul le juge pénal peut prononcer, exceptionnellement en pratique, une peine privative de liberté), ce qui aurait alors conduit le Conseil à estimer que l’article 8 de la Déclaration de 1789 avait été méconnu.
Reste que la fraude fiscale ne rencontre pas la moindre mansuétude de la part de la rue de Montpensier. Non seulement, il a été jugé que « l’exercice des libertés et droits individuels ne saurait en rien excuser la fraude fiscale ni en entraver la légitime répression »41 mais a été aussi reconnu, découlant de l’article 13 de la Déclaration de 1789, « un objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale »42.
Le Conseil a donc choisi un chemin de traverse et regardé les articles 1729 et 1741 du CGI comme établissant des « procédures complémentaires » (§. 20) et non distinctes. Bref, la règle du non bis in idem n’est pas concernée faute de la présence d’un « bis ». On est ici face à deux mécanismes législatifs permettant « d’assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l’État ainsi que l’égalité devant l’impôt en poursuivant des finalités communes, à la fois dissuasive et répressive » (par. 20 – nous soulignons). Le versant pénal de la répression a pour objet de renforcer son équivalent administratif. Toutefois, il a été rajouté que le cumul des sanctions respecte le principe de nécessité des délits et des peines à condition de rester exceptionnel. Plus précisément, les sanctions pénales devront être exclusivement réservées « aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt » (§. 21). Quant à la proportionnalité entre les peines, il a indiqué selon une démarche traditionnelle que l’article 8 de la Déclaration n’était pas méconnu tant que « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues » (§. 24).
On l’a compris, le raisonnement du Conseil constitutionnel est au final quelque peu sinueux mais c’était le prix à payer pour sauver le cumul des poursuites et des sanctions en matière fiscale. Quant à celui que l’ancien ministre devra acquitter, c’est une autre affaire…
Jean-Éric Gicquel
Validation des évaluations de valeur locative par comparaison avec un local détruit ou restructuré
Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-525 QPC, Société civile immobilière PB 12. En réponse aux réclamations formulées par les contribuables souhaitant, afin de pouvoir contester utilement les taxes portant sur les propriétés bâties (soit la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises), obtenir davantage de précision sur les modalités de calcul retenues par l’administration fiscale, il est généralement fait état d’une énigmatique référence à une « VL1970 ». Celle-ci est obtenue en multipliant la valeur-locative unitaire par le nombre de m² de la surface pondérée. C’est à partir d’elle que l’impôt final est ensuite calculé.
Un des enjeux majeurs de la contestation entre le contribuable et l’Administration tourne autour de la détermination de cette valeur locative unitaire que ce soit pour un local d’habitation et à usage professionnel autre que commercial (régi par l’article 1496 du CGI) ou pour un local commercial (article 1498). Pour des raisons de concision, seul ce dernier sera ici présentement traité.
Trois méthodes de détermination des valeurs locatives unitaires sont ici prévues. La première (1° de l’article 1498) fait appel au loyer au m² pratiqué dans le bail de location conclu à des conditions normales au 1er janvier 1970. Il n’est pas besoin d’insister sur le fait qu’au fil des années, cette approche est devenue de plus en plus marginale. La seconde (2° de l’article 1498), de loin la plus utilisée, est la méthode dite « par comparaison ». On applique au local à évaluer la valeur locative unitaire d’un autre local (soit le local-type). Encore faut-il, d’une part, que le local-type et le local, figurant sur le procès-verbal communal des opérations de révision des évaluations des propriétés bâties, ne soient pas franchement dissemblables (par exemple, un local-type « boulangerie » ne peut être utilisé pour évaluer la valeur locative d’un hôtel) et, d’autre part et surtout, que la valeur du local-type soit régulièrement fixée. C’est-à-dire qu’elle ait été, elle aussi, évaluée par référence à un bail courant au 1er janvier 1970 ou, à défaut, par comparaison avec un local-type lui-même évalué conformément à cette méthode. En d’autres termes, un enchaînement de termes de comparaisons (la valeur locative de l’immeuble C sert à déterminer la valeur locative de l’immeuble B qui servira à connaître la valeur locative de l’immeuble A) peut être effectué. Il exige qu’à son origine se trouve un immeuble (ici le C) dont la valeur locative découle régulièrement du bail conclu au 1er janvier 1970. Enfin, à titre subsidiaires, si les deux premières méthodes ne peuvent être utilisées, l’Administration procède alors à l’appréciation directe (3° de l’article 1498).
Pour revenir à la méthode par comparaison, le Conseil d’État a, en 2014, compliqué la tâche de l’administration fiscale en décidant « qu’un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d’une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d’un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d’une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition » (CE, 5 févr. 2014, n° 367995, Société Ishtar). En clair, le local-type servant de fondement originel de comparaison (v. supra) ne doit pas avoir été détruit ou restructuré au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’affaire aurait pu en rester là mais l’administration fiscale, qui éprouve des difficultés grandissantes à trouver ce terme de comparaison ultime, en raison de la disparition progressive des locaux loués au 1er janvier 1970, a réussi à convaincre le Gouvernement de passer par la voie d’une validation législative. C’est ainsi que l’article 32 de la loi de finances du 29 décembre 2014 se retrouve devant le prétoire du Conseil constitutionnel. Notons, avant d’aller plus loin, que ce dernier, saisi de ladite loi dans le cadre de l’examen a priori43, avait décidé de ne pas soulever d’office son inconstitutionnalité. Quitte à recourir à cette technique, le juge, comme on l’a déjà dit, préfère se focaliser sur des aspects procéduraux. Comme cette affaire en témoigne, les justiciables disposent toujours de la QPC pour faire valoir leurs droits sur le plan substantiel.
Recourant à son faisceau de critères, dans sa version ciselée en 201444, le juge a censuré l’article de validation législative. La question centrale tournait autour du motif impérieux d’intérêt général avancé ; à savoir, concomitamment le développement d’un contentieux de masse de nature à perturber le fonctionnement de l’administration fiscale et un risque financier pour l’État et les collectivités territoriales. Ces arguments n’ont pas convaincu les Sages.
D’abord, compte-tenu du caractère circonscrit de la jurisprudence Ishtar, qui on l’a vu ne concerne que les seuls immeubles détruits ou entièrement restructurés, rien n’établit « que le nombre de contestations de la fixation des valeurs locatives s’accroisse dans des conditions de nature à perturber l’activité de l’administration fiscale et de la juridiction administrative » (cons. 9). Ensuite, sur le plan financier, étant précisé qu’en soi ce motif n’est pas considéré par le Conseil comme suffisant45, les risques de dommage avaient être franchement exagérés.
En effet, une valeur locative contestée à bon droit par un contribuable n’emporte jamais le dégrèvement de l’imposition sauf dans l’hypothèse limitée où le local de référence dont la valeur locative a été opposée au contribuable ne figure pas au procès-verbal communal des opérations de révision des évaluations des propriétés bâties46. L’Administration est ainsi fondée, lors de la procédure contentieuse, à proposer un nouveau local de référence et, à titre subsidiaire, recourir à la méthode d’appréciation directe. Au surplus, il relève de l’office du juge de trancher ultimement en faveur d’une valeur locative47. Au final, il n’est pas rare de voir le contribuable, tel l’arroseur arrosé, se voir opposer une valeur locative plus élevée que celle initialement choisie par l’Administration et qu’il a eu rétrospectivement le malheur de remettre en cause. Dans ces conditions, le Conseil a estimé que « l’existence d’un risque financier pour l’État et les collectivités territoriales n’est pas établie » (cons. 10).
Il n’y avait donc pas péril en la demeure et on pourra alors méditer sur la puissance de conviction de l’administration fiscale auprès des gouvernants…
Jean-Éric Gicquel
Notes de bas de pages
-
1.
Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC ; Cons. const., 18 mars 2015, n° 2015-462 QPC (Cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour manquement d’initié). Le Conseil vient de rappeler sa position dans sa décision du 30 septembre 2016, n° 2016-572 QPC (Cumul des poursuites pénales pour le délit de diffusion de fausses informations avec des poursuites devant la commission des sanctions de l’AMF pour manquement à la bonne information du public). Afin de mettre en conformité le système de répression des délits d’initié, la loi du 21 juin 2016 a mis en place un système d’aiguillage procédural permettant de choisir entre la voie pénale et la voie administrative (C. mon. fin., art. L. 465-3-6). V. Bonneau T., « La réforme du système de répression des abus de marché », JCP E 2016, 1412 ; Dezeuze E., « La refonte de la répression des abus de marché », JCP G 2016, 846 ; Conac P.-H., « La loi du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché », BJB juill. 2016, n° 114n0, p. 343 et Rev. sociétés 2016, p. 469 ; Lasserre Capdeville J., « Présentation succincte de la réforme du droit pénal financier », AJ pénal 2016, p. 424 ; Conte P., « Les voies boursières répressives : le grand carrefour. Brève présentation des dispositions procédurales de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016, réformant le système de répression des abus de marché », Dr. pén. 2016, n° 9, étude n° 19.
-
2.
Amende de 37 500 € pour des faits antérieurs à la loi du 14 mars 2012 (QPC n° 545) ou de 500 000 € pour des faits postérieurs à cette loi (QPC n° 546),
-
3.
Cass. crim., 2 oct. 2002, n° 01-87996 ; Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 01-88561 ; Cass. crim., 6 oct. 2004, n° 03-86378 ; Cass. crim., 17 juin 2009, n° 08-86111 ; Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-86249 ; Cass. crim., 21 sept. 2011, n° 09-86657 ; Cass. crim., 13 juin 2012, n° 11-84092.
-
4.
V. Liebert-Champagne M., « Le rôle de la Commission des infractions fiscales », Dr. fiscal 2016 n° 38, 497.
-
5.
Depuis Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, cons. 22.
-
6.
CEDH, 27 janv. 2015, n° 17039/13, Rinas c/ Finlande, § 54 : « However, under the Finnish system the criminal and the administrative sanctions are imposed by different authorities without the proceedings being in any way connected : both sets of proceedings follow their own separate course and become final independently from each other. Moreover, neither of the outcomes of the proceedings is taken into consideration by the other court or authority in determining the severity of the sanction, nor is there any other interaction between the relevant authorities ».
-
7.
CEDH, 13 janv. 2016, nos 24130/11 et 29758/11, Frisvold et Flom-Jacobsen c/ Norvège.
-
8.
V. Cutajar C., « Plaidoyer pour la suppression du “verrou de Bercy”. À propos du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière », JCP G 2013, 728 ; Cabon S.-M., « Le particularisme du déclenchement des poursuites pénales. Le maintien du “verrou de Bercy” », Dr. fisc. 2014 n° 46, p. 620. Un procureur célèbre déclarait en 2013 à propos du verrou de Bercy : « Ce système est pervers puisqu’on ne peut poursuivre en matière fiscale que ce que l’exécutif a décidé de nous laisser poursuivre. En clair, on nous concède quelques dossiers… Cela donne l’impression, à nous autres magistrats, de prêter la main à une inégalité fondamentale : certaines fraudes relevant du judiciaire, et d’autres de la seule volonté de l’exécutif », de Montgolfier E., La Croix, 8 mai 2013.
-
9.
Cons. const., 17 déc. 2010, n° 2010-81 QPC, M. Boubakar B. (Détention provisoire : réserve de compétence de la chambre de l’instruction).
-
10.
V. not. la chronique, LPA 15 déc. 2014, p. 6.
-
11.
Cons. const., 6 août 2009, n° 2009-588 DC, Repos dominical : Rec. Cons. const., 2009, p. 163.
-
12.
Observations du gouvernement, Site internet du Conseil constitutionnel.
-
13.
V. not. Jérôme B., « Travail du dimanche : Hidalgo refuse de discuter avec Macron », Le Monde, 16 sept. 2015.
-
14.
Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
-
15.
V. Cons. const., 7 juin 2013, n° 2013-318 QPC, M. Mohamed T. : Rec. Cons. const., 2013, p. 809 – cette chronique, LPA 16 mai 2014, p. 6 – Cons. const., 22 mai 2015, n° 2015-468/469/472 QPC, Sté Uber ; Cons. const., 22 mai 2015, n° 2014-422 QPC, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis : Rec. Cons. const., 2015, p. 463.
-
16.
Sénat, n° 741, enregistré à la présidence du Sénat le 16 juillet 2014, p. 49.
-
17.
Rapp. Thévenoud, « Un taxi pour l’avenir des emplois pour la France », 2014, p. 8.
-
18.
En revanche, les ADS délivrées après l’entrée en vigueur de la loi du 1er octobre 2014 devront, elles, être exploitées personnellement (art. L. 3121-1-2 du Code des transports entrant en vigueur le 1er janvier 2017).
-
19.
Ainsi, sur un contrôle portant sur 2 023 factures de 19 transporteurs dans le Val-d’Oise, la CNAM a-t-elle identifié un préjudice total de 421 494 € sur un seul mois de facturation (octobre 2007). Cour des comptes, Rapport sur la sécurité sociale de 2012, p. 336.
-
20.
Cette liberté comprenant « non seulement la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l’exercice de cette profession ou de cette activité ». (Cons. const., 30 nov. 2012, n° 2012-285 QPC, Christian S. : Rec. Cons. const., 2012, p. 636 (v. chronique LPA 15 juill. 2013, p. 6).
-
21.
Cons. const., 16 janv. 1986, n° 85-200 DC, Cumul entre pensions de retraite et revenus d’activité : Rec. Cons. const., 1986, p. 9.
-
22.
Le contrôle de proportionnalité effectué par le Conseil est restreint (c’est-à-dire limité à la censure d’une erreur manifeste ou plus précisément d’une disproportion flagrante) lorsqu’une exigence constitutionnelle est avancée par le législateur et entier (ou normal) en cas de présence « seulement » d’un motif d’intérêt général ; un motif dont la pertinence peut d’ailleurs être appréciée par le juge.
-
23.
Cons. const., 16 janv. 2001, n° 2000-439 DC, Loi relative à l’archéologie préventive : Rec. Cons. const., 2001, p. 42.
-
24.
Cons. const., 7 déc. 2000, n° 2000-436 DC, Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains : Rec. Cons. const., 2000, p. 176 (liberté d’entreprendre et droit de propriété) – Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-45 QPC, M. Mathieu P. : Rec. Cons. const., 2010, p. 270 (liberté d’entreprendre et liberté de communication).
-
25.
Cons. const., 9 avr. 1996, n° 96-373 DC, Polynésie Française : Rec. Cons. const., 1996, p. 43.
-
26.
Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-320/321 QPC, M. Yacine T. et a. : Rec. Cons. const., 2013, p. 829 – Cons. const., 25 sept. 2015, n° 2015-485 QPC, M. Johny M.
-
27.
La directrice de l’administration pénitentiaire fait ainsi état qu’« en 2014, 27 524 téléphones portables ou accessoires ont été saisis contre 10 990 en 2010, soit un quasi-doublement en quatre ans. C’est effectivement un véritable fléau » (Rapport de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, AN, n° 2828, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2015, p. 278).
-
28.
Cons. const., 16 oct. 2015, n° 2015-494 QPC, Consorts R.
-
29.
Urvoas J.-J., JO Sénat, 31 mars 2016, p. 5057.
-
30.
Il n’y avait pas pour autant non-lieu à statuer pour le Conseil puisque la disposition n’était pas encore considérée comme définitivement adoptée par le Parlement le jour de la décision. Il a par ailleurs été décidé de reporter la déclaration d’abrogation afin d’éviter que celle-ci « affecte les modifications législatives en cours d’adoption par le Parlement » (§ 21).
-
31.
Ainsi, souhaitant tirer les conséquences de la décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 (Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Rec. Cons. const., 2013, p. 1060) censurant la possibilité de recourir à la garde de vue de 96 heures pour des délits de corruption, de trafic d’influence et de fraude fiscale, le Gouvernement avait souhaité, via l’exercice du droit d’amendement, prendre les devants et étendre l’exclusion au délit d’escroquerie en bande organisée (loi du 27 mai 2014 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne). Toutefois, le Conseil jugea cette nouvelle rédaction du CPP non conforme à la Constitution (Cons. const., 9 oct. 2014, n° 2014-420/421 QPC, M. Maurice L. et a. : Rec. Cons. const., 2014, p. 453). Une nouvelle intervention du législateur fut donc nécessaire (loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne).
-
32.
Voir par exemple, l’invalidation des vingt-huit articles introduits à l’Assemblée nationale sur le texte portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’UE (Cons. const., 13 août 2015, n° 2015‑719 DC, Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’UE).
-
33.
« Je prends note que le risque de report de ce procès est encouru. Mais je relève que lorsqu’il était ministre du Budget, Jérôme Cahuzac ne s’est jamais ému du problème que poserait le fait de poursuivre un citoyen à la fois au plan fiscal et au plan pénal. Il a même renforcé le dispositif de lutte contre la fraude fiscale. Et aujourd’hui que la loi s’applique à sa personne, il considère qu’elle est inconstitutionnelle. Pourquoi ne l’a-t-il pas défendu lorsqu’il était aux commandes ? » : Robert-Diard P., « Jérôme Cahuzac devant ses juges, le procès de la fraude et du mensonge », Le Monde, 5 sept. 2016.
-
34.
Debré J.-L., « Entretien », Le Monde, 6-7 mars 2011.
-
35.
V. not. Vauchez A., « Les affaires devant le Conseil constitutionnel », 9 juin 2016 in doyoulaw. blogs, http://www.liberation.fr/.
-
36.
Cons. const., 30 juill. 1982, n° 82-143 DC, Blocage des prix et des revenus : Rec. Cons. const., 1982, p. 57.
-
37.
Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier : Rec. Cons. const., 1989, p. 71.
-
38.
On se contentera, sur cette thématique bien connue, de renvoyer à une comparaison entre les exigences initiales du Conseil constitutionnel (Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-119 DC, Loi portant validation d’actes administratifs : Rec. Cons. const., 1980, p. 46) et les contraintes actuelles (Cons. const., 14 févr. 2014, n° 2013-366 QPC, SERLAL PJA : Rec. Cons. const., 2014, p. 130 – v. chron. LPA 15 déc. 2014, p. 6).
-
39.
Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et Cons. const., 18 mars 2015, n° 2015-462 QPC.
-
40.
Commentaire « officiel » de la décision, Site internet du Conseil, p. 18 et s.
-
41.
Cons. const., 29 déc. 1983, n° 83-164 DC, Loi de finances pour 1984 : Rec. Cons. const., 1983, p. 67.
-
42.
Cons. const., 29 déc. 1999, n° 99-424 DC, Loi de finances pour 2000 : Rec. Cons. const., 1999, p. 156.
-
43.
Cons. const., 29 déc. 2014, n° 2014-707 DC, Loi de finances pour 2015 : Rec. Cons. const., 2014, p. 583.
-
44.
« Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie » – Cons. const., 14 févr. 2014, n° 2013-366 QPC, SERLAL PJA : Rec. Cons. const., 2014, p. 130).
-
45.
Cons. const., 28 déc. 1995, n° 95-369 DC, Loi de finances pour 1996 : Rec. Cons. const., 1995, p. 257 – Cons. const., 18 déc. 1998, n° 98-404, Loi de financement pour la sécurité sociale 1999 : Rec. Cons. const., 1998, p. 130.
-
46.
CE, 8 avr. 1998, nos 140458 et 167973, Cardot.
-
47.
CE, 19 nov. 2008, n° 305305, SNC Sequoia Lodge Associés.