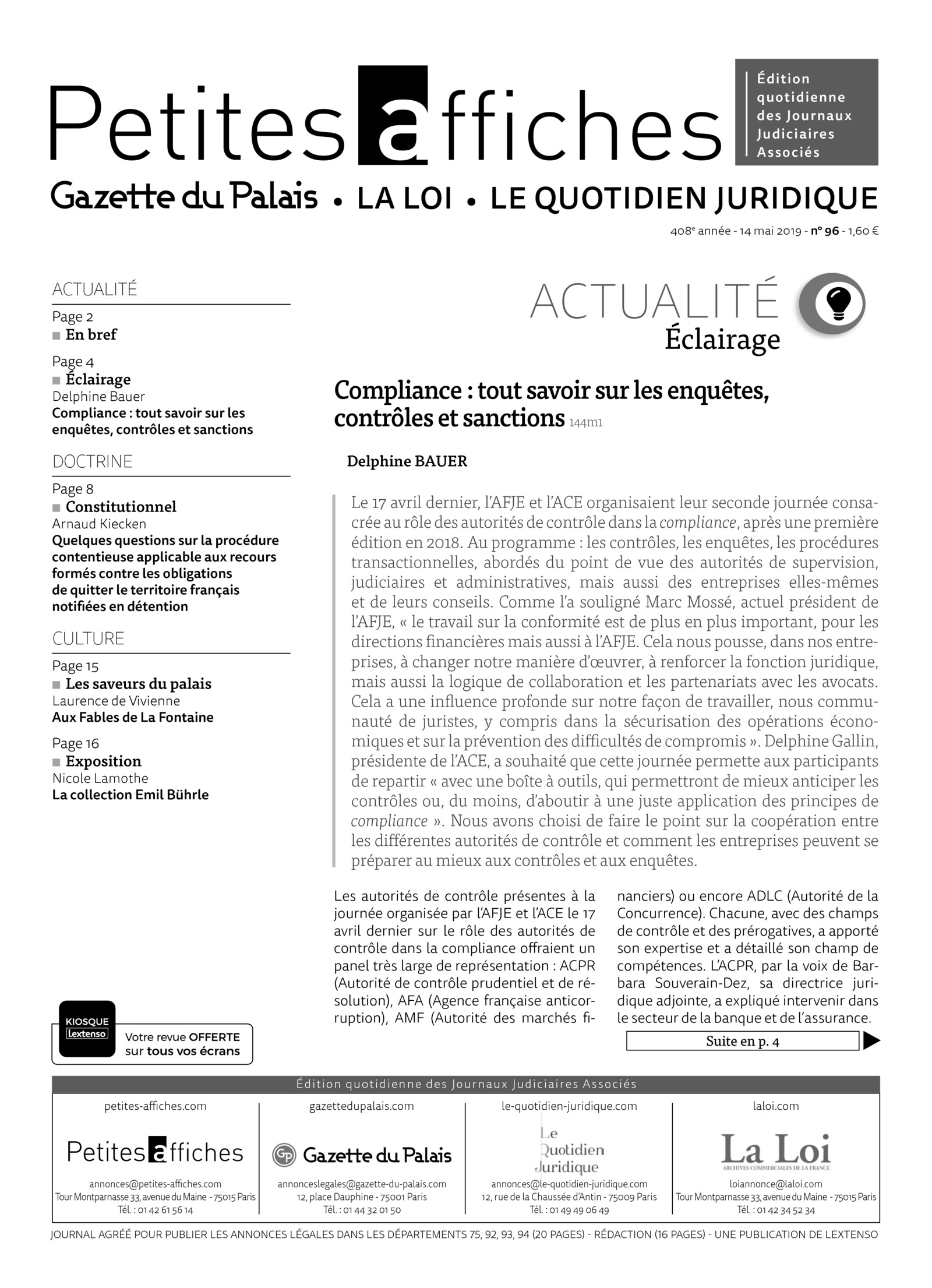Quelques questions sur la procédure contentieuse applicable aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français notifiées en détention
Après que le Conseil constitutionnel a (très) partiellement censuré la disposition issue de la loi du 7 mars 2016 organisant une procédure spécifique pour les recours formés contre les OQTF notifiées en détention, un nouveau régime juridique de ces recours a été institué par le législateur avec la loi du 10 septembre 2018.
Si cette nouvelle loi semble plus respectueuse du droit des détenus à un recours juridictionnel effectif, la pratique de cette procédure conduit à s’interroger (sérieusement) sur la question du respect de ce droit fondamental devant les juridictions administratives.
1. C’est la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France qui a, pour la première fois, réservé un traitement contentieux spécifique aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF) par des personnes placées en détention.
Cette innovation avait été ajoutée au projet de loi dès le stade de la première lecture parlementaire, par un amendement d’Erwann Binet, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale. Le législateur avait alors fait le choix de « plaquer »1 sur les étrangers en détention le régime contentieux applicable aux étrangers placés en centre de rétention ou assignés à résidence. Le but poursuivi par le gouvernement était de régler rapidement le sort des mesures d’éloignement notifiées à des étrangers détenus et d’éviter que, dans le cas où des recours d’étrangers détenus seraient toujours pendants devant les tribunaux administratifs au moment de leur élargissement, ces étrangers soient placés en rétention à l’issue de leur détention2.
Ce régime légal, contenu au paragraphe IV de l’article L. 512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), prévoyait que lorsque l’étranger était en détention, il était statué sur son recours « selon la procédure et dans les délais prévus » en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Ainsi, les étrangers détenus ne disposaient que d’un délai de 48 heures à compter de la notification de l’OQTF pour en demander l’annulation au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné à cette fin. Et, surtout, ce magistrat devait statuer sur ce recours dans un délai particulièrement bref de 72 heures maximum. Dans sa décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016 relative à cette loi, le Conseil constitutionnel s’était borné à statuer sur les griefs soulevés par les sénateurs et exclusivement relatifs à la procédure d’adoption de la loi : il n’avait soulevé d’office aucune question de conformité à la constitution.
2. Le Conseil constitutionnel a été saisi en 2018 d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur cette disposition législative et il en a déclaré certains mots (« et dans les délais ») contraires à la constitution.
Dans sa décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, Section française de l’observatoire international des prisons et autres, le Conseil a relevé que cette disposition enserrait « dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l’étranger détenu afin de former son recours et au juge afin de statuer sur celui-ci ». Il a estimé que ces dispositions, « qui [s’appliquaient] quelle que soit la durée de détention, [n’opéraient] pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par le législateur d’éviter le placement de l’étranger en rétention administrative à l’issue de sa détention » (§ 9). Le Conseil a également estimé qu’aucun motif ne justifiait de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité et qu’elle était applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, soit le 2 juin 20183. À compter de cette date, les recours formés à l’encontre d’OQTF notifiées en détention restaient soumis à la « procédure » contentieuse applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence mais la référence aux « délais » de 72 heures était abrogée du fait de cette déclaration d’inconstitutionnalité à effet immédiat.
La juridiction administrative ne s’attendait, semble-t-il, pas à cette déclaration d’inconstitutionnalité.
La QPC qui allait fonder la décision du Conseil constitutionnel du 1er juin 2018 a en effet été rejetée par cinq juridictions administratives du fond (quatre tribunaux et une cour) avant d’être finalement transmise au Conseil d’État par la cour administrative d’appel de Douai4, au même moment où le Conseil d’État était directement saisi d’une QPC identique, soulevée par l’association Section française de l’observatoire international des prisons. La juridiction administrative semblait d’autant moins s’attendre à cette censure que, pendant l’examen de cette QPC par le Conseil d’État puis par le Conseil constitutionnel, il n’a été sursis à statuer que dans deux instances sur les treize dans lesquelles une QPC identique était soulevée. Une telle attitude est particulièrement surprenante au regard des dispositions de l’article R. 771-6 du Code de justice administrative qui précisent que, dans le cas où la juridiction du fond ne transmet pas au Conseil d’État une QPC mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’État ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi, « elle diffère sa décision sur le fond, jusqu’à ce qu’elle soit informée de la décision du Conseil d’État ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel ».
3. Ne s’attendant pas à cette censure, la juridiction administrative allait alors plonger dans un profond abîme de perplexité après la décision du Conseil constitutionnel.
Les conséquences de cette décision de censure ont en effet été très diversement appréciées au sein des tribunaux.
Pour certains tribunaux, la censure du délai global de cinq jours ne faisait pas obstacle à ce que le délai de recours de 48 heures puisse continuer à être appliqué aux recours des étrangers détenus formés contre des OQTF sans délai : c’est alors sur le fondement, non du paragraphe III de l’article L. 512-1 du CESEDA (applicable à la rétention et donc, par l’effet du renvoi qu’opérait le paragraphe IV, à la détention) mais du paragraphe II de ce même code, relatif aux OQTF sans délai, que ce délai de recours leur était opposé5.
Mais cette position a été loin de faire l’unanimité dans les tribunaux.
Le tribunal administratif de Strasbourg a en effet opposé à un requérant le délai de recours de 30 jours, prévu au paragraphe I de l’article L. 512-1 du CESEDA, et ce alors même qu’il s’agissait en l’espèce d’un recours formé contre une OQTF sans délai6. À Nancy, il a été jugé que le seul délai de recours désormais applicable était le délai de droit commun de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative7, et à Rouen, qu’aucun délai de recours n’était plus opposable après la déclaration d’inconstitutionnalité8.
4. La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » a mis un terme à ces regrettables atermoiements juridictionnels.
La décision du Conseil constitutionnel est intervenue en cours de discussion au Parlement d’un nouveau projet de loi relatif au droit des étrangers. Pour remédier à cette censure, le gouvernement a fait adopter un amendement de réécriture du paragraphe IV de l’article L. 512-1 du CESEDA. Au terme de cette nouvelle rédaction, les recours formés contre les OQTF notifiées en détention sont désormais soumis, en principe, aux règles de droit commun en la matière : le délai de recours et la procédure contentieuse applicables à ces recours dépendent donc, d’une part, du fondement légal de l’OQTF et, d’autre part, de l’octroi ou du refus à l’étranger d’un délai de départ volontaire.
Ainsi, dans le cas d’une OQTF assortie d’un délai de départ volontaire, le recours est soumis, en fonction du fondement légal de la mesure d’éloignement, soit à un délai de recours de 30 jours et à un délai de jugement de trois mois par une formation collégiale (trois magistrats et un rapporteur public, qui pourra toutefois se dispenser de prononcer des conclusions à l’audience)9, soit à un délai de recours de 15 jours et à un délai de jugement de six semaines par un magistrat statuant seul.
Mais cette hypothèse d’une OQTF prise à l’encontre d’un étranger détenu, assortie d’un délai de départ volontaire sera sans doute marginale. Dans la plupart des cas en effet, le comportement de l’étranger pourra être regardé par l’Administration comme constituant une « menace pour l’ordre public » au sens du 1° du paragraphe II de l’article L. 511-1 du CESEDA, justifiant alors de lui refuser tout délai de départ volontaire10. Par ailleurs, l’Administration pourrait également estimer qu’il existe un risque que l’étranger détenu se soustraie à son OQTF, justifiant également ce refus par application de l’un des nombreux motifs prévus au 3° du même paragraphe.
C’est donc cette seconde hypothèse d’une OQTF sans délai qui devrait être la plus fréquemment rencontrée en matière de mesure d’éloignement notifiée en détention. Le délai de recours contre ces OQTF est de 48 heures. Quant à la procédure contentieuse applicable, elle dépendra du fondement légal de la mesure d’éloignement : soit l’affaire relèvera de la compétence d’une formation de jugement collégiale, et le jugement interviendra, dans un délai de trois mois, après le prononcé de conclusions du rapporteur public qui pourra toutefois, sous certaines conditions, en être dispensé, soit, l’affaire relèvera d’un magistrat statuant seul, dans un délai de six semaines.
5. Le législateur a toutefois prévu une exception au principe de l’application de la procédure de droit commun aux recours formés contre les OQTF notifiées en détention.
Il demeure en effet possible de soumettre les recours formés contre des OQTF notifiées en détention à une procédure accélérée « lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge statue ». Dans ce cas de figure, le nouveau paragraphe IV de l’article L. 512-1 du CESEDA prévoit que « l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de huit jours à compter de l’information du tribunal par l’Administration ». C’est donc un magistrat statuant seul, comme en matière de placement en rétention administrative, qui réglera alors l’affaire dans un délai, non plus de 72 heures, mais de huit jours. Le Sénat avait initialement adopté l’amendement du gouvernement qui appliquait un délai de jugement plus court de 144 heures, soit six jours, mais la commission des lois de l’Assemblée nationale, dans sa grande sagesse, a adopté en nouvelle lecture l’amendement d’Élise Fajgeles, rapporteure, fixant un délai de huit jours, afin de permettre « une meilleure conciliation des objectifs poursuivis par l’Administration et du droit à un recours effectif »11.
L’application de cette nouvelle procédure accélérée de huit jours n’a d’effet que sur la procédure contentieuse applicable, et non sur le délai de recours, qui, en matière d’OQTF sans délai, est toujours de 48 heures.
Ces nouvelles dispositions législatives ont été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018. Le Conseil a en effet estimé que le législateur avait opéré « une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par le législateur d’éviter le placement de l’étranger en rétention administrative à l’issue de sa détention » (§ 82).
Si la constitutionnalité de ces nouvelles dispositions législatives est désormais établie, leur application peut néanmoins susciter une série de questionnements délicats.
I – Première question : quel est le champ d’application de cette nouvelle procédure accélérée de huit jours ?
1. Eu égard à la rédaction du nouveau paragraphe IV de l’article L. 512-1 du CESEDA, ce champ d’application semble particulièrement réduit.
Le nouveau paragraphe IV de l’article L. 512-1 du CESEDA n’envisage le basculement en procédure accélérée que « lorsqu’il apparaît en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge statue ». Le Conseil constitutionnel a estimé que l’hypothèse ici envisagée correspondait à celle d’une « libération imminente du détenu »12.
Par ailleurs, l’application de la procédure accélérée n’est possible qu’à l’égard des recours formés devant les tribunaux administratifs, à l’exclusion de ceux portés devant les cours administratives d’appel ou devant le Conseil d’État. Il aurait sans doute été tout aussi opportun pour l’Administration de bénéficier d’une procédure rapide de règlement d’un litige porté en appel, voire en cassation, mais le législateur a clairement limité l’application de cette procédure accélérée aux seuls recours pendants devant les tribunaux, et toute interprétation contraire serait sans doute contra legem.
Il est à relever également que la loi fait mention du « président du tribunal administratif ou [du] magistrat désigné » lorsqu’elle évoque l’information de la date de libération du détenu. Ce n’est donc pas le tribunal qui doit en être destinataire, mais un seul magistrat. Cette expression du « président du tribunal administratif ou [du] magistrat désigné » fait immédiatement penser à la compétence d’un magistrat statuant seul et elle se retrouve d’ailleurs aux I bis et III de l’article L. 512-1 du CESEDA. La loi semble donc n’avoir rendue applicable cette procédure accélérée qu’aux recours relevant d’un magistrat statuant seul, à l’exclusion donc de ceux relevant de la compétence d’une formation de jugement collégiale. Or c’est une formation collégiale qui est pourtant compétente pour statuer notamment sur les recours formés contre les OQTF, assorties ou non d’un délai de départ volontaire, prises au motif que le comportement de l’étranger « constitue une menace pour l’ordre public »13. Cette même formation de jugement peut également connaître (certes, de manière tout à fait exceptionnelle en contentieux des étrangers) de recours relevant normalement de la compétence d’un magistrat statuant seule qu’il déciderait néanmoins de lui renvoyer, au regard, par exemple, de la difficulté de l’affaire.
Il est permis de s’interroger sur la véritable intention du gouvernement, qui n’a sans doute pas mesuré pleinement la portée – limitée – du texte qu’il a demandé au Parlement d’adopter. Mais, telle qu’elle est rédigée, c’est à cette interprétation restrictive que semble inviter la loi. Et les travaux parlementaires ne comportent pas de développements particuliers relatifs à une extension du champ d’application de cette procédure. Cette interprétation restrictive pourrait d’ailleurs être confirmée au regard de l’expression de « libération imminente » retenue par le Conseil constitutionnel, qui renforce l’idée selon laquelle l’application de la procédure accélérée devrait être réservée aux recours soumis à un bref délai de jugement, c’est-à-dire à ceux devant être jugés non pas en trois mois mais en six semaines14.
Enfin, la loi ne prévoit le basculement dans cette procédure contentieuse accélérée qu’en cours d’instance et après transmission par l’Administration de la date de la libération du requérant. C’est à compter de la réception de cette information par le magistrat que se déclenche le délai alors de huit jours. Mais il pourrait toutefois apparaître, ce qui n’est pas envisagé par la loi, que, dès l’introduction d’un recours formé par un détenu, sa libération sera imminente, soit que le requérant l’indique de lui-même dans ses écritures, soit que cela ressorte des pièces qu’il verse à l’appui de son recours. Dans ce cas de figure, la loi ne prévoit pas que le magistrat statuera selon la procédure accélérée, tant que l’Administration ne lui aura pas transmis cette information. Tout au plus serait-il permis au magistrat, au stade de l’instruction de l’affaire, de solliciter de l’Administration qu’elle lui transmette formellement cette information, afin de faire basculer le recours en procédure accélérée conformément aux exigences de la loi.
Cette lecture du nouveau paragraphe IV de l’article L. 512-1 du CESEDA est rigoureuse mais elle confirme l’intention du gouvernement de ne réserver cette procédure accélérée qu’aux « cas extrême[s] »15. Dans sa décision du 1er juin 2018, le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs rappelé à l’Administration qu’elle pouvait « notifier à l’étranger détenu une obligation de quitter le territoire français sans attendre les derniers temps de la détention, dès lors que cette mesure peut être exécutée tant qu’elle n’a pas été abrogée ou retirée ». Le Conseil indiquait également que l’Administration pouvait, par conséquent, « lorsque la durée de la détention le [permettait], procéder à cette notification suffisamment tôt au cours de l’incarcération tout en reportant son exécution à la fin de celle-ci ».
2. Mais cette lecture rigoureuse de la loi, qui découle tant de ses termes que de son esprit, ne semble partagée ni par l’Administration, ce qui ne surprend guère compte tenu des objectifs affichés et notamment du nombre d’éloignement qu’elle s’assigne, ni, ce qui est plus inquiétant, par la juridiction administrative.
D’une part en effet, le décret pris pour l’application de la loi du 10 septembre 2018 et la circulaire du ministre de l’Intérieur adressée aux préfets ont retenu une interprétation très extensive du champ d’application de cette nouvelle procédure accélérée.
La rédaction du nouvel article R. 776-29 du Code de justice administrative, issue du décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018, fait référence à l’hypothèse d’une libération « avant l’expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l’article R. 776-13 [3 mois] ou à l’article R. 776-13-3 [6 semaines] ». Par cette référence à l’article R. 776-13, le décret envisage donc le cas, qui ne se trouve toutefois pas dans la loi pour l’application de laquelle il a été pris, d’un basculement dans la procédure de huit jours des recours relevant d’une formation de jugement collégiale et sur lesquels il est statué en trois mois.
Quant à la circulaire du ministre de l’Intérieur du 31 décembre 2018, elle donne une interprétation du texte qui ne correspond pas tout à fait aux exigences telles qu’elles ont été posées par la loi et interprétées par le Conseil constitutionnel. Il est en effet précisé aux préfets que la procédure accélérée s’applique lorsqu’il apparaît en cours d’instance que l’étranger « sera libéré prochainement »16 et qu’en pareille hypothèse, « le juge doit se prononcer dans un délai qui ne peut excéder huit jours »17. Il n’est donc pas exigé des préfets qu’ils informent le magistrat chargé de statuer sur le recours de la date de libération du requérant.
D’autre part, de nombreux jugements des tribunaux administratifs ont été rendus depuis le début de l’année 2019, sans même qu’il apparaisse à leur lecture que l’Administration aurait porté à la connaissance du magistrat la date de libération18. Dans ces jugements, les magistrats ont appliqué d’office cette procédure accélérée. Cette pratique est pour le moins étonnante car l’information délivrée par l’Administration au magistrat et relative à la date de libération du requérant semble avoir été conçue par le législateur comme la seule possibilité permettant de justifier le basculement dans la procédure accélérée.
Pour l’heure, la juridiction administrative semble avoir conservé le réflexe d’un jugement très rapide de ces recours, malgré les termes et l’esprit de la nouvelle la loi. Il serait sans doute plus respectueux tant de l’intention du législateur que du droit à un recours juridictionnel effectif de ne basculer en procédure accélérée qu’après que le tribunal aura recueilli, de la part de l’Administration, l’information sur la date de libération prévisible du détenu.
II – Deuxième question : dans le cadre de cette nouvelle procédure accélérée, dans quel délai le jugement doit-il être rendu ?
1. La réponse semble plus évidente que pour la question précédente puisque la loi fixe un délai de huit jours.
Dans l’amendement qu’il a présenté devant le Sénat, et qui est à l’origine de cette modification législative, le gouvernement indiquait que le délai (alors de 144 heures, cumulé au délai de recours de 48 heures) était un délai minimum. La rédaction du texte ne confirmait toutefois pas cette analyse généreuse19 et le Conseil constitutionnel en a d’ailleurs déduit qu’il s’agissait d’un délai « maximum »20. C’est également un délai maximum qui est envisagé dans le décret du 12 décembre 2018 et la circulaire du ministre de l’Intérieur du 31 décembre 2018.
Comme dans les autres hypothèses de délais de jugement contraints en matière de contentieux de l’éloignement des étrangers, aucune conséquence n’est toutefois envisagée par les textes en cas de non-respect de ce délai, ce qui laisse penser que son dépassement resterait sans incidence sur la régularité du jugement.
2. Mais à ce délai maximum doit certainement s’ajouter un délai minimum.
Ni les textes ni le Conseil constitutionnel, qui n’a assorti sa déclaration de conformité à la constitution du paragraphe IV de l’article L. 512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’aucune réserve d’interprétation, ne l’ont précisé. Pourtant, cela découle nécessairement de la déclaration d’inconstitutionnalité du 1er juin 2018. Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé que le délai global de cinq jours, imparti à l’étranger détenu pour former son recours et au juge pour y statuer, qui s’appliquait « quelle que soit la durée de la détention », était inconstitutionnel. Alors que le Conseil constitutionnel ne lui interdisait pas formellement de réserver un délai global de cinq jours à certains recours, notamment en cas de détention particulièrement courte, le législateur a choisi de fixer un délai général de huit jours. Mais l’application de ces nouvelles dispositions législatives pourrait conduire – et conduit d’ailleurs21 – les juridictions à statuer en deçà du délai de cinq jours. Or en traitant de la sorte ces recours, les juridictions ne font que renouer avec la pratique issue d’une loi jugée inconstitutionnelle.
Il peut sembler étonnant que le Conseil constitutionnel n’ait pas assorti sa déclaration de constitutionnalité d’une réserve d’interprétation, invitant les magistrats administratifs à veiller au respect d’un délai minimum susceptible de permettre au requérant de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter tous éléments à l’appui de son recours. Mais le Conseil s’est conformé à sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle la possibilité d’une application inconstitutionnelle d’une loi n’entache pas, en elle-même, la loi d’inconstitutionnalité22. Une évolution de cette jurisprudence, avec la précision par la voie d’une réserve d’interprétation d’un délai minimum de jugement, aurait pourtant été bienvenue afin de préserver l’effet utile de la censure du 1er juin 2018 et d’éviter, autant que faire se peut, la pratique actuelle des tribunaux administratifs.
Il importe donc de ne pas juger ces requêtes trop vite et de laisser quelques jours au requérant pour qu’il puisse présenter des éléments au soutien de sa contestation. Les tribunaux administratifs doivent donc se défaire de la pratique consistant à soumettre ces recours à un jugement dans un très bref délai.
III – Troisième question : quelles sont les spécificités applicables à cette nouvelle procédure accélérée ?
1. Elles sont sensiblement les mêmes que sous l’empire de la loi de 2016.
L’ancienne loi précisait que la procédure et les délais prévus en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence étaient rendus pleinement applicables aux recours formés contre les OQTF notifiées en détention. Le décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 est venu modifier certaines dispositions réglementaires du code de justice administrative pour adapter cette procédure, principalement conçue pour la rétention, au cas particulier de la détention.
En particulier, et il s’agissait là d’une avancée pour les droits des détenus, le décret de 2016 avait rendue applicable à tout recours formé contre une OQTF notifiée en détention la disposition permettant à un étranger retenu de déposer valablement sa requête contre une mesure d’éloignement, dans le délai de recours de contentieux, au sein du centre de rétention lui-même : la combinaison des articles R. 776-19 et R. 776-31 du Code de justice administrative permettait ainsi à tout étranger détenu de déposer valablement sa requête auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. En vertu de ces textes, il appartient alors au chef de cet établissement, comme en matière de rétention administrative, de faire mention du dépôt de la requête sur un registre ouvert à cet effet, de délivrer au requérant un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt et de transmettre sans délai et par tous moyens cette requête au président du tribunal administratif.
Cette possibilité, qui a été consacrée par un décret du 25 janvier 1990 au profit des étrangers « retenus »23, a été appliquée par le Conseil d’État aux étrangers « détenus » dès 199424. Depuis lors, la jurisprudence administrative semble avoir dégagé un principe, applicable même sans texte, en vertu duquel une personne privée de liberté peut valablement déposer son recours juridictionnel auprès d’une autorité administrative, à charge pour cette dernière d’enregistrer le recours et de le transmettre à la juridiction compétente25.
Cet aménagement de la procédure administrative contentieuse était destiné à surmonter les difficultés auxquelles les requérants sont confrontés du fait de leur détention, qui ont été rappelées par le Défenseur des droits dans sa décision n° 2018-087 du 7 mars 2018, produite devant le Conseil d’État à l’occasion de l’examen de la QPC qui donnera lieu à la décision du 1er juin 2018, et tenant notamment à l’absence d’association spécialisée en droit des étrangers et aux difficultés d’accès à un avocat ou à une communication électronique.
Ainsi, en application des dispositions réglementaires adoptées en 2016 et contenues dans le Code de justice administrative26, les étrangers détenus se sont vus reconnaître certaines garanties de procédure dont une liste peut être donnée : dépôt de la requête auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, production d’un exemplaire unique de la requête, production de la décision attaquée par l’Administration, droit de demander jusqu’avant le début de l’audience la désignation d’office d’un avocat, information de ce droit par le greffe au moment de l’introduction de sa requête, droit à l’assistance d’un interprète et information de ce droit par le greffe « au besoin » lors de l’enregistrement de sa requête. Par ailleurs, ils ont également le droit, en vertu des dispositions communes contenues à l’article R. 776-5 du Code de justice administrative, de soulever des moyens nouveaux et de former des conclusions dirigées contre les décisions qui leur ont été notifiées simultanément jusqu’à la clôture de l’instruction.
La loi du 10 septembre 2018 et le décret du 12 décembre 2018 pris pour son application ont renforcé certaines de ces garanties.
Il est désormais exigé de l’Administration qu’elle informe les étrangers détenus dès la notification de l’OQTF qu’ils peuvent exercer leur droit de demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil « avant même l’introduction de [la] requête » et auprès du « président du tribunal administratif », précisant ainsi le moment de ces demandes et – surtout – l’autorité devant laquelle elles peuvent être exercées. Le décret du 12 décembre 2018 exige en outre des greffes des tribunaux qu’ils rappellent ces droits au requérant lors de l’enregistrement de sa requête.
2. Mais le maintien en vigueur et le renforcement de ces garanties ne s’appliquent pour autant que le recours de l’étranger sera soumis à la procédure accélérée de huit jours.
L’article R. 776-29 du Code de justice administrative ne rend en effet applicable ces aménagements de procédure qu’après que l’Administration aura informé le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné « que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant l’expiration du délai de jugement ». Autrement dit, alors que ces aménagements sont destinés à rendre effectif le droit au recours juridictionnel des détenus et qu’ils avaient été reconnus à tout requérant contestant une OQTF notifiée en détention, le code ne les consacre désormais que pour les requérants que l’Administration aura choisi de soumettre à la procédure accélérée de huit jours.
Une telle limitation pose de graves inconvénients pratiques et juridiques. En effet, au seul motif que son recours ne relèverait pas de la procédure accélérée, soit que sa libération ne serait pas imminente, soit que l’Administration n’en informerait pas le magistrat, un requérant ne pourrait pas bénéficier de cet aménagement de la procédure. Il ne pourrait par exemple pas déposer sa requête auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, il ne se verrait pas rappeler par le greffe au moment de l’enregistrement de sa requête son droit à bénéficier d’un interprète et d’un avocat et il devrait produire lui-même la décision attaquée.
Or cet aménagement au stade du dépôt de la requête et de la mise en état de l’affaire, n’a d’intérêt pour le requérant que si elles s’appliquent indépendamment de la procédure contentieuse à laquelle sera soumis son recours. L’objet même de ces règles est de faciliter l’exercice par le détenu de son droit au recours et elles concernent une phase de la procédure au cours de laquelle le tribunal n’est pas encore informé de la date de libération. Si ces règles sont réservées aux recours qui ont basculé en procédure accélérée, certaines d’entre elles perdraient tout intérêt car, par définition, le détenu aurait déjà déposé sa requête directement auprès du tribunal administratif.
Afin de préserver l’effet utile de ces aménagements de procédure, il importe sans doute de faire bénéficier tout requérant formant un recours contre une OQTF notifiée en détention des règles prévues aux articles R. 776-29 et suivants, indépendamment de la procédure à laquelle est soumis son recours. Mais les juridictions administratives seront-elles en mesure, en l’état des textes et de la pratique de ce contentieux, d’assurer le respect du droit fondamental des étrangers détenus à un recours juridictionnel effectif ?
Notes de bas de pages
-
1.
Selon l’expression employée par M. Xavier Domino, rapporteur public, dans ses conclusions sous la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité : CE, 14 mars 2018, nos 416737 et 417314, Section française de l’observatoire international des prisons et M. Bathily.
-
2.
Le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi indique à cet égard : « Enfin, un amendement du rapporteur a étendu la procédure accélérée de jugement en soixante-douze heures par un juge unique aux cas d’éloignement d’un détenu. En effet, le cadre juridique actuel ne favorise pas le règlement de ces situations avant l’élargissement, en dépit de la volonté des préfectures d’engager la procédure suffisamment tôt. Une OQTF ne peut être exécutée d’office avant que le juge ait statué sur sa légalité ; or, en l’absence d’assignation à résidence ou de rétention (ce qui est bien le cas dans une détention), le tribunal administratif statue dans le délai de droit commun de trois mois. Le moindre retard peut conduire l’autorité administrative à faire succéder une rétention à une détention, ce qui n’est satisfaisant ni pour l’étranger ni pour l’efficacité de l’action publique. En outre, les gestionnaires de centre de rétention administrative ont fait état avec insistance de la difficile cohabitation entre les étrangers sortant de prison et les autres dans l’attente d’un éloignement. Le dispositif adopté devrait permettre de prévenir cette situation. ».
-
3.
JORF n° 0125, 2 juin 2018, texte n° 88.
-
4.
CAA Douai, 14 déc. 2017, n° 17DA00603.
-
5.
V. not., pour une caractéristique de ce premier courant, TA Toulouse, ord. n° 1802768, 13 juin 2018, classée en C+.
-
6.
Ord. n° 1803704, 18 juin 2018.
-
7.
Jugement du 25 juin 2018, n° 1801669.
-
8.
Jugement du 12 juin 2018, n° 1801957.
-
9.
CJA, art. R. 732-1-1.
-
10.
En vertu du 1° du II de l’article L. 511-1 du CESEDA.
-
11.
Rapport de la commission sur le projet de loi, n° 1173, p. 83-84.
-
12.
Déc. Cons. const., 6 sept. 2018, n° 2018-770 DC, § 82.
-
13.
En vertu du 7° du I de l’article L. 511-1 du CESEDA.
-
14.
C’est le paragraphe I bis de l’article L. 512-1 du CESEDA qui régit ces recours : « L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / La même procédure s’applique lorsque l’étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu’il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ».
-
15.
Amendement n° 146 du 13 juin 2018 : « Ainsi, l’étranger disposera désormais a minima de huit jours (correspondant aux 48 heures du délai de recours en cas de refus du délai de départ volontaire et des 144 heures allouées au juge pour se prononcer) pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves au soutien de ceux-ci, alors que ce délai était de cinq jours maximum. Encore faut-il souligner que cette hypothèse de huit jours constitue un cas extrême, lorsque l’OQTF est notifiée dans les derniers jours de la détention. Dans les autres cas, le délai ouvert à l’étranger sera nécessairement plus long ».
-
16.
Cette notion de libération « prochaine » correspond-elle exactement à celle de libération « imminente » ?
-
17.
Point 7.6 de la circulaire NOR INTV1835403J du 31 décembre 2018, p. 16.
-
18.
Aucun de ces jugements – ou presque (TA Pau, 1er mars 2019, n° 1900247) – n’indique que le magistrat aurait recueilli de la part de l’Administration l’information de la date de libération.
-
19.
Amendement n° 146 du 13 juin 2018.
-
20.
V. § 80 de la décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 : « en vertu des dispositions contestées, lorsque l’Administration, en cours d’instance, informe le juge que le détenu est susceptible d’être libéré avant que sa décision n’intervienne, il statue dans un délai maximum de huit jours à compter de cette information ».
-
21.
V. pour un exemple extrême, TA Lyon, 1er mars 2019, n° 1901566 : OQTF notifiée le 27 février, requête enregistrée le lendemain, affaire jugée le 1er mars, soit… trois jours après la notification de l’acte attaqué.
-
22.
V. not. décision Cons. const., 26 juin 1986, n° 86-207 DC, qui juge « que l’éventualité d’un détournement de procédure ou d’un abus dans l’application d’une loi ne saurait la faire regarder comme contraire à la constitution ; que d’ailleurs, il appartiendrait aux juridictions compétentes de paralyser et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques », cons. 76.
-
23.
Le décret n° 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d’étrangers à la frontière et complétant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel avait inséré un article R. 241-6 dans le code consacrant cette possibilité de déposer « valablement » son recours auprès de l’autorité administrative de rétention.
-
24.
CE, 30 mai 1994, n° 143947.
-
25.
V. not. CE, 8 mars 2002, nos 215139 et 215369 et CE, 24 mars 2004, n° 258155.
-
26.
CJA, art. R. 776-29 et s.