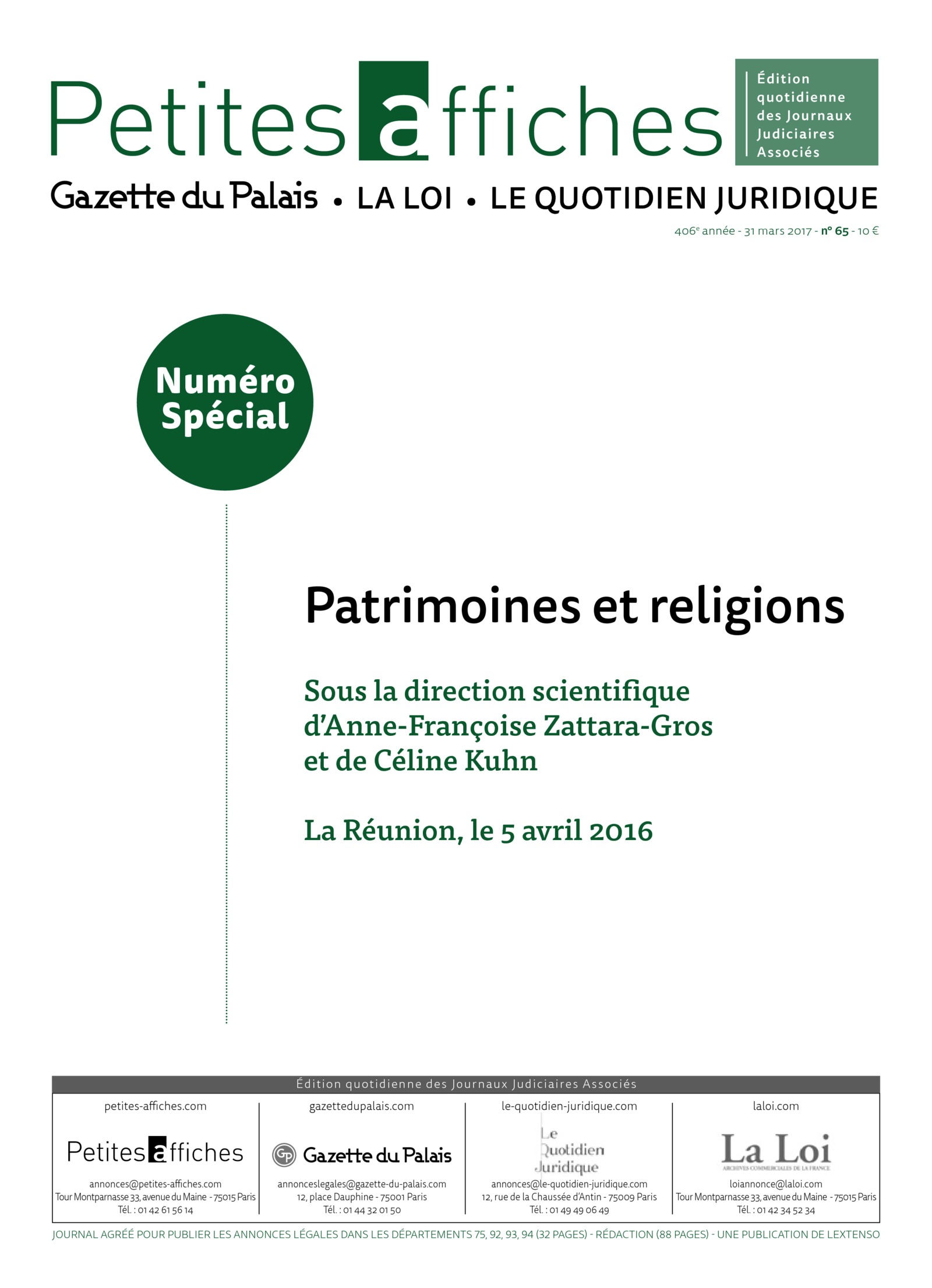Rapport de synthèse
De la condition patrimoniale des religions à leur influence patrimoniale.
« Quand il est question d’argent, tout le monde est de la même religion », écrivait Voltaire. Le fait est que l’argent peut être vénéré comme un dieu ; on s’y peut vouer comme d’autres, sinon les mêmes, se vouent à une divinité ; et il est un système et une culture aussi élaborés et prégnants que bien des religions, sinon toutes.
Le thème de ce beau colloque n’est pas précisément l’argent et les religions, mais « patrimoines et religions » ; patrimoines au pluriel et religions au pluriel. Ensemble de croyances, de dogmes, de pratiques et de rites communs à un grand nombre d’êtres humains, qui définissent le rapport de l’homme au sacré ou une divinité, la religion est le résultat de l’angoisse ontologique de l’homme, consécutive à sa finitude et à la conscience aiguë qu’il en a. Elle épouse la condition humaine. Elle est un système explicatif global qui nourrit le besoin de transcendance et de métaphysique de chaque être humain : elle propose une compréhension des causes et de fins de l’existence qui lui confère une vocation naturelle à interférer, sinon à régir tous les aspects de cette même existence.
La notion de « religion » n’a guère été juridicisée s’agissant de saisir le phénomène qu’elle recouvre. On la rencontre surtout en matière de discriminations1. Le droit positif lui préfère souvent le concept de « culte », utilisé à satiété par la loi du 9 décembre 1905, hormis dans son titre qui, aveu à peine caché par le pluriel du premier destinataire de l’entreprise que constituait cette loi considérable, a préféré le mot « Églises » (avec un « s ») à celui de cultes, bien que le concept d’« église » ne puisse concerner d’autres religions que les religions chrétiennes, auxquelles il est étroitement lié. François Cafarelli a rapporté quelques définitions doctrinales et jurisprudentielles du « culte », dont il appert qu’elles ne sont guère éloignées de celle de la « religion ». Didier Blanc a rappelé que le culte désigne à la fois l’institution et l’activité religieuses.
Le patrimoine est une invention plus récente que la religion, quoiqu’il soit lui-même déjà ancien. Ensemble des biens venant du père de famille, et transmis à celui ou ceux de ses enfants qui étaient en situation de le recevoir, le patrimonium romain était un bien universel – au sens d’universalité – notamment lié à un mécanisme, la succession. Les juristes modernes en ont fait un prolongement de la personne juridique, elle-même issue de la modernité, réunissant l’ensemble des biens saisissables de chacun, que la loi affecte impérativement à la garantie de chacune des dettes dont cette même personne est tenue, à quelque titre que ce soit (C. civ., art. 2284 ; C. civ., art. 2285). Par une sorte de syncrétisme entre la conception romaine et la conception moderne du patrimoine, ce concept a bientôt fini par désigner, dans le langage juridique courant, l’ensemble des biens d’une personne – y compris, donc, ses biens insaisissables. C’est en ce sens, me semble-t-il, que les organisatrices du colloque ont entendu le mot.
Cette première évocation d’Anne-Françoise Zattara-Gros et de Céline Kuhn est une première occasion de les féliciter d’avoir imaginé, conçu et organisé le riche colloque qui s’achève. Tous les rapports ont confirmé l’importance et l’actualité du thème qu’elles ont retenu pour fêter dignement les dix ans du Master 2 Droit du patrimoine qu’elles codirigent avec talent. L’invitation d’autorités civiles et religieuses, outre les universitaires savants que nous avons entendus, a donné aux échanges un relief et une dimension qui accroissent le profit que l’on retira de la lecture des actes. Cette manifestation apporte, en effet, une contribution éclairante à l’évaluation de la situation et de la place des religions dans la France, métropolitaine et d’outre-mer, de ce début de XXIe siècle. Ce siècle, que, par une phrase apocryphe, André Malraux aurait prédit que s’il n’était pas religieux il ne serait pas du tout, et dont on mesure, en tout cas, chaque jour, ou presque, combien la question religieuse y est présente et complexe, entre évolution douloureuse et déstabilisante de certaines religions traditionnelles et refus radical et violent de toute modernité par certaines branches d’autres, en passant par le développement, parfois exponentiel, de nouvelles confessions ou déclinaisons de cultes classiques ou moins classiques, qui ne répugnent pas au mélange des genres, comme il en va souvent dans les périodes troublées. Dans un tel contexte, les cadres d’établissement et de fonctionnement des religions, dans la République française, fixés, pour ce qui est de leur économie générale, il y a plus d’un siècle, ont-ils encore une suffisante validité et pertinence, alors que le paysage religieux pour lequel ils ont été conçus a connu, sous certains aspects, des mutations de premier ordre ?
Les organisatrices du colloque ont conçu la quête de la réponse à cette question à travers le prisme du patrimoine. S’il s’explique d’abord, à l’évidence, par la thématique du Master 2 dont il a déjà été fait mention, ce choix ne manque pas de pertinence s’agissant d’évaluer la situation juridique des religions dans la France d’aujourd’hui. Houssen Amode nous a rappelé cette vérité première que toute religion doit « réunir les conditions permettant (à ses membres) de répondre à leurs obligations ». L’accomplissement de ce qui constitue la raison d’être d’une institution religieuse requiert, en effet, des moyens en locaux, mobiliers, matériels, contrats, monnaie, notamment. Les religions ont besoin de biens ; elles ont besoin d’un patrimoine – d’un ensemble de biens.
L’histoire des religions est d’ailleurs étroitement liée à celle des biens. Outre leur besoin naturel d’en réunir pour fonctionner, elles se doivent de faire montre de puissance, à l’image de la ou des divinités dont, selon elles, elles sont l’œuvre, avant que d’être humaines ; or l’affichage de leur force ne peut se faire que selon les modalités en vigueur dans le genre humain, lesquelles consistent largement dans les richesses imposantes et visibles. C’est pourquoi, tout au long de l’histoire, les religions n’ont eu de cesse d’accumuler des biens, parfois considérablement, et de contribuer par ailleurs à la création des plus imposants, des plus majestueux, des plus durables sinon des plus impressionnants de ceux qui jalonnent l’histoire. La contribution des religions au patrimoine mondial de l’humanité, dans son volet culturel, est de premier ordre ; le fait que ce patrimoine soit parfois diminué, sous l’action des membres d’une religion qui entendent, par ces biais, en combattre une autre, ou impressionner les populations proches et lointaines – on songe par exemple à la destruction des Bouddhas colossaux de Bâmiyân par les talibans, en 2001 – n’en est que l’affligeante confirmation. Si cet aspect des relations entre religions et biens n’épuise pas les rapports complexes et ambivalents qui les unissent, il rappelle, en tout cas, que la nécessité de disposer des moyens d’actions est notamment au cœur de la problématique concrète de toute organisation cultuelle, dans son volet matériel.
La question patrimoniale constitue d’ailleurs l’une des questions majeures dans l’évolution contemporaine du régime juridique des religions présentes en France. La séparation des cultes et de l’État, qui était donc, avant tout et surtout, la séparation de la République française et de l’Église catholique, apostolique et romaine, a d’abord constitué une séparation patrimoniale ; ou plutôt, comme dans toutes les séparations qui viennent après une longue vie commune, autrement dit les séparations dans lesquelles les intérêts de ceux qui se quittent sont étroitement entrelacés, sinon emmêlés, une tentative de séparation patrimoniale, ou une séparation relative, partielle, à parfaire, à achever, plus tard, quand ce sera possible, si ça l’est un jour.
Ce diagnostic rétrospectif doit être mis en regard avec le paysage cultuel de la France du début du IIIe millénaire : les évolutions qu’il a connues, s’agissant des confessions présentes en 1905 autant que de celles qui sont advenues sur le territoire français depuis lors, spécialement le territoire métropolitain – car bien des nouveaux ou quasi-nouveaux cultes métropolitains étaient déjà présents outre-mer, notamment ici, sur l’Île de La Réunion –, ces évolutions, donc, ne peuvent que renouveler, en partie au moins, la perception de l’organisation patrimoniale des religions issues de la loi du 9 décembre 1905. Que vaut ce système, non pas en 1905, mais en 2016, dans la France religieuse telle qu’elle est ? Une partie des rapports, m’a-t-il semblé, a été consacrée à cette évaluation. Pour s’efforcer d’en rendre succinctement compte, je déclinerai donc une première forme de relations entre les patrimoines et les religions en examinant la condition patrimoniale des religions (I).
Ce premier prisme n’épuise pas la tentative de restitution synthétique des propos qui ont été tenus ce jour sur la rencontre entre les patrimoines et les religions. Les rapports entre ces deux entités ne se ramènent pas à la seule question du patrimoine des religions car ces dernières ne sont pas les seules détentrices de patrimoines. Or, porteuses de cosmogonies, elles développent, notamment, une conception de la relation aux richesses que leurs ressortissants sont naturellement enclins à prendre en compte, et se sentent même souvent obligés de suivre dans la gestion de leurs propres biens, autrement dit, de leur patrimoine. Il n’est que de citer la prohibition du prêt à intérêt, par la religion catholique, par la religion musulmane, ainsi que, en partie, par la religion juive, comme nous l’a exposé Imrane Omarjee (intervention non publiée dans ce numéro spécial), pour mesurer combien a pu être, et demeure encore, dans certains pays, considérable et durable l’impact des préceptes religieux sur la vie économique, sur le régime des échanges, autrement dit sur la gestion des patrimoines – de tous les patrimoines. Si cette prohibition n’a plus court, en France, depuis beau temps, ce n’est pas à dire que les considérations religieuses ne jouent plus aucun rôle dans la société française, alors même qu’elle est chaque jour un plus sécularisée, comme l’a évoqué Olivier Desaulnay. Une partie des rapports l’a démontré, qui nous conduira donc à nous efforcer de mesurer, dans un second temps, l’influence patrimoniale des religions (II).
I – La condition patrimoniale des religions
La rupture de 1905 avait pour ambition, révolutionnaire au regard de l’histoire, de rompre les liens entre l’État et les religions, à l’instar de la première tentative du décret de l’An III, qu’a rappelée Didier Blanc. Tel était l’intitulé même de la loi, que son contenu s’employait, à maints égards, à concrétiser. De composante de l’architecture étatique, tout particulièrement pour celle qui, à l’instar de l’Église catholique romaine, était religion d’État, les religions étaient vouées à devenir de simples composantes de ce qu’aujourd’hui on dénommerait « la société civile ». Des structures ad hoc étaient créées, sur le modèle des associations, précisément destinées à marquer ce basculement de la sphère publique vers la sphère privée.
Ce projet considérable est pourtant resté inachevé, avant tout par l’effet même de la loi qui l’avait porté, qui n’a pas pu ou voulu aller au bout du programme qu’elle avait annoncé (A).
La loi de 1905 était également porteuse, potentiellement, d’un autre trait qui est devenu aujourd’hui particulièrement caractéristique de la condition patrimoniale des religions, et qui consiste dans l’inégalité de traitement entre les patrimoines des religions, trait qui s’est imposé comme une donnée majeure de la problématique religieuse actuelle avec l’avènement, l’installation et le développement d’une religion qui était très peu présente dans la France métropolitaine de 1905 : ce sera le second point sur lequel je m’arrêterai (B).
A – L’inachèvement du refoulement des patrimoines religieux dans la sphère privée
L’idée d’une séparation entre l’État et les cultes est une idée profondément moderne. Elle concrétise la doctrine luthérienne des deux règnes, laquelle est au fondement de la sécularisation et marque la rupture avec la conception antérieure dans laquelle la religion a une compétence universelle. Cette évolution est d’une importance considérable : l’organisation sociale et politique qui se met en place sur de telles bases se différencie essentiellement de celle à laquelle elle succède.
Ce phénomène est d’une violence certaine pour les religions, en particulier, dans l’histoire française, pour l’Église catholique romaine, qui s’était totalement construite sur la centralité de sa position dans l’architecture sociale et politique. Le mouvement de réduction de la vocation des cultes à régir le temporel autant que le spirituel a certes des racines lointaines, au fur et à mesure de la construction de l’État-nation, dont l’avènement suppose l’émancipation du roi puis de ceux qui lui succéderont à l’égard de la tutelle religieuse. La séparation de 1905 s’inscrit dans cette longue histoire, alors même qu’elle constitue, à maints égards, une étape unique. Elle marque également une rupture dans la fonction de la puissance publique à l’égard des religions, fonction de contrôle et d’encadrement, de même que dans la légitimation réciproque de l’État et des cultes qui, au fur et à mesure de la construction de l’État-nation, bénéficiera de plus en plus à la puissance publique. Il fallait donc être particulièrement anticlérical, en même temps que particulièrement libéral, pour concevoir un régime radicalement différent, fondé sur le principe d’un cantonnement dans la sphère privée des institutions et des activités cultuelles. S’il y avait là un certain aboutissement d’un processus engagé depuis fort longtemps, il n’y avait pas moins, aussi, une vraie rupture dans la cosmogonie de la place sociale des religions : jamais, jusqu’alors, une telle relégation n’avait été réellement envisagée.
Précisément, si la philosophie aux fondements de la loi du 9 décembre 1905 fut bien celle qui vient d’être dite, cette ambition proprement révolutionnaire a pourtant été, d’emblée, contrariée par des choix majeurs de la même loi (1). Les contradictions se sont ultérieurement multipliées (2).
1) a. La séparation patrimoniale entre l’État et les cultes de 1905 n’a pas emporté le transfert aux nouvelles structures chargées d’incarner en droit les religions – les associations cultuelles – de la propriété de l’intégralité des édifices cultuels et de leurs dépendances, ainsi que du mobilier les garnissant. Ainsi que l’a rappelé François Cafarelli, ce transfert n’a concerné qu’une partie de ces biens, ceux qui appartenaient aux établissements publics qui avaient été créés en exécution de la loi concordataire du 8 avril 1802, et qui étaient propriétaires des édifices construits ou acquis entre le Concordat et la séparation ; les autres édifices, à savoir ceux qui étaient édifiés sur un terrain communal et intégrés au domaine public communal ainsi que ceux pris en charge par l’État et les départements en 1789, sont demeurés la propriété de ces personnes publiques. Les biens retenus par la puissance publique ont été affectés aux associations cultuelles, à condition, précise la loi, comme l’a rappelé Didier Blanc, qu’elles soient reconnues par le culte dont elles se proposent d’organiser l’exercice. Le Vatican refusera d’abord cette reconnaissance, si bien que les associations cultuelles ne seront créées que par les cultes protestants et israélites. Il faudra attendre 1924 et la création des associations diocésaines, jugées compatibles avec l’organisation du pouvoir dans l’Église romaine, pour que la loi de 1905 s’applique, dans ce volet, à cette religion.
Ainsi donc, dès la loi de séparation, un lien étroit était maintenu entre la puissance publique et les cultes, ainsi qu’un engagement financier de la puissance publique au bénéfice des religions. Comme l’a encore précisé François Cafarelli, l’article 13 de la loi de 1905 permet à l’État, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale d’engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue. Le grand principe de l’article 2 de la même loi, aux termes duquel, notamment, la puissance publique « ne subventionne aucun culte », était donc, ab initio, battu fortement en brèche puisque la conservation de la propriété des édifices cultuels et de leur dépendance par la puissance publique concernait, dans les faits, un nombre considérable d’églises, temples et autres synagogues. Sans doute était-il difficile de faire autrement car les cultes installés, spécialement le culte catholique, n’avaient probablement pas les moyens d’assumer, d’un coup, la charge que représentait la propriété de la kyrielle de bâtiments employés à leur exercice. Il n’y a pas moins là une considérable limite, autant juridique que factuelle, à la logique et au mouvement de séparation entre l’État et les cultes.
b. La subordination de l’affectation des édifices cultuels au fait que les associations cultuelles affectataires « se conforment aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice », pour reprendre les termes mêmes de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, contribue encore, à mon sens, à l’impossible refoulement des patrimoines religieux dans la sphère privée. Cette subordination marque, en effet, la reconnaissance d’un pouvoir concurrent à celui de la puissance publique, s’agissant d’une disposition décisive de la loi de 1905 dans l’organisation de la séparation patrimoniale entre l’État et les cultes, puisqu’elle concerne l’aptitude des nouvelles structures juridiques d’organisation matérielle de l’exercice du culte à devenir propriétaire ou affectataire des biens nécessaires à cet exercice : dans une logique de pur droit privé, cette aptitude résulterait de la seule réunion des conditions intrinsèques requises pour la constitution régulière d’une association cultuelle ou d’une association diocésaine ; dans le système de la loi de 1905, cette réunion ne suffit pas puisqu’il faut encore un adoubement d’autorités visées implicitement mais certainement par la loi, laquelle s’en remet, sur ce point, aux instances qui, dans l’organisation que chaque religion s’est donnée, ont compétence pour dire, sans qu’aucune contestation ne soit possible, si telle association se conforme ou non aux règles d’organisation générale de leur culte. Comme il a été rapporté, la jurisprudence administrative s’en est d’ailleurs effectivement remise aux décisions souveraines prises en la matière par les autorités des religions habilitées selon les règles d’organisation interne de chaque religion.
Cette absence de précision, par la loi, quant à la nature, à la forme, au lieu ou à la qualité des instances compétentes en la matière, vaut, à mon sens, aveu de l’irréductibilité des religions présentes sur le territoire français à la forme que la loi avait créée pour constituer le nouveau cadre d’organisation matérielle de son exercice. Avec ce phénomène, c’est donc, toujours, la velléité de refouler le patrimoine religieux dans la sphère privée qui est compromise. Les instances religieuses auxquelles la loi de 1905 s’en remet en se soumettant à l’avance à leur décision en matière d’adoubement des associations cultuelles ou diocésaines consomment la persistance d’une perception des religions comme des pouvoirs concurrents de l’État : l’adoubement des associations cultuelles et diocésaines, n’est-ce pas une sorte de « lettre de créance » ?
c. Une troisième illustration du caractère très inachevé, d’emblée, de la relégation des patrimoines religieux dans la sphère privée, est fournie par l’affectation des édifices cultuels et de leurs dépendances, notamment mobilières. Comme l’ont rappelé Céline Kuhn et Me Camoz, l’affectation cultuelle concerne tous les édifices du culte construits avant 1905, y compris ceux qui appartiennent à des associations cultuelles. L’article 4 de la loi précise, en effet, que les associations cultuelles deviennent propriétaires « avec leur affectation spéciale » « des biens mobiliers et immobiliers » qui appartenaient aux « établissements publics du culte ». Cette affectation inscrit fortement les associations cultuelles dans le continuum des établissements publics dont elles prennent le relais, alors même que les premières sont censées ressortir au droit privé tandis que les secondes relevaient du droit public. Céline Kuhn l’a souligné, en observant que « les édifices cultuels qui existaient avant 1905 restent opérationnels même après la disparition du service public cultuel : la loi assure une continuité réelle de l’activité religieuse sur le territoire national ». La propriété privée des associations cultuelles relativement aux biens, construits avant 1905, nécessaires à l’exercice du culte, subit une affectation comme quand ces biens ne leur appartiennent pas puisque l’affectation leur est imposée : or l’affectation est un acte de propriétaire, donc un acte de souveraineté, si bien qu’en principe, seul le propriétaire peut affecter ; une affectation par la puissance publique constitue donc toujours une dérogation au régime des biens, qui suppose que l’intérêt général soit en cause. On pourrait certes considérer que le principe de spécialité des personnes morales justifie cette affectation à l’exercice du culte des biens appartenant aux associations cultuelles : ces associations ne sauraient, en effet, que posséder les biens nécessaires à la réalisation de leur objet, qui est d’organiser matériellement l’activité cultuelle, en tous ses aspects. Mais cette circonstance justifie-t-elle que l’affectation soit imposée a priori, plutôt que d’avoir prévu un contrôle a posteriori de ce que les biens appartenant aux associations cultuelles ont tous un lien suffisant avec l’organisation matérielle de l’exercice du culte ?
En toute hypothèse, l’affectation « spéciale » impérative des biens appartenant aux associations cultuelles pour les avoir reçues en 1905, « affectation spéciale » selon l’expression de Céline Kuhn, qui relève l’absence, dans la loi de 1905, de formules telles qu’« affectation religieuse » ou « affectation cultuelle », démarque le régime de ces biens du droit commun de la propriété au profit d’une logique qui les maintient dans la dépendance du droit public. Elle semble faire émerger, au moins pour les édifices construits antérieurement à la loi de 1905, une tierce catégorie : ces biens ne sont pas des « biens religieux par nature », puisque, comme l’a démontré Céline Kuhn, une telle catégorie n’existe pas dans le système juridique français contemporain, mais, peut-être, des « biens religieux par fonction », fonction durable car l’affectation est en principe perpétuelle et la désaffectation suppose des conditions destinées à vérifier qu’elle répond à une situation qui la justifie indéniablement, comme l’a rappelé Me Camoz.
d. Une dernière illustration du phénomène relaté est fournie par la police des lieux de cultes prévue par la loi de 1905, étudiée par Romain Ollard. Son constat est des plus clairs : « Lorsqu’elle se pratique collectivement dans un édifice ouvert au public, la religion n’est pas une affaire purement privée, de sorte que l’État veille à ce que ces pratiques ne remettent pas en cause l’ordre républicain ou ne créent pas de troubles à l’ordre public ». La raison profonde de ce contrôle, dans le contexte de la loi de 1905 comme dans celui de 2016, est la méfiance de la puissance publique envers les religions, à raison de ce qu’elles sont : des systèmes globaux et non pas des activités particulières, des cadres d’un pouvoir potentiellement concurrent de celui de la puissance publique, compte tenu de ce qu’elles offrent des réponses ou des principes de réponses aux questions individuelles et collectives essentielles. La loi de 1905 est faussement paradoxale s’agissant de l’activité qui se déploie dans les lieux de culte : elle entend que l’activité y soit exclusivement cultuelle, en tout cas que des activités qui menaceraient directement l’ordre, la tranquillité, la paix publique y soit proscrites, précisément parce qu’elle redoute qu’elles s’y déploient. Le risque n’est d’ailleurs pas nul, il s’en faut, l’histoire, ancienne comme récente, le confirme sans discontinuer, fût-ce de façon plus ou moins intense selon les époques. Mais n’est-ce pas, alors, l’aveu que la relégation des religions dans la sphère privée – exclusivement – est une chimère compte tenu de ce que sont, fondamentalement, les religions ? Le contrôle qui s’exerce, par les moyens divers et variés évoqués par Romain Ollard, confirme que les édifices culturels ne peuvent être appréhendés à la seule aune du caractère privé de leur propriétaire ou de leur affectataire, ou du caractère censément privé des activités qui s’y déploient. Là encore, le continuum avec la situation antérieure est plus grand que l’annonce ne le laissait accroire.
2) Cette forme de négation de la séparation, inscrite dans la loi même de séparation, n’est pas restée isolée car, dans une certaine mesure probablement, elle en a appelé d’autres tout au long du siècle qui s’est écoulé depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905.
a. De nombreux exemples ont été donnés tout au long de la journée, j’en évoquerai sommairement quelques-uns. Certaines de ces dérogations ont été validées par la jurisprudence, je vous renvoie à cet égard aux exemples éloquents évoqués par François Cafarelli, ainsi en matière de financement des travaux d’entretien des édifices du culte, notamment par subvention pour aménagement d’un équipement en rapport avec cet édifice. De même, Anne-Françoise Zattara-Gros nous a rappelé que pour appuyer le financement, par une commune, des dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation des édifices du culte dont elle est propriétaire, les particuliers peuvent réaliser à leur profit des libéralités qui ne sont pas considérées comme des subventions du culte.
D’autres dérogations n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de légalité ou de constitutionnalité, du moins à ma connaissance, mais n’en sont pas moins pratiquées plus ou moins massivement : on songe à la déduction fiscale des dons aux associations cultuelles, à l’instar de la déduction fiscale des dons aux associations ordinaires, alors qu’une telle déduction, en ce qu’elle crée un manque à gagner pour le budget de l’État, devrait, en toute logique, être considérée comme un subventionnement des cultes et déclarée, en conséquence, inconstitutionnelle. Dans un ordre voisin, Houssen Amode nous a exposé que « certaines mosquées ont déjà créé des fonds de dotation avec les avantages fiscaux prévus par la loi ».
b. C’est toujours par l’intérêt général que sont justifiées les nouvelles dérogations au principe de non-subventionnement des religions par la puissance publique. Ainsi raisonne le Conseil d’État, comme l’a exposé François Cafarelli. Ainsi raisonnent également les responsables religieux, tel Houssen Amode qui, pour expliquer le recours aux fonds de dotation par des mosquées, explique que l’accès aux avantages fiscaux des fonds de dotation prévus par la loi est justifié par les « objectifs d’intérêt général » qu’ils poursuivent. Houssen Amode avait pourtant exposé, peu auparavant, que le financement du culte musulman à La Réunion en manifestait la « totale indépendance. Aucun euro ne provient de l’extérieur y compris de la métropole ». Le fait de bénéficier des avantages fiscaux subordonnés à la poursuite d’une activité d’intérêt général n’est donc pas jugé, par lui, constituer une atteinte à l’indépendance financière.
Il ne s’agit pas ici de contester le fait que les groupements religieux peuvent poursuivre, indépendamment de l’exercice du culte, des activités d’intérêt général, tel l’enseignement, la solidarité sociale, les activités de soins et autre activités cultuelles. Il s’agit seulement de constater que des activités, dont la nature est différente de celle de l’exercice du culte, sont invoquées ou utilisées pour permettre un financement public à peine indirect du culte. Il y a là une incontestable atteinte, au moins à la lettre de la loi du 9 décembre 1905, qu’il convient de constater comme telle, d’autant que le phénomène de contournement et de dérogations au texte fondateur est massif et durable. La rhétorique utilisée pour tenter de le rendre formellement compatible avec les principes de la loi de 1905 est symptomatique de l’échec de cette loi dans son entreprise de relégation des religions dans la sphère privée – en même temps qu’elle nourrit cet échec : en toute rigueur, dans un système de séparation, quels que soient les liens patrimoniaux maintenus entre l’État et les cultes, nulle activité religieuse ne saurait plus ressortir à l’intérêt général, sauf à rétablir, au petit pied, une forme de reconnaissance des cultes. Cette donnée élémentaire aurait dû conduire à traquer les velléités de rétablir un lien entre religion et intérêt général, qui résultent de l’admission qu’en toute périphérie de l’activité cultuelle peuvent se déployer des activités d’intérêt général : le raisonnement étant exclusivement destiné à créer l’illusion factice d’un respect du principe fondamental de non-subventionnement quand il est précisément question de le contourner, il comporte sa propre contradiction et n’a donc aucune véritable pertinence. On comprend en tout cas parfaitement, dans ces conditions, que comme il a été exposé, le principe de non-subventionnement ne saurait avoir acquis une quelconque valeur constitutionnelle, tant sont nombreuses les dérogations qui lui sont apportées. Mais on est au-delà du constat d’Olivier Desaulnay selon lequel « la laïcité est moins intransigeante qu’il n’y paraît quant à l’application de ses principes » : la laïcité se révèle particulièrement conciliante, sinon anormalement conciliante.
L’acceptation sociale dont semblent plutôt faire l’objet ces multiples dérogations et autres contournements, autant qu’on puisse en juger, suggère que la séparation absolue entre la puissance publique et les religions n’a pas été recherchée jusqu’ici. Comme il a été indiqué par plusieurs intervenants tout au long de la journée, la loi de 1905, loi de « compromis », a plutôt créé une séparation relative et inachevée.
C’est sur cette base qu’il faut envisager le second volet de la condition patrimoniale des religions dans la France d’aujourd’hui, qui consiste dans la forte inégalité patrimoniale entre les religions.
B – L’importante inégalité de traitement entre les patrimoines des religions
L’inachèvement du processus de séparation entre l’État et les cultes, au rebours du programme affiché par le titre de la loi du 9 décembre 1905 et au rebours du principe de non-subventionnement, qui reste un principe même dépourvu de valeur constitutionnelle, rend problématique la situation patrimoniale du culte musulman par rapport aux cultes qui étaient présents en France lors de l’élaboration de la loi de 1905, en considération desquels cette loi a été élaborée. Ainsi qu’il a été rappelé par Didier Blanc à partir d’un rapport sénatorial, il existe en France environ 100 000 édifices cultuels, dont 90 000 affectés à l’usage du culte catholique ; et 90 % de ces derniers édifices appartiennent à la puissance publique, pour avoir été construits avant l’entrée en vigueur de la loi de 1905 sur un terrain communal et intégrés au domaine public communal ou avoir été pris en charge par l’État et les départements en 1789. En regard de ce chiffre, il a été relevé, par le même rapport sénatorial, qu’aucun édifice cultuel dédié au culte musulman n’appartient à la puissance publique. Or, depuis 1905, plus précisément depuis quelques décennies, le culte musulman est devenu, numériquement, le deuxième des cultes présents en France.
Ce matin, dès le début des travaux, le préfet Dominique Sorain avait proclamé : « La laïcité c’est l’égalité des cultes ». Didier Blanc a rappelé ensuite que la laïcité c’est « la neutralité », laquelle s’entend d’abord de la non-reconnaissance, ensuite de l’absence de subventionnement, dont Didier Blanc a précisé qu’elle constitue « le cœur de la séparation ».
Ainsi, le hiatus est-il majeur entre ces principes et orientations, d’une part, et le traitement patrimonial comparé des deux premiers cultes en activité sur le territoire de la République, d’autre part : le premier, à tous les sens du terme d’ailleurs, bénéfice, patrimonialement, d’un traitement incontestablement favorable dans un système censé être un système de séparation, non seulement en soi, mais encore en regard du traitement faits aux autres cultes, spécialement le deuxième en termes d’effectifs. Ce dernier culte, en effet, parce qu’il n’est réellement apparu en France qu’après la conception, le vote et l’entrée en vigueur de la loi de 1905, subit la pleine rigueur d’un principe de séparation qui ne trouve réellement à s’appliquer qu’avec lui. Certes, les dérogations et autres contournements de la loi de 1905 bénéficient, notamment, au culte musulman, et il est même permis d’estimer que parmi les raisons pour lesquelles le gouvernement, le Parlement ou le Conseil d’État ont engagé et développé cette politique larvée de remise en cause partielle du principe de non-subventionnement des cultes, réside, en place non négligeable, la volonté de permettre un certain financement public du culte musulman, au moins indirect, afin de combler quelque peu l’écart considérable de traitement, en termes patrimoniaux, entre les deux premiers cultes aujourd’hui présents en France. Mais comment ne pas souscrire alors à l’appréciation de François Cafarelli selon laquelle il n’y a rien d’autre, ici, qu’une « discrimination à rebours » ?
Il reste que ce bricolage marginal ne saurait qu’atténuer marginalement l’atteinte frontale au principe d’égalité entre les religions, dans un contexte où la puissance publique a doublement affirmé ne plus reconnaître aucun culte et entendre, en conséquence, ne plus en subventionner aucun.
On est ici au cœur de la difficulté majeure que pose à la société française du début du IIIe millénaire la loi de séparation promulguée au début du dernier siècle du IIe millénaire. L’argument de l’ancienneté de la présente des cultes qui, peu ou prou, bénéficient au moins du subventionnement indirect que constitue la propriété publique maintenue des édifices du culte et de leurs dépendances qui appartenaient aux communes et autres collectivités publiques en 1905, est un argument indéniable mais qui ne peut que s’émousser au fur et à mesure que la distance s’accroît d’avec l’année 1905 : le renouvellement substantiel du contexte que constitue, d’un côté, l’avènement, désormais quantitativement remarquable, d’une religion à peu près non présente en France jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle, d’un autre côté, le recul constant des religions traditionnelles, dans le nombre de leurs ressortissants comme dans leur influence sociale et politique, à raison, précisément, de ce que la sécularisation n’a cessé de se produire à leur égard, rend et rendra de moins en moins performante la justification de l’inégalité drastique de traitement entre culte catholique et culte musulman, du point de vue de leurs situations patrimoniales respectives.
La question est donc désormais fortement posée de savoir comment mettre fin à ce hiatus. Faut-il aller enfin au bout de la logique de séparation, logique annoncée mais jamais accomplie, alors même que le chemin parcouru est déjà remarquable ? Faut-il prendre acte de cet inachèvement et multiplier les dérogations et les contournements afin de réduire autant que possible, en tout cas toujours plus, l’écart qui sera de plus en plus intenable entre les conditions patrimoniales respectives des cultes présents en France ? On pressent que la puissance publique a déjà choisi entre ces deux options celle qui consiste à détricoter toujours plus le principe de séparation : non seulement il semble politiquement impossible d’abandonner formellement ce principe, alors même que dans les faits, il est autrement plus édulcoré qu’il n’est prétendu et soutenu depuis toujours, notamment dans les sphères politiques ; mais encore, l’expérience de remise en cause larvée du principe de non-subventionnement semble fonctionner sans grande difficulté, ce qui constitue un fort encouragement à le poursuivre et même à l’intensifier.
Le résultat est que la perspective initiale, rappelée par Didier Blanc, selon laquelle « la loi de 1905 est moins l’instrument d’une domination étatique que celui de l’émancipation du fait religieux », est grandement démentie par l’expérience. Le fait religieux ne s’est pas émancipé selon les modalités qui étaient espérées ou suggérées, consistant en la transformation des religions en des composantes de la société civile ; la distinction des deux règnes relève encore trop de l’idéal lointain sur lequel s’est fondée la modernité ; la domination étatique se transforme subrepticement en une dépendance étatique, au fur et à mesure que la puissance publique s’efforce de multiplier les voies indirectes, voire directes, d’un subventionnement des religions. Aristide Briand doit se retourner dans sa tombe !
Ce mouvement trouve un certain écho dans l’examen de l’influence patrimoniale des religions.
II – L’influence patrimoniale des religions
Les religions développent, notamment, une conception du rapport aux richesses et aux biens de chacun de leurs membres, sinon de chaque membre des sociétés qu’elles régissent, dans les pays où il en va ainsi. Cette influence est des plus naturelles car la religion propose une compréhension générale des causes et des fins de l’existence humaine, qui la conduit à concevoir, en conséquence, la façon dont ceux qui suivent les dogmes et préceptes qui les fondent doivent se comporter dans les aspects majeurs de l’existence. Or le rapport aux biens participe de ces données essentielles de la vie humaine.
Dans les pays qui, comme le nôtre, s’inscrivent dans un processus de séparation des cultes et de l’État, donc de cantonnement des religions à la sphère privée, la tendance est au recul de l’influence des religions sur les décisions patrimoniales individuelles. Le mouvement historique est dans le sens de la libération de l’individu, notamment à l’égard des religions, ce qui se traduit par la multiplication des déclarations d’incompatibilités de tel précepte religieux à l’aune des conditions générales de validité des actes et des opérations par lesquelles, dans la législation étatique, les particuliers organisent la gestion de leurs richesses (A).
Pourtant, dans la dernière période, on voit poindre les germes d’un renouveau de cette influence des conceptions religieuses sur les décisions patrimoniales, renouveau qui se manifeste par le fait que leur cantonnement traditionnel pourrait être moins appuyé, moins légitime, moins soutenu qu’il ne l’a longtemps été (B).
A – Le cantonnement traditionnel de l’influence patrimoniale des religions
Le cantonnement traditionnel de l’influence patrimoniale des religions se manifeste par le contrôle relativement rigoureux des considérations ou de la dimension religieuses des actes conclus par les particuliers.
C’est ainsi que les libéralités à une personne morale de droit public, assorties de charges cultuelles, sont déclarées illicites par l’article 9 de loi du 9 décembre 1905, comme l’a rappelé Anne-Françoise Zattara-Gros. À la suite de la loi de séparation, la jurisprudence française a développé une police des actes à titre gratuit destinés à les éradiquer des clauses religieuses qui, longtemps, n’avaient appelé aucune sanction : on considérait en effet, classiquement, que les actes à titre gratuit, donation ou testament, permettaient à leurs auteurs, compte tenu de ce que par ces actes ils s’appauvrissent au bénéfice des gratifiés, d’imposer toutes sortes de conditions et restrictions, dont l’appréciation du caractère illicite ou contraire aux bonnes mœurs manifestait un indéniable libéralisme. Au milieu de XXe siècle, la position des tribunaux a évolué, notamment à l’occasion d’une clause de révocation d’une libéralité qui prenait pour événement déclenchant le fait que le gratifié épousât une personne de confession juive : cette stipulation fut annulée pour contrariété à l’ordre public2. Depuis lors, cette tendance à lutter contre les discriminations religieuses par le truchement des actes particuliers, y compris les actes à titre gratuit, n’a cessé d’être confortée. Anne-Françoise Zattara-Gros l’a clairement énoncé : « la condition de religion est contraire non seulement aux principes de la loi française et notamment à celui de la liberté de conscience, mais encore à ceux de l’ordre public international au rang desquels figure la liberté de religion (Conv. EDH, art. 9). De telles clauses sont réputées non écrites ».
C’est un même phénomène qu’a relaté Jean-Baptiste Seube, rapportant cette jurisprudence relative aux contrats à titre onéreux, en l’occurrence un bail, qui refuse de faire entrer par principe, et hors toute prévision contractuelle spéciale, la liberté religieuse des parties, afin d’imposer à l’une d’elles des obligations destinées à permettre à l’autre de respecter ses obligations religieuses. Comme l’a expliqué Jean-Baptiste Seube, « il est délicat de considérer que le respect des convictions religieuses des contractants pourrait avoir un effet additif et se traduire par l’ajout de stipulations au contrat : le penser reviendrait à faire sauter la sécurité juridique et à exposer tous les contractants à tenir compte des impératifs religieux de leur co-contractant ».
Ce qui est remarquable, toutefois, dans ce type d’affaire, c’est avant tout la formulation de la demande. Elle manifeste, en effet, une évolution de l’articulation entre les convictions religieuses d’un contractant et le contrat qu’il a conclu car elle repose sur le postulat selon lequel l’entrée de ces convictions dans le champ contractuel, quand aucune clause ne l’a prévu, ne constitue pas pour autant, en soi, une perspective tellement saugrenue qu’elle ne saurait seulement être présentée. Il est, par conséquent, permis de voir dans ces séquences jurisprudentielles, quand bien même elles se traduisent par un débouté du demandeur, le signe d’une évolution des mentalités des plaideurs quant à la place qui doit être assignée aux données religieuses lorsqu’elles agissent en qualité de contractant. Le fait que les décisions rapportées n’aient pas fait droit aux demandes ne saurait signifier qu’il en ira toujours ainsi.
Des indices suggèrent, en effet, qu’un renouveau dans l’influence patrimoniale des religions pourrait marquer les temps qui viennent.
B – Le renouvellement potentiel de l’influence patrimoniale des religions
Le renouveau de l’influence patrimoniale des religions est annoncé, d’une part par la conception ouverte que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme développe à l’égard de la possibilité pour chacun de se prévaloir, sur l’espace social, de ses convictions religieuses, d’autre part par le mouvement tendant à chercher à permettre la meilleure réception en droit positif des exigences et préceptes régissant le financement et le crédit.
1) La CEDH a une conception des convictions religieuses qui se démarque nettement du cantonnement traditionnel de ces convictions dans l’ordre de l’intimité personnelle qu’a développé la jurisprudence française, selon la conception qu’elle se fait de la vie privée et dans un contexte fortement marqué par la velléité de refoulement de phénomène religieux dans la sphère privée. Dans ce schéma, la divulgation des convictions religieuses contre la volonté de celui auquel elles se rapportent consomme une atteinte à la vie privée. En revanche, il n’est nul droit de se prévaloir de ses convictions religieuses sur l’espace social, par principe et sans l’avoir spécialement prévu par la clause d’un acte particulier. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous l’influence directe du Right of privacy anglo-américain, fait de l’affirmation publique des éléments constitutifs de la personnalité profonde un droit : empêcher, d’une façon ou d’une autre, cette affirmation, c’est porter à atteinte au droit de mener une vie privée, c’est-à-dire au droit d’épanouir sa personnalité sous la seule réserve de ne pas porter une atteinte excessive aux droits d’autrui.
Cette façon de voir gagne insensiblement la jurisprudence française, comme en témoigne l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2015, par lequel elle a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt ayant refusé de faire interdiction à la direction d’un foyer de résidents de supprimer la mise à leur disposition d’une salle pour la pratique du culte musulman, aux motifs que cette direction n’était pas conventionnellement tenue « d’assurer aux (intéressés) la possibilité matérielle d’exercer leur culte » et que ces derniers pouvaient « pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, (laquelle) facilite seulement leur pratique religieuse ». Comme l’a expliqué Jean-Baptiste Seube, le rejet du pourvoi est loin de signifier que la prise en compte des demandes du type de celles qui furent adressées au bailleur dans cette espèce ne verra pas ses chances de succès augmenter. Car la méthode retenue pour justifier le rejet du pourvoi marque un soin dans la considération des arguments des demandeurs qui manifeste la reconnaissance du caractère non illégitime en soi de la demande initiale. La nécessité pour le bailleur de prendre en compte les convictions religieuses fait, ainsi, progressivement, son entrée dans le champ contractuel. C’est la logique du Right of privacy.
2) Sophie Schiller nous a présenté l’existence de fonds d’investissements qui se conforment, ou qui prétendent se conformer, par leurs règles particulières, à un système de valeur qui puise directement dans le corpus religieux relatif au comportement qui doit être adopté en la matière – ne pas gagner d’argent sans effort ; ne pas s’enrichir injustement au détriment d’autrui ; adosser les investissements à l’économie réelle, etc. Dans le même ordre, Imrane Ormarjee a évoqué (dans son intervention non publiée dans ce numéro spécial) la nécessaire mutualisation des risques. Il a, par ailleurs et notamment, mis en avant les spécificités des montages de financement par rapport au schéma classique du prêt.
Sophie Schiller a alors rendu compte de la position de l’AMF relative aux « critères extra-financiers de sélection des actifs et application aux OPC se déclarant conformes à la loi islamique »3, document du 17 juillet 2007, modifié en 2013 puis en 2015. On peut également citer avec Imrane Ormajee les textes publiés par le ministère des Finances en 2008 et 2009 pour promouvoir les investissements s’inscrivant dans la finance islamique, afin de leur offrir un cadre fiscal.
La technique du sukuk est généralement définie comme un instrument financier représentatif d’un droit de copropriété indirect sur des actifs sous-jacents appartenant à l’émetteur4. Le législateur français a même essayé de réformer la fiducie afin de lui permettre de constituer un cadre d’accueil de la finance islamique, en conférant un droit réel au bénéficiaire pendant la durée de la fiducie, alors que les biens figurent dans le patrimoine fiduciaire, ce qui est conforme aux exigences islamiques en la matière5. L’objectif poursuivi était de permettre l’émission de sukuk et de rapprocher la fiducie du trust6. La décision n° 2009-589 DC du Conseil constitutionnel censura sur ce point la loi précitée en se basant sur la théorie du cavalier législatif.
Dans l’immédiat, le recours au droit commun des contrats permet d’assurer la réception des exigences particulières de la finance islamique. On pourrait donc considérer qu’il n’y a qu’à mobiliser le principe de liberté contractuelle, la dimension ou le substrat religieux de l’opération ne modifiant pas l’économie juridique générale des montages considérés. Toutefois, comment ne pas anticiper le fait qu’avec le développement de ces montages, donc avec l’inévitable survenance des litiges, il sera référé aux corpus religieux ayant directement inspiré les stipulations les plus significatives et les plus originales des opérations mises en place : les juges ou les arbitres pourront-ils en faire abstraction ? S’ils les prennent en compte, à quel titre cela se fera-t-il : ces normes seront-elles entrées dans le champ contractuel ? Constitueront-elles des sources d’inspiration susceptibles d’éclairer l’interprétation ? On perçoit aisément l’importance et la gravité des conséquences d’une prise de position dans telle ou telle direction. Or, tôt ou tard, il ne faudra pas moins trancher.
Au moment où s’achève ce riche colloque, tous les intervenants doivent être remerciés et Anne-Françoise Zattara-Gros et Céline Kuhn félicitées d’avoir conçu, organisé et contribué avec talent à cette superbe manifestation.
Qu’en retenir, en un mot – ou presque ?
La séparation de l’État et des cultes constitue une étape remarquable dans le mouvement d’expurgement de la divinité des affaires publiques. Elle prône un statut des religions qui, sans méconnaître leur importance sociale, repose sur leur totale extériorité à l’égard des fondements et des finalités de l’action publique. Si, dans ce schéma, les cultes peuvent poursuivre une partie de leurs activités, c’est exclusivement dans la sphère privée. Le contrat qui leur est proposé est celui d’une dissociation fonctionnelle et matérielle douce d’avec la puissance publique, contre la garantie de leur possibilité d’existence et d’action dans la société libérale et sécularisée que porte la modernité.
L’enjeu des temps présents et de ceux qu’ils annoncent reste bien celui de la place des cultes dans une société qui se laïcise toujours plus intensément. Partout, des tensions majeures se nouent à propos de cette localisation, tant la religion a intimement façonné les sociétés humaines, donc leur organisation et leur fonctionnement. Le défi est d’établir les règles qui, dans ce cheminement, permettront de gérer les manifestations du fait religieux que les rédacteurs de la loi de séparation n’avaient pu anticiper.
Pourtant, comme le disait Pierre Laroque à propos du droit du travail, la première réforme de la loi de 1905 ne serait-elle pas de l’appliquer – pleinement ? Et, dans la foulée, de faire en sorte que, par des textes additionnels, le projet porté par cette même législation soit conduit à son terme – projet ô combien adapté au sens de l’histoire ?
Notes de bas de pages
-
1.
C. pén., art. 225-1.
-
2.
T. civ. Seine, 22 janv. 1947 : D. 1947, p. 126.
-
3.
Position AMF n° 2007-19.
-
4.
Dr. et patr. 2010, n° 192, p. 84 et s., Bertran de Balanda J. et Bourabiat F.
-
5.
L. n° 2009-1255, 19 oct. 2009.
-
6.
Sur ce point et ses conséquences en droit français, v. Bertran de Balanda J. et Bourabiat F., préc. ; D. 2009, p. 2559, Aynès L. et Crocq P.