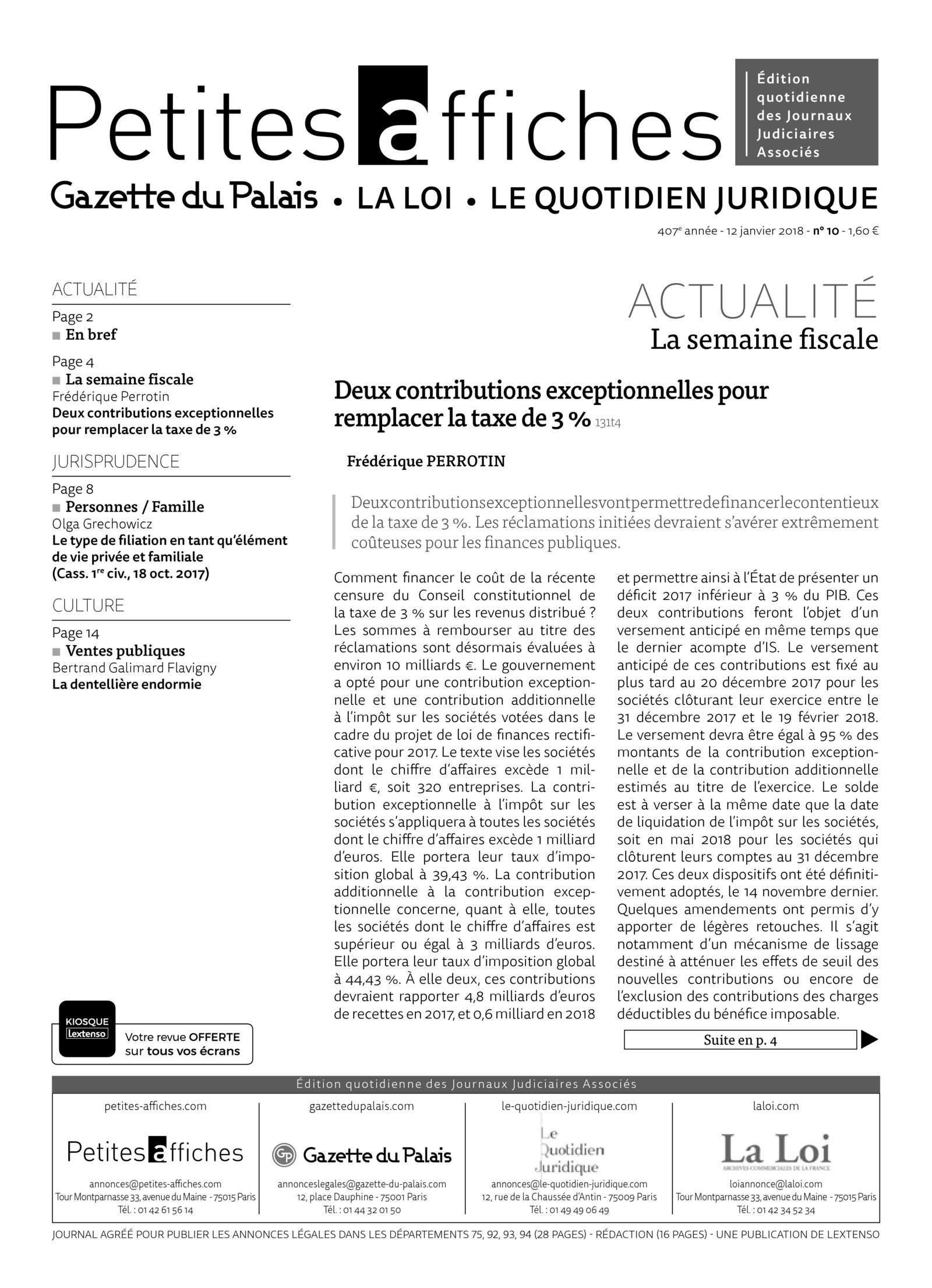Deux contributions exceptionnelles pour remplacer la taxe de 3 %
Deux contributions exceptionnelles vont permettre de financer le contentieux de la taxe de 3 %. Les réclamations initiées devraient s’avérer extrêmement coûteuses pour les finances publiques.
Comment financer le coût de la récente censure du Conseil constitutionnel de la taxe de 3 % sur les revenus distribué ? Les sommes à rembourser au titre des réclamations sont désormais évaluées à environ 10 milliards €. Le gouvernement a opté pour une contribution exceptionnelle et une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés votées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2017. Le texte vise les sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard €, soit 320 entreprises. La contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés s’appliquera à toutes les sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros. Elle portera leur taux d’imposition global à 39,43 %. La contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle concerne, quant à elle, toutes les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros. Elle portera leur taux d’imposition global à 44,43 %. À elle deux, ces contributions devraient rapporter 4,8 milliards d’euros de recettes en 2017, et 0,6 milliard en 2018 et permettre ainsi à l’État de présenter un déficit 2017 inférieur à 3 % du PIB. Ces deux contributions feront l’objet d’un versement anticipé en même temps que le dernier acompte d’IS. Le versement anticipé de ces contributions est fixé au plus tard au 20 décembre 2017 pour les sociétés clôturant leur exercice entre le 31 décembre 2017 et le 19 février 2018. Le versement devra être égal à 95 % des montants de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice. Le solde est à verser à la même date que la date de liquidation de l’impôt sur les sociétés, soit en mai 2018 pour les sociétés qui clôturent leurs comptes au 31 décembre 2017. Ces deux dispositifs ont été définitivement adoptés, le 14 novembre dernier. Quelques amendements ont permis d’y apporter de légères retouches. Il s’agit notamment d’un mécanisme de lissage destiné à atténuer les effets de seuil des nouvelles contributions ou encore de l’exclusion des contributions des charges déductibles du bénéfice imposable. Le texte fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel.
De nombreuses réclamations
L’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a instauré une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, codifiée à l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts, due par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au titre des montants qu’elles distribuent et mettent en paiement à compter du 17 août 2012. Le vote de ce texte a répondu a un double objectif. Il s’agissait selon la formule de Bercy « de soutenir l’investissement au détriment du dividende » mais également de répondre à un impératif budgétaire : compenser les diminutions de recettes fiscales résultant de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes versés à des OPCVM étrangers, due à la jurisprudence communautaire Santander Asset Management SGIIC SA (CJUE, 10 mai 2012, C‑338/11 à C‑347/11). Dès sa création, la validité de cette contribution a été régulièrement mise en doute, notamment au regard des principes du droit communautaire que ce soit sur le fondement de la directive mère-filles ou celui de la liberté d’établissement. Pourtant, comme l’a rappelé le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Joël Giraud, dans son rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, lors de l’adoption de la contribution de 3 %, la contrariété du dispositif avec le droit européen n’a pas été évoquée au cours de la procédure. Les conditions d’examen du texte expliquent peut-être ce défaut d’analyse, le Parlement ayant disposé de moins d’un mois pour se prononcer sur un texte comptant initialement 30 articles, et 46 articles au terme de la navette parlementaire. La constitutionnalité de la contribution de 3 % n’a ensuite pas été contrôlée par le Conseil constitutionnel. Ni les députés, ni les sénateurs, ne l’avaient saisi de cette partie du texte, et le Conseil ne l’a pas non plus soulevé d’office. « Si la contrariété avec le droit européen est aujourd’hui évidente, tel n’était pas le cas en juillet 2012 », souligne le rapporteur. L’analyse alors faite du point de vue, tant de la compatibilité de la disposition à l’article 4 de la directive « mère-fille », dont l’application a finalement entraîné la censure de la disposition, que de l’article 5, semblaient toutes deux robustes. « Cette contrariété n’était pas évidente à l’époque et les évocations d’un doute quant à la compatibilité européenne du dispositif adopté relevaient plus d’une interprétation prospective du droit alors en vigueur que d’une certitude assise sur des précédents juridiques (sans qu’y fasse obstacle le fait que cette interprétation prospective se soit ultérieurement révélée fondée) », précise à cet égard ce dernier.
Les réclamations déposées ont visé à obtenir la restitution de cette contribution au motif principal soit de son inconstitutionnalité, soit de sa contrariété avec l’article 49 du TFUE qui proscrit toute restriction à la liberté d’établissement ainsi qu’avec l’article 4 qui vise à éviter la double imposition des bénéfices reçus par une société mère de ses filiales établies dans un autre État membre et l’article 5 relatif à l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère de la directive « mère-fille » de 2011. Différents griefs ont été soulevés dans ces réclamations. Les sociétés concernées soulignaient la différence de traitement opérée au détriment des filiales de sociétés établies dans un autre État membre de l’Union européenne par rapport aux succursales ainsi que la différence de traitement défavorable à l’égard des filiales françaises détenues à au moins 95 % par une société mère non résidente. Elles pointaient également la contradiction de l’article 235 ter ZCA avec les articles 4 et 5 de la directive « mère-fille ».
Première censure du Conseil constitutionnel
Par une décision rendue le 27 juin 2016 sur demande de la société Layher, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du I du E de l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-958 du 16 août 2012, codifiées à l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts, en tant qu’elles exonèrent de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés les montants distribués « entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A » du code précité. La société Layher soutenait, en effet, que l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts introduisait une différence de traitement entre les distributions réalisées au sein d’un groupe intégré et celles effectuées en dehors de ce cadre, alors même que les conditions objectives d’application du régime de l’intégration, en termes de détention de capital et de durée des exercices, étaient remplies, cette différence de traitement n’étant justifiée ni par une différence objective de situation, au regard de l’objet de la contribution, ni par aucune raison d’intérêt général. La société soutenait qu’il y avait atteinte aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques. Par une décision du 30 septembre 2016, rendue suite à la question prioritaire de constitutionnalité posée par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement ainsi instituée entre les sociétés d’un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale, n’est justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général. Le Conseil constitutionnel a, par conséquent, déclaré contraires à la Constitution les mots : « entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A », figurant au 1° du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015. Constatant qu’il revenait au seul législateur de choisir les modifications qui lui apparaissent nécessaires pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2017 l’abrogation des dispositions contestées. L’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2016 a tiré les conséquences de cette jurisprudence. Le législateur a étendu le champ de l’exonération à toutes les situations dans lesquelles la bénéficiaire de la distribution est une société qui remplit les conditions pour être membre du même groupe intégré que la société distributrice, même si elles n’ont pas opté pour ce régime, ou qui les remplirait si elle était établie en France. Les conséquences financières de cette extension ont alors été évaluées comme conduisant à une perte de 250 millions d’euros par an pour le budget de l’État, pour un rendement annuel moyen de 2 milliards d’euros environ.
L’impact du droit communautaire
Le fait que la contribution a d’abord été jugée contraire à la directive « mère-fille », a conduit à la rendre inapplicable aux dividendes redistribués par une société mère qui provenaient d’une filiale européenne. Dès lors, cette exclusion des dividendes européens redistribués a été considérée comme induisant une différence de traitement avec les autres dividendes, créant une rupture d’égalité inconstitutionnelle. Cette situation a conduit le Conseil constitutionnel à se prononcer à nouveau sur la légalité de la taxe de 3 % dans le cadre d’une deuxième question prioritaire de constitutionnalité. En effet, à l’occasion d’une affaire Association française des entreprises privées du 27 juin 2016, les entités requérantes ont relevé que la redistribution par une société française de dividendes perçus de ses filiales implantées dans d’autres États membres de l’Union européenne serait exonérée de retenue à la source, par application de la directive mère-fille, alors que la redistribution de dividendes en provenance de filiales françaises ou établies hors de l’UE serait assujettie à la contribution additionnelle, ce qui générerait une discrimination à rebours. La contrariété des dispositions de l’article 235 ter ZCA avec les articles 4 ou 5 de la directive « mère-fille » de 2011 n’apparaissait alors pas certaine. Cette difficulté sérieuse d’interprétation desdits articles supposait d’être préalablement réglée par transmission d’une question préjudicielle.
Le régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents est issu de la directive du 30 novembre 2011, modifiée en 2014 et en 2015. Il vise à exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices que des filiales européennes distribuent à leur société mère établie dans un autre État membre, et à éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère. L’article 4 de la directive prévoit que l’État membre de la société mère qui perçoit des bénéfices de sa filiale s’abstient d’imposer ces bénéfices s’ils ne sont pas déductibles par la filiale ou les impose, en autorisant la société mère à déduire de son IS la fraction de l’impôt afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale. Il peut imposer les dividendes dans une limite maximale de 5 % de ceux-ci, au titre d’une quote-part pour frais et charge. L’article 5 de la directive précise, quant à lui, que « les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source ». L’article 6 de la directive prohibe la mise en place, par l’État membre dont relève la société mère, d’une telle retenue à la source. Aux termes de l’article 4 de cette directive, l’État membre de la société mère doit s’abstenir d’imposer ces revenus ou, s’il décide de les imposer, autorise la société mère à déduire de son impôt la fraction de l’impôt afférente à ces revenus acquittée par la filiale. Est seule autorisée l’imposition d’une quote-part forfaitaire pour frais et charges qui ne peut excéder 5 % du montant des revenus distribués à la société mère – la quote-part ne pouvant excéder 5 % des revenus distribués, la charge fiscale maximale admise correspond à l’application du taux normal d’IS sur cette assiette, soit 1,67 % en France (33 1/3 % × 5 %). Le Conseil d’État a transmis à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur la conformité de ce mécanisme aux articles 4 et 5 de la directive « mère-fille » de 2011. La CJUE s’est prononcée sur ces questions dans un arrêt du 17 mai 2017. Elle a validé la thèse des sociétés plaignantes, et a jugé la contribution française de 3 % contraire à l’article 4 de la directive « mère-fille ». La Cour relève que, dès lors qu’ils ont opté pour le régime de l’exonération, cette disposition interdit aux États membres d’imposer la société mère ou son établissement stable au titre des bénéfices distribués par la filiale à sa société mère, sans distinguer selon que l’imposition de la société mère a pour fait générateur la réception de ces bénéfices ou leur redistribution. La Cour relève ensuite qu’une imposition de ces bénéfices par l’État membre de la société mère dans le chef de cette société lors de la redistribution de ces derniers qui aurait pour effet de soumettre lesdits bénéfices à une imposition dépassant le plafond de 5 % prévu à l’article 4, paragraphe 3, de la directive, entraînerait une double imposition au niveau de ladite société contraire à ladite directive. La contribution de 3 % conduit donc selon la Cour à une double imposition irrégulière, en ce qu’elle entraînait une imposition excédant la part autorisée de 5 %. Il résulte de cet arrêt que dans le cadre transfrontalier communautaire, la contribution ne peut plus être exigée lors de la redistribution des dividendes reçus de filiales. Elle peut en revanche être appliquée à l’ensemble des autres bénéfices redistribués par cette société mère.
Une différence de traitement sanctionnée par le Conseil constitutionnel
Ces dispositions, telles qu’elles doivent être appliquées à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, créent ainsi une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les bénéfices qu’elles redistribuent proviennent ou non de filiales relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30 novembre 2011. En juin 2017, le Conseil d’État a été saisi de deux nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité en vue de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts. Le dispositif tel qu’éclairé par la décision de la CJUE aboutit à une discrimination à rebours à l’encontre des situations purement domestiques et des situations impliquant des filiales établies sur le territoire d’États tiers à l’Union européenne, avancent les sociétés concernées. En outre, elles soulignent que l’extension de la jurisprudence communautaire aux situations domestiques ou impliquant des États tiers laisse à la charge des seules sociétés opérationnelles la contribution sur les revenus distribués, générant une nouvelle discrimination à leur encontre. Dans un arrêt Société Sorpafi du 7 juillet 2017, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel les deux questions. La décision du Conseil constitutionnel n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 a conduit à invalider l’intégralité de la contribution.
Un enjeu financier de taille
Cette nouvelle décision alourdit le poids financier des réclamations dont le montant est désormais estimé à 10 milliards d’euros. Si aucun décaissement n’a pour l’instant été effectué dans le cadre de ce contentieux, le montant des réclamations identifié au mois d’août 2017 s’élevait à 6,8 milliards d’euros. Le projet de loi de programmation anticipait un coût budgétaire de 5,7 milliards, étalé sur quatre ans.
La décision du Conseil constitutionnel abrogeant l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts étant intervenue après le dépôt du projet de loi de programmation pour les années 2018 à 2022 et du projet de loi de finances pour 2018, ces évaluations ont été revues à la hausse. Lors de son audition par la commission des finances de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a rappelé que la décision de la CJUE du 17 mai 2017 avait amené le gouvernement à ne provisionner « qu’un peu plus de 5 milliards d’euros dans la trajectoire budgétaire du projet de loi de finances, en estimant que l’annulation des recettes de la taxe ne serait que partielle. Le Conseil constitutionnel en a jugé différemment le 6 octobre dernier : il a déclaré cette différence de traitement inconstitutionnelle car méconnaissant les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Il a donc annulé l’intégralité de la taxe avec effet rétroactif, ce qui conduit à une facture de 10 milliards d’euros pour l’État, en tenant compte des intérêts moratoires dont le montant s’élève à 1 milliard d’euros environ ». Lors de la discussion de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2018, le ministre de l’Économie et des Finances a en effet indiqué que le montant que l’État devrait rembourser s’élevait à près de 10 milliards d’euros, concentrés sur l’année 2018, et décomposés de la manière suivante : 7,365 milliards d’euros de demandes de restitutions, dont 2,5 milliards devant le tribunal administratif de Montreuil ; 1,37 milliard d’euros au titre du reliquat potentiel estimé par l’administration fiscale et 0,924 milliard d’euros au titre des intérêts moratoires.