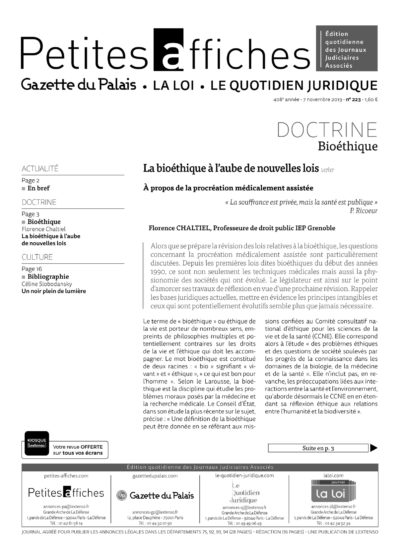La bioéthique à l’aube de nouvelles lois
Alors que se prépare la révision des lois relatives à la bioéthique, les questions concernant la procréation médicalement assistée sont particulièrement discutées. Depuis les premières lois dites bioéthiques du début des années 1990, ce sont non seulement les techniques médicales mais aussi la physionomie des sociétés qui ont évolué. Le législateur est ainsi sur le point d’amorcer ses travaux de réflexion en vue d’une prochaine révision. Rappeler les bases juridiques actuelles, mettre en évidence les principes intangibles et ceux qui sont potentiellement évolutifs semble plus que jamais nécessaire.
Le terme de « bioéthique » ou éthique de la vie est porteur de nombreux sens, empreints de philosophies multiples et potentiellement contraires sur les droits de la vie et l’éthique qui doit les accompagner. Le mot bioéthique est constitué de deux racines : « bio » signifiant « vivant » et « éthique », « ce qui est bon pour l’homme ». Selon le Larousse, la bioéthique est la discipline qui étudie les problèmes moraux posés par la médecine et la recherche médicale. Le Conseil d’État, dans son étude la plus récente sur le sujet1, précise : « Une définition de la bioéthique peut être donnée en se référant aux missions confiées au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)2. Elle correspond alors à l’étude « des problèmes éthiques et des questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé ». Elle n’inclut pas, en revanche, les préoccupations liées aux interactions entre la santé et l’environnement, qu’aborde désormais le CCNE en en étendant sa réflexion éthique aux relations entre l’humanité et la biodiversité »3.
Les débats de ce début de XXIe siècle sont sans commune mesure avec ceux des débuts des réflexions sur les droits de la vie. Dans les années 1970, avec la technique de congélation du sperme, apparaissent en France les centres d’études et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS). Ces centres organisent le don de spermatozoïdes selon les règles éthiques d’anonymat et de gratuité. En 1982, naît Amandine, premier bébé français né après une fécondation in vitro. En 1983, après les Assises de la recherche, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) est créé. On considère que la bioéthique concerne la médecine et la recherche utilisant des parties du corps humain. Elle vise à définir les limites de l’intervention de la médecine sur le corps humain en garantissant le respect de la dignité de la personne et a pour objectif d’éviter toute forme d’exploitation dérivée de la médecine (trafic d’organes, clonage humain…). À l’échelle mondiale, il existe un Comité international de la bioéthique qui est une branche de l’Unesco. Il prend en compte les progrès permanents de la médecine et les enjeux éthiques et juridiques des recherches dans le secteur des sciences de la vie. En France, le CCNE publie régulièrement des avis sur les questions de bioéthique. Il a d’ailleurs émis plusieurs avis et recommandations en vue de la révision des lois bioéthique et précisément de la PMA. Celle-ci a déjà de nombreuses bases juridiques (I) que la révision annoncée des lois de bioéthique devrait modifier de manière substantielle (II).
I – Les bases juridiques de la procréation médicalement assistée
Les techniques médicales en matière de procréation ont permis à de nombreux couples ne parvenant pas à avoir des enfants naturellement de pouvoir donner la vie. Ces formidables avancées techniques ont commencé à être encadrées par des lois, dites lois Bioéthique, à partir du début des années 1990. Il a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.
La législation relative à la PMA est fixée par les lois Bioéthique du 29 juillet 1994.Depuis, les lois Bioéthique ont connu plusieurs modifications, à la fois sur fond de sophistications toujours accrues des techniques et sur fond de débat sociétal plus ou moins apaisé. Aujourd’hui, 25 ans après les premières lois, l’état du droit français a évolué, sur des questions aussi fondamentales que la conception du couple, mais plus généralement de la famille, de l’accès aux origines. Aussi, les enjeux de la révision des lois Bioéthique sont majeurs. D’ailleurs, plusieurs autorités ont déjà pu remettre des études et avis sur le sujet.
Ainsi, en juillet 2018, le Conseil d’État4 a rendu publique une étude approfondie sur les questions bioéthiques, allant au-delà des seuls sujets de procréation. Le Comité consultatif national d’éthique a, lui aussi, rendu public un avis à l’automne 20185.En effet, par courrier en date du 6 décembre 2017, le Premier ministre a confié au Conseil d’État la réalisation d’une étude sur le cadrage juridique préalable au réexamen de la loi relative à la bioéthique. L’étude a été adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’État le 28 juin 2018 sous le titre « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? ». L’avis 129,« Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019 » a été adopté à la suite du Comité plénier du 18 septembre 2018 après 11 réunions tenues entre juin et septembre 2018. Ainsi, depuis les premières lois relatives à la bioéthique (A), les techniques utilisées pour les personnes concernées ont singulièrement évolué (B).
A – Les premières lois relatives à la bioéthique
1994, 2011 et 2013 sont les trois dates marquant l’adoption de lois relatives à la bioéthique. Trois lois datent du 29 juillet 19946. Les dispositions sont relatives au respect du corps humain. La loi affirme solennellement trois fondements éthiques essentiels : l’inviolabilité du corps humain, l’impossibilité pour le corps humain d’être l’objet d’un droit patrimonial évaluable en argent, et l’obligation du consentement.
D’autres dispositions des lois de 1994 sont relatives au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps, à l’assistance médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal. Les principes énoncés sont ceux du consentement préalable ou présumé et révocable à tout moment, de la gratuité, de l’anonymat, et du respect des règles de sécurité sanitaire.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi7 et avait déjà pu dresser un cadre de jurisprudence constitutionnelle de la bioéthique. Il avait ainsi affirmé que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine8.
Le principe avait été acté de révisions législatives régulières afin de veiller à une actualisation du droit au regard des techniques disponibles et des premières applications des lois. Le délai de 5 ans a souvent été dépassé. Il faut en effet attendre 2004 pour voir une révision d’envergure des lois Bioéthique. Ainsi, la loi avait mis du temps à être adoptée, au terme de 3 ans de discussions et après une décision du Conseil constitutionnel la validant. Les principales innovations de la loi concernent la création d’une nouvelle incrimination de « crime contre l’espèce humaine » pour réprimer tout clonage reproductif, l’interdiction du clonage thérapeutique, c’est-à-dire l’utilisation du clonage de cellules dans un but thérapeutique.
En matière de recherche scientifique, la loi ouvre une brèche en admettant l’autorisation à titre dérogatoire pendant 5 ans de recherches sur l’embryon lorsqu’elles sont « susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques ». La loi porte aussi création d’une agence de la biomédecine. En matière de procréation médicalement assistée, la règle est posée de la nécessité de 2 ans de vie commune pour l’accès d’un couple à l’assistance médicale à la procréation. Le Conseil constitutionnel9 avait validé cette loi qui visait notamment à la transposition d’une directive européenne en jugeant qu’aux termes de l’article 88-1 de la constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la constitution ; qu’en l’absence d’une telle disposition, il n’appartient qu’au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur l’Union européenne10.
Cette loi n’apportait pas d’innovation majeure en matière d’aide à la procréation médicale. Il en va de même de la loi du 6 août 2013 tendant à modifier la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires11.C’est surtout la loi de 2011 qui tire les conséquences des techniques médicales en présence et comporte des évolutions au regard des personnes concernées.
B – Les personnes concernées et les techniques utilisées
En 1994, les principes relatifs aux techniques et aux personnes sont ainsi posés. L’article L. 152-1 d’alors, du Code de la santé publique, définit l’assistance médicale à la procréation en faisant référence aux pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi qu’à toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. L’article L. 152-2 dispose alors que cette assistance médicale, destinée à répondre à la demande parentale d’un couple, a pour objet soit de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué, soit d’éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité. Ce même article impose que l’homme et la femme formant le couple soient vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins 2 ans, et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. De plus, l’article L. 152-3 prévoit à ce moment-là, que compte tenu de l’état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons dans l’intention de réaliser leur demande parentale dans un délai de 5 ans et qu’ils sont alors consultés chaque année pendant 5 ans sur le point de savoir s’ils maintiennent leur demande parentale.
La loi de 1994 pose aussi la règle générale selon laquelle un embryon ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des deux membres du couple, même si l’article L. 152-4 dispose qu’à titre exceptionnel les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple, tandis que l’article L. 152-5 en fixe les conditions, à savoir que ce dernier couple réponde aux exigences formulées par l’article L. 152-2 et qu’il ne puisse bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sans recours à un « tiers donneur ».
La loi organise une procédure soumettant l’accueil de l’embryon à une décision de l’autorité judiciaire, avec le principe selon lequel le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.
L’article L. 152-6 souligne alors que l’assistance médicale à la procréation avec « tiers donneur » ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l’intérieur du couple ne peut aboutir. Selon l’article L. 152-7 : « Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles » et l’article L. 152-8 dispose que la conception in vitro d’embryons humains à des fins d’étude, de recherche ou d’expérimentation est interdite de même que toute expérimentation sur l’embryon. Il prévoit cependant qu’à titre exceptionnel, l’homme et la femme formant le couple peuvent accepter par écrit que soient menées des études sur leurs embryons, ces études doivent alors avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l’embryon et ne peuvent être entreprises qu’après avis conforme d’une commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l’article 11 de la loi insérant dans le Code de la santé publique un nouvel article L. 184-3.
L’article 10 de la loi insère au chapitre premier du titre VII du livre premier du Code civil une section IV intitulée « De la procréation médicalement assistée » comprenant deux articles nouveaux 311-19 et 311-20. L’article 311-19 dispose alors qu’en cas de procréation médicalement assistée avec « tiers donneur », aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation et qu’aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. L’article 311-20 alors inséré régit les conditions dans lesquelles les époux et concubins demandeurs doivent préalablement donner leur consentement à un juge ou un notaire qui les informe des engagements qu’ils prennent de ce fait au regard de la filiation.
La loi de 2011, qui intervient 17 ans après les premières lois de 1994, est une étape essentielle dans la conception de la PMA, tirant à la fois les conséquences des évolutions techniques en réaffirmant les grands principes et tenant compte des évolutions sociétales vers un changement de la notion de couple marié.
Plusieurs dispositions l’illustrent clairement. Le titre VI est consacré à la procréation médicalement assistée. En premier lieu, l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique est modifié afin de mettre à jour la définition de la PMA. Selon cet article, tel que modifié par la loi de 2011 :« L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du Code civil, l’efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l’enfant à naître.
L’Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la Santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d’inscription des procédés sur cette liste.
Toute technique visant à améliorer l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l’objet, avant sa mise en œuvre, d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d’orientation. Lorsque le conseil d’orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa. La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus ».
Ces dispositions viennent ainsi apporter des éléments de définition plus précis, en tenant compte des évolutions techniques en termes de conservation des gamètes et de conservation des ovocytes.
L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, tel que modifié en 2011, devrait faire l’objet de discussions et d’évolutions dans le débat à venir fin 2019. Il réaffirme la corrélation entre la PMA et l’infertilité et la dimension pathologique, tout en adaptant la règle en la matière à l’avènement du pacte civil de solidarité. Ainsi, dans sa version issue de la loi de 2011, cet article précise que « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». À la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant » sont alors remplacés par les mots : « et consentir ».
L’article L. 2141-4 du CSP apporte des précisions sur la conservation des embryons conçus dans le cadre d’un projet parental en disposant que : « S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres d’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que : 1° Leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; 2° Leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par cet article et l’article L. 1125-1, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques ; 3° Il soit mis fin à la conservation de leurs embryons. Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de 3 mois. En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l’expiration d’un délai d’1 an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part ».
La loi du 6 août 2013 modifie la loi de bioéthique de 2011. Le texte prévoit de passer du régime d’interdiction de la recherche sur l’embryon avec dérogation à une autorisation encadrée. Les recherches pourront être menées à partir d’embryons surnuméraires conçus dans le cadre d’une procréation médicalement assistée (fécondation in vitro), ne faisant plus l’objet d’un projet parental, après information et consentement écrit du couple concerné. Le consentement du couple doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de 3 mois et peut être révoqué sans motif par les deux membres du couple ou le membre survivant tant que les recherches n’ont pas débuté. La recherche sur ces embryons est limitée à 5 ans et doit avoir pour seul objectif de permettre des progrès thérapeutiques. Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de biomédecine qui transmet sa décision, assortie de l’avis du conseil d’orientation aux ministres chargés de la Santé et de la Recherche qui, dans un délai d’un mois, peuvent conjointement demander un nouvel examen du dossier12. Cette loi n’est donc pas à visée de modification des conditions d’accès à la PMA.
Plusieurs techniques sont mises à la disposition des personnes désireuses de s’inscrire dans un protocole de procréation médicalement assistée. Il existe en effet plusieurs modalités, ainsi de l’insémination artificielle, de la fécondation in vitro ou encore de l’accueil d’embryon.
Dans le cas de la technique de l’insémination artificielle, la fécondation a lieu naturellement, à l’intérieur du corps de la femme. L’acte médical consiste à déposer les spermatozoïdes dans l’utérus, afin de faciliter la rencontre entre le spermatozoïde et l’ovule ou l’ovocyte. L’insémination artificielle peut se faire avec soit avec le sperme du conjoint soit du sperme congelé d’un donneur. Le principe est celui de la gratuité et de l’anonymat du don. Le plus souvent, la femme suit préalablement un traitement hormonal. L’insémination artificielle est réalisée par un médecin spécialisé en fertilité, sans hospitalisation.
Dans le cas de la fécondation in vitro, la fécondation a lieu en laboratoire, et non dans l’utérus de la femme. Un spermatozoïde est directement injecté dans l’ovule pour former un embryon. L’embryon est ensuite transféré dans l’utérus de la future mère. Si le nombre d’embryons obtenus est supérieur au nombre d’embryons transférés, les embryons non utilisés peuvent être conservés pour être réutilisés par la suite. La notion d’accueil d’embryon concerne des couples dont les deux membres ont un problème de stérilité ou en cas de risque de transmission d’une maladie génétique à l’enfant. L’embryon de parents donateurs anonymes est transféré dans l’utérus de la femme du couple receveur.
La loi de 2011 prévoit que : « tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux.
Ceux-ci sont organisés à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPESCT). À la suite du débat, le comité établit un rapport qu’il présente devant l’OPESCT, qui procède à son évaluation. En l’absence de projet de réforme, le comité est tenu d’organiser des états généraux de bioéthique au moins une fois tous les 5 ans ».
La loi de 2011 devait faire l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de 7 ans après son entrée en vigueur, soit en 2018. Le processus de révision est officiellement lancé avec l’ouverture par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) des États généraux de la bioéthique, le 18 janvier 201813. Le Conseil d’État a rendu publique son étude en juillet 2018, ayant été saisi fin 2017 par le gouvernement. Le projet de loi devrait être discuté durant l’été et l’automne 2019, avec de nombreux enjeux en termes de société et de dessin de la famille de demain.
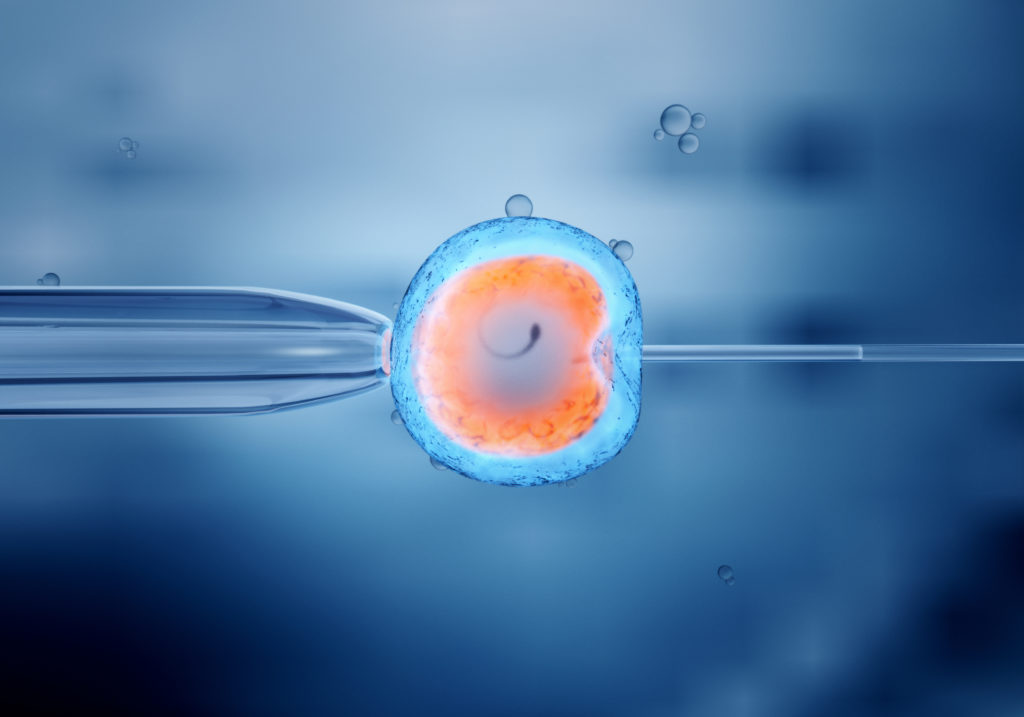
II – Les perspectives d’évolution de la procréation médicalement assistée
Le Conseil d’État, dans son étude rendue publique en juillet 2018, posait d’emblée trois principes à respecter dans la révision à venir des lois bioéthiques : dignité, liberté, solidarité. Outre le fait que, comme nous le dirons plus bas, ces trois principes ne se situent pas nécessairement sur le même plan, ils doivent sans doute, chacun d’entre eux, être davantage caractérisés : la dignité de qui ? La liberté de qui ? Ne s’agit-il pas plutôt de libertés à équilibrer avec des droits d’autrui et le devoir de tous ? Quant à la solidarité enfin, elle inclut sans nul doute une dimension financière de prise en charge par la sécurité sociale, mais sans doute davantage encore. Le CCNE, quant à lui, dès les premières pages de son avis pose une question essentielle : comment veiller à ce que la défense de libertés individuelles ne morcelle pas la société en une seule juxtaposition de points de vue et de pratiques inconciliables14 ? La question centrale, en matière de PMA, que le législateur aura à trancher est celle de l’extension des bénéficiaires potentiels des techniques médicales (A). Cette question, pour être tranchée, doit prendre en compte les principes, certains étant à ce jour intangibles, d’autres pouvant être estimés évolutifs (B).
A – L’extension possible des bénéficiaires des techniques médicales
Dans sa Lettre à une mère15, René Frydman, écrivait : « Comment dites-vous déjà ? Mari ? Concubin ? Compagnon ? Peu importe, le désir d’enfant ne s’embarrasse plus de considérations religieuses ou administratives. Il est venu au premier rendez-vous, revenu pour la première échographie. J’essaie de lui laisser sa place. Mais je le connais moins, je le vois moins. Je ne le touche pas. Et plus la difficulté est grande pour une femme à être enceinte, plus le médecin prend de la place, tandis que la sienne est mise à l’épreuve. Les enfants de la médecine naissent comme les autres de la volonté, de l’amour d’un homme et d’une femme. Je ne fais, moi, qu’aider le désir à se nicher ». Les termes de cette citation, si la loi ouvrait la voie à la PMA pour une femme seule ou un couple de femme, deviendraient ainsi en partie obsolètes. Une double dissociation est ainsi envisagée dans les discussions en cours, d’une part la dissociation entre la notion de pathologie et la PMA (1), d’autre part la dissociation entre la notion de couple hétérosexuel et la PMA (2).
1 – La dissociation possible entre pathologie et PMA
Dans le droit actuel, un lien existe entre la pathologie et la PMA. Le Code de la santé le spécifie nettement. L’aide médicale à la procréation est destinée aux couples ayant des difficultés à donner naturellement naissance à un enfant. La technique médicale s’adresse aux couples hétérosexuels, qu’ils soient mariés, pacsés ou en concubinage, en âge de procréer et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : soit le couple ou l’un des membres présente une stérilité, ou infertilité, pathologique médicalement constatée, après un bilan d’infertilité ; soit l’un des membres du couple est porteur d’une maladie grave, susceptible d’être transmise au conjoint ou à l’enfant. En somme, seul un couple, constitué d’un homme et d’une femme peut s’inscrire dans le processus d’assistance médicale à la procréation, avec les techniques décrites plus haut.
La demande est croissante de femmes seules ou de couples de femmes, de pouvoir accéder à la PMA. Derrière cette proposition se trouvent deux dimensions. L’une des dimensions concerne la possibilité, pour toutes les femmes, de conserver ses gamètes en l’absence de projet parental immédiat et afin d’éviter de ne plus être suffisamment fertile le moment venu. Il faut bien souligner sur ce point que les possibilités offertes dans d’autres pays ont conduit, de fait, de nombreuses femmes françaises à avoir recours au procédé de conservation des ovocytes, hors contexte pathologique. C’est dans ce cadre de réflexion que l’Académie des sciences s’était prononcée, dès 2017, en faveur d’une base juridique française à la conservation des gamètes hors contexte pathologique16. L’avis du Comité consultatif national d’éthique du 15 juin 2017, évoquait deux à trois mille femmes françaises chaque année, se rendant à l’étranger afin de bénéficier des techniques offertes dans d’autres pays.
L’autre dimension concerne la possibilité pour une femme seule ou en couple avec une autre femme, de bénéficier d’un don de sperme afin de mener une grossesse. Ces dimensions d’évolution profonde de la PMA comportent des incidences différentes sur la notion de parentalité et de famille et se fondent, pour la deuxième hypothèse, sur la possible dissociation entre le couple hétérosexuel et la PMA.
2 – La dissociation possible entre couple hétérosexuel et PMA
S’agissant de l’accès des femmes seules à la PMA, une telle évolution porterait une double dissociation ; d’une part dissociation entre la PMA et la pathologie, d’autre part dissociation entre le couple constitué d’un homme et d’une femme et la filiation. S’agissant de la possibilité de conserver ses ovocytes pour plus tard, elle apparaît comme ce que l’on pourrait appeler une manière de contourner l’horloge biologique. Le point commun avec le cas précédent est la distorsion entre pathologie et PMA, sachant que la législation actuelle permet effectivement la congélation des ovocytes dans des cas de pathologie déterminés. Ce sont ainsi potentiellement de profondes mutations qui s’annoncent et elles vont bien au-delà des dimensions techniques. C’est bien le cœur de la bioéthique qui est concerné.
Sur ces éléments centraux de la discussion, il existe des faits et des questions. S’agissant des faits, le rétrécissement des territoires, par les moyens de communication, de connaissance des législations d’un État à un autre, les moyens de transport, font que l’interdiction nationale est largement dépassée par les accès aux techniques hors cadre national. Dit autrement, une femme seule – qu’elle soit en couple avec une autre femme ou pas – peut, techniquement, se rendre dans un État dont la législation est autre, pour en revenir enceinte, quelle que soit la technique utilisée. C’est un exemple paroxystique de la dialectique du fait et du droit.
Ce fait ne saurait éluder les nombreuses questions. Ce fait doit-il conduire le législateur à changer le droit ? En soi, la réponse n’est pas évidente. En droit, le Conseil d’État, comme le Comité consultatif national d’éthique, sont d’accord pour dire que le droit français n’interdit pas une extension de la PMA aux femmes seules – ou aux couples de femmes.
Ainsi selon le Conseil d’État : « Aucun principe juridique n’impose en effet l’extension de l’accès à l’AMP. Ni le fait que l’adoption soit ouverte aux couples de femmes et aux personnes seules, ni le principe d’égalité, ni le droit au respect de la vie privée, ni la liberté de procréer, pas plus que l’interdiction des discriminations, ne rendent nécessaire l’ouverture d’accès à l’AMP17. Il souligne, dans le même temps, que si rien ne semble interdire cette évolution, rien ne l’oblige non plus »18.
La Cour européenne des droits de l’Homme a également eu l’occasion d’écarter tout impératif juridique d’extension de la PMA. Dans un arrêt du 15 mars 2012, elle juge en effet que : « (…) si le droit français ne prévoit l’accès à ce dispositif [IAD] que pour les couples hétérosexuels, cet accès est également subordonné à l’existence d’un but thérapeutique, visant notamment à remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement constaté ou à éviter la transmission d’une maladie grave (…). Ainsi, pour l’essentiel, l’IAD n’est autorisée en France qu’au profit des couples hétérosexuels infertiles, situation qui n’est pas comparable à celle des requérantes. Il s’ensuit, pour la Cour, que la législation française concernant l’IAD ne peut être considérée comme étant à l’origine d’une différence de traitement dont les requérantes seraient victimes19 ».
Si le Comité consultation national d’éthique ne soulève pas non plus d’obstacle constitutionnel, il précise que : « La relation de l’enfant à ses origines et à sa filiation peut également se construire comme dans toute situation familiale, en soulignant cependant l’importance pour l’enfant que la vérité sur la réalité de son origine lui soit révélée le plus tôt possible, ainsi que l’importance de tenir compte des repères sexués, symboliques et sociaux, au-delà du couple de femmes ou de la femme seule ». L’on sent ici l’importance du droit de l’enfant, qui doit impérativement être pris en considération, au cœur des obstacles que les évolutions de la bioéthique doivent prendre en compte. Il existe en effet, des obstacles juridiques aux évolutions.
B – Les obstacles juridiques entre principes intangibles et principes évolutifs
À travers l’expression « obstacles juridiques », l’on envisage le droit au sens large du terme. Certes, il s’agit du droit positif applicable, mais, justement parce que le droit est en cours d’évolution, ce sont les principes éthiques de la société française, ici et maintenant, qui guideront le législateur sous le contrôle du juge constitutionnel, qui aura, aussi, à veiller au respect des principes constitutionnels par la loi. Si certains principes peuvent être, aujourd’hui, considérés comme intangibles, certains sont néanmoins sujets à interprétation, appréciation modulée en fonction d’autres principes, tandis que d’autres peuvent évoluer en fonction de la loi, expression de la volonté générale. C’est au cœur de l’humain, de sa conception et de sa protection que devra œuvrer le législateur, éclairé par les techniques médicales applicables.
Dans son étude rendue publique à l’été 2018, comme il a été mentionné plus haut, le Conseil d’État avait mis en évidence trois principes qui sont la dignité, la liberté, et la solidarité (1). Si ces principes semblent effectivement essentiels à la réflexion, ils n’apparaissent pas sur un même plan d’analyse et méritent sans doute d’être qualifiés ou précisés. On relèvera que le Conseil ne mentionne pas le principe d’égalité en l’espèce. Celui-ci ne manquera cependant pas d’être invoqué, tout comme celui de l’accès aux origines (2). La mise en équation de ces principes n’épuise pas le champ des interrogations que le législateur devra affronter (3).
1 – L’équation entre les principes de dignité, de liberté et de solidarité
Chacun de ces principes appelle d’abord quelques précisions. Le principe de dignité est un principe constitutionnel qui doit conduire à une protection des individus, adultes et enfants. Il s’agit d’un principe relativement nouveau, issu de la jurisprudence européenne et nationale. Dans sa décision du 27 juillet 199420, le Conseil constitutionnel a consacré le caractère constitutionnel du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Il a considéré que la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de la vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine tendaient à en assurer le respect.
Le principe de liberté est aussi, sous la dénomination de liberté individuelle, un principe constitutionnel. Selon l’article 66 de la constitution : « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
Cependant, ce principe, lui aussi doit être précisé et envisage sous l’angle de la liberté de la femme adulte mais aussi sous l’angle de la liberté de l’enfant, et plus généralement, des droits de l’enfant. La convention internationale des droits de l’enfant est un traité international adopté par l’Assemblée générale des Nations unies, le 20 novembre 1989. La convention énonce les droits fondamentaux des enfants. Elle est normalement contraignante pour les 195 États qui l’ont ratifiée. Sa bonne application est contrôlée par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies. Son article 3 stipule que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité ». On soulignera aussi que l’article L. 2141-10 du Code de la santé publique prévoit la possibilité de différer la mise en œuvre de l’AMP « dans l’intérêt de l’enfant à naître ».
Enfin le principe de solidarité est mentionné essentiellement dans l’objectif de préconiser une prise en charge de l’extension de l’AMP par la solidarité nationale. Sur ce point, si la décision semble acquise, on soulignera que les États ayant déjà une législation plus libérale en matière de PMA n’optent pas tous pour cette conception du principe de solidarité. Ainsi par exemple, le droit israélien ne prévoit la prise en charge que dans les cas de pathologie, les conservations d’ovocytes relevant d’un choix personnel, indépendamment de toute pathologie, sont autorisées mais à la charge des intéressés21. La notion de solidarité implique aussi le principe du don de gamète gratuit et anonyme, sachant que ce principe pourrait être questionné.
À l’aune de ces principes, les obstacles sont juridiques pour l’essentiel, même si certaines questions techniques ou pratiques ne doivent pas être éludées. Ainsi le CCNE considère comme essentiel d’anticiper les conséquences, dans un sens comme dans l’autre (de nouveaux types de donneurs pouvant aussi apparaître à cette occasion) de l’ouverture de l’AMP sur la capacité de la France à répondre à cette nouvelle demande en matière de don de sperme. Cette notion de don s’inscrit effectivement dans le principe de solidarité.
Il existe évidemment un lien entre cet aspect technique et les principes. Les principes actuellement jugés intangibles sont ceux en effet relatifs à la non-marchandisation du corps humain. Parmi ces principes se trouvent ceux déjà cités de la gratuité et de l’anonymat du don. Or les risques soulignés par le CCNE, en termes de manque de sperme pourraient indirectement conduire à une évolution du principe de gratuité. La question sera alors de savoir si ce principe est intangible ou pas. On peut ainsi lire dans un rapport du Sénat que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial »22, le don est admis, dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, dès lors qu’« aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte des produits de celui-ci23 ». Le corps humain se trouve ainsi exclu de la sphère marchande, mais pas de tout commerce juridique ». Parmi les questions hautement sensibles se trouvent celles relatives à l’accès aux origines et celles relatives au principe d’égalité.
2 – La mise en perspective des principes d’égalité et d’accès aux origines par les réformes envisagées
S’agissant de l’accès aux origines, il existe déjà une législation, qui avait dû évoluer, notamment à la faveur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. La loi de 2002 concerne essentiellement les personnes ayant fait l’objet d’une adoption. La loi du 22 janvier 2002, relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État a réformé la procédure d’accouchement secret, et a créé un Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), placé auprès du ministre chargé des Affaires sociales. Il a pour mission de traiter, en lien avec ses correspondants départementaux, les demandes d’accès aux origines, de rechercher le parent de naissance pour lui demander s’il accepte de lever le secret.
Concernant les enfants nés grâce aux techniques de procréation médicalement assistée, étant donné le principe d’anonymat du don, la question, jusqu’à présent ne pouvait pas se poser. Dit autrement, il revenait aux parents d’informer ou non leur enfant de l’usage de la PMA le cas échéant. Avec les évolutions envisagées, l’ouverture de la PMA aux femmes seules ou couples de femmes, les possibles changements du droit en matière d’anonymat du don, la question de l’accès aux origines ne manquera pas de se poser. Se retrouve ici la question du droit de l’enfant. Faut-il inscrire le droit de l’enfant de connaitre ses origines ? Et si oui, jusqu’à quel point ? C’est-à-dire : pourrait-il avoir accès à l’identité du donneur, dans quel délai ? Le donneur pourrait-il s’opposer à la diffusion de l’information ? Ce sont des questions éthiques très difficiles à trancher. Car nous sommes face à deux libertés : les droits de l’enfant dont la définition demandera à être repensée à l’aune de la nouvelle loi, d’un côté, et la liberté d’anonymat du donneur.
S’agissant du principe d’égalité, il est sans doute encore plus difficile à apprécier dans le contexte à la fois de la révision de la loi Bioéthique en ce qui concerna la PMA mais aussi dans un contexte sociétal que l’on pourrait qualifier de « post mariage pour tous ». La conception du couple a profondément évolué. Il en résulte implicitement mais nécessairement des évolutions des conceptions de la famille. Avec l’extension de la PMA à toutes les femmes, les risques d’ouverture de boîtes de Pandore ne manquent pas. Plusieurs sujets sont liés et ils devront être précisés par le législateur, sous le contrôle du juge constitutionnel.
En premier lieu, il est certes essentiel de rappeler que le principe d’égalité en France est un principe qui n’est pas absolu. Depuis la jurisprudence des années 1970, du Conseil d’État, la notion d’égalité catégorielle est bien connue. Cette base étant rappelée, il convient de distinguer les principes réputés actuellement intangibles, des faits existants et enfin des arguments « égalitaires » qui pourraient arriver dans les débats. Il faut néanmoins rappeler que le Conseil constitutionnel a admis que les règles du droit de la famille fondent une différence de traitement sur une différence de situation liée à l’altérité des sexes24. Il juge alors « que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du préambule de la constitution de 1946 qui dispose : “La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement” ; que le dernier alinéa de l’article 75 et l’article 144 du Code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l’article 515-8 de ce code ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants ; que le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe ; que, par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale25 ». Il précise encore : « que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; qu’en maintenant le principe selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui attribue l’article 34 de la constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d’un homme et d’une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation »26.
On soulignera cependant que cette décision portait sur une tentative de faire juger inconstitutionnelle l’ancienne version du droit du mariage qui ne l’autorisait que pour un homme et une femme. Or la législation a pu évoluer sans obstacle constitutionnel27. À propos de la loi ouvrant le mariage entre personnes de même sexe, le Conseil constitutionnel juge alors que « si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu’à la loi déférée, regardé le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, cette règle qui n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l’organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du préambule de 1946 ; qu’en outre, doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait « naturellement » l’union d’un homme et d’une femme »28. On mesure dès lors ici la profondeur de la notion de loi comme expression de la volonté générale.
Les principes actuellement réputés intangibles sont ceux de l’absence de marchandisation du corps humain, et, partant, l’interdiction de la gestation pour autrui, ou, dit encore autrement, l’interdiction des mères porteuses. Pourtant, les faits existants, que l’on ne peut nier ni ignorer sont l’arrivée sur le territoire français, et dans des couples, hétérosexuels ou homosexuels, constitués de deux hommes ou de deux femmes, d’enfants nés de mères porteuses. Le droit européen a eu un impact sur ces situations et leur prise en compte par le droit. La Cour de cassation avait résumé ainsi les évolutions jurisprudentielles par son communiqué de presse. En premier lieu, en cas de GPA réalisée à l’étranger, l’acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, qui n’a pas accouché. Précisément, la cour indique que l’article 47 du Code civil ne permet de transcrire à l’état civil français que ceux des actes étrangers dont les énonciations sont conformes à la réalité : il est donc impossible de transcrire un acte faisant mention d’une mère qui n’est pas la femme ayant accouché.
En revanche, la désignation du père doit être transcrite si l’acte étranger n’est pas falsifié et la réalité biologique de la paternité n’est pas contestée, selon les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de cassation.
Au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des enfants garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de cassation rappelle d’abord que la prohibition de la GPA par la loi française poursuit un but légitime de protection des enfants et des mères porteuses, ensuite que la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, dès lors que les autorités françaises n’empêchent pas ce dernier de vivre en famille, qu’un certificat de nationalité française lui est délivré et qu’il existe une possibilité d’adoption par l’épouse ou l’époux du père.
En deuxième lieu, la Cour de cassation juge qu’une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père »29. Sur ce point la Cour précise qu’elle tire les conséquences de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Ce texte a pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de procréation ; de ses arrêts du 3 juillet 2015, selon lesquels le recours à une GPA à l’étranger ne constitue pas, à lui seul, un obstacle à la transcription de la filiation paternelle. Il appartient toutefois au juge de vérifier que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cette jurisprudence tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Après les affaires dites Menneson et Labassée de 2014, la France a en effet fait évoluer sa jurisprudence. Le droit français a posé, d’abord par sa jurisprudence depuis 1991 et par des arrêts ultérieurs, la nullité absolue des contrats de mère porteuse, puis par la loi, à travers l’article 16-7 du Code civil. Cette nullité absolue interdit aux français qui y ont néanmoins recours de demander à l’État français de transcrire une filiation de l’enfant par rapport à eux, que le contrat se déroule sous l’empire du droit français ou sous l’empire d’un droit étranger.
C’est pourquoi deux couples se sont heurtés à un tel refus, après avoir obtenu un enfant grâce à un tel contrat dit de « gestation pour autrui », le fait que ce contrat se soit déroulé à l’étranger, dans les deux espèces aux États-Unis ne change pas le caractère frauduleux du processus et la violation à l’ordre public international qu’il constitue.
Les couples ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme contre la France sur le fondement de l’article 8 de la convention, qui pose le droit pour chacun de voir respecter sa vie privée, affirmant que leur vie privée était violée, ainsi que celle de l’enfant.
Les deux arrêts de section ont condamné la France, estimant que le droit à la vie privée de l’enfant avait été méconnu, en ce qu’il comprend un « droit à l’identité », lequel implique le droit de voir retranscrit sur l’état civil français son lien de filiation à l’égard de celui-ci avec lequel il a un « lien biologique » (le père), quand bien même le droit national interdit la convention de GPA, ce qu’il est par ailleurs légitime à faire30.
La situation de la France est donc bien celle de la prohibition au nom de l’inaliénabilité du corps humain et de la non-marchandisation du corps. Pour autant les faits, réalisés hors cadre national, et hors légalité nationale, ont conduit à des évolutions du droit national. L’interdiction de la GPA pourrait-elle être contestée dans un second temps, après extension de la PMA à toutes les femmes ?
On en arrive alors au principe d’égalité et ses invocations possibles. À ce stade des discussions et des avis autorisés tant du Conseil d’État que du Comité consultatif national d’éthique, mais aussi des engagements du président de la République, l’évolution majeure annoncée est le principe de l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. Les hommes ne sont pas concernés par la réforme. La première réponse d’évidence est celle de la nature. Ce sont les femmes qui portent les enfants et les techniques existantes, permettant le concours d’un tiers donneur, pour un couple hétérosexuel, seraient, dans l’hypothèse de l’adoption de la loi ouvrant la PMA pour toutes les femmes, mises à disposition des femmes, quelle que soit leur vie privée.
Cependant, passée cette première réponse d’évidence, et au regard de ce qui a été rappelé plus haut en termes de « faits », d’évolutions jurisprudentielles et de transformation de la physionomie du couple et de la famille, de nouvelles questions peuvent apparaître. Elles sont certes souvent brandies par les opposants politiques affichés à l’extension de la PMA. Elles sont brandies comme un repoussoir en arguant de ce que si la PMA est étendue à toutes les femmes, les hommes pourraient alors, au nom du principe d’égalité, revendiquer un droit de pouvoir concevoir des enfants avec les techniques possibles. Or compte tenu de la nature, décrite plus haut, un couple d’hommes ne peut accéder à la paternité, ou à la parentalité, que moyennant le concours d’une femme.
Pour autant, cet argument ne semble pas, en tout cas, à ce stade des réflexions et des avis déjà cités des autorités ayant rendu des prises de position sur le sujet, recevable. En effet, étant donnée la jurisprudence constante sur la notion d’égalité catégorielle, il semble difficile de considérer que l’extension de la PMA à toutes les femmes serait contraire au principe d’égalité. Cette affirmation est sous-tendue par plusieurs arguments. Outre celui de la nature et par conséquent de la différence évidente de situation entre la femme et l’homme, il ne saurait exister de droit à l’enfant. L’ensemble des prises de position sur ces sujets délicats l’affirment nettement. Il semble décisif de marteler cette absence juridique de droit à l’enfant et de l’envisager en relation avec les droits de l’enfant. Ce sont là des questions essentielles pour une société inscrite dans un contexte d’européanisation du droit, des fruits fondamentaux, mais aussi d’internationalisation des échanges et des mobilités accrue des personnes, par les moyens de transport mais aussi par les réseaux numériques qui abolissent potentiellement les frontières du droit. Les interrogations que le législateur devra lever apparaissent ainsi nombreuses.
3 – Le législateur face au défi de questions bioéthiques inédites
Les questions en suspens sont nombreuses. Si l’engagement du président de la République d’étendre la PMA à toutes les femmes semble recueillir l’assentiment de la majorité parlementaire en place, une série d’interrogations apparaît comme un défi que la volonté générale devra relever. Sans pouvoir être exhaustif, on relèvera la question de l’évolution de la filiation, de l’homoparentalité et in fine de la famille, ainsi que la question, peu abordée, mais ayant donné lieu à une jurisprudence, de l’insémination post mortem.
On rappellera en effet la jurisprudence du 31 mai 2016. Le Conseil d’État autorisait un transfert de sperme demandé par une ressortissante espagnole, sachant qu’en Espagne ce procédé d’insémination post mortem n’est en effet pas interdit. Toutefois, le couple vivait en France et l’homme avait fait congeler ses gamètes pour prévenir sa stérilité en cas de rémission de sa maladie. Or la loi française interdit l’insémination post mortem et l’exportation de gamètes pour des usages non conformes à la loi française. Il a donc été décidé, en regard des conditions exceptionnelles « et en l’absence de toute intention frauduleuse de la requérante (…) [que] le refus qui lui a été opposé (…) porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Si l’enfant né n’aura pas de lien avec la France, le Conseil d’État a souligné que les dispositions du Code de la santé publique qui régissent le droit français ne sont pas compatibles avec les « stipulations de la convention européenne des droits de l’Homme » car celles-ci relèvent de « la marge d’appréciation dont chaque État dispose ». Le Conseil d’État a ainsi indiqué que le refus des autorités françaises serait une « atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme31.
Le Conseil d’État avait ainsi jugé que : « Dans ces conditions et en l’absence de toute intention frauduleuse de la part de la requérante, dont l’installation en Espagne ne résulte pas de la recherche, par elle, de dispositions plus favorables à la réalisation de son projet que la loi française, mais de l’accomplissement de ce projet dans le pays où demeure sa famille qu’elle a rejointe, le refus qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions précitées du Code de la santé publique – lesquelles interdisent toute exportation de gamètes en vue d’une utilisation contraire aux règles du droit français – porte, eu égard à l’ensemble des circonstances de la présente affaire, une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il porte, ce faisant, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale32. »
S’agissant de la parentalité, les hypothèses en présence concernent essentiellement les modalités d’évolution du droit de la filiation. L’alternative entre une inscription à l’état civil des enfants nés de couples de femmes par PMA ou de l’ensemble des enfants nés grâce à la PMA a été laissée ouverte dans le projet transmis pour avis au Conseil d’État.
Jusqu’à présent, le régime de la filiation ne semblait pas devoir faire l’objet de réformes. La PMA étant réservée aux couples hétérosexuels, en cas de couple marié, la femme qui accouche est sans conteste la mère et le père bénéficie de la présomption de paternité. Si le couple n’est pas marié, le père doit procéder à une reconnaissance de l’enfant devant l’officier d’état civil. Le Code civil prévoit seulement que cette filiation ne puisse pas être contestée : ni par le père qui a consenti la PMA ni par le donneur ni par un tiers. La question ouverte est celle de savoir s’il faut prévoir une authentification juridique, devant notaire par exemple, de la naissance à venir, en cas de mise en œuvre d’une PMA. Si la réponse est positive, alors la deuxième question est celle de savoir s’il faut distinguer entre les couples hétérosexuels, dont le régime juridique quant à la filiation demeurerait inchangé, et les couples de femmes ou les femmes seules. La question de l’égalité ne manquera certes pas d’apparaître.
La notion d’homoparentalité devra aussi à l’évidence être traitée par le législateur dès lors que la PMA pour toutes les femmes serait adoptée. Il faut ici rappeler la position adoptée par la Cour de cassation dans deux avis de 201433. Elle n’estime que le recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger, par insémination artificielle avec donneur anonyme, ne fait pas obstacle à ce que l’épouse de la mère puisse adopter l’enfant ainsi conçu. La Cour de cassation écarte la solution fondée sur la fraude à la loi en matière d’insémination artificielle avec donneur anonyme pratiquée à l’étranger. En effet, en France, certes sous conditions, cette pratique médicale est autorisée : dès lors, le fait que des femmes y aient eu recours à l’étranger ne heurte aucun principe essentiel du droit français. La Cour tire ainsi les conséquences de la loi du 17 mai 2013, qui a eu pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de conception de cet enfant. La Cour rappelle cependant que, conformément à l’article 353 du Code civil et aux engagements internationaux de la France, l’adoption ne peut être prononcée que si les conditions légales sont remplies et si cette même adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.34
Les comparaisons internationales montrent une grande diversité d’approches, avec un fil conducteur autour de l’intérêt de l’enfant. Ainsi par exemple, la loi suisse sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998 limite l’accès à la PMA au nom du « bien de l’enfant » selon son article 3. En Allemagne, en Italie, à Malte, en République tchèque et en Slovénie, la PMA est strictement réservée « aux couples hétérosexuels stables pour lesquels un diagnostic d’infertilité a été diagnostiqué ». L’Espagne, le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas notamment autorisent la PMA pour les femmes seules35. Plusieurs pays comme la Suède le Danemark ou les Pays-Bas par exemple permettent un accès aux origines à travers l’accès à l’identité du donneur »36.
Ce ne sont que quelques exemples, qui témoignent d’une grande diversité en Europe quant aux modalités de la PMA. Plusieurs protagonistes, dans une PMA, sont potentiellement en présence. L’enfant à naître, qui nous semble devoir être sujet de réflexions approfondies, la femme désireuse d’avoir recours à la PMA, seule, en couple avec un homme, ou en couple avec une femme, les donneurs éventuels, selon des modalités de gratuité maintenue ou non, d’anonymat ou non – en conciliation avec le principe d’accès aux origines. Si la matière demeure nationale, la question peut se poser de la détermination d’un socle de principes communs au niveau européen. En effet, au vu des déplacements géographiques, des jurisprudences parfois forcées par les faits afin de concilier les principes juridiques et les réalités concrètes, il n’est pas inutile de se demander si le principe de subsidiarité ne commanderait pas l’édiction d’un certain nombre de bases juridiques communes de l’éthique de la PMA.
Les questions sont délicates et seule la représentation nationale, sous le contrôle du juge constitutionnel, semble désormais devoir se prononcer. Un élément essentiel est celui des droits de l’enfant. Or la frontière entre la liberté de procréer, quelle que soit sa situation personnelle, et l’absence de « droit à l’enfant » semble difficile à tracer. Dans son étude déjà citée de 2018, le Conseil d’État ne s’y trompait pas, en affirmant qu’est « ainsi revendiquée, non pas un droit à l’enfant, mais une liberté de procréer et de transmettre, en tant qu’expression de l’autonomie personnelle, au nom de l’égalité des projets parentaux37 ».
À l’automne 2018, l’ordre des médecins avait pris position sur l’extension de la PMA, en récusant toute sortie de leur rôle. « Le rôle des médecins est d’apaiser les souffrances, qu’elles soient physiques ou psychologiques. Or, le désir d’enfant est une souffrance et le médecin est là pour l’entendre », avait affirmé le docteur Jean-Marie Faroudja, alors président de la section éthique et déontologie du Conseil national de l’ordre38. Cette formule fait écho à la formule de Paul Ricoeur, mise en exergue de la présente étude. La santé physique et la santé psychique sont éminemment liées, c’est indubitable. Cependant n’est pas non plus mis en doute le fait que les évolutions envisagées de la PMA la feraient quitter de son objet initial, qui était de mimer la nature, c’est-à-dire la reproduction entre un homme et une femme.
En pratique, comme on l’a vu plus haut, cette philosophie première n’est plus exclusive, grâce aux techniques sophistiquées, aux moyens de voyager aisément dans d’autres pays aux législations autres. C’est alors la dialectique du fait et du droit qui est de nouveau à l’œuvre. Comme le souligne le Conseil d’État, faute d’études suffisamment nombreuses, d’ « un point de vue scientifique, la question de savoir si priver a priori un enfant d’une double filiation sexuée serait contraire à son intérêt reste controversée »39.Les instances consultées, dont les rapports ont été mentionnés tout au long de la présente étude, ont nettement renvoyé le législateur face à ses responsabilités, dans le respect des principes constitutionnels.
Il s’agit là, selon les termes du CCNE, d’un temps de démocratie sanitaire et de santé démocratique40. Chacun a son avis, son intime conviction, les enthousiasmes ou réticences. La représentation nationale, démocratiquement élue par le peuple, a désormais la charge de définir les conditions de la procréation médicalement assistée, et, partant, le dessin de la famille de demain.
Notes de bas de pages
-
1.
Le Premier ministre a confié au Conseil d’État la réalisation d’une étude sur le cadrage juridique préalable au réexamen de la loi relative à la bioéthique. L’étude a été adoptée le 28 juin 2018 par l’assemblée générale du Conseil d’État.
-
2.
CSP, art. L. 1412‐1, dans sa version issue de la loi L. n° 2004‐800, 6 août 2004, relative à la bioéthique.
-
3.
V. contribution du CCNE à la réflexion de la COP 21 et l’avis n° 125 du 19 mars 2017. Citée par le Conseil d’État.
-
4.
L’étude « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? » a été adoptée par l’Assemblée générale plénière du Conseil d’État du 28 juin 2018 et remise au Premier ministre le 6 juillet 2018. https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/etudes/revision-de-la-loi-de-bioethique-quelles-options-pour-demain.
-
5.
Avis 129, contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision des lois Bioéthique. Cet avis a été adopté à la suite du Comité plénier du 18 septembre 2018 après onze réunions tenues entre juin et septembre 2018.
-
6.
L. n° 94-653, 29 juill. 1994, relative au respect du corps humain ; L. n° 94-654, 29 juill. 1994, relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal : JO 30 juill. 1994, p. 11060. Il faut aussi mentionner, en matière de protection des données, la loi L. n° 94-548, 1 juill. 1994, relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi L. n° 78-17, 6 janv. 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
-
7.
Cons. const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC, loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
-
8.
Cons. const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC, loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, cons. 18.
-
9.
Cons. const., 29 juill. 2004, n° 2004-498 DC, loi relative à la bioéthique.
-
10.
Cons. const., 29 juill. 2004, n° 2004-498 DC, loi relative à la bioéthique, cons. 4.
-
11.
La loi L. n° 2011-814, 7 juill. 2011, relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
-
12.
https://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/bioethique/#art13896.
-
13.
https://www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/bioethique/#art13896.
-
14.
Avis 129, contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision des lois Bioéthique. Cet avis a été adopté à la suite du Comité plénier du 18 septembre 2018 après 11 réunions tenues entre juin et septembre 2018, p. 9.
-
15.
Frydman R., Lettre à une mère, 2005, Le Livre de poche.
-
16.
https://www.fiv.fr/rapport-favorable-academie-medecine-conservation-ovocytes/.
-
17.
https://www.fiv.fr/rapport-favorable-academie-medecine-conservation-ovocytes/, p. 49.
-
18.
https://www.fiv.fr/rapport-favorable-academie-medecine-conservation-ovocytes/, p. 49.
-
19.
CEDH, 15 mars 2012, n° 25951/07, Gas et Dubois c/ France.
-
20.
Cons. const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344.
-
21.
https://www.health.gov.il/French/Topics/fertility/ovum_preserving/Pages/ovum_preserv.aspx.
-
22.
C. civ., art. 16-7.
-
23.
C. civ., art. 16-6.
-
24.
Cons. const., 28 janv. 2011, n° 2010-92 QPC.
-
25.
Cons. const., 28 janv. 2011, n° 2010-92 QPC, cons. 8.
-
26.
Cons. const., 28 janv. 2011, n° 2010-92 QPC, cons. 9.
-
27.
Cons. const., 17 mai 2013, n° 2013-669 DC, loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
-
28.
Cons. const., 17 mai 2013, n° 2013-669 DC, cons. 21.
-
29.
https://www.courdecassation.fr/communiques_4309/gpa_realisee_37266.html.
-
30.
http://mafr.fr/fr/article/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-3/.
-
31.
CE, ass., 31 mai 2016, n° 396848.
-
32.
CE, ass., 31 mai 2016, n° 396848, pt. 11.
-
33.
Avis nos G1470006, J1470007, 22 sept. 2014 ; Avis n° 15010, 22 sept. 2014.
-
34.
Communiqué sur l’avis n° 15010, cité note précédente.
-
35.
Site internet www.touteleurope.fr.
-
36.
https://www.franceinter.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-europe/le-vrai-faux-de-l-europe-13-juin-2019.
-
37.
Étude précitée du Conseil d’État, juillet 2018, p. 49.
-
38.
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Ethique/Reformes-bioethique-role-medecine-question-2019-06-26-1201031448.
-
39.
Étude précitée du Conseil d’État, juillet 2018, p. 54, citant les travaux du CCNE du 15 juin 2017.
-
40.
Avis du CCNE du 15 juin 2017.