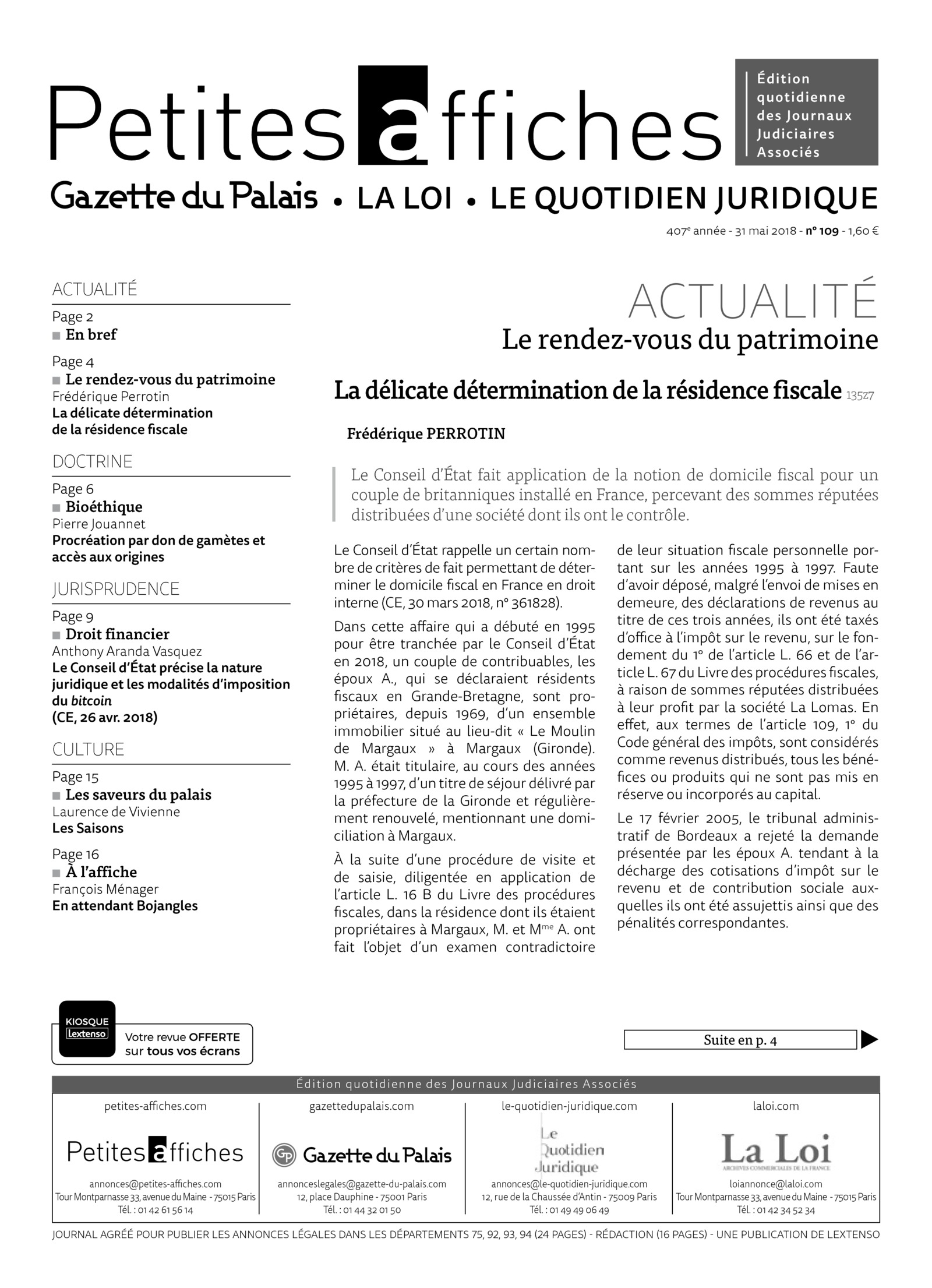Procréation par don de gamètes et accès aux origines
Par les moyens médicaux qu’elle procure, la société, reconnaît, autorise, organise des procréations impliquant un don d’ovocytes ou de spermatozoïdes. Les enfants qui naissent n’ont pas de lien biologique avec l’un ou l’autre de leurs parents et certains d’entre eux revendiquent le droit de connaître l’identité du donneur ou de la donneuse. Cette vérité biologique influence-t-elle la quête des origines et modifie-t-elle notre imaginaire collectif de la filiation ?
Pourquoi un médecin aurait-il son mot à dire sur les questions relatives à l’accès aux origines ou à la filiation qui n’ont rien de médical ? Sans doute parce qu’il a été amené depuis quelques dizaines d’années à prendre en charge des modes de procréation qui interpellent les normes traditionnelles des relations parents-enfants.
Depuis toujours, l’enfant a eu une mère et bien souvent un père mais la nature des liens unissant ces trois personnes a fait l’objet d’interprétations variées au fil du temps et des cultures. Si de tout temps, des hommes et des femmes confrontés à des procréations impossibles ont su trouver des moyens pour devenir parents malgré tout, ces moyens et les choix qui les justifiaient appartenaient avant tout à l’intimité de leur couple. L’événement récent est l’intervention de la société qui, par les moyens médicaux qu’elle procure, reconnaît, autorise, organise ces procréations différentes impliquant un don d’ovocytes ou un don de spermatozoïdes. Il est donc légitime que la société s’interroge sur les conséquences de son intervention notamment quand elle risque de bousculer ses propres systèmes normatifs.
L’autre nouveauté est la possibilité de lever désormais toutes les incertitudes concernant la dimension biologique de la filiation notamment paternelle. Si la grossesse et l’accouchement fondaient de manière inévitable le rôle de la mère dans la procréation, le rôle du père pouvait toujours garder une part d’interrogation, voire de mystère. Ce n’est désormais plus le cas puisqu’un simple prélèvement de quelques cellules buccales adressé à un laboratoire proposant ses services sur internet permet de savoir ce qui unit ou ce qui sépare biologiquement les uns et les autres.
Cette médicalisation des procréations différentes, cette vérité biologique influencent-elles la quête des origines, modifient-elles notre imaginaire collectif de la filiation ? Il est tentant de penser que la science permet d’aborder la question de la procréation avec plus d’objectivité. En réalité, c’est peu probable car la réflexion collective semble parfois entravée par des présupposés dont la puissante séduction reste implicite. Actuellement, le rôle attribué aux gènes dans la construction de l’identité, donc dans des liens de filiation que l’on croit fondés scientifiquement, est aussi et en même temps l’objet d’une croyance. La perception culturelle du monde de la science et des technologies ne joue-t-elle pas un rôle déterminant dans le débat sur la sexualité, la procréation et la construction sociale de l’image de la personne ?
Le recours à un tiers pour réaliser un projet d’enfant autrement impossible n’est pas récent. Cependant, la médicalisation de la procréation par don de sperme offre une situation aussi originale qu’intéressante pour étudier la manière dont les différentes composantes participant à la filiation sont susceptibles d’interférer entre elles de manière harmonieuse ou non. En effet, la dissociation entre la dimension biologique et les autres dimensions de la paternité n’est plus le fruit d’un hasard, d’un accident ou d’un mensonge. Elle sort de l’intimité du couple pour devenir un acte social. Ce changement crée-t-il de nouvelles obligations ? Faut-il informer systématiquement l’enfant de cette partie biologique dissociée ? Si l’identité de celui ou de celle qui est à l’origine de l’élément biologique est inconnue, l’enfant sera-t-il dans l’incapacité de construire sa propre identité ?
Les questions engendrées par l’anonymat du don de sperme suscitent des débats ininterrompus au point de négliger quelquefois les questions sur la paternité et ses représentations exprimées de manière plus ou moins consciente par ceux qui sont directement concernés par ces nouvelles pratiques médicales, qu’il s’agisse des parents, des donneurs, des enfants ou des équipes médicales et psychologiques qui les accompagnent. De ce point de vue, il est particulièrement maladroit, voire inadéquat d’utiliser le terme de « père » pour désigner le donneur même si ce terme est assorti du qualificatif « biologique » ou « génétique ». Cette fonction paternelle ainsi attribuée au donneur ne peut que fragiliser la paternité de l’homme stérile. Si l’homme stérile ne peut être le géniteur de ses enfants, il peut en être l’initiateur en décidant de l’acte qui permettra sa naissance. C’est en effet le choix fait avec sa compagne qui est à l’origine de l’enfant. Cet acte fondateur est non seulement nécessaire pour que l’enfant existe mais il est irremplaçable. Sans lui, il n’y aura plus de projet donc plus d’enfant, du moins dans cette histoire-là.
Bien sûr, le spermatozoïde du donneur est aussi nécessaire mais l’homme donnant son sperme n’a pas, en principe, l’intention de créer un lien de parenté quel qu’il soit avec les enfants issus de son don. Cette distanciation est d’autant plus facile quand il est lui-même déjà père comme le prévoyait la déontologie des CECOS. Le donneur donne pour un autre couple, pour un autre homme, pour inscrire l’enfant dans une histoire qui est celle d’un autre, celle de celui pour qui la paternité est impossible naturellement. Cette distanciation est aussi marquée par le fait que les spermatozoïdes d’un donneur ne sont pas attribués spécifiquement à un couple lors de la réalisation d’une assistance médicale à la procréation. Ils peuvent être remplacés par ceux d’un autre, d’un cycle de traitement à l’autre. C’est donc un peu par hasard que tel ou tel donneur est lié à la naissance d’un enfant donné.
Déclarer que le donneur n’est pas à l’origine de l’enfant, est-ce le réduire à un simple matériau biologique ? Est-ce nier son existence ? Certainement pas, le donneur anonyme n’est pas clandestin et la profonde humanité de son geste désintéressé doit être distinguée.
Reconnaître l’homme stérile comme étant celui qui est à l’origine de l’enfant ne peut masquer, ni guérir la blessure de sa stérilité mais peut l’aider à mieux construire son rôle de père. Cette construction sera d’autant plus facile que l’homme sera considéré comme père à part entière. Le besoin d’inscrire l’enfant dans leur histoire, dans leur propre lignée généalogique est une aspiration compréhensible de tous les couples qui souhaitent devenir parents avec l’aide de gamètes donnés par un(e) autre. Chercher à valoriser ainsi une origine et un lien de parenté qui soient avant tout sociaux et affectifs, est-ce entretenir le mensonge ? Il semble au contraire qu’une parenté mieux assumée conduise plus facilement les couples à raconter à l’enfant l’histoire de sa conception.
Chercher à construire la paternité principalement autour de l’homme stérile, n’est-ce pas une illusion naïve ? À une époque où les familles recomposées sont si fréquentes, ne pourrait-on envisager que la paternité puisse être partagée entre le père social et le « père biologique » ? Pourquoi pas, mais il est peu probable que le rôle accordé au donneur se limite alors à sa seule dimension biologique. Le donneur sera en ce cas vraisemblablement choisi selon les critères les plus variés, qu’il s’agisse de son allure physique mais aussi de ses diplômes, de sa religion, de ses pratiques sportives, de ses goûts culturels, culinaires ou autres. Ces caractéristiques, telles qu’elles sont fréquemment affichées par les banques ou les services commerciaux vendant des gamètes de donneurs et de donneuses, favorisent-elles la construction de la personnalité et de l’identité des enfants ? On ne le sait pas. En revanche, on sait qu’il s’agit d’arguments promotionnels bien illusoires dans la mesure où la plupart de ces traits ne sont pas transmis par les gènes.
Pour beaucoup, le vécu et les demandes de l’enfant devraient être au cœur des éléments déterminant le choix des modalités des procréations médicalisées. L’enfant n’a-t-il pas le droit de savoir d’où il vient, de savoir quel a été son mode de conception ? Peut-on lui refuser le droit de connaître l’identité de son géniteur que d’autres connaissent ? Anonymat du don de gamètes et secret sur les origines sont très souvent confondus, l’un justifierait l’autre. Il est souvent affirmé que le maintien de l’anonymat empêcherait l’enfant d’accéder à l’histoire de sa conception et serait extrêmement dommageable pour son développement. Malheureusement, on ne sait pas sur les résultats de quelles études reposent ces affirmations.
Très peu de recherches ont été menées pour évaluer le développement et les difficultés éventuelles des enfants, conçus par don de sperme ou don d’ovocytes, et pour tenter de comprendre la nature des liens de filiation établis avec les parents ainsi que la place occupée par le donneur ou la donneuse dans leur histoire. La plupart des études qui ont été faites dans le domaine proviennent de pays où le don n’est plus anonyme (États-Unis, Grande-Bretagne, Australie). Elles sont très partielles car elles portent le plus souvent sur un faible nombre de personnes qui sont rarement recrutées de manière objective. De plus, si elles analysent surtout le vécu des donneurs de sperme et parfois celui des enfants, elles ne s’intéressent pratiquement jamais aux parents. Néanmoins, les résultats de ces études montrent que tout n’est pas toujours aussi simple que l’on pourrait le croire quand le don n’est pas anonyme, certains donneurs exprimant parfois le désir d’être reconnus comme le père de l’enfant. Le phénomène est particulièrement net quand les parents sont un couple de femmes mais il se manifeste aussi quand les parents sont un couple constitué d’une femme et d’un homme. Les études faites dans ces pays montrent aussi que s’il y a rencontre, les liens qui s’établissent peuvent s’élargir aux autres membres de la famille du donneur ou aux autres enfants issus du don. L’enfant s’inscrit alors clairement dans la généalogie du donneur qui n’est pas celle de ses parents.
Dans certains pays enfin, la primauté du lien biologique sur tous les autres liens unissant parents et enfants peut être parfois confortée par des décisions judiciaires. Ainsi en Grande-Bretagne, des juges ont permis à une jeune femme de faire effacer le nom de son père de son acte de naissance, d’imposer des rencontres régulières entre un donneur et un enfant contre la volonté de ce dernier, d’accorder aux parents d’un donneur le droit de voir leurs « petits enfants », etc.
Il n’y a probablement pas de modèle idéal en matière de procréation avec un tiers donneur. Le projet parental le mieux réussi sera celui assumé par les femmes et les hommes qui choisissent de devenir parents ainsi. C’est à eux que revient le devoir de raconter à l’enfant les circonstances de sa venue au monde. Leur responsabilité s’exerce au moment du choix initial mais aussi tout au long de leur vie de parents et de la vie de leurs enfants en tenant compte de leur entourage familial, amical et social. Le regard que porte la société est en effet essentiel à la réussite de l’aventure. Comme nous le rappelle Françoise Héritier, « toutes les formules que nous pensons neuves sont possibles socialement et ont été expérimentées dans des sociétés particulières. Mais pour qu’elles fonctionnent comme des institutions, il faut qu’elles soient soutenues sans ambiguïté par la loi du groupe, inscrites fermement dans la structure sociale et correspondent à l’imaginaire collectif et aux représentations de la personne et de l’identité »1.
Dans ce contexte, le rôle du médecin ne se limite pas à réaliser au mieux l’acte d’AMP qui lui est demandé. Il doit aussi accompagner les uns et les autres autant que nécessaire. Il doit donner toutes les informations médicales utiles aux intéressés. Il peut lever les inquiétudes sur les risques de rencontre consanguine. Il devrait pouvoir satisfaire la curiosité des enfants et des parents, quand elle se manifeste, en donnant des informations non identifiantes sur les caractéristiques physiques, sociales et culturelles des donneurs et des donneuses ainsi que sur leurs motivations quand elles sont requises.
Faut-il aller au-delà ? Ce n’est pas au médecin de le décider. Si la nécessité d’établir un contact entre donneurs-donneuses et enfants est reconnue, on peut imaginer que ce soit possible en confiant l’opération à un organisme indépendant comme le Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) qui pourrait s’assurer que la rencontre soit organisée avec l’accord des intéressés et en les accompagnant. Cette possibilité ne devrait pas être réservée qu’aux personnes conçues par don ayant atteint l’âge de la majorité mais devrait être aussi accessible aux enfants mineurs avec l’accord de leurs parents. Enfin, pourquoi ne pas imaginer que de futurs parents puissent choisir de réaliser leur projet parental avec un donneur ou une donneuse connu(e) d’eux et à qui il sera accordé ensuite une place du type marraine ou parrain dans la vie familiale, pourquoi pas ?
Notes de bas de pages
-
1.
Héritier-Augé F., « La cuisse de Jupiter », L’Homme 1985, n° 94, p. 5-22.