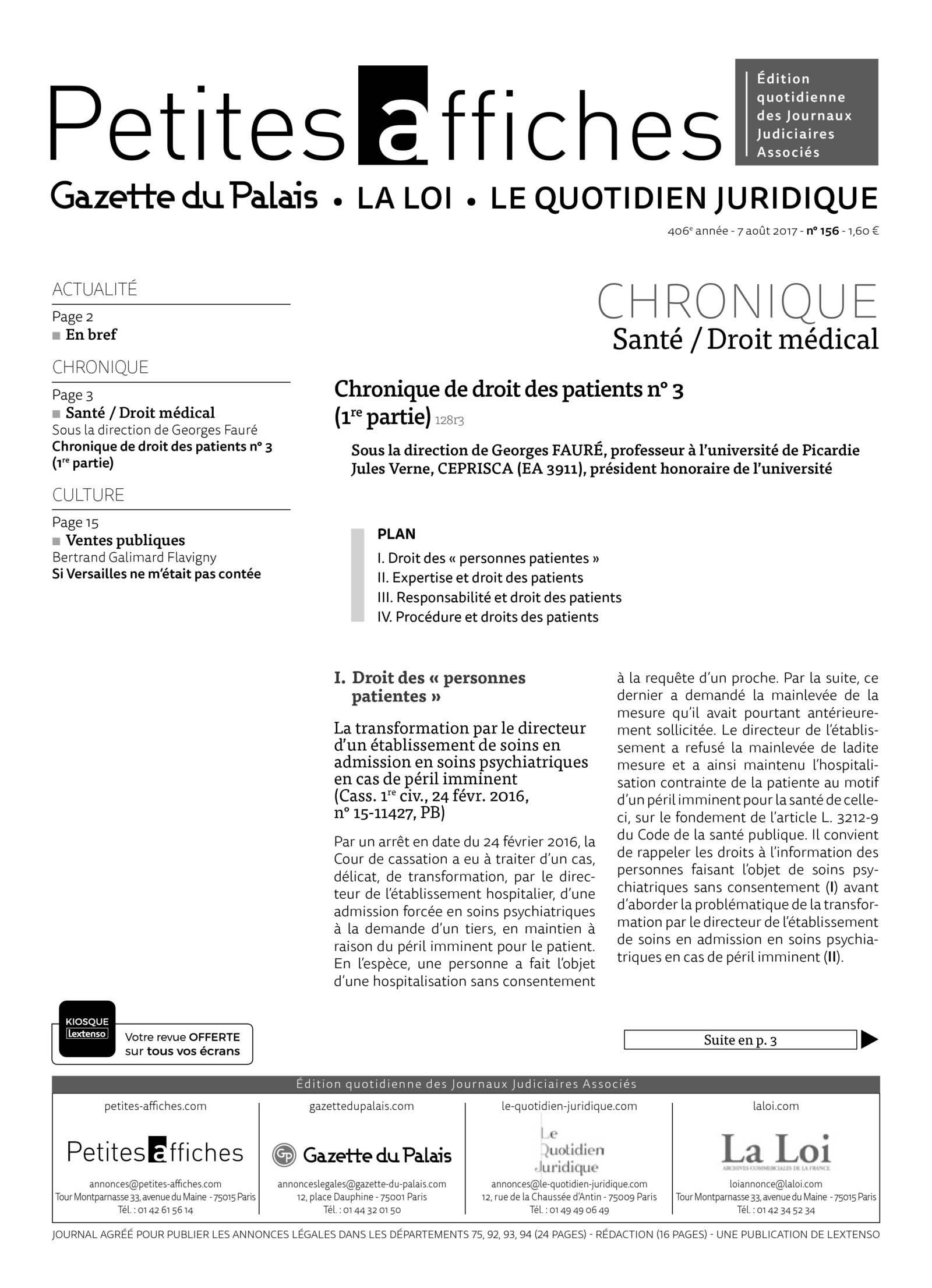Chronique de droit des patients n° 3 (1re partie)
I – Droit des « personnes patientes »
La transformation par le directeur d’un établissement de soins en admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, (Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-11427, PB)
Par un arrêt en date du 24 février 20161, la Cour de cassation a eu à traiter d’un cas, délicat, de transformation, par le directeur de l’établissement hospitalier, d’une admission forcée en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en maintien à raison du péril imminent pour le patient. En l’espèce, une personne a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement2 à la requête d’un proche. Par la suite, ce dernier a demandé la mainlevée de la mesure qu’il avait pourtant antérieurement sollicitée. Le directeur de l’établissement a refusé la mainlevée de ladite mesure et a ainsi maintenu l’hospitalisation contrainte de la patiente au motif d’un péril imminent pour la santé de celle-ci, sur le fondement de l’article L. 3212-9 du Code de la santé publique. Il convient de rappeler les droits à l’information des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement (I) avant d’aborder la problématique de la transformation par le directeur de l’établissement de soins en admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent (II).
I. Les droits à l’information des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement
La loi n° 94‐653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain3 a renforcé la protection accordée jusque-là4 aux personnes contre toute atteinte corporelle. Non seulement l’article 16 du Code civil dispose depuis que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie », mais encore l’article 16-1 énonce que « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Autrement dit, puisque tout acte est attentatoire à l’intégrité physique, chaque médecin est tenu de recueillir l’accord préalable du patient avant de lui prodiguer des soins. En outre, une information adaptée et suffisante doit être délivrée par le médecin avant d’obtenir le consentement du patient, afin que celui-ci soit éclairé5.
Il existe ici, comme pour d’autres professionnels, une hiérarchie des obligations d’information6, consacrées au nouvel article 1112-1 du Code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016. Le praticien doit ainsi progressivement monter l’échelle de l’information, en bas de laquelle il rencontre, primo, l’obligation de renseignement qui consiste à répondre simplement aux questions du cocontractant ou en l’espèce du patient. Crescendo, elle s’amplifie et se transforme, secundo, en obligation d’information, c’est-à-dire la délivrance, de manière objective, de toute information qui serait, in abstracto, salutaire au patient. Tertio, à l’étage supérieur, elle prend corps dans une obligation de conseil, qui suppose de donner un avis au malade sur l’orientation ou le comportement qui est dans son plus fort intérêt. Quarto enfin, son sommet culmine avec l’obligation de mise en garde, qui invite à déconseiller au patient de poursuivre dans la voie qu’il avait lui-même projeté7. En matière médicale toutefois, l’information est étalonnée avec la gradation de l’urgence de l’acte et la dégradation symétrique du consentement habituellement éclairé du patient.
L’urgence modifie la portée de ces obligations. Selon la rapidité avec laquelle il peut être nécessaire d’agir, la délivrance de l’information nécessaire pour obtenir le consentement est atténuée8. En dehors du cas particulier des personnes vulnérables et de leur régime de protection de justice, certaines situations pathologiques aiguës sont à l’origine d’une incapacité à obtenir un consentement éclairé. Les praticiens sont ainsi confrontés à des personnes dont l’état de conscience est altéré par une dose excessive de produits toxiques (drogues, médicaments) ou par une pathologie aiguë, et des personnes âgées atteintes des prémices de démence. Deux dispositions d’ordre général sont à concilier dans ce contexte. Le titre I du Code de déontologie médicale ayant trait aux devoirs généraux des médecins, en son article 9 (CSP, art. R. 4127-9), prévoit que « tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril, ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». L’article 36 de ce Code de déontologie (titre II relatif aux devoirs envers les patients ; CSP, art. R. 4127-36) dispose également que « si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité ». À titre dérogatoire, certains textes organisent des régimes spéciaux au sein desquels le malade peut faire l’objet de soins en dépit de son consentement. Parmi ces exceptions légales, on trouve notamment le cas des mineurs victimes de sévices ou de privation (Code de déontologie médicale, art. 43 et 44 ; CSP, art. R. 4127-43 et R. 4127-44) et celui qui nous intéresse plus particulièrement, le malade mental placé sous le régime de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent (CSP, art. L. 3211-1 et s.).
S’il est né d’une création prétorienne9, le principe du consentement éclairé du patient a fait l’objet d’une consécration légale nationale et internationale. Mais la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a distingué « les soins psychiatriques libres » et « les soins psychiatriques sans consentement », à titre d’exception10. Ces derniers sont initiés à la demande d’un tiers et en cas de péril imminent11, ou à la demande d’un représentant de l’État12, soumis au contrôle du juge de la liberté et de la détention. Les libertés individuelles de la personne demeurent même dans le cas de soins psychiatriques sans consentement13. On ne chasse plus les fous comme jadis, au Moyen-Âge, « on les éloignait à jamais en les embarquant sur des navires »14. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs invité les autorités administratives et judiciaires à veiller, plus largement, au respect de la dignité des personnes hospitalisées sans leur consentement15. L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique impose ainsi qu’une information « appropriée à son état » lui soit donnée. Néanmoins, ces mêmes dispositions retiennent que ces libertés font l’objet de restrictions adaptées, nécessaires, et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Parmi ces restrictions, se pose le problème de la transformation par le directeur de l’établissement de soins en admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
II. La transformation par le directeur de l’établissement de soins en admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent
L’arrêt de la première chambre civile en date du 24 février 2016 vient rappeler, dans la seconde branche du premier moyen, que l’intervention du juge des libertés et de la détention est prévue, d’une part, par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, lors du contrôle systématique des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées et, d’autre part, en application de l’article L. 3211-12 du même code, lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de la mesure16. Toutefois, nous précisent les magistrats du quai de l’Horloge, aucun texte ne prévoit la saisine de ce juge par le directeur de l’établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d’une transformation, par ce directeur, de l’hospitalisation du patient à la demande d’un tiers en hospitalisation au motif d’un péril imminent pour la santé de ce patient. En effet, cette mesure demeure régie par les dispositions de l’article L. 3212-9 du Code de la santé publique17.
S’agissant de l’entrée forcée en soins psychiatriques en cas de péril imminent ou sur la demande d’un tiers, le rapport de l’IGAS et de l’IGSJ18 a été influent. En effet, ses recommandations se sont retrouvées au cœur de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. L’obligation de soins est depuis, différenciée des modalités de leur réalisation.
Des modalités alternatives sont venues compléter les deux formes connues de l’hospitalisation d’office et de celle sur demande d’un tiers. Pour ce dernier cas qui nous intéresse en l’espèce, deux conditions à l’intervention d’un tiers en vue de soins sous contrainte sont prévues à l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique. L’expression du consentement doit non seulement être rendue impossible par les troubles, mais encore des soins immédiats sont indispensables, compte tenu de l’état de la personne. La forme des soins nécessaires est variable et peut aller jusqu’à l’hospitalisation complète.
Sans compter la personne de confiance prévue par l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique qui peut remplir ce rôle, l’article L. 3212-1 du même code réserve l’initiative de la demande tant aux membres de la famille du malade qu’à « une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ». Naturellement, une interprétation stricte prédomine quant à l’examen de ces conditions, tant cette procédure atteint directement la liberté de la personne19. En outre, la jurisprudence écarte les membres du personnel administratif exerçant dans l’établissement d’accueil20 en sus du personnel soignant déjà exclu par l’article L. 3212-1 précité.
Un formalisme important a été instauré pour encadrer la demande du tiers aux fins de protection renforcée des personnes hospitalisées sans consentement. À ce titre, l’article 3 du décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 a complété les dispositions de la loi du 5 juillet 2011. Ce texte, codifié à l’article R. 3212-1 du Code de la santé publique, dispose que « la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes : 1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ; 2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ; 3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ; 4° La date ; 5° La signature. Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte ». Dit autrement, la demande écrite est soumise à certaines mentions obligatoires.
La loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 a modifié les dispositions de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique ayant trait aux conditions d’établissement des deux certificats médicaux. Il est recherché l’absence de lien de parenté entre les personnes concernées. Dans sa version antérieure, cet article L. 3212-1 instaurait déjà l’obligation de joindre à la demande d’admission des soins forcés deux certificats médicaux. Il est à présent différencié entre une procédure normale d’admission forcée et une procédure exceptionnelle. Dans la procédure normale, le passage en unité d’urgence requiert la délivrance de deux certificats médicaux. Pour qu’un directeur d’un établissement puisse décider de l’hospitalisation forcée d’une personne atteinte de troubles mentaux afin de lui administrer des soins psychiatriques, l’article L. 3212-1, I, du Code de la santé publique établit deux conditions préalables. Il convient, d’une part, que ses troubles mentaux « rendent impossible son consentement » et, d’autre part, que « son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
Selon l’article L. 3212-1, II, du Code de la santé publique, deux principales situations se présentent au directeur de l’établissement pour prononcer la décision d’admission.
En premier lieu, le directeur de l’établissement a été saisi d’une demande présentée par un tiers, précisément « par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade » voire par le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par l’article R. 3212-1 du Code de la santé publique rappelé précédemment. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions préalables tenant à l’impossibilité du consentement à raison des troubles mentaux et à la nécessité impérieuse des soins immédiats. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
En second lieu, le législateur a envisagé la situation des personnes isolées. L’article L. 3212-1, II, 2°, du Code de la santé publique se réfère à l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers, si et seulement si il existe un péril imminent pour la santé du malade. Dès lors, le directeur de l’établissement est dans la possibilité d’admettre un malade sans consentement lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 3212-1, II, et qu’il existe, à la date d’admission, « un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ». L’unique certificat constate alors l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. À bref délai, d’autres certificats devront être produits, comme dans le cas d’admission sur décision du représentant de l’État. De même, le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. À ce titre, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Dans tous les cas, les certificats doivent dater de moins de quinze jours avant l’hospitalisation.
Par surimpression, une procédure exceptionnelle d’admission a été créée. À cet effet, en cas d’urgence, avec « un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade », le directeur peut, « à titre exceptionnel » est-il indiqué à l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade « au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ». Ce dernier devient alors quasiment un médecin urgentiste.
Enfin, bien que parfois difficilement dissociable de l’urgence, la notion de péril imminent pour la personne est retenue pour justifier l’opposition du directeur à une demande de levée de soins. L’on saura à présent avec plus de netteté que le Code de la santé publique prévoit l’intervention du juge des libertés et de la détention non seulement dans le cadre d’un contrôle systématique des situations des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement, aux échéances légalement fixées (CSP, art. L. 3211-12-1), mais encore d’une saisine aux fins de mainlevée de la mesure (CSP, art. L. 3211-12)21. Cependant, il ne résulte d’aucun texte que le juge des libertés et de la détention peut être saisi par le directeur de l’établissement pour statuer sur la légalité du maintien en soins sous contrainte à la suite de la transformation par lui décidée d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en hospitalisation en situation de péril imminent. C’est dans ces conditions que la requête du directeur de l’établissement psychiatrique a été déclarée, dans l’arrêt du 24 février 2016, irrecevable. Il s’agit, en définitive, d’un tempérament à la judiciarisation du contrôle de l’hospitalisation psychiatrique22. Certes, subsiste l’hypothétique contrôle administratif de la mesure de soins sans consentement, par suite d’une saisine, dite aussi alerte, de l’autorité administrative compétente (la commission départementale des soins psychiatriques notamment)23. Mais il s’est révélé que ni les moyens d’action mis à leur disposition ni les sanctions en cas d’insuffisance ou de carence dans l’exercice de leurs prérogatives ne permettent d’assurer véritablement l’effectivité et l’efficacité de ce contrôle24. À défaut, il ne reste plus qu’à trouver « des mots pour réparer des maux »25.
Rodolphe Bigot
II – Expertise et droit des patients
Les conditions d’accès à la réparation intégrale devant les CIVI au regard de la nomenclature Dintilhac
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) est une entité dépendante du tribunal de grande instance (TGI). La réparation peut être intégrale ou non, et la faute de la victime peut entraîner la réduction voire la suppression de son droit à indemnisation26. Quant à l’évaluation du montant de l’indemnisation, elle se fait par référence à la nomenclature Dintilhac27 de façon autonome au regard du droit pénal28. Pour toute victime d’une infraction, l’obtention d’une réparation intégrale de son préjudice, nécessite que les faits aient entraîné une incapacité totale de travail (ITT) égale ou supérieure à un mois ou un taux d’incapacité permanente, quel qu’il soit29. Que ce soit l’ITT ou l’incapacité permanente, ces deux notions posent des difficultés d’articulation avec le droit commun de l’indemnisation. Nous nous intéressons ici aux victimes de violences à l’origine d’un dommage corporel. Après le parcours de soins, vient le temps de l’indemnisation, qui constitue une étape essentielle pour chaque victime. Le patient blessé dans ses chairs a aussi besoin que son préjudice soit reconnu, évalué par un médecin expert et enfin indemnisé pour « se réparer ». La guérison ou la stabilisation des lésions nécessite bien sûr des soins, mais aussi une prise en charge sur le plan social et juridique.
Avant de se pencher sur les pratiques des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), il convient de rappeler les principes de la nomenclature Dintilhac30 concernant les deux postes de préjudices extrapatrimoniaux qui nous intéressent ici. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est un préjudice extrapatrimonial temporaire, traduisant l’aspect non économique de l’incapacité temporaire que subit la victime jusqu’à consolidation. La période de déficit fonctionnel temporaire (DFT) débute le jour de l’agression pour se terminer à la consolidation31. Avant la nomenclature Dintilhac, le même acronyme ITT désignait l’incapacité temporaire de travail au civil et l’incapacité totale de travail au pénal. Depuis la nomenclature Dintilhac, l’ancienne incapacité temporaire totale ou partielle a été remplacée par le déficit fonctionnel temporaire (DFT) qui traduit « l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation ».
Le DFT comprend des périodes dites de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT), et également les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP). Le DFT correspond aux périodes de privation temporaire de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique32. Il s’agit de l’ensemble des activités habituelles autres que professionnelles (personnelles, familiales et d’agrément) réalisées habituellement par la victime avant l’accident comme passer du temps en famille, rencontrer des amis, sortir, vaquer à des occupations librement33.
Dans la nomenclature Dintilhac, l’ancienne notion d’incapacité permanente partielle (IPP) est remplacée par deux préjudices permanents34, l’un patrimonial et l’autre extra patrimonial. Il s’agit des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et surtout du déficit fonctionnel permanent (DFP).
La diminution des capacités physiques résultant des lésions traumatiques est évaluée par un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) fixé à la date de consolidation, par un pourcentage de 0 à 100 %. Pour le médecin, aucun barème n’est imposé réglementairement, en droit commun, pour fixer le taux de DFP. Mais en pratique, deux barèmes sont utilisés par les médecins35.
Nous déplorons que l’adoption quasi unanime de la nomenclature Dintilhac n’ait pas, à ce jour, incité le législateur à modifier les articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale, afin d’harmoniser les notions et les rendre moins obscures. Le flou actuel laisse une grande variabilité dans la fixation. L’incapacité totale de travail (ITT) qui relève du droit pénal et est déterminante concernant les sanctions encourues pour l’agresseur, n’est pas pertinente pour indemniser les victimes. Le taux d’incapacité permanente se confond avec le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) utilisé en droit social dans le cadre des accidents de travail et des maladies professionnelles. Pourtant ITT et incapacité permanente restent des critères importants devant la CIVI (I) alors même qu’ils ne sont pas adaptés et sont surtout source de confusion pour tous les acteurs de l’indemnisation, qu’ils soient magistrats, juristes ou médecins experts et surtout pour les victimes (II).
I. Persistance des notions d’incapacité permanente et ITT devant la CIVI
La durée de l’incapacité totale de travail (ITT) permet au magistrat d’apprécier la violence subie lors d’une agression. Il ne s’agit pas d’exiger un état de dépendance totale du patient. La perte d’autonomie n’a pas à être complète pour pouvoir être qualifiée d’ITT36. Il n’existe pas d’échelle d’évaluation objective de l’ITT reconnue par tous les médecins, d’où une grande disparité dans l’appréciation de l’ITT par le corps médical, y compris au sein des unités médico-judiciaires (UMJ). La traduction du préjudice en ITT demeure marquée par une certaine subjectivité des médecins, notamment au regard des circonstances de l’infraction, de la nature de l’infraction subie (violences conjugales, conflit au travail, violence accompagnée d’un vol, violences dans le cadre d’une interpellation, violence entre détenus…) et parfois selon le degré de médiatisation de l’affaire et de l’émotion suscitée dans l’opinion publique.
La notion d’incapacité totale de travail personnel (ITTP) apparaît dans le Code Pénal de 1810 à l’article 309, mais depuis le Code pénal de 1992, entré en vigueur le 1er mars 1994, le terme « personnel » a disparu et pourtant, il est encore utilisé par certains.
L’ITT est une notion propre au droit pénal, mais n’est pas définie par le Code pénal. L’ITT est très mal nommée car l’incapacité « de travail » ne vise pas l’exercice d’une activité professionnelle, mais plus largement l’incapacité d’exercer toute activité personnelle d’autonomie. Ainsi, l’ITT peut s’appliquer aux personnes actives professionnellement mais aussi aux personnes sans emploi, aux retraités et aux enfants. Elle est fixée par le médecin confronté à une victime de violences, et sa durée détermine la nature de l’infraction (contravention ou délit) et donc la peine encourue. L’ITT ne correspond pas à la période d’arrêt de travail médicalement justifiée.
Le terme « totale » n’est pas plus adapté que le terme « travail ». L’incapacité est une impossibilité physique ou psychique de réaliser certains actes, mais qui ne doit pas être absolue. C’est la durée de la gêne réelle et globale éprouvée par la victime pour effectuer certains gestes de la vie courante et non tous les gestes de la vie courante. Elle s’étend à toute activité courante, aux efforts nécessaires à la vie de chaque jour37. L’ITT ne renvoie ainsi à aucun des termes qui la désignent – ni incapacité « de travail », ni incapacité « totale ».
L’ITT est la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable dans les actes de la vie courante (manger, dormir, se laver, s’habiller, faire ses courses, se déplacer…)38.
Dans un arrêt du 22 novembre 198239, la Cour de cassation a considéré que le fait pour la victime « de s’être livrée à quelques courses, trois jours après avoir été frappée, n’est pas incompatible avec la notion d’incapacité totale de travail ».
Dans un arrêt du 30 juin 199940, la Cour de cassation indiquait que « l’incapacité totale de travail n’interdit pas toute activité, et le fait que l’expert ait indiqué une reprise intermittente, mais cependant partielle, ne signifie pas que l’incapacité de travail ait cessé ».
En octobre 2011, la Haute autorité de santé (HAS) a établi et diffusé aux médecins, un guide de recommandations pour la pratique clinique (RPC) pour la rédaction des certificats médicaux initiaux concernant une personne victime de violences. La question de l’opportunité d’une évolution du cadre juridique de l’ITT n’a pas été abordée n’étant pas de la compétence de ce groupe de travail.
La variabilité des ITT peut aussi s’expliquer par le moment où elle est appréciée par rapport à l’infraction. L’ITT, dans les faits, est rarement fixée dans le seul contexte de la saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). L’ITT est fixée le plus souvent initialement, dans les heures ou les jours qui suivent l’infraction, par un médecin requis à cet effet. Il est alors trop tôt pour déterminer si le traumatisme psychologique subi par la victime justifiera un prolongement de l’ITT.
Soit la victime a déposé plainte rapidement et est examinée par un médecin légiste sur réquisition, dans le cadre d’une unité médico judiciaire (UMJ) d’un établissement de santé. Soit le certificat d’ITT est demandé dans l’urgence car l’auteur présumé est en garde à vue. Cette garde à vue est possible en cas de délit et non de contravention41, donc n’est possible que si l’ITT est supérieure à 8 jours en l’absence de circonstances aggravantes. L’ITT détermine, pour un certain nombre d’infractions, la qualification juridique de l’infraction et la peine encourue par l’auteur des faits. En matière de violences volontaires, la gradation des peines encourues est fonction à la fois de l’existence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes et de l’ITT subie par la victime. L’ITT sera déterminante pour la juridiction compétente42 : tribunal correctionnel pour les délits et tribunal de police pour les contraventions en l’absence de circonstances aggravantes. Le seuil de compétence du tribunal correctionnel est de 8 jours en cas de violences volontaires alors que le seuil déterminant est d’un mois devant la CIVI. Lorsqu’une victime est examinée dans les heures qui suivent l’infraction, il est difficile d’emblée de retenir une ITT supérieure à 1 mois, même en cas d’hospitalisation. La plupart des victimes ne seront pas réexaminées dans le cadre de la CIVI, et c’est l’ITT initiale qui guidera l’application de l’article 706-3 ou du 706-14 du Code de procédure pénale. Parfois le juge d’instruction sollicitera une expertise43 mais alors la majorité des missions comporte une évaluation des préjudices selon la nomenclature Dintilhac, alors même que le juge d’instruction devrait avant tout solliciter une détermination de l’ITT et rechercher une mutilation ou une infirmité permanente44 pour qualifier l’infraction.
En réquisition, le médecin fixe une ITT à l’instant T de la consultation. C’est une photographie in concreto du résultat des violences. Un état antérieur doit être décrit et sera pris en compte : ce peut être une circonstance aggravante de l’infraction (état de grossesse, personne vulnérable du fait d’une pathologie physique ou psychique). Il convient de ne pas soustraire cet état antérieur, car il faut évaluer la durée réelle de l’ITT qui peut être allongée du fait des antécédents : un traumatisme chez un patient hémophile peut avoir de lourdes conséquences, une simple « bousculade » à l’origine d’une chute peut entraîner une fracture chez un patient âgé ostéoporotique. C’est bien la durée de l’immobilisation liée à la fracture qui entraîne la durée de l’ITT. De façon provocatrice, il vaut « mieux » agresser une personne jeune en bonne santé qu’une personne âgée malade, car la durée de l’ITT sera le plus souvent plus longue chez la deuxième.
La CIVI peut ordonner la réalisation d’une expertise médicale mais, dans un souci de rapidité et de limitation des coûts45, ne le fait pas systématiquement et se prononce sur des rapports antérieurs d’expertise : sur ordonnance du juge d’instruction ou plus rarement du président de la cour d’assises46 ou plus souvent des expertises diligentées par le tribunal correctionnel47 statuant sur intérêts civils. Les médecins experts ont alors fixé les préjudices selon la nomenclature Dintilhac, c’est-à-dire le déficit fonctionnel temporaire (DFT) et le déficit fonctionnel permanent (DFP), conformément à ce qui est demandé dans la mission d’expertise. Dans le cadre d’une expertise sollicitée par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils, l’expert doit convoquer toutes les parties, dispositions destinées à donner un caractère contradictoire à l’expertise48. Des juges d’instruction, par anticipation sur le procès civil, incluent dans leur mission d’expertise49 l’ensemble des postes de préjudices de la nomenclature Dintilhac. Mais le caractère contradictoire n’est pas respecté lors de ces expertises pénales50.
La CIVI va devoir indemniser sur la base d’un rapport d’expertise qu’elle n’a pas elle-même diligentée et souvent en l’absence d’appréciation spécifique de l’ITT et de l’incapacité permanente.
II. Indemnisation par la CIVI
Une fois que le tribunal correctionnel a condamné l’auteur d’une infraction puis a statué sur les dommages et intérêts à verser à la victime qui s’est constituée partie civile, celle-ci sera parfois bien désappointée des difficultés à obtenir le versement effectif des sommes allouées. En principe, la charge de la réparation incombe à la personne condamnée. Toutefois, en pratique et le plus fréquemment, la réparation pécuniaire pèse sur un assureur en cas d’infraction involontaire51, ou sur un fond de garantie en cas d’infraction volontaire, de défaut ou d’insuffisance d’assurance. La réparation intervient dans cette hypothèse sur le fondement de la solidarité nationale et non d’une responsabilité personnelle et directe.
Le problème majeur en matière d’indemnisation des victimes d’infractions volontaires reste l’insolvabilité, ainsi que la non-identification de l’auteur. Les CIVI répondent à cette difficulté et permettent l’obtention d’une indemnisation par le fonds de garantie52. Les CIVI, instituées par une loi du 3 janvier 197753, ont le caractère de juridictions civiles54, malgré le fait que les dispositions qui régissent leur fonctionnement se trouvent dans le Code de procédure pénale. Ce sont en outre des juridictions indépendantes des juridictions pénales. Les victimes peuvent être indemnisées si l’auteur de l’infraction est soit inconnu, soit connu mais insolvable ou ne répondant pas aux demandes d’indemnisation, ce qui est fréquent. Mais ce système basé sur la solidarité nationale imposée par la loi, a pour corollaire des conditions d’accès variant selon la nature de l’infraction et le préjudice subi.
Le Code de procédure pénale distingue les infractions avec une atteinte grave à l’intégrité de la personne, des infractions corporelles « légères » ou matérielles. Cette dichotomie influant sur les conditions et le montant de la réparation ressort des articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toutes les atteintes à la personne ouvrent droit à l’indemnisation par les CIVI si elles ont entraîné un taux d’incapacité permanente d’au minimum un pour cent ou une incapacité totale de travail (ITT) d’au moins un mois.
A. Infractions avec atteinte corporelle grave55
Toutes les agressions sexuelles ouvrent droit à l’indemnisation par les CIVI. Le fait d’avoir été victime d’un viol ou d’une agression sexuelle suffit à lui seul à emporter réparation intégrale, sans considération de l’étendue du préjudice et donc sans besoin de fixer un taux d’incapacité permanente ou une ITT.
En revanche, une personne victime de violences physiques répétées mais sans que l’ITT atteigne un mois, ne peut être indemnisée au titre de l’article 706-3 du Code de procédure pénale. On peut citer le cas des mineurs victimes de sévices récurrents, hors des violences sexuelles. Faut-il parler d’inégalité comme certains auteurs ? 56 Très peu d’expertises médicales sont sollicitées pour les victimes d’infractions sexuelles57 et il est alors très difficile de fixer une durée d’ITT surtout dans les jours qui suivent l’infraction. Il est donc préférable qu’aucun seuil de gravité n’ait été imposé dans le cadre des violences sexuelles. Mais pour les victimes d’agressions physiques sans caractère sexuel, il peut paraitre plus difficile d’obtenir une indemnisation du fait des critères stricts. Lorsqu’un enfant a été victime de violences physiques répétées commises en intrafamilial sans qu’il en résulte une incapacité totale de travail, du fait de l’absence de consultation médicale, les tribunaux en déduisent que les conditions d’une indemnisation intégrale au titre de l’article 706-3 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies. La loi exclut du champ de la réparation intégrale les victimes de violences habituelles lorsque celles-ci n’ont pas entraîné d’incapacité permanente ou d’incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois.
Il est fait un amalgame entre l’incapacité totale de travail initiale fixée dans les jours qui ont suivi l’infraction, qui est sollicitée dans le cadre de l’enquête pénale, le déficit fonctionnel temporaire de la nomenclature Dintilhac et enfin l’ITT au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale. La difficulté pour les victimes résulte de la confusion des notions (ITT et DFT puis incapacité permanente et DFP) et l’absence d’évaluation spécifique à la CIVI. Dans la pratique, la CIVI « pioche » les informations sur le certificat initial établi sur réquisition pour l’ITT et l’incapacité permanente est déduite du taux de DFP retenu dans le rapport d’expertise judiciaire s’il a été sollicité. Il est considéré comme nul en l’absence de document. De nombreuses victimes réalisent seules leurs démarches devant la CIVI sans l’aide d’un avocat et ne réunissent pas tous les certificats nécessaires.
On dispose de peu de jurisprudence dans ce domaine, mais l’arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 201558 vient enfin préciser qu’il ne faut pas confondre ITT et DFT. En l’espèce, un homme a été victime de violences volontaires durant la nuit du 31 mai 2008 au 1er juin 2008, ayant entraîné un traumatisme facial avec une fracture de la mandibule. Le patient a pu regagner son domicile quelques jours avant d’être hospitalisé pour une intervention chirurgicale. Il a été retenu par l’expert que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) avait été partiel, à 50 % (classe 3), du 1er au 4 juin 2008 puis un DFT total durant les deux jours d’hospitalisation (du 5 au 6 juin 2008), puis à 50 % (classe 3) durant 56 jours (du 7 juin 2008 au 1er août 2008) correspondant à la période d’immobilisation de la mâchoire, et enfin un DFT partiel à 10 % (classe 1) du 2 août 2008 au 26 septembre 2008, date de consolidation59.
L’AREDOC60 a proposé une répartition du DFT partiel en quatre classes61, très largement utilisée en expertise judiciaire et d’assurance. Ces classes, déterminées par le médecin expert, sont reprises dans l’arrêt du 19 novembre 2015 alors qu’elles n’ont aucune existence réglementaire.
En l’espèce, la victime ne présentait pas de déficit fonctionnel permanent. Son état était consolidé le 26 septembre 200862. Au plan professionnel, la victime, représentant de commerce, ne pouvait pas démarcher sa clientèle, mais pouvait toutefois faire de la comptabilité, passer des commandes, effectuer des activités annexes, durant la période de DFT.
Devant la cour d’appel63, les juges ont débouté la victime de sa demande d’indemnisation, estimant que la durée de l’incapacité totale de travail (ITT) se limitait aux deux jours d’hospitalisation correspondant à la période de déficit fonctionnel total (DFT) retenue par l’expert. Devant la Cour de cassation, la question se posait donc de savoir si l’ITT au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale se confondait avec le DFT total. Par son arrêt du 19 novembre 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative. La victime devrait pouvoir obtenir une nouvelle évaluation de la durée d’ITT. L’enjeu est d’entrer dans le cadre de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et ainsi obtenir une réparation intégrale. L’ITT ne doit pas se limiter aux deux jours de DFT total et pourrait dans le cas d’espèce, dépasser un mois. C’est un premier pas et nous espérons que cet arrêt incitera le législateur à réformer les articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale. Il ne paraît pas réalisable que le législateur ou le pouvoir réglementaire établisse une table de concordance entre les deux notions ITT et DFT. Il faudrait plutôt remplacer la notion d’ITT par le DFT au sein du Code de procédure pénale et de même introduire le DFP en remplacement de l’incapacité permanente.
L’ITT, au sens pénal, est « une photographie immédiate de l’impact que l’infraction a eu sur la victime » et « une notion unique évaluée en jours ou en mois », tandis que le DFT « se décline en périodes dégressives, du jour de l’atteinte corporelle jusqu’au jour de la consolidation »64.
Une difficulté au pénal est que l’ITT ne peut pas être partielle. C’est la loi du tout ou rien : on bascule du jour au lendemain de l’ITT à « rien », ce qui ne reflète pas la réalité de l’évolution des blessures lors d’une convalescence. De ce fait, la durée de l’ITT pénale est logiquement plus longue que le DFT total. La période d’ITT recouvre la période de DFT total, qui correspond le plus souvent à l’hospitalisation et l’ITT s’étend à une partie du DFT partiel, à 50 ou à 75 %, par référence aux classes 3 et 4 de l’AREDOC.
L’autre difficulté est que le médecin fixe l’ITT sur des présupposés dans les jours qui suivent l’agression donc sans connaître l’évolution réelle, alors que le DFT est fixé a posteriori, après la consolidation, sur la base de l’évolution réellement vécue par la victime.
Nous pensons que l’ITT devrait demeurer une notion propre au droit pénal permettant de déterminer si les faits de violences relèvent du délit ou de la contravention, sans incidence sur l’indemnisation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire doit être la référence en matière de réparation du dommage corporel.
Pour déterminer le seuil d’indemnisation intégrale par une CIVI, il serait préférable de se référer à la nomenclature Dintilhac sur le modèle de ce qui se fait devant les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux65, c’est-à-dire un seuil à 50 % de DFT. En effet, les commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI) dans le cadre du règlement amiable des accidents médicaux, sont compétentes sous certaines conditions dont un seuil de gravité. Pour que les CCI se déclarent compétentes66, il faut que l’accident médical soit à l’origine d’au moins un critère dont un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 % ou un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Ce taux de DFT partiel à 50 % sera déterminé par les médecins experts.
Ces deux notions (ITT de DFT) « peuvent être ainsi théorisées de manière distincte, elles ont vocation à se superposer en pratique dès lors que la durée de l’ITT conditionne devant la CIVI le droit à réparation du DFT »67.
Mais à la question de l’articulation entre l’ITT et le DFT s’ajoute une autre difficulté tenant à l’articulation de l’ITT au sens du droit pénal général avec l’ITT au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, puisque certaines CIVI ont cru pouvoir s’affranchir de la durée de l’ITT retenue dans le cadre de la procédure pénale, en dépit du principe de l’autorité de la chose jugée des décisions pénales en ce qui concerne la qualification du fait incriminé.
D’autre part, les dommages ne répondant pas aux critères de gravité posés par l’article 706-3 du Code de procédure pénale (en particulier si l’ITT est supérieure ou égale à un jour et inférieure à 1 mois et s’il n’y a pas d’incapacité permanente) peuvent être réparés via l’article 706-14 du Code de procédure pénale, sous réserve de remplir les conditions, plus exigeantes, de celui-ci.
B. Réparation en matière de dommage matériel ou d’atteinte « légère » à la personne68
Le domaine de la CIVI a été étendu par la loi du 8 février 198169 à toute personne victime « d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant » et qui « ne peut obtenir à titre quelconque une réparation ou indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave »70. Les infractions matérielles sont limitativement énoncées.
À la différence des infractions ayant entraîné une atteinte grave à la personne, la réparation des atteintes corporelles « légères »71 n’est pas intégrale mais plafonnée. L’indemnisation est plafonnée au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu pour obtenir l’aide juridictionnelle partielle (soit 4 116 € en 2016).
La loi prévoit trois conditions strictes d’indemnisation des victimes d’infractions que l’on peut résumer ainsi : disposer de faibles ressources, démontrer l’absence d’obtention d’une indemnisation de son préjudice à un titre quelconque, et se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave. Si ces trois conditions cumulatives sont réunies, les victimes peuvent obtenir de la CIVI une indemnisation qui ne peut, en tout état de cause, excéder le plafond prévu.
Détaillons les trois conditions, qui paraissent insurmontables pour de nombreuses victimes non conseillées72 qui notamment ont toujours beaucoup de mal à fournir les justificatifs d’imposition des deux années nécessaires73. Les ressources du demandeur doivent être inférieures au plafond pour bénéficier de l’aide juridictionnelle74. Le demandeur doit établir que l’auteur de l’infraction est inconnu ou insolvable75. Il doit justifier du fait qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de la part d’une assurance, un organisme social ou autre. Le demandeur doit se trouver dans une « situation matérielle ou psychologique grave » du fait de l’infraction et de l’absence d’indemnisation. La preuve d’une situation matérielle grave est draconienne en ce qu’elle s’ajoute déjà aux conditions de ressources. Ce peut être le vol d’un véhicule empêchant la personne concernée de travailler. La preuve d’une situation psychologique est évidemment difficile à établir s’agissant d’un état psychique mais peut être retenue sur la base de certificats médicaux du médecin traitant ou d’un psychiatre avec des prescriptions d’anxiolytiques et antidépresseurs ou des attestations de suivi par un psychologue. Le refus de la CIVI de reconnaître qu’il y a eu un préjudice matériel ou psychologique grave est mal ressenti par la victime, qui y voit une négation de sa souffrance.
La CIVI, en tant que juridiction indépendante, est souveraine dans l’appréciation du préjudice. Elle n’est pas liée par l’évaluation faite par la juridiction répressive des dommages-intérêts. Si une CIVI accorde une indemnité à une victime d’un montant supérieur à ce qu’il est ensuite accordé par la juridiction statuant sur intérêts civils, le fonds ne peut pas demander le remboursement de la différence. De même, la CIVI n’est pas tenue par la somme allouée par le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils.
Par ailleurs, en cas de préjudice « léger », quand bien même le tribunal a alloué telle somme, la CIVI ne pourra pas dépasser le seuil maximal d’indemnisation.
Si la demande est rejetée, il est loisible de contester la décision de la CIVI devant la cour d’appel, et ce quel que soit le montant des demandes76. En effet, la CIVI se prononce en premier ressort77.
Conclusion
Les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) constituent un élément-clé du dispositif de solidarité nationale mis en place à l’intention des victimes d’infractions, et permettent sous certaines conditions, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes les plus graves à la personne.
Une difficulté résulte des deux critères imposés par le Code de procédure pénale (ITT et incapacité) pour déterminer le seuil de l’indemnisation intégrale. Le dispositif est empreint d’étrangetés juridiques qu’il conviendrait de réformer pour adopter aussi la nomenclature Dintilhac dans ce cadre d’indemnisation des victimes d’infractions. Il convient de souligner qu’il avait été répondu à une question écrite78 d’Odette Duriez, députée, que « La garde des Sceaux indique qu’il a été décidé d’inscrire les propositions issues d’un rapport du Conseil national de l’aide aux victimes tendant à clarifier les dispositions des articles 706-3 et 706-14 du Code de procédure pénale, au sein du troisième projet de loi de simplification du droit »79.
Dans le rapport évoqué80, les sénateurs ont retenu : « L’article 706-14 du Code de procédure pénale est contesté par les associations de victimes en raison de son caractère restrictif : seules des victimes d’une liste limitative d’infractions, répondant à des conditions de ressources strictes et devant apporter la preuve d’une situation matérielle ou psychologique grave résultant de l’impossibilité d’être indemnisées bénéficieront d’une indemnisation qui, en outre, est plafonnée ». Ils ont proposé d’assurer une large diffusion, auprès des personnels de santé comme de l’ensemble des acteurs du procès pénal, du guide de recommandations pour la pratique clinique (RPC) pour la rédaction des certificats médicaux initiaux concernant une personne victime de violences établi en octobre 2011 par la Haute autorité de santé81. Mais on sait bien que la portée des vœux de formation des professionnels reste très limitée et cela ne changera rien à la confusion qui règne.
Cécile Manaouil
III – Responsabilité et droit des patients
IV – Procédure et droits des patients
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-11427, PB.
-
2.
Pour une étude transversale, v. Cabannes X. et Benilouche M. (dir.), Hospitalisations sans consentement, 2013, CEPRISCA, colloques.
-
3.
JO, 30 juill., p. 11056.
-
4.
Savatier R. et J. Auby J.-M et Pequignot H., Traité de droit médical, 1957, Librairies techniques, n° 247 : « Le premier attribut juridique de chaque personne est l’intangibilité de son intégrité corporelle et des principes de sa vie. Il n’y peut être touché, même par le médecin, qu’avec son consentement ».
-
5.
Sur le consentement du malade, v. Lambert-Faivre Y. et Porchy-Simon S., Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, 8e éd., 2016, Précis Dalloz, n° 840.
-
6.
Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., « La formation du contrat, tome 1 : Le contrat – Le consentement », in Traité de droit civil, Ghestin J. (dir.), 4e éd., 2013, LGDJ, n° 1597.
-
7.
Sur la gradation des obligations d’information des professionnels, v. Bigot R., « Avis de tempête sur les crédits à la consommation : du bon temps de l’information précontractuelle au mauvais temps des moyens soulevés d’office », avr. 2014, www.eurojuris.fr.
-
8.
Le Lamy Droit de la Santé, n° 349-5.
-
9.
Bergoignan-Esper C., Sargos P., Les grands arrêts du droit de la santé, 2e éd., 2016, Dalloz, p. 39 et s. : l’arrêt de 1942 Parcelier c/ Teyssier (puis de 1998 Castagnet c/ CPAM de la Vienne et a.) érige de longue date le principe de respect de la personne humaine, lequel impose au praticien, avant de pratiquer une opération ou un acte, d’obtenir le consentement du patient.
-
10.
Chaigneau A., « Introduction », in Cabannes X. et Benilouche M. (dir.), Hospitalisations sans consentement, 2013, CEPRISCA, colloques, p. 9 : « L’hospitalisation constitue un acte d’isolement thérapeutique qui requiert l’accord de la personne concernée. Tel est le principe dont l’hospitalisation sans consentement figure l’exception ».
-
11.
Vialla F. et Guigue S., « L’hospitalisation à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent », in Cabannes X. et Benilouche M. (dir.), Hospitalisations sans consentement, 2013, CEPRISCA, colloques, p. 17 et s.
-
12.
Fevrot O. et Diebold J., « Le préfet dans les différentes procédures d’hospitalisation sans consentement », in Cabannes X. et Benilouche M. (dir.), Hospitalisations sans consentement, 2013, CEPRISCA, colloques, p. 47 et s.
-
13.
Kissangoula J.-C., « Libertés individuelles et hospitalisation sans consentement », in Cabannes X. et Benilouche M. (dir.), Hospitalisations sans consentement, 2013, CEPRISCA, colloques, p. 77 et s.
-
14.
Laude A., « Préface », in Cabannes X. et Benilouche M. (dir.), Hospitalisations sans consentement, 2013, CEPRISCA, colloques, p. 5.
-
15.
Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC : Rec. Cons. const., 2010, p. 343. ; v. Genevois B., « La dignité de la personne humaine : principe symbolique ou réalité juridique ? », in Mélanges en l’honneur de Robert Badinter, L’exigence de justice, 2016, Dalloz, p. 445 et s., spéc. p. 457 ; Poujade B., « Les soins sans consentement au gré des questions prioritaires de constitutionnalité », in Cabannes X. et Benilouche M. (dir.), Hospitalisations sans consentement, 2013, CEPRISCA, colloques, p. 67 et s. ; Hauser J., « Hospitalisation d’office : la rafale des annulations », RTD civ. 2012, p. 92.
-
16.
Py B., « Le juge des libertés et de la détention et la psychiatrie », in Cabannes X. et Benilouche M. (dir.), Hospitalisations sans consentement, 2013, CEPRISCA, colloques, p. 141 et s.
-
17.
Modifié par L. n° 2013-869, 27 sept. 2013, art. 8 ; CSP, art. L. 3212-9 dispose en effet que :
-
18.
« Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
-
19.
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
-
20.
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2°, du II, de l’article L. 3212-1.
-
21.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L. 3211-12.
-
22.
Dans ce même cas, lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L. 3213-6 ».
-
23.
Lopez A., Yeni I., Valdes-boulouque M. et Castoldi F., « Rapport IGAS et IGSJ, Propositions de réforme de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation », La Documentation Française, mai 2005.
-
24.
Le Lamy Droit de la Santé, n° 288-60.
-
25.
CAA Nantes, 30 déc. 1999, n° 97NT01930, centre hospitalier spécialisé de Pontorson : AJDA 1999, p. 231.
-
26.
Py B., « Le juge des libertés et de la détention et la psychiatrie », in Cabannes X. et Benilouche M. (dir.), Hospitalisations sans consentement, 2013, CEPRISCA, colloques, p. 141 et s., spéc. p. 148.
-
27.
Py B., op. cit., p. 143.
-
28.
Castaing C., « Les contrôles administratifs des mesures de soins psychiatriques sans consentement », in Cabannes X. et Benilouche M. (dir.), Hospitalisations sans consentement, 2013, CEPRISCA, colloques, p. 13 et s, spéc. p. 178 : « Une fois l’admission prononcée, et quelle que soit la modalité d’admission, le contrôle administratif de la mesure de soins ne sera effectif que si l’information circule. Le rôle du directeur de l’établissement est ici prépondérant : il doit informer les différentes autorités de contrôle ».
-
29.
Castaing C., op. cit., p. 174.
-
30.
Usciati M.-D., « Témoignage : des mots pour réparer des maux », in Cabannes X. et Benilouche M. (dir.), Hospitalisations sans consentement, 2013, CEPRISCA, colloques, p. 153 et s.
-
31.
CPP, art. 706-3.
-
32.
À ce jour, il n’existe pas d’obligation légale ou réglementaire d’appliquer la nomenclature Dintilhac mais elle est quasiment utilisée par toutes les juridictions dans la pratique.
-
33.
Une consultation publique avait été lancée en décembre 2014 par le ministère de la Justice sur un projet de décret instaurant une nomenclature des postes de préjudices résultant d’un dommage corporel mais le décret annoncé est toujours attendu.
-
34.
CPP, art. 706-3.
-
35.
Jean-Pierre Dintilhac, alors président de la 2e chambre civile de la Cour de cassation. « Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels », 2006, Paris, La Documentation Française.
-
36.
La consolidation peut correspondre à la fin des soins ou à la dernière consultation de contrôle, lorsqu’aucun traitement n’est plus nécessaire.
-
37.
Selon le rapport Dintilhac : « Séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique… ».
-
38.
Bernfeld C., « Fiche pratique XII : Le déficit fonctionnel temporaire », Gaz. Pal. 31 janv. 2009, n° H3340, p. 39 ; les fiches pratiques de l’Anadavi, « Réparation du dommage corporel », Bernfeld C. et Bibal F.
-
39.
Après consolidation.
-
40.
« Barème d’évaluation médico-légale », 2000, Paris, ESKA, p. 141 et « Barème publié par le concours médical », 2001, Paris et « Missions d’expertise médicale », 2001, AREDOC, édition du concours médical, p. 64.
-
41.
Manaouil C., Pereira T., Gignon M. et Jardé O., « La notion d’incapacité totale de travail (ITT) dans le Code pénal », La Revue de Médecine Légale 2011 ; 2 : 59-71.
-
42.
Cass. crim., 26 mai 1959 : D. 1959, p. 277 – Cass. crim., 6 oct. 1960 : Gaz. Pal. Rec. 1961, 1, p. 9 – Cass. crim., 7 mars 1967 : JCP G 1967, IV 57.
-
43.
Guide de l’action publique « la lutte contre les violences au sein du couple », DACG, direction des affaires criminelles et des grâces, nov. 2004, p. 25
-
44.
Cass. crim., 22 nov. 1982, n° 81-92856 : Bull. crim., n° 263.
-
45.
Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-81267.
-
46.
CPP, art. 62-2 : il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
-
47.
C. pén., art. 222-11 (ITT supérieure à 8 jours) ; C. pén., art. R. 624-1 (violences n’ayant pas entraîné d’ITT) ; C. pén., art. R. 625-1 (ITT comprise entre 1 et 8 jours).
-
48.
CPP, art. 156 ; CPP, art. 81.
-
49.
C. pén., art. 222-9.
-
50.
Les expertises demandées par la CIVI sont payées par le Trésor public dans le cadre des expertises pénales donc passant par le portail « CHORUS » avec un coût supporté par l’État ; alors que les expertises pénales statuant sur intérêts civils sont payées par les parties avec versement d’une provision sauf pour ceux qui bénéficient de l’aide juridictionnelle
-
51.
CPP, art. 283.
-
52.
CPP, art. 434.
-
53.
CPC, art. 16 ; CPC, art. 6 ; Conv. EDH, art. 6-1.
-
54.
CPP, art. 161-1.
-
55.
Toutes les parties ne sont pas convoquées à l’expertise, en particulier les conseils des personnes mises en examen. Le rapport d’expertise pourra ainsi être contesté par les avocats des mis en cause et du Fonds de garantie, car ils n’étaient pas convoqués à l’expertise. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) n’est pas convoqué pour l’expertise pénale et rarement présent au tribunal correctionnel.
-
56.
Ou des violences volontaires commises par un mineur par l’assureur en responsabilité civile des parents.
-
57.
C. assur., art. L. 422-4.
-
58.
Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction.
-
59.
CPP, art. 706-4.
-
60.
CPP, art. 706-3.
-
61.
Penaud B., « L’inégalité des victimes devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions », JCl Pénal, fasc. n° 22.
-
62.
Seule une expertise psychologique de la victime est ordonnée le plus souvent : CPP, art. 164.
-
63.
Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-25519, FS-PB : Resp. civ. et assur. 2016, comm. 47, Groutel H. ; Tapinos D. « L’incapacité totale de travail personnel (ITT) ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) », Gaz. Pal. 15 mars 2016, n° 260a0, p. 63.
-
64.
À la lecture de l’arrêt, il existe des confusions sur cette durée qui est fixée du 2 au 10 août 2008 alors que le DFT à 10 % se termine forcément au 26 septembre 2008, date de consolidation. De plus les termes employés sont très disparates : incapacité temporaire partielle, incapacité totale de travail personnelle, période d’incapacité partielle, incapacité temporaire de travail… ce qui montre bien la confusion qui règne sur cette notion d’ITT.
-
65.
Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel, commentaires dans le journal d’information de l’AREDOC et du centre de documentation, mars 2010.
-
66.
Pour l’AREDOC, le taux de DFT partiel correspond à une classe 1 à 10 %, classe 2 à 25 %, classe 3 à 50 % et classe 4 à 75 %.
-
67.
Cet arrêt est l’occasion de souligner les trop longs délais de règlement des indemnisations de victimes. Le rapport d’expertise date du 6 février 2012, soit plus de 3 ans après la consolidation.
-
68.
CA Rennes, 14 mai 2014.
-
69.
Berlaud C., « Estimation de l’incapacité totale de travail », Gaz. Pal. 10 déc. 2015, n° 251n3, p. 26.
-
70.
L. n° 2002-303, 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
-
71.
CSP, art. L. 1142-1 et CSP, art. D. 1142-1.
-
72.
Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-25519 : Resp. civ. et assur. 2016, comm. 47, Groutel H.
-
73.
CPP, art. 706-14.
-
74.
L. n° 81-82, 2 févr. 1981, renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
-
75.
CPP, art. 706-14.
-
76.
On insiste sur les guillemets, car pour une victime, il n’est pas supportable d’entendre ce terme de léger.
-
77.
Et parfois aussi des victimes « mal » conseillées…
-
78.
CPP, art. R. 50-10 : il faut fournir une copie de la déclaration des revenus de l’année précédant l’infraction et de l’année précédant celle où la CIVI est saisie et à défaut un certificat de non-imposition.
-
79.
Plafond prévu par la L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 4, relative à l’aide juridique.
-
80.
Cela passe par des courriers auprès de l’auteur de l’infraction, ce qui est très difficile soit parce qu’il n’a pas d’adresse connue et stable ou soit lorsque la victime et l’auteur habitent dans le même village, se côtoient avec agressivité et que la victime a peur des représailles… Par ailleurs, recourir à un huissier de justice impose des frais que la victime ne supporte pas de devoir débourser.
-
81.
CPP, art. R. 50-23.
-
82.
CPP, art. 706-4.
-
83.
Question écrite n° 6908 d’Odette Duriez, députée du Pas-de-Calais : JOAN, 9 oct. 2007, p. 6084.
-
84.
Réponse du garde des Sceaux, ministère de la Justice : JOAN, 13 mai 2008, p. 4051.
-
85.
« Pour une meilleure indemnisation des victimes d’infractions pénales », rapport d’information n° 107 (2013-2014) de Christophe Béchu et Philippe Kaltenbach, sénateurs, fait au nom de la commission des lois, enregistré à la présidence du Sénat le 30 octobre 2013, http://www.senat.fr/rap/r13-107/r13-107.html#fn82.
-
86.
Proposition n° 9.