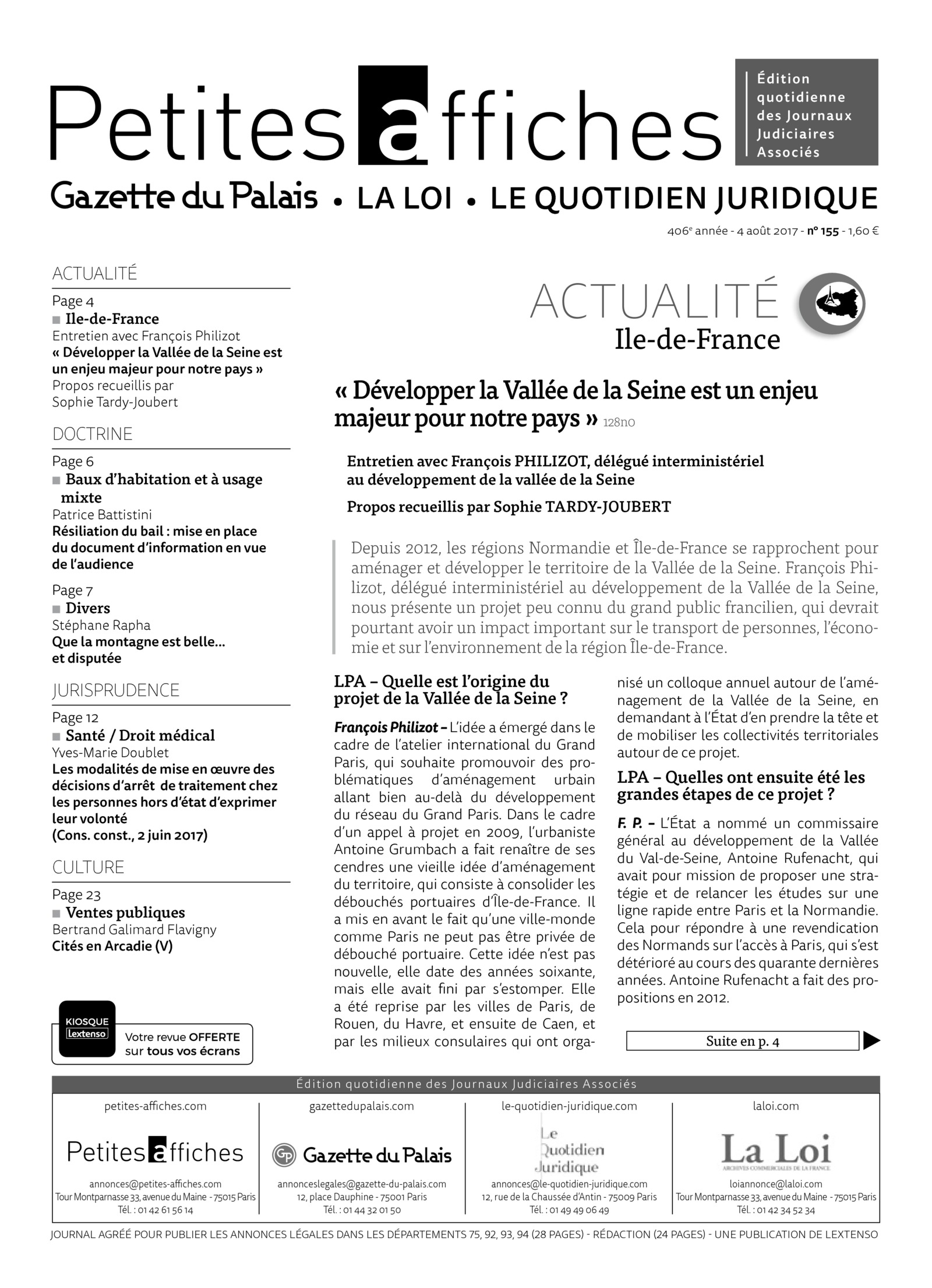Les modalités de mise en œuvre des décisions d’arrêt de traitement chez les personnes hors d’état d’exprimer leur volonté
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2017 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de la procédure collégiale d’arrêt de traitement d’une personne en fin de vie hors d’état d’exprimer sa volonté et sur le droit au recours contre cette même décision. Dans sa décision 2017-632 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions issues de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie conformes à la Constitution, après avoir assorti cette décision de deux réserves d’interprétation sur le droit au recours juridictionnel effectif. Cette décision complète l’encadrement des arrêts de traitement, axé autour des droits du patient, sans le remettre en cause.
Cons. const., 2 juin 2017, no 2017-632 QPC
Fruits chacune d’une longue maturation, deux lois ont encadré la fin de vie depuis 2005 mais n’ont pas pour autant complètement apaisé les controverses sur ce sujet, comme le montre le dépôt par une association d’une question prioritaire de constitutionnalité à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’application de la loi du 3 août 2016 relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
La réponse apportée le 2 juin 20171 par le Conseil constitutionnel à cette question prioritaire de constitutionnalité sur la législation sur la fin de vie, transmise par le Conseil d’État, valide constitutionnellement la procédure des arrêts de traitement. Elle clôt un débat juridique ouvert par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie2 et les discussions qui l’ont suivie jusqu’à l’adoption de la loi du 2 février 20163 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
Le renvoi par le Conseil d’État4 au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité et le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel éclairent la portée de cette décision du 2 juin 2017.
I – Le renvoi par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité
L’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébrolésés (UNAFTC) a saisi le Conseil d’État le 5 décembre 2016 et le 6 janvier 2017 d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du Code de la santé publique (CSP) dans leur rédaction issue de la loi du 2 février 2016.
L’article L. 1110-5-1 CSP proscrit l’obstination déraisonnable, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire, chez les patients hors d’état d’exprimer leur volonté, lorsque les actes thérapeutiques apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, la nutrition et l’hydratation artificielles constituant des traitements pouvant être arrêtés. L’article L. 1110-5-2 du CSP renvoie à cette même procédure collégiale le soin de déterminer les modalités de la sédation profonde et continue jusqu’au décès en cas d’arrêt de traitement chez un patient hors d’état d’exprimer sa volonté et au titre du refus de l’obstination déraisonnable. L’article L. 1111-4 du CSP subordonne l’arrêt de traitement au respect de cette procédure collégiale, des directives anticipées du patient et de la consultation de la personne de confiance, de la famille ou des proches. L’association requérante soutenait qu’en renvoyant la définition de la procédure collégiale au pouvoir réglementaire et en n’instituant pas un recours suspensif contre les décisions d’arrêt de traitement chez les patients ne pouvant exprimer leur volonté, le dispositif retenu méconnaissait l’article 34 de la Constitution, impartissant au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens et privant ainsi de garanties légales les exigences constitutionnelles de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le Conseil d’État est tenu de renvoyer la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel lorsque trois conditions cumulatives sont remplies : la disposition est applicable au litige, la disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel sauf changement de circonstances et la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Dans ses conclusions, le rapporteur public invitait le Conseil d’État à renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, la loi du 22 avril 2005 et la loi du 2 février 2016 n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle constitutionnel a priori ou d’une question prioritaire de constitutionnalité. Au regard des critères jurisprudentiels de la nouveauté de la question posée, le sujet présentait un intérêt réel, dans la mesure où le renvoi se trouvait justifié par des circonstances de fait nouvelles5. En effet, si le Conseil constitutionnel s’était prononcé dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la sauvegarde de la dignité de la personne humaine6 et le droit à un recours juridictionnel effectif7, il n’avait pas statué sur un éventuel droit constitutionnel à la vie invoqué par l’association requérante. Par ailleurs, au titre de la qualification de l’intérêt réel de la question, son rattachement à un sujet de société important plaidait pour le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. La Cour de cassation a à ce titre soumis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe8. Sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère sérieux des moyens soulevés par l’association requérante, ces motifs ont suffi pour le Conseil d’État à déférer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Le rapporteur public qui recommandait au Conseil d’État de se placer sur ces deux terrains9 n’a pas été suivi en revanche pour considérer que la question était à la fois nouvelle et sérieuse.
II – La décision du Conseil constitutionnel 2017-632 QPC du 2 juin 2017
L’association requérante adressait trois séries de reproches aux trois dispositions législatives précitées. Elles privaient de garanties légales les exigences constitutionnelles de sauvegarde de la dignité de la personne humaine dont découlerait le droit à la vie et de la liberté personnelle, protégée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Elles ne garantissaient pas le respect de la volonté du patient incapable d’exprimer sa volonté, dans la mesure où seul un médecin à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire décidait seul de l’arrêt des traitements. Enfin, elles n’assuraient pas l’exercice d’un recours effectif.
Le moyen tiré de la violation du droit à la vie n’a pas été accueilli par le Conseil constitutionnel. Comme le relève le rapporteur public devant le Conseil d’État, la jurisprudence constitutionnelle n’a pas conféré dans sa jurisprudence de valeur constitutionnelle au droit à la vie. La prudence l’a guidé dans cette retenue et explique qu’il ait préféré en l’espèce répondre sur les terrains de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de la liberté personnelle. En revanche le Conseil d’État attribue le caractère d’une liberté fondamentale au droit au respect de la vie10, la Cour européenne des droits de l’Homme accordant une large marge d’appréciation aux États membres dans ce domaine. Cette distanciation ressort de l’arrêt de la cour du 20 janvier 2011, HAAS c. Suisse11, à propos du refus de la Suisse d’autoriser la délivrance de Pentobarbital sans ordonnance à des personnes souffrant de troubles psychiques souhaitant accéder au suicide assisté. Si le droit à la vie se rattache au droit au respect de la vie privée12, la combinaison des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH) sur le droit à la vie et le respect de la vie privée fait obligation aux autorités de protéger les individus des agissements qui menacent leur propre vie. L’article 2 impose aux autorités nationales d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause.
Dans l’arrêt du 5 juin 2015, Vincent Lambert et autres c. France13, la Cour reconnaît également une marge d’appréciation aux États membres14 dans les domaines du début et de la fin de vie mais l’évalue au regard de la loi du 22 avril 2005 et de l’interprétation qu’en a faite le Conseil d’État dans sa décision du 24 juin 201415.
A – Les principes de la liberté personnelle et de la dignité de la personne humaine
Après avoir rappelé que la liberté personnelle tire ses fondements des articles 1er, 2 et 4 de la Déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel confronte les décisions médicales d’arrêt de traitement aux garanties fondamentales accordées aux citoyens par l’article 34 de la Constitution.
Quatre arguments le convainquent d’écarter le moyen de la méconnaissance de la dignité de la personne, érigée en principe de valeur constitutionnelle par la décision 94-343/344 DC du 27 juillet 199416, à propos de la loi relative au respect du corps humain et de la loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Sont mis en avant par le Conseil constitutionnel des arguments liés aux dispositions de la loi elle-même et d’autres plus classiques : le respect de la volonté du patient, l’absence d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, le rôle de la procédure collégiale préalable à la décision médicale et la soumission de cette dernière au contrôle du juge.
1 – Le respect de la volonté du patient
Le Code de la santé publique concilie moyennant des garanties suffisantes le droit à la vie avec le droit de mourir dans la dignité ainsi que le droit à ne pas faire l’objet d’une obstination déraisonnable y compris lorsque la personne n’a plus la faculté d’exprimer sa volonté. Même si depuis 2005 le patient s’est vu reconnaître le droit de rédiger des directives anticipées, la diffusion de celles-ci dans la société est encore très marginale17. Les garanties de la liberté personnelle du patient et de sa dignité en fin de vie sont cependant nombreuses :
-
Le Code de la santé publique définit les conditions de fond relatives à la gravité de l’état du patient et à l’inutilité des soins18.
-
L’article L. 1111-12 consacre le respect de la volonté du patient et la recherche de témoignages sur l’expression de cette volonté. En l’absence de directives anticipées, l’article L. 1111-12 enjoint au médecin de recueillir le témoignage de la personne de confiance ou à défaut tout autre témoignage de la famille ou des proches. Le principe rappelé par le Conseil d’État dans l’affaire Lambert est que force doit rester au patient, la haute juridiction ayant admis que cette expression de la volonté du patient pouvait être orale, à l’instar des bonnes pratiques recommandées par le Conseil de l’Europe19. Dans le considérant 17 de la décision Vincent Lambert, le Conseil d’État indique clairement que : « Dans l’hypothèse où cette volonté [du patient] demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d’être maintenu en vie dans les conditions présentes. Le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans les cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut de l’un de ses proches, en s’efforçant de dégager une position consensuelle ; il doit dans l’examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard ». Le législateur, à l’article 9 de la loi du 2 février 2016, a clairement affirmé que « La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne »20. Plus récemment dans sa décision du 8 mars 201721 rendue à l’occasion d’un arrêt de traitement sur un enfant souffrant de lésions neurologiques dont les conséquences ne pouvaient être établies de manière certaine, le Conseil d’État a fait valoir que « le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu’en soient la forme et le sens ».
-
Dans la loi du 2 février 2016, les directives anticipées22, se situent désormais en tête des éléments à prendre en compte par les médecins, alors qu’elles figuraient jusque-là en dernière place dans la version antérieure de cet article. Les directives anticipées s’imposent au médecin sauf dans trois hypothèses : une urgence vitale, un caractère manifestement inapproprié ou une rédaction non conforme à la situation médicale du patient. Le caractère manifestement inapproprié des directives anticipées renvoie à une motivation non médicale ne correspondant pas au besoin du patient. La situation médicale hors champ du cas traité peut faire référence à une situation désormais caduque, parce que le traitement en cause n’est pas celui visé dans ces directives ou parce que leur auteur n’avait pas anticipé des circonstances qui auraient affecté sa décision.
-
L’équipe soignante, appelée à être consultée dans le cadre de la procédure collégiale est définie désormais par l’article L. 1110.12, issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, alors que son statut n’était pas déterminé antérieurement23.
-
Enfin, la loi garantit la traçabilité de l’ensemble de la procédure avec l’inscription de la procédure et de la décision d’arrêt de traitement dans le dossier médical24.
Ces raisons suffisaient à écarter le moyen tiré du non-respect de la volonté du patient. Il y avait d’ailleurs quelque paradoxe de la part du requérant de reprocher au législateur de rester en deçà de sa compétence au regard des droits de la personne, alors que sous l’effet conjugué de la loi et de la jurisprudence administrative, ces droits ont été sensiblement renforcés depuis 2005.
2 – Le pouvoir général d’appréciation et de décision du Conseil constitutionnel
S’agissant des modalités d’arrêt de traitement au regard de l’obstination déraisonnable et de l’expression d’une volonté incertaine ou inconnue du patient, le Conseil constitutionnel invoque dans un deuxième temps sa jurisprudence traditionnelle sur son incompétence à substituer son appréciation à celle du législateur. Cette prudence, le Conseil constitutionnel l’a déjà manifestée dans plusieurs décisions touchant des questions de société : dans des décisions rendues à propos de la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception2526 et de l’accès aux origines personnelles2728. On retient du raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel en l’espèce, qu’une volonté du patient inconnue ou exprimée vaguement ne peut contraindre le médecin à arrêter les traitements. La décision consacre le poids des directives anticipées et exige qu’elles soient précises pour être opérationnelles mais en même temps elle est inspirée par la prudence. Cette formulation s’inscrit dans la voie tracée par le considérant 17 de la décision du Conseil d’État Vincent Lambert du 24 juin 2014. Les directives anticipées sont un élément essentiel pour les arrêts de traitement et le recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, lorsque le malade n’a pu exprimer sa volonté. Mais si ce raisonnement s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence Lambert, il marque un infléchissement par rapport aux dispositions de l’article L. 1110-5-2, 2°, 2e alinéa, issu de la loi du 2 février 2016. Celui-ci autorise la sédation profonde et continue jusqu’au décès en cas d’arrêt de traitement lorsque le patient ne peut exprimer sa volonté, au titre du refus de l’obstination déraisonnable. Dans ce cas, force est de constater que c’est plus la bienfaisance médicale qui prévaut que la volonté du patient.
3 – La nature de la procédure collégiale d’arrêt de traitement
Dans un troisième temps, le Conseil constitutionnel rappelle que la décision médicale d’arrêt de traitement est prise au terme d’une procédure collégiale. On sait que l’UNAFTC avait fait de l’incompétence négative du législateur pour définir la procédure collégiale par le règlement un des deux axes de son argumentation. Pour comprendre les enjeux juridiques et éthiques de cette procédure collégiale, il convient de rappeler les raisons du choix opéré par le législateur.
Introduite dans la loi du 22 avril 2005, cette procédure obéit à la nécessité de faire échec à des décisions médicales solitaires. Les personnalités auditionnées par la Mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie de l’Assemblée nationale en 2003 et 2004 ayant débouché sur la loi du 22 avril 2005 ont été nombreuses à plaider pour cette collégialité, ce qui explique la voie arrêtée par le législateur en 2005.
François Lemaire, secrétaire de la Commission d’éthique de la Société de réanimation de langue française s’exprimait ainsi devant cette mission d’information : « Il est temps de montrer que les décisions ne sont ni clandestines ni solitaires mais qu’elles sont prises au sein d’une collégialité qui a discuté et écouté la famille »29.
Interrogé par les députés, le vice-président du Conseil d’État partageait ce point de vue : « Le médecin est placé face à sa seule conscience, celle-ci pouvant être confortée et enrichie par la confrontation avec deux ou autres personnes, par exemple ses confrères, qui auraient une compétence avérée dans les domaines de la déontologie, de la morale et de l’éthique »30.
On constate donc que la procédure collégiale s’est imposée pour le législateur comme une nécessité : « La procédure collégiale est un processus délibératif obligeant chacun à développer une argumentation dans un espace public. C’est un moyen essentiel d’éviter l’arbitraire des décisions solitaires imposées par un rapport de forces hiérarchiques »31. Cette approche a été confirmée dans le rapport de la mission d’information d’évaluation de l’Assemblée nationale de la loi du 22 avril 2005, publié le 28 novembre 2008. La conclusion qui en ressort est qu’une décision raisonnable se dégage plus probablement d’une discussion que d’un monologue lorsque ses motivations débordent le seul champ du savoir technique. « Le médecin traitant voit son appréciation de la situation croisée par celle d’un autre médecin et par celle des soignants paramédicaux qui sont au plus proche du malade ; il élabore avec l’ensemble de l’équipe soignante la motivation rationnelle d’une décision médicale dont il demeure seul responsable »32. Dans son avis 121 du 1er juillet 2013 « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir », le Comité consultatif national d’éthique considérait de son côté que « plutôt que d’une procédure, il doit s’agir d’une délibération collective entre personnes ayant des avis argumentés différents ».
Cette procédure collégiale ne signifie pas pour autant une décision collective. Là encore les travaux parlementaires sont éclairants. Le rapport parlementaire de la première mission d’information distingue nettement le processus délibératif de la décision : « Si collégialité il y a, le dernier mot doit revenir au médecin. Dans un contexte social où les familles recomposées ne sont pas rares, où les proches dispersés géographiquement n’ont pas la même perception des problèmes et où il appartient d’assurer une totale impartialité au regard de l’interférence possible d’arrière-pensées et d’intérêts des proches peu avouables, il apparaît sage que la décision finale incombe au médecin. La décision doit être prise avec les familles mais jamais par les familles »33.Transférer cette décision à la famille risquait au surplus d’exposer celle-ci à un sentiment de culpabilité34. Dans sa décision Vincent Lambert du 24 juin 2014 le Conseil d’État a clairement établi que la décision de limitation ou d’arrêt de traitement revenait au seul médecin. On soulignera aussi que le Guide du Conseil de l’Europe sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux en fin de vie recommande que la décision soit prise par le patient s’il est en capacité de le faire ou par le médecin en charge du patient sur la base des conclusions de la délibération collective 35.
ll faut enfin rappeler qu’en vertu de l’article R. 4127-37-2-I, III, du CSP la décision d’arrêt de traitement requiert l’avis motivé d’au moins un médecin appelé en qualité de consultant, l’avis d’un second consultant pouvant être recueilli si l’un des deux médecins l’estime utile. Définie dans les commentaires de l’article 37-2 du Code de déontologie médicale, la notion de « consultant » renvoie à un médecin qui dispose des connaissances, de l’expérience, et, puisqu’il ne participe pas directement aux soins, du recul et de l’impartialité nécessaires pour apprécier la situation dans sa globalité. Ce praticien est étranger à l’équipe de soins qui assure la prise en charge du patient.
Si ces raisons expliquent les étapes de la procédure d’arrêt de traitement, des considérations juridiques et éthiques les justifient également.
Ce que sous-tend le moyen soulevé par l’UNAFTC dans son recours est que l’unanimité des participants à cette délibération collective aurait dû être imposée par le législateur. Mais les contours d’une telle assemblée sont difficiles à cerner dans la pratique : où s’arrête la famille ? Cette exigence est délicate à satisfaire dans tous les établissements de santé et du secteur sanitaire et social, peu équipés pour ce faire. Le droit français par ailleurs, sauf à de très rares exceptions, ignore la responsabilité collective. Plaider pour une décision collective aboutissant à une responsabilité collective, c’est aller contre le principe constitutionnel du fait personnel36.
Des considérations éthiques ne sont pas absentes non plus de ce débat. Confier la prise de décision à la famille « au nom du patient » pourrait aboutir à faire des choix dictés non pas par sa situation médicale mais par des motifs exclusivement matériels peu honorables, l’affaire Terri Schiavo aux États-Unis ayant montré la complexité d’une délégation de la décision aux proches37.
4 – Une décision soumise au contrôle du juge
Enfin, le Conseil constitutionnel rappelle que la décision médicale et l’appréciation de la volonté du patient sont toujours soumises au contrôle du juge, qui peut être soit le juge administratif ou le juge judiciaire suivant la situation du patient.
Le Conseil constitutionnel n’a pas fait droit expressément au requérant pour considérer que le législateur avait méconnu sa propre compétence à propos de dispositions affectant un droit ou une liberté3839, comme la haute instance avait pu le relever à propos des conditions essentielles de l’organisation et du régime intérieur des établissements pénitentiaires4041. En affirmant que la procédure d’arrêt de traitement était assortie de garanties suffisantes, il a fait valoir par voie de conséquence que le législateur n’avait pas porté d’atteinte inconstitutionnelle au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de la liberté personnelle.
B – Le droit au recours effectif
L’UNAFTC contestait également l’absence d’un recours effectif contre les décisions d’arrêt de traitement.
Après avoir rappelé classiquement que le droit à un recours juridictionnel effectif s’évince de l’article 16 de la Déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel affirme qu’il s’exerce dans les conditions de droit commun et émet deux réserves d’interprétation.
La formation à ce jour de sept recours devant le juge administratif et la Cour européenne des droits de l’Homme dans la seule affaire Vincent Lambert montre que la procédure d’urgence invoquée dans le cadre d’un référé-liberté a pu pleinement s’exercer. Cependant ce droit au recours n’est pas institué par une disposition législative spéciale au sens de l’article L. 4 du Code de justice administrative.
Le Conseil constitutionnel ne confère pas de valeur constitutionnelle au caractère suspensif du recours juridictionnel. À propos du pouvoir de consignation du préfet pour défaut d’exécution par une commune de ses obligations d’aménagement et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait ne pas attribuer de caractère suspensif au recours contre l’ordre de consignation4243. Mais cela ne l’empêche pas de ranger ce principe parmi les garanties légales du droit au recours.
Le Conseil constitutionnel a considéré ainsi qu’au regard des conséquences résultant de l’exécution de la vente des biens saisis par l’administration douanière, le cumul de l’absence de caractère contradictoire et du caractère non suspensif du recours juridictionnel constituait une atteinte excessive aux exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et justifiait l’inconstitutionnalité de la mesure4445. Le droit de propriété de l’employeur, qui se voit tenu au paiement des frais de l’expertise, nonobstant l’annulation de la décision du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail par le juge, est atteint au travers d’une procédure méconnaissant l’exigence du droit à un recours effectif. La combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours46. On rappellera également que dans un arrêt Gebremedhin du 26 juillet 2007, la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé qu’au regard de l’article 3 de la Convention EDH et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas d’exposition au risque de torture ou de mauvais traitements, dans un pays où un étranger risquait d’être renvoyé, l’article 13 de la Convention EDH sur le recours effectif exigeait que l’intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif.
En l’espèce, le droit de recours contre les décisions d’arrêt de traitement, estimées à plus de 100 000 par an en réanimation, ne peut être exercé que par la personne de confiance, la famille ou un des proches.
La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de l’arrêt de traitement en vertu du IV de l’article R. 4127-37-2. Une disposition similaire s’applique pour le recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès47.
Par conséquent si le caractère irrémédiable de la décision d’arrêt de traitement est une évidence, la réglementation française prévoit une notification préalable à l’exercice possible d’un droit de recours et le référé d’urgence en milieu hospitalier public réglementé par le titre II du livre cinquième du Code de justice administrative y pourvoit, tandis que la procédure de référé civil instituée par l’article 809 du Code procédure civile a vocation à s’appliquer aux arrêts de traitement dans les établissements de soins privés ou au domicile du patient.
Le Conseil constitutionnel a déjà invoqué l’existence de la procédure du référé pour ne pas accueillir un moyen tiré de l’absence d’un droit au recours : 2011- 119 QPC, 1er avril 2011, Mme Denise R.et autre, à propos du référé-suspension contre les décisions de suspension ou de retrait d’agrément des assistants maternels4849 ; 2015-490 QPC, 14 octobre 2015, M. Omar K., à propos de l’interdiction administrative du territoire qui peut être contestée devant le juge des référés50.
À la lumière du droit applicable et de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a été conduit à formuler deux réserves d’interprétation dans le considérant 17 de sa décision. L’une exige que le médecin se soit enquis de la volonté du patient auprès de son entourage dans des conditions lui permettant d’exercer un recours en temps utile. Cette réserve d’interprétation est à rapprocher de celle qu’il avait exprimée à propos des effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation5152. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel avait jugé que la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif imposait que chacune de ces personnes soit mise à même d’exercer son droit de former une réclamation contentieuse, dans la mesure où elle avait informé l’administration fiscale du changement de sa situation matrimoniale. Dès lors, les dispositions contestées portaient une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de former une réclamation, si le délai de réclamation pouvait commencer à courir sans que l’avis de mise en recouvrement ait été porté à la connaissance de chacun d’eux. En l’espèce, comme on l’a vu, la personne de confiance, la famille ou un des proches sont informés de la nature et des motifs de l’arrêt de traitement.
La seconde réserve d’interprétation porte sur les délais dans lesquels le recours doit être analysé pour obtenir le cas échéant la suspension de la décision d’arrêt de traitement. Le Conseil constitutionnel exige que le recours soit examiné dans les meilleurs délais. On retrouve une parenté entre cette réserve et celle émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur le recours juridictionnel effectif à propos de l’hospitalisation sans consentement. Le Conseil constitutionnel avait jugé que, s’agissant d’une mesure privative de liberté, le droit impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais5354.
Si cette décision affiche une continuité certaine avec sa jurisprudence antérieure, est-elle en cohérence avec l’arrêt de la cour Gebremedhin55 ? On peut considérer que les conditions posées par cet arrêt sont remplies si les proches du patient sont en mesure de former un recours suspensif une fois que la décision d’arrêt de traitement leur sera notifiée et que le juge saisi se prononcera rapidement. Citant une affaire Conka ayant trait au référé d’extrême urgence devant le Conseil d’État Belge, la Cour européenne des droits de l’Homme a fait valoir dans l’arrêt Gebremedhin que les exigences de la convention sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique. Or en prescrivant ces garanties procédurales, qui pourraient relever de dispositions réglementaires introduites dans le IV de l’article R. 4127-37-2, le Conseil constitutionnel répond aux conditions posées par la Cour européenne des droits de l’Homme. Ce dispositif devra se concrétiser dans l’élaboration de formulaires mis à la disposition des médecins en charge des patients en fin de vie pour les requérants éventuels. Cette information devra être accompagnée par ailleurs d’une formation spécifique tournée spécialement vers les réanimateurs, qui sont les médecins les plus concernés par les arrêts de traitement.
En formant des recours contre des décisions d’arrêt de traitement et en déposant une question prioritaire de constitutionnalité contre la procédure collégiale réglementaire, d’aucuns semblent tentés de considérer que la justice est la mieux placée pour arbitrer des conflits familiaux autour de patients en fin de vie. Il faut se rassurer en rappelant que 98 % des arrêts de traitement ne soulèvent pas de problèmes dans la pratique. Soit la personne de confiance, la famille et les proches parviennent à un accord. Soit en cas de désaccord, le médecin en charge du patient suspend l’arrêt de traitement, dans l’attente de parvenir à un consensus entre la personne de confiance, la famille et les proches. D’ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme a affirmé clairement que passer outre à l’objection de la mère d’un enfant pour l’administration de traitements, en l’absence d’une autorisation judiciaire, contrevenait à l’article 8 de la Convention56.
La France a fait le choix raisonné et mûri d’un encadrement juridique des arrêts de traitement. En définissant les modalités de notification des arrêts de traitement et des voies de recours offerts aux proches des patients en fin de vie, cette décision du Conseil constitutionnel apporte sa pierre à un édifice construit peu à peu depuis 2005. Ces précisions viennent compléter un dispositif axé autour des droits du patient, sans le remettre en cause.
Notes de bas de pages
-
1.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-632-qpc/decision-n-2017-632-qpc-du-2-juin-2017.149060.html.
-
2.
Doublet Y.-M., « La loi du 22 avril 2005 », LPA 23 juin 2005, p. 6 ; Garaud E., « La question de l’euthanasie traitée à droit presque constant par la loi sur la fin de vie », RLDC 2005, p. 41 ; Pradel J., « La Parque assistée par le droit. Apports de la loi du 22 avril 2205 relative aux droits des malades et à la fin de vie », D. 2005 p. 2106.
-
3.
Desgorces R., « La loi 2016 -87 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie », LPA 13 juin 2016, p. 12 ; Bergoignan-Esper C., « La loi du 2 février 2016 : quels nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie ? », RDSS 2016, p. 296 ; Devalois B., Taounhaer S. et Puybasset L., « Nouvelle loi sur la fin de vie : ce qu’il faut retenir », Praticien en anesthésie réanimation, 2016 ; Doublet Y.-M., « La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie », LPA 18 mars 2016, p. 7 ; Denizot A., « Législation française », RTD civ. 2016, p. 460 ; Doublet Y.-M., « Les dispositions réglementaires d’application de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie », RDSS 2016, p. 1092.
-
4.
CE, 3 mars 2017, n° 403944, UNAFTC.
-
5.
CE, 2 févr. 2012, n° 355137, Mme Le Pen, B.
-
6.
Cons. const., 25 avr. 2014, n° 2014-393 QPC : JO 27 avr. 2014 ; Céré J.-P. et Herzog-Evans M., « Note sous 2014-393 QPC », D. 2014, p. 1235 ; Slama S. Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 7 mai 2014, p. 9.
-
7.
Cons. const., 4 déc. 2015, n° 2015-503 QPC : JO n° 0283, 6 déc. 2015 ; Severino C., RFDC 2016, p. 494 ; Perrotin F., LPA 24 mars 2016, p. 3.
-
8.
Cass. 1re civ., 16 nov. 2010, n° 10-40042.
-
9.
Concl. Decout-Paolini R.
-
10.
CE, 16 nov. 2011, n° 353172, Ville de Paris, A.
-
11.
CEDH, 20 janv. 2011, n° 31322/07, Haas c/ Suisse.
-
12.
Ibid., § 51.
-
13.
CEDH, 30 juill. 2015, n° 46043/14. Vialla F., « La Cour européenne approuve l’arrêt des traitements », D. 2015, p. 1625.
-
14.
Idem.
-
15.
Doublet Y.-M., GAJA, 20e éd. 2015, Dalloz ; « La décision du Conseil d’État du 24 juin 2014 sur l’arrêt des traitements de Vincent Lambert, une décision sage et raisonnée », LPA 17 oct. 2014, p. 6.
-
16.
Deswarte M.-P., « Le droit à la vie dans la décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1994 », Journal international de bioéthique, 1996, vol. 7, n° 1, p. 10-15 ; Mathieu B. « Bioéthique : un juge constitutionnel réservé face aux défis de la science », RFDA 1994, n° 1 ; Byk C., « La loi relative au respect du corps humain », JCP G 1994, n° 39.
-
17.
2, 5 % des décès d’après l’INED, Population et société, nov. 2012.
-
18.
CSP, art. L.1110-5-1, CSP, art. L. 1110-5-2 et CSP, art. L. 1111-4.
-
19.
Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux en fin de vie, Conseil de l’Europe, mai 2014.
-
20.
CSP, art. L. 1111-6.
-
21.
CE, 8 mars 2017, n° 408146, Assistance publique- Hôpitaux de Marseille.
-
22.
CSP, art. L. 1111-4, 5e al.
-
23.
Morlet-Haïdara L., « Le nouveau cadre légal de l’équipe de soins et du partage des données du patient », RDSS 2016, p. 1103.
-
24.
CSP, art. L. 1110-5-2 et CSP, art. L. 1111-4.
-
25.
Cons. const., 27 juin 2001, n° 2001-446 DC : JO 7 juill. 2001, p. 10828, Rec., p. 74.
-
26.
Schoettl J.-É., « La nouvelle législation relative à l’interruption volontaire de grossesse », LPA 10 juill. 2001, p. 25 ; Mathieu B., « Une jurisprudence selon Ponce Pilate (constitutionnalité de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et la contraception) », D. 2001, p. 2533 ; Gimeno-Cabrera V., « Les apports de la décision IVG au traitement jurisprudentiel du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine », RDP 2001, p. 1483.
-
27.
Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC : JO 17 mai 2012, p. 9154, Rec., p.270.
-
28.
Dumortier T., « L’accouchement sous X déclaré conforme à la Constitution », Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 24 mai 2012, p. 2 ; Diane R., « La constitutionnalité de la procédure d’accouchement sous X : une décision attendue et prévisible », RDSS 2012, p. 750 ; Nicolas G., « Le juste équilibre “à la française” dans la protection des droits de la femme et de l’enfant. Jurisprudence du Conseil constitutionnel », RFDC 2012, p. 869 ; Bourgault-Coudervylle D. « L’enfant né sous X », LPA 19 août 2013, p. 4.
-
29.
Respecter la vie, Accepter la mort, 1708, t. 1, XII législature, p. 236.
-
30.
Ibid, p. 238.
-
31.
Mislawski R., Directives anticipées, Enjeux éthiques de la réanimation, 2010, Springer Verlag, p. 73.
-
32.
Solidaires devant la fin de vie, 1287, t. 1, XIII législature, p. 22.
-
33.
Respecter la vie, Accepter la mort, 1708, t. 1, XII législature p. 239.
-
34.
CEDH, 5 juin 2015, n° 46043/14, Vincent Lambert et a. c/ France, cons. 164.
-
35.
Guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux en fin de vie, Conseil de l’Europe, mai 2014.
-
36.
Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, cons. 7, Rec., p. 75 ; Cons. const., 25 févr. 2010, n° 2010-604 DC, cons. 11, Rec., p. 70.
-
37.
Devalois B et Burnod A., Place des familles dans la réflexion collégiale : l’exemple des soins palliatifs, Enjeux éthiques de la réanimation, 2010, Springer Verlag, p. 139.
-
38.
Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-5 QPC, SNC Kimberly Clark : JO, p. 11149, Rec. p. 114.
-
39.
Boucher J., « Question prioritaire de constitutionnalité : la première décision de renvoi du Conseil d’État soulève la question de l’incompétence négative du législateur (CE, 23 avril 2010, n° 327166) », Dr. fisc. 2010, p. 32 ; Meier E. et Boucheron G.-H., « QPC : le Conseil constitutionnel saisi d’une question sur l’incompétence négative du législateur », Dr. fisc. 2010, p. 4 ; Mouriesse E., « QPC et droit au consentement à l’impôt », RFFP 2017, p. 241 ; Arrighi de Casanova J., Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 46 (L’incompétence en droit constitutionnel) janv. 2015, p. 29 ; Camby J.-P. « Le consentement à l’impôt et le Conseil constitutionnel : droit individuel ou décision démocratique ? » in Mélanges en l’honneur de D. Turpin, 2017, LGDJ, p. 133.
-
40.
Cons. const., 25 avr. 2014, n° 2014-393 QPC, « Organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires », JO, p. 7362.
-
41.
V. supra, note 6.
-
42.
Cons. const., 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC, Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, cons. 86 : JO 18 janv. 2017.
-
43.
Chaltiel F., « La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté devant le juge constitutionnel. Loi-balai, lisibilité du droit et exigences constitutionnelles », LPA 24 mars 2017, p. 6.
-
44.
Cons. const., 2 déc. 2011, n° 2011-203 QPC : JO 3 déc. 2011, p. 20015, Rec. p. 572.
-
45.
Robert J.-H., « Prise d’une petite Bastille » In Lois pénales spéciales, Dr. pén. 2012, p. 39.
-
46.
Cons. const., 27 nov. 2015, n° 2015-500 QPC : JO p. 11149, Rec. p. 114.
-
47.
CSP, art. R. 4127-37-3, II.
-
48.
Bhagestani L., « Peine ou sanction à caractère punitif, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (2e partie) », LPA 31 juill. 2012, p. 27.
-
49.
JO 2 avr 2011, p. 5895, Rec., p. 180.
-
50.
JO 16 oct. 2015, p. 19327.
-
51.
Cons. const., 4 déc. 2015, n° 2015-503 QPC : JO 6 déc. 2015, p. 22500.
-
52.
Perrotin F., « Solidarité fiscale des conjoints : des progrès », LPA 24 mars 2016, p. 3.
-
53.
Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-71 QPC , Danielle S., JO, p. 21119, Rec., p. 343.
-
54.
Renaudie O. « L’hospitalisation sans consentement devant le juge constitutionnel », RDSS 2011, p. 304 ; Grabaczyk K., « L’hospitalisation sans consentement sous les feux des juges européen et constitutionnel », JCP G 2011, p. 325 ; de Bechillon D., « Pragmatisme. Ce que la QPC peut utilement devoir à l’observation des réalités », JCP G 2010, p. 2410 ; Hauser J., « Hospitalisation psychiatrique sans consentement : branle-bas de combat ! », RTD civ. 2011, p. 101 ; Castaing C, « Quand les "sages" veillent sur les "fous" », LPA 23 déc. 2010, p. 5 ; Boiy X., « La judiciarisation accrue de l’hospitalisation sous contrainte », AJDA 2011, p.174.
-
55.
Marguénaud J.-P. « Le droit de demander asile à la frontière », D. 2007, p. 2780 ; Labayle H. et Sudre F. « Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et droit administratif », RFDA 2008, p. 737.
-
56.
CEDH, 9 mars 2004, n° 61827/00, Glass c/ Royaume-Uni.