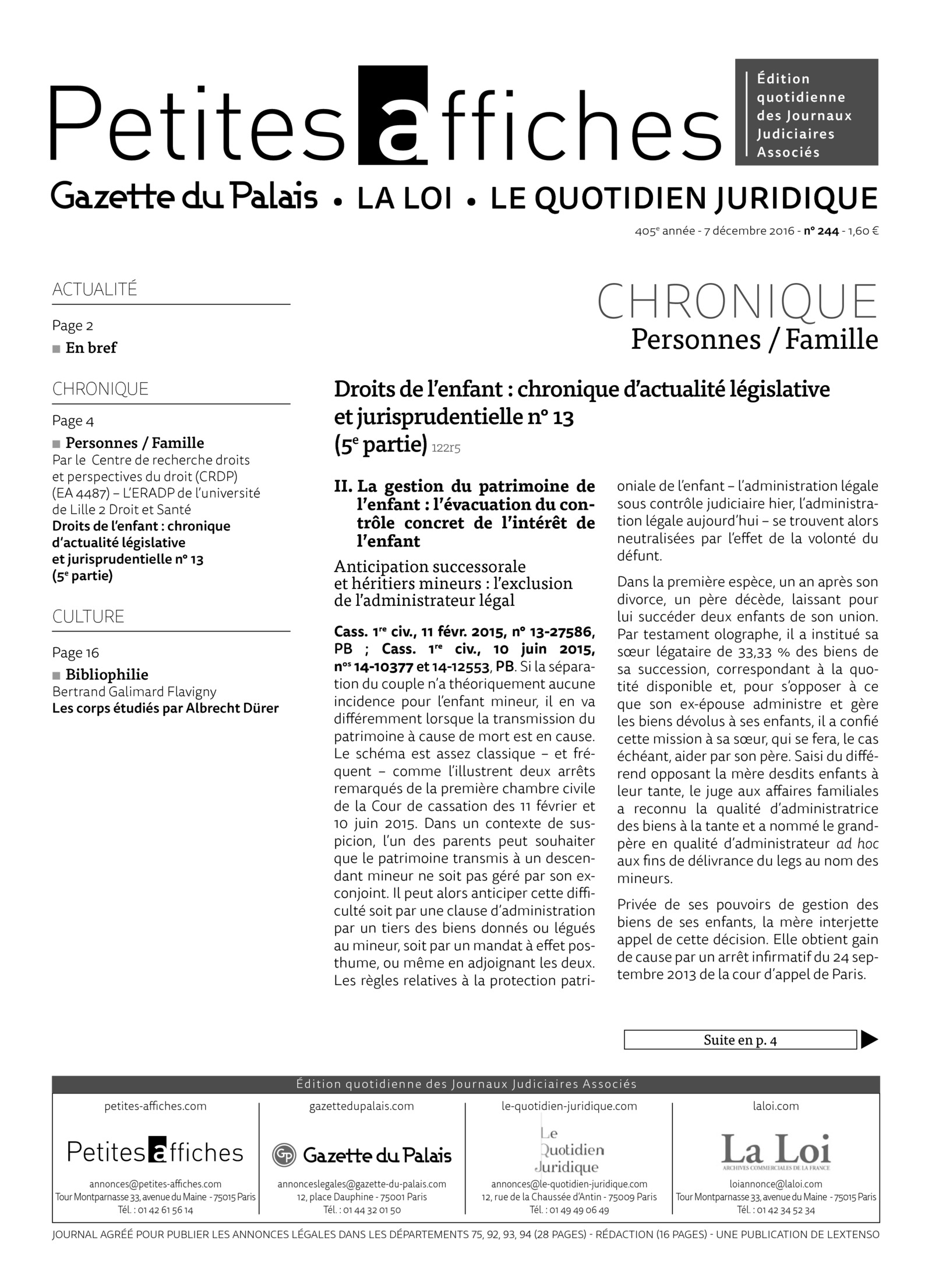Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 13 (5e partie)
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-23724, PB
BGH (Cour fédérale de justice allemande), 23 sept. 2015, n° XII ZR 99/14
CJUE, 3e ch., 16 juill. 2015, no C-184/14
Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, no 13-27983, PB
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, no 14-16511, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-12592, PB
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, no 14-22636, D
CA Paris, 18 juin 2015, no 15/00864
Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, nos 14-16425 et 14-24267, PB : RJPF 2015, 12/21, p. 33-34, note Meyzeaud-Garraud M.-C.
CA Toulouse, 7 juill. 2015, nos 15/673 et 14/06754
Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15472, D
CA Caen, ch. civ. et com. 2, 22 oct. 2015, no 14/04093
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, no 13-27586, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-10377 et 14-12553, PB
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, no 14-20790, D
CA Metz, 24 mars 2015, no 15/00165
Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, no 14-14702, PB
CA Reims, 13 mars 2015, no 14/01057
CA Colmar, 16 juin 2015, no 13/00995
I – Le gouvernement de la personne de l’enfant : l’empire du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
A – L’intérêt de l’enfant élevé par ses deux parents
1 – Le principe de coparentalité, garant de l’intérêt de l’enfant
2 – Le juge, garant du principe de coparentalité
B – L’intérêt de l’enfant dont les parents sont défaillants
1 – L’intérêt du pupille de l’État
2 – L’intérêt de l’enfant non entretenu par le parent séparé
II – La gestion du patrimoine de l’enfant : l’évacuation du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
Anticipation successorale et héritiers mineurs : l’exclusion de l’administrateur légal
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27586, PB ; Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-10377 et 14-12553, PB. Si la séparation du couple n’a théoriquement aucune incidence pour l’enfant mineur, il en va différemment lorsque la transmission du patrimoine à cause de mort est en cause. Le schéma est assez classique – et fréquent1 – comme l’illustrent deux arrêts remarqués de la première chambre civile de la Cour de cassation des 11 février2 et 10 juin 20153. Dans un contexte de suspicion, l’un des parents peut souhaiter que le patrimoine transmis à un descendant mineur ne soit pas géré par son ex-conjoint. Il peut alors anticiper cette difficulté soit par une clause d’administration par un tiers des biens donnés ou légués au mineur, soit par un mandat à effet posthume, ou même en adjoignant les deux. Les règles relatives à la protection patrimoniale de l’enfant – l’administration légale sous contrôle judiciaire hier, l’administration légale aujourd’hui4 – se trouvent alors neutralisées par l’effet de la volonté du défunt5.
Dans la première espèce, un an après son divorce, un père décède, laissant pour lui succéder deux enfants de son union. Par testament olographe, il a institué sa sœur légataire de 33,33 % des biens de sa succession, correspondant à la quotité disponible et, pour s’opposer à ce que son ex-épouse administre et gère les biens dévolus à ses enfants, il a confié cette mission à sa sœur, qui se fera, le cas échéant, aider par son père. Saisi du différend opposant la mère desdits enfants à leur tante, le juge aux affaires familiales a reconnu la qualité d’administratrice des biens à la tante et a nommé le grand-père en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de délivrance du legs au nom des mineurs.
Privée de ses pouvoirs de gestion des biens de ses enfants, la mère interjette appel de cette décision. Elle obtient gain de cause par un arrêt infirmatif du 24 septembre 2013 de la cour d’appel de Paris. Cette dernière reconnaît à la mère la qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens dévolus aux enfants dans la succession de leur père et déclare qu’elle bénéficie du droit de jouissance légale dans les conditions des anciens articles 383 et suivants du Code civil, tout en l’autorisant à accepter purement et simplement, ès-qualité, ladite succession. La cour décharge la tante de sa mission d’administration des biens des mineurs et le grand-père de ses fonctions d’administrateur ad hoc, motif pris qu’il n’y a pas eu de donations ou de legs aux mineurs et que, par conséquent, les dispositions de l’article 389-3 du Code civil ne peuvent s’appliquer.
La tante et le grand-père se pourvoient en cassation au motif que les biens transmis aux mineurs au titre de la réserve héréditaire peuvent être soustraits à la gestion parentale. Par arrêt du 11 février 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris au visa des articles 1134, 383 et 389-3 du Code civil. Elle considère que « la clause d’exclusion de l’administration légale qui emport[e] privation de la jouissance légale de la mère [a] nécessairement pour effet d’augmenter les droits des mineurs sur leur émolument dans la succession de leur père, de sorte qu’une telle clause stipulée par le testateur pour « [son] patrimoine » qui reviendra à [ses] enfants caractérisait un legs ».
Dans la seconde espèce, un père est décédé le 23 août 2012, laissant pour lui succéder son épouse et un fils de cinq ans issu d’une première union. Par testament olographe du 16 février 2012 et un codicille du 3 juillet 2012, il a institué son épouse légataire universel et légataire à titre particulier d’un certain nombre de biens, en indiquant que « tout le reste de ses biens et œuvres d’art » reviendrait à son fils, et que si, à la date de son décès, son fils était encore mineur, la mère de celui-ci n’aurait « ni l’administration légale ni la jouissance légale » des biens recueillis dans sa succession, lesquels seraient administrés par l’un de ses amis, avec les pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire, conformément à l’article 389-3 du Code civil. Par ailleurs, par acte authentique du 8 mars 2012, il a conféré à ce même ami un mandat à effet posthume afin d’administrer et gérer le capital de la société détentrice de la majorité de son patrimoine, dans le domaine de l’audiovisuel, afin de protéger les intérêts de son fils mineur.
Écartée de la gestion du patrimoine de son fils, la mère de l’enfant agit en justice. Elle obtient également gain de cause par plusieurs arrêts successifs de la cour d’appel de Paris, qui ordonne, le 17 décembre 2013, la révocation du mandat à effet posthume avant d’écarter, le 13 mai 2014, l’application de la disposition testamentaire confiant l’administration des biens légués à un tiers.
Pour les juges du fond, les dispositions successorales prises par le défunt, en raison d’une complexité patrimoniale et de la présence d’un héritier mineur, « aboutissent à dessaisir la mère, administratrice légale sous contrôle judiciaire, des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur, et à écarter celui-ci, de fait, de son droit à une réserve libre de charges ». L’arrêt précise, pour la clause d’exclusion de l’administration légale, que les dispositions prises par le père montrent sa volonté d’exclure la mère de la gestion et de l’administration des biens recueillis dans la succession, et visent non pas à protéger le patrimoine transmis, mais tendent seulement à empêcher l’application des dispositions légales relatives à l’administration des biens du mineur. Enfin, en ce qui concerne le mandat à effet posthume, la cour d’appel relève qu’il n’est pas démontré que le mandant ait cherché à résoudre une difficulté objective identifiée au regard de la nécessité de préservation des intérêts de son fils, n’ayant pas expliqué spécifiquement en quoi la mère était dans l’incapacité d’assurer une bonne gestion des intérêts de l’enfant mineur commun.
Par deux arrêts du 10 juin 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation censure les juges du fond. Elle considère non seulement qu’ils ont ajouté des conditions à la loi, méconnaissant respectivement l’article 389-3, alinéa 3, du Code civil pour l’exclusion de l’administration légale des biens légués et l’article 812-4, 3° dudit code relatif à la révocation du mandat à effet posthume, mais aussi inversé la charge de la preuve.
Ces deux arrêts démontrent que la haute juridiction se montre particulièrement bienveillante afin d’assurer l’efficacité des dispositions de dernières volontés prises par le de cujus pour la gestion des biens transmis à cause de mort à un descendant mineur, que l’exclusion de l’administrateur légal résulte soit d’une clause d’administration des biens par un tiers (I), soit d’un mandat à effet posthume (II).
I. L’exclusion par une clause d’administration des biens par un tiers
Par ces deux décisions, la Cour de cassation rappelle les conditions de validité de la clause d’administration par un tiers des biens donnés ou légués à un mineur prévue par l’article 389-3, alinéa 3, du Code civil : si elle est subordonnée à l’exigence d’une libéralité (A), les mobiles du disposant sont indifférents (B).
A. L’exigence d’une libéralité
Si la clause d’administration des biens par un tiers, telle qu’elle résulte de l’article 389-3, alinéa 3, du Code civil, a longtemps laissé planer une incertitude quant à son efficacité au regard de son assiette, le doute a été levé par un arrêt du 6 mars 20136.
Dorénavant, la clause permet de soustraire aux règles d’administration ordinaire tous les biens donnés ou légués, même s’ils portent sur la réserve héréditaire. Pour autant, l’arrêt du 6 mars 2013 n’avait pas réglé toutes les difficultés. Prise à la lettre, la clause d’administration des biens par un tiers vaut pour les biens donnés ou légués à l’enfant mineur. Peut-elle dès lors produire ses effets pour les biens revenant à l’enfant en vertu de la loi ?
Or, dans la première espèce, le père ayant légué la quotité disponible à sa sœur, la clause ne pouvait grever que la réserve héréditaire, et porter sur les droits dévolus au mineur ab intestat.
Pour les juges du fond, en l’absence de legs au profit du mineur, la clause n’est pas valable. Elle ne pouvait donc pas priver la mère de ses pouvoirs, en qualité d’administratrice des biens sous contrôle judiciaire.
En censurant cette analyse, la Cour de cassation adopte une lecture salvatrice du testament et plus précisément de la clause d’administration des biens par un tiers. En effet, elle considère que la clause ayant pour effet de priver l’administratrice légale de la jouissance légale, conformément à l’ancien article 387 du Code civil, augmente l’émolument du mineur dans la succession de son père. Elle y infère un legs fait au mineur, permettant ainsi d’en admettre la validité. La clause recèlerait en elle-même un legs.
Même si cette analyse permet de respecter la volonté du défunt, la caractérisation du legs n’était toutefois pas évidente. Le fait que l’ex-conjoint soit privé de l’usufruit permet-il d’y déceler un legs ? La réponse n’est évidente au regard ni de l’élément matériel, ni de l’élément intentionnel. Au demeurant, c’est le patrimoine dévolu à l’enfant qui a vocation à s’accroître, de sorte qu’il s’agirait, pour certains, d’un « legs de biens futurs ou de biens virtuels »7.
Si la situation était moins nette que dans la première espèce du 11 février 2015, le second arrêt procède de la même veine. Par testament, le père avait effectivement institué son épouse légataire universelle et lui avait fait plusieurs legs à titre particulier. Le codicille qui y était adjoint prévoyait que « le reste devait revenir à l’enfant mineur ». De nouveau, la Cour de cassation y décèle un legs au profit de l’enfant de « tout le reste des biens et œuvres d’art du père et des fruits attachés à la jouissance légale dont la mère a été privée ». Pourtant, la rédaction du codicille était sujette à interprétation : ce « reste » avait-il vocation à revenir à l’enfant en vertu de la loi ou en vertu d’un legs ? A priori, le légataire universel ayant une vocation à recevoir l’intégralité des biens, la caractérisation d’un legs n’était pas plus évidente8, même si l’institution d’un légataire « du surplus » n’est pas en soi incompatible avec l’institution d’un légataire universel9.
Pour louable qu’elle soit, la solution n’en est pas moins peu orthodoxe. D’une part, le raisonnement consiste à déduire de la clause l’existence du legs pour la rendre efficace, c’est-à-dire à admettre la validité de la clause au regard des effets produits, ce qui est pour le moins discutable10. D’autre part, elle procède d’une extension de la notion de legs. C’est pourquoi, certains considèrent qu’il serait plus simple d’admettre que la clause puisse, comme pour le mandat à effet posthume, porter sur les biens reçus ab intestat11. La solution aurait pu être adoptée en invoquant l’esprit du texte, si l’on entend par « biens donnés ou légués », les biens transmis à titre gratuit12. Pour d’autres, l’exigence d’une libéralité à laquelle la clause est adjointe ne s’imposerait plus depuis que la Cour de cassation a admis que la clause puisse porter non seulement sur la quotité disponible mais aussi sur la réserve héréditaire13.
De prime abord, l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille n’a pas modifié la donne puisque la lettre de l’article 384 du Code civil reprend celle de l’ancien article 389-3, alinéa 3. Cependant, en vertu de l’article 386-4 du Code civil, « la jouissance légale ne s’étend pas aux biens : (…) 2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas ». C’est dire que dorénavant l’exclusion de la jouissance légale ne résultera plus automatiquement de l’exclusion de l’administration légale ; elle devra être expresse – ce qui était le cas uniquement dans la seconde espèce.
En outre, en censurant la cour d’appel de Paris, qui a ajouté une condition supplémentaire au texte, la Cour de cassation affirme clairement que la validité de la clause n’est soumise à aucune autre condition supplémentaire. Elle n’a pas à être conforme à l’intérêt de l’enfant et, plus généralement, les mobiles du de cujus sont indifférents.
B. L’indifférence des motifs
Dans la seconde espèce, la première chambre civile de la Cour de cassation censure les juges parisiens qui avaient exigé que la clause soit conforme à l’intérêt de l’enfant. Là encore, la solution n’est pas nouvelle. Alors que pour certains la clause devait être conforme à l’intérêt de l’enfant14, la haute juridiction avait déjà jugé que la désignation d’un tiers pour administrer les biens donnés ou légués à un mineur ne peut être écartée au seul motif qu’elle serait contraire à l’intérêt de l’enfant15.
En l’espèce, la Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir remis en cause la désignation du tiers pour administrer les biens du mineur au motif que cette clause écartait de la gestion de la succession le parent survivant, administrateur légal sous contrôle judiciaire, ce qui serait contraire à l’intérêt de l’enfant. C’est dire que le de cujus n’a pas à démontrer que l’administration des biens par un tiers est conforme à l’intérêt de l’enfant. Derechef, la démarche adoptée par les juges du fond consistant à ajouter une condition à la loi est censurée. Peu importe que la clause ait pour effet d’exclure les règles légales de gestion des biens du mineur. Peu importe également que le disposant soit uniquement animé par la volonté d’exclure son ex-conjoint, la cause n’est pas pour autant immorale. Les mobiles du testeur sont indifférents. Tout au plus, pourrait-on réserver l’hypothèse où le disposant serait animé d’une animosité à l’encontre de l’enfant16. En outre, un contrôle de l’intérêt de l’enfant peut toujours intervenir a posteriori par le juge des tutelles, notamment eu égard à la manière dont le mandataire exerce sa mission, si les actes sont contraires à l’intérêt de l’enfant17. La clause d’exclusion n’a donc pas à être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Et de ce point de vue, la technique utilisée pour exclure l’administrateur légal est importante, car les mobiles sont loin d’être indifférents lorsque l’exclusion résulte d’un mandat à effet posthume.
II. L’exclusion par un mandat à effet posthume
Le parent, administrateur des biens de son enfant mineur, peut également être privé de ses pouvoirs de gestion par un mandat à effet posthume, comme le révèle l’arrêt rendu dans la seconde espèce. La Cour de cassation censure également la cour d’appel de Paris qui a révoqué le mandat à effet posthume confié par un père à un tiers pour la gestion d’un groupe de sociétés dans le domaine de l’audiovisuel pour défaut d’intérêt sérieux et légitime, faute de démonstration des capacités de gestion du mandataire concernant le capital des sociétés du défunt et de l’incapacité de la mère à assurer une bonne gestion des biens dévolus à son fils. Elle rappelle que la validité du mandat à effet posthume est subordonnée à l’exigence d’un intérêt sérieux et légitime (A), qui peut être contrôlé a posteriori (B).
A. L’exigence d’un intérêt sérieux et légitime
Le mandat à effet posthume ayant pour effet de déposséder l’héritier de ses pouvoirs de gestion, le recours à cet outil doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime afin de le protéger. La cause doit être exprimée dans l’acte. Selon l’article 812-1-1, alinéa 1er, du Code civil, ce mandat « n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé ».
Au regard du patrimoine, la présence d’une société est généralement considérée comme ne justifiant pas à elle seule le mandat à effet posthume, même si la forme sociale est complexe18. Mais, en l’espèce, s’y ajoutait également un intérêt au regard de la personne de l’héritier, mineur en l’espèce.
Nul doute que l’intérêt sérieux et légitime à l’égard de la personne de l’héritier puisse être fondé sur son âge, et notamment sur sa minorité – cinq ans en l’espèce –, et ce d’autant que l’article 812-1 du Code civil prévoit que le mandat à effet posthume peut porter sur les biens du mineur, même s’ils composent la réserve héréditaire. Pour autant, la présence d’un héritier mineur n’est pas non plus à elle seule constitutive d’une difficulté de gestion, même si celui-ci est incapable juridiquement19. En effet, les règles de l’administration légale sous contrôle judiciaire – de l’administration légale aujourd’hui – n’ont-elles pas précisément pour objet de pallier l’incapacité du mineur, qui est alors représenté ?
Mais alors, en pareilles circonstances, comment apprécier l’intérêt sérieux et légitime ? Doit-il être caractérisé au regard du seul héritier mineur ou également par rapport au titulaire de l’autorité parentale évincé par le mandat à effet posthume ? Certains considèrent qu’il est nécessaire de motiver le mandat à effet posthume à l’égard non seulement de l’héritier mineur mais aussi du représentant légal20 en identifiant clairement les difficultés de gestion. Il faut donc théoriquement établir les données qui font que les règles propres à la protection du mineur ne suffisent pas à assurer une bonne gestion des biens qui lui sont transmis21. Il appartient donc normalement au défunt d’expliquer les raisons pour lesquelles la représentation du mineur ne suffit pas à assurer une bonne gestion des biens transmis.
Pour autant, la Cour de cassation confirme que le défunt n’avait pas à expliquer dans le mandat à effet posthume en quoi la mère pouvait se trouver dans l’incapacité d’assurer une bonne gestion des biens dans l’intérêt de l’enfant. C’est dire que cet intérêt sérieux et légitime a vocation à être contrôlé a posteriori.
B. Le contrôle a posteriori de l’intérêt sérieux et légitime
En vertu de l’article 812-4 3° du Code civil, le mandat à effet posthume peut prendre fin par « la révocation judiciaire22, à la demande d’un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d’absence ou de disparition de l’intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ». Le juge est alors conduit à contrôler les motifs du disposant ; il doit vérifier si le mandat est d’une réelle utilité pour les biens qui en sont l’objet.
Or, pour la cour d’appel, la seule volonté du de cujus d’exclure son ex-conjoint de l’administration des biens de son enfant pouvait invalider le mandat à effet posthume, d’autant que le défunt n’avait pas justifié de l’incapacité de la mère – administratrice légale – à assurer une bonne gestion des intérêts de son fils mineur.
Pourtant, la haute juridiction censure les juges du fond qui ont inversé la charge de la preuve. Et la censure était inévitable : c’est bien évidemment à celui qui invoque l’absence d’intérêt sérieux et légitime d’en apporter la preuve23.
Au demeurant, la solution se justifie, car le mandat à effet posthume et la mesure de protection ont vocation à coexister24. La loi admet l’exclusion, au moins partielle, du conjoint survivant comme administrateur légal pour les biens objet du mandat.
Cependant, la mère se prévalait en l’espèce d’une exclusion totale de ses pouvoirs légaux. En effet, par la combinaison du mandat à effet posthume et de la clause d’administration par un tiers des biens légués à son fils – lequel était d’ailleurs la même personne : un ami du défunt –, l’exclusion de la mère était totale. Le montage combine alors les avantages des deux techniques, tout en en supprimant leurs inconvénients. Les règles légales protectrices du mineur se trouvaient totalement neutralisées par l’effet de la volonté du défunt. Cette combinaison révèle son attrait ou ses effets pervers selon le point de vue adopté25…
Comme pour la clause d’administration des biens par un tiers, la gestion par l’administrateur posthume doit en principe être conforme à l’intérêt des héritiers26, c’est-à-dire à l’intérêt de l’enfant – sous peine de révocation du mandataire, mais l’absence d’intérêt sérieux et légitime peut également en justifier la nullité. Contrairement à la clause de l’article 389-3, aliéna 3, du Code civil, les mobiles sont loin d’être indifférents. À cet égard, la seule volonté du de cujus d’exclure son ex-conjoint de l’administration des biens de son enfant pourrait éventuellement invalider le mandat à effet posthume, en présence d’une atteinte effective à l’intérêt de l’enfant, contrairement à la clause d’administration des biens par un tiers…
Delphine AUTEM
Professeur à l’université de Lille 2
Droits et perspectives du droit (EA 4487) – L’ERADP
III – La filiation de l’enfant : vers un contrôle abstrait de l’intérêt de l’enfant par le juge ?
A – L’enfant majeur : le contrôle de proportionnalité validé par le juge du droit
Clair-obscur sur le régime des actions en matière de filiation : quand la prescription doit composer avec le contrôle de proportionnalité !
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-20790, D. Quoi de plus étrange a priori qu’une prescription qui ne prescrit pas, du moins pas nécessairement ? Pourtant, c’est bien là le tour de force que réussissent les jurisprudences européenne et nationale : proposer une nouvelle approche de la prescription pour dessiner, en matière d’actions ayant trait à la filiation, une prescription non-automatique.
Pour mieux mesurer le caractère novateur de ce paradigme, il semble important de repartir de l’objectif qui était celui de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. L’une des ambitions assumées par le droit français était, au début des années 2000, de parvenir à sécuriser la filiation via l’instauration d’une prescription relativement courte et uniforme pour les actions, qu’elles soient en établissement ou en contestation de filiation27. Cette volonté était le fruit d’un historique riche. En effet, il faut se souvenir que les actions en matière de filiation ont longtemps été imprescriptibles (sous réserve de dispositions spécifiques)28, puis elles ont été assorties d’une prescription longue à compter de la loi n° 72-3 du 3 janvier 197229. Le mouvement de réduction des délais de prescription s’est progressivement poursuivi : ledit délai s’établit aujourd’hui à 10 ans pour presque toutes les actions, conformément aux prévisions de l’article 321 du Code civil30 et de la circulaire du 30 juin 200631. L’ordonnance de 2005 était dès lors censée traduire la conception française de la filiation qui n’entend pas céder à une logique de « tout biologique », a fortiori lorsque la vérité biologique apparaît tardivement. C’est en ce sens par exemple qu’a été posée l’irrecevabilité de l’action en contestation de paternité en raison de l’existence d’une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque, conforme au titre et ayant duré au moins 5 ans depuis la naissance (C. civ., art. 333, al. 2). A débuté rapidement cependant une phase de tâtonnements puis de renversement de la tendance. Une première temporisation de ce processus d’encadrement strict, voire de fermeture des actions en matière de filiation, est issue de la loi de 2009 qui a ouvert une possibilité d’action supplémentaire au ministère public pour contester un lien de filiation qui – en 2005 – avait été considéré comme inattaquable (« Nul à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance »)32. Intervient aujourd’hui une seconde remise en cause des prescriptions en matière de filiation par le biais de la jurisprudence. Tant et si bien que si on regarde l’ensemble de cette évolution en matière de délai de prescription des actions relatives à la filiation, on voit se dessiner un mouvement de balancier : les possibilités d’agir ont d’abord été généreusement ouvertes, puis elles ont été très étroitement encadrées et limitées pour aujourd’hui être de nouveau réouvertes.
Dans notre espèce envisagée par la Cour de cassation le 10 juin 201533, un enfant né en 1992 avait été rattaché au mari de sa mère par possession d’état (ladite possession d’état ayant duré plus de 5 ans). En 2006, la mère divorce et se remarie avec le père biologique de l’enfant. Elle saisit en 2010 le ministère public afin qu’il agisse en contestation de paternité sur le fondement de l’article 336 du Code civil. La mère souhaitait que soit mobilisée l’exception introduite par la loi de 2009 permettant au ministère public de contester une filiation alors que le titre de l’enfant et sa possession d’état avaient été conformes pendant plus de 5 ans (C. civ., art. 333, al. 2). La cour d’appel rejette la demande du ministère public en s’appuyant sur l’article 336 du Code civil. Elle relève que le ministère public ne rapporte ni preuve ou indices rendant vraisemblable la filiation, ni éléments pouvant caractériser la fraude. L’intervention du ministère public n’est dès lors pas envisageable. La Cour de cassation casse l’arrêt pour défaut de réponse à conclusions : selon elle, la cour d’appel n’a pas répondu aux arguments qui faisaient valoir qu’un juste équilibre devait être ménagé, dans la mise en œuvre de l’article 8 de la Convention EDH, entre le droit de l’enfant de voir établir sa filiation biologique et les intérêts des héritiers du second mari (décédé) qui s’opposaient à ce que l’enfant hérite.
La Cour de cassation propose une neutralisation originale de l’article 333, alinéa 2 du Code civil. Elle choisit d’écarter la rigueur de la solution de cette disposition au profit d’un contrôle de proportionnalité et de la recherche d’un juste équilibre. Cette solution peut apparaître audacieuse dès lors que, par le passé, la Cour de cassation avait refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 333 du Code civil. Cette question prioritaire de constitutionnalité interrogeait sur la conformité de cette disposition aux droits et libertés constitutionnels garantis par les articles 1, 6, 16 et 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Était alléguée plus précisément une contrariété au principe d’égalité, au droit au recours effectif et au droit au respect de la vie privée et familiale. À l’époque, la Cour de cassation avait indiqué que « la question (soulevée) ne présent(ait) pas un caractère sérieux, en ce sens que l’article 333 du Code civil, qui réglemente les conditions et les délais de l’action en contestation de la filiation, répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les personnes bénéficiant d’une possession d’état, en distinguant selon la durée de celle-ci, afin de stabiliser leur état, dans un but d’intérêt général et en rapport avec l’objet de la loi qui a recherché un équilibre entre les composantes biologique et affective de la filiation, dans le respect de la vie privée et familiale des intéressés »34. Elle avait, ce faisant, fermé la porte à une remise en cause de la prescription prévue à l’article 333 du Code civil.
Le contrôle de constitutionnalité n’a pas abouti en 2011. C’est une autre voie de remise en cause de l’article 333 du Code civil qu’emprunte dans notre espèce la Cour de cassation : un contrôle du droit français – et plus précisément du régime des actions ayant trait à la filiation – à l’aune de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH). L’effet de ce contrôle est considérable : comme le remarque un auteur, les évolutions du droit français « auraient pu donner au contentieux de la filiation un tour presque mécanique duquel l’usage de concepts flous comme l’intérêt de l’enfant ou la proportionnalité auraient été bannis », mais c’était « sans compter la pénétration du modèle juridique de la CEDH »35. Le contrôle de conventionnalité admis offre une possibilité de remise en cause des prescriptions de droit interne s’agissant des actions en matière de filiation. Au-delà de cette certitude, des zones d’ombre subsistent s’agissant des conséquences qui découleront d’une telle modification de l’application de notre droit interne. Ces zones d’ombre devront être dissipées. La clarification apportée (I) interroge sur le nouvel équilibre à construire (II).
I. La clarification apportée : la possibilité d’une remise en cause d’une prescription a priori acquise
Dans notre espèce, la Cour de cassation affirme le contournement possible de la prescription posée en droit français pour les actions en matière de filiation en mobilisant la Convention européenne, et plus précisément le principe du contrôle de proportionnalité développé par la jurisprudence européenne (A). Cette solution qui peut sembler surprenante au regard du droit positif français était néanmoins prévisible à l’aune de la jurisprudence européenne sur la question de la prescription en matière de filiation (B).
A. La mobilisation du contrôle de proportionnalité
La haute cour admet, dans son arrêt, le principe d’un contrôle de la prescription à la lumière des exigences de la Convention EDH. Ce contournement de l’article 333, alinéa 2 du Code civil conduit à une neutralisation possible, mais non-automatique, de l’irrecevabilité de l’action en contestation de la filiation. Notre espèce marque clairement un accroissement du contrôle sur les prescriptions de droit interne via la Convention européenne, contrôle qui semble pouvoir avoir des conséquences non négligeables. Il faut bien reconnaître que la prescription peut apparaître peu compatible avec le droit à la connaissance des origines et le droit à la vie privée, droits qui sont au cœur de l’article 8 de la convention. Rappelons cependant que la CEDH ne considère pas qu’il y ait de contradiction de principe de la prescription à l’article 8 de la Convention européenne36. En témoigne par exemple l’arrêt de la CEDH en date du 18 février 201437 : la Cour conclut dans cette affaire que l’intérêt de l’enfant peut justifier que son père juridique, même s’il peut rapporter la preuve génétique de la non-conformité de son lien de filiation à la réalité biologique, se voie opposer une impossibilité d’agir en contestation de paternité à l’expiration d’un délai de prescription de 12 mois. La juridiction européenne n’y voit pas de contrariété avec l’article 8 de la convention.
Le moyen du contrôle consiste plus précisément en l’introduction d’un contrôle de proportionnalité en matière de prescription des actions ayant trait à la filiation. Cet outil conduit à envisager le cas d’espèce par référence à la notion de juste équilibre. Le contrôle de la proportionnalité s’effectue dans notre hypothèse entre, d’une part, le droit pour l’enfant de voir sa filiation établie au regard du défunt et, d’autre part, le droit pour les héritiers de ce défunt de s’y opposer. La neutralisation du jeu automatique de la prescription permet à un conflit d’intérêts de se déployer. Cette pondération casuistique s’inscrit aux antipodes d’« une application de manière mécanique » des règles de la prescription38. Comme pour tout contrôle de proportionnalité, il est admis que les États disposent d’une marge d’appréciation en la matière : il leur appartient donc au premier chef de procéder à la pondération des intérêts en présence. C’est d’ailleurs ce qu’ils font quand ils choisissent a priori d’instaurer un délai de prescription39. Reste que cet arbitrage peut être contrôlé a posteriori et remis en cause par la Cour européenne. Les avantages découlant de l’introduction d’un tel contrôle de proportionnalité dans la possibilité d’agir en établissement ou en contestation de filiation sont aisés à appréhender : davantage de souplesse et une adaptabilité tant synchrone que diachrone. Cependant, la prévisibilité et la sécurité juridiques peuvent sembler malmenées en retour. Elles le seront d’autant plus que l’ensemble des implications de cette solution nouvelle n’auront pas été mesurées.
B. La prévisibilité de la solution
La présente solution pouvait à la vérité être prévisible au regard de la jurisprudence européenne. Elle traduit sans doute la prise en considération par la Cour de cassation de l’attachement de la Cour européenne à la vérité biologique40 même si, nous l’avons rappelé, le principe de la prescription n’est pas nécessairement considéré comme contraire à l’article 8 de la CEDH.
Ainsi, par exemple, dans l’arrêt Róńaźski c/ Pologne41, la Cour européenne a-t-elle considéré que le fait pour un père biologique d’avoir été empêché d’établir sa paternité du fait de l’établissement préalable d’un lien juridique de paternité avec le nouveau compagnon de la mère de l’enfant constituait une violation du droit au respect à la vie familiale. La CEDH a également consacré le droit de contester une filiation qui ne serait pas conforme à la vérité biologique. Le premier arrêt notable illustrant cette tendance est l’arrêt Shofman c/ Russie42. La Cour y dénonce la non-conformité au droit au respect de la vie privée et familiale de l’impossibilité d’agir en contestation de paternité dès lors que le requérant peut rapporter la preuve génétique de la non-conformité de son lien de filiation à la réalité biologique. D’autres décisions confirment cette position. Ainsi, si la Cour européenne reconnaît la légitimité de la recherche d’une sécurisation des liens juridiques familiaux, elle décide toutefois d’exercer un contrôle de proportionnalité entre ce but légitime qui peut être poursuivi par les États et l’atteinte au droit à la vie privée et familiale que représente l’impossibilité de remettre en cause un lien de filiation qui ne correspond pas à la vérité biologique43. Si ce contrôle de proportionnalité a déjà été opéré par la Cour à l’égard de législations étrangères44, il s’est également porté sur le droit français45.
La jurisprudence qui s’est développée en droit européen était naturellement susceptible d’avoir des répercussions en droit interne46. Ces arguments de « juste équilibre des droits et intérêts concurrents en jeu » se sont sans surprise développés dans les moyens des pourvois des affaires traitées par la Cour de cassation47. Il n’est finalement que peu étonnant que la haute juridiction se décide à s’en faire l’écho. La jurisprudence interne ne peut ignorer cet état de la jurisprudence européenne qui consiste à rechercher un équilibre entre l’objectif de sécurité juridique et l’accès à la vérité biologique.
II. Le nouvel équilibre à construire : les enjeux de cette remise en cause
La « pénétration du modèle juridique de la CEDH » qui conduit, dans notre espèce, à neutraliser le jeu de la prescription en mobilisant le contrôle de proportionnalité n’est pas sans soulever des inquiétudes quant au devenir d’un droit subjectif – le droit à l’identité – qui commençait à s’imposer en jurisprudence et qui précisément composait avec la logique de la prescription (A). Par ailleurs, ce contrôle de proportionnalité qui peut permettre de pondérer l’automaticité du jeu de la prescription engendre d’autres bouleversements en droit interne dès lors qu’il replace l’intérêt de l’enfant comme critère de premier plan en droit de la famille (B).
A. Le devenir du droit à l’identité ?
Le droit à l’identité est un droit qui semblait émerger dans la jurisprudence interne pour atténuer les effets de la prescription des actions en matière de filiation. L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2014 illustre l’apparition de ce droit48. Dans cette espèce, le demandeur – ayant découvert tardivement que l’homme qui l’avait reconnu et légitimé par mariage n’était pas son géniteur – réclamait l’exhumation de celui qu’il soupçonnait être son « parent » biologique au nom d’un « intérêt primordial à connaître son ascendance génétique », sans pour autant prétendre à une remise en cause sa filiation légalement établie, définitive en raison de la prescription. L’article 16-11 du Code civil s’opposait à cette demande dès lors que l’identification par expertise génétique ne pouvait avoir lieu que dans le cadre d’une action relative à la filiation. Par ailleurs, il n’existait pas d’accord exprès de la personne concernée par l’expertise post mortem permettant d’y procéder. La cour d’appel avait donc logiquement rejeté la requête. La Cour de cassation censure cependant l’arrêt d’appel au visa (entre autres) de l’article 8 de la Convention européenne. La Cour de cassation consacre – de façon non explicite mais néanmoins claire – l’existence d’une action inédite qui permet l’accès à des éléments identitaires (et non la filiation elle-même, puisque cette dernière était définitivement établie). Cette « action tendant à la reconnaissance d’une ascendance génétique par voie d’expertise »49 a donc posé la première pierre de l’avènement dans notre droit d’un « droit à l’identité »50, droit qui avait déjà été consacré par la Cour européenne à la faveur de différentes décisions. Précisons que la jurisprudence fonde ce droit nouveau sur le droit au respect de la vie privée51 (et non pas sur le droit au respect de la vie familiale). Le droit à la filiation – entendu comme le droit à une filiation qui corresponde à la vérité biologique – n’étant pas accessible à tout un chacun (en raison précisément des règles de prescription ou de la place de la filiation sociologique en droit français), un droit à l’identité pouvait donc prospérer avec l’aval des jurisprudences européenne et nationale. L’intérêt de cette proposition est qu’elle permettait de préserver la stabilité de la filiation, tout en donnant aux individus un droit à la connaissance d’éléments importants pour leur construction personnelle ou la maîtrise de leur ascendance biologique.
Si, comme cela semble dorénavant être le cas, le contrôle de proportionnalité permet d’établir une filiation au-delà du délai de prescription, on peut légitimement s’interroger sur le devenir de ce droit à l’identité. Va-t-il disparaître ? A minima, comment ce droit s’articulera-t-il avec le droit à l’établissement de la filiation qui reprend, à la suite de notre espèce, une vigueur évidente ? Le droit à l’identité conservera-t-il une frange d’application résiduelle ou devra-t-on considérer que si – sur la base du contrôle de proportionnalité et donc de l’appréciation à l’aune de l’intérêt de l’enfant – la prescription n’est pas écartée, la communication d’éléments d’information sur l’identité de l’intéressé ne se justifie pas davantage ? Ces questions mériteront d’être progressivement élucidées.
B. L’intérêt de l’enfant, critère de résolution des conflits familiaux structurels
L’intérêt de l’enfant s’est imposé – depuis de nombreuses années – comme un critère central et bien visible du droit de la famille pour les questions ayant trait à l’autorité parentale mais également à la vie et à la séparation des couples : les références textuelles à ce critère font partie du paysage législatif en ces matières. Le terrain d’épanouissement de cette notion à contenu variable semblait donc devoir être le contentieux fonctionnel du droit de la famille52. La nouveauté liée à l’introduction d’un contrôle de proportionnalité en matière de prescription des actions relatives à la filiation est que ce critère s’impose désormais également s’agissant des questions familiales structurelles. La notion d’équilibre des intérêts en présence portée par la Cour européenne et la Cour de cassation permet à l’intérêt de l’enfant de s’affirmer comme un critère en matière de contentieux structurel. Cette évolution est considérable dès lors qu’on avait coutume de considérer que l’intervention du législateur se devait d’être plus ferme lorsqu’il s’agit de régir la structure familiale que lorsqu’il s’agit d’encadrer le fonctionnement dynamique de cette cellule familiale. Ce raisonnement excluait donc le jeu de notions à contenu variable telles que l’intérêt de l’enfant des questions de contentieux de structure.
À la vérité, cette première analyse mérite d’être quelque peu nuancée en étant précisée. L’intérêt de l’enfant a toujours été pris en compte dans la détermination de la filiation – et plus généralement dans les questions familiales structurelles. La plupart des réformes du droit de la filiation depuis 1972 ont d’ailleurs été inspirées par l’intérêt de l’enfant. Ce même « intérêt supérieur de l’enfant » se retrouve au cœur de la Convention internationale sur les droits de l’enfant qui promeut, en son article 3, la prise en considération de cet intérêt pour toutes les décisions qui concernent ce dernier. Cependant, jusqu’à ces dernières années, il s’agissait davantage – en matière de filiation – d’un intérêt de l’enfant apprécié en amont et de façon abstraite par le législateur lors de l’édiction des textes législatifs que d’un intérêt de l’enfant laissé à l’appréciation des juges pour adapter la réponse du droit au cas par cas53. Or, la question de méthode d’appréciation privilégiée est capitale54 : selon que l’appréciation retenue s’effectue in abstracto ou in concreto, l’intérêt de l’enfant – notion instrumentalisée – peut en effet justifier tout et son contraire. Ainsi, par exemple, si, abstraitement parlant, il peut par exemple sembler de l’intérêt de l’enfant de prohiber les conventions de mère porteuse, concrètement on doit admettre que l’intérêt de l’enfant né d’une convention de mère porteuse est de pouvoir établir sa filiation à l’égard de ceux qui ont souhaité sa venue au monde, ce qui passe par une transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français55. Assurément, il s’agit d’une notion réfractaire à toute définition figée56 et qui se trouve aujourd’hui encore au cœur de multiples interrogations s’agissant du rôle qu’elle peut jouer dans notre droit57. L’intérêt de notre espèce ne réside donc pas tant dans la prise en compte de l’intérêt de l’enfant en matière de filiation que l’admission d’une intervention a posteriori de cet intérêt de l’enfant – apprécié par le juge in concreto – pour corriger les solutions parfois rigides découlant de l’application des règles de droit en proposant une nouvelle balance des intérêts au moment de l’application de la norme.
Précisons en outre que la Cour européenne, comme la Cour de cassation, accordent une importance particulière aux souhaits de l’enfant de sorte que l’impossibilité de contestation lui semble d’autant moins justifiée, donc acceptable, que l’enfant en cause ne s’oppose pas à la remise en cause de sa filiation, voire la sollicite58. Cette prise en compte de la parole de l’enfant contribue sans aucun doute à la détermination de son intérêt.
Ce critère de l’intérêt de l’enfant qui participe à la détermination de l’équilibre recherché dans le cadre du contrôle de proportionnalité peut conduire à une remise en cause du principe de la prescription mais également des modalités de la prescription. Les contrôle opéré est donc fin. Concrètement, la Cour admet l’institution d’un délai pour agir en contestation de paternité, délai justifié par le souci de garantir la sécurité juridique des rapports familiaux et de protéger l’intérêt de l’enfant, mais elle exerce un contrôle sur les modalités de la prescription afin de s’assurer que celles-ci ne portent pas une atteinte excessive au droit de contester sa paternité. La Cour européenne s’assure dès lors que le délai de prescription prévu n’est pas trop bref59 ou ne s’applique pas de manière trop rigide60. La vigilance glisse du principe de la prescription vers ses modalités.
L’équilibre du droit français en matière de filiation ne sort assurément pas indemne de cette prise de position. Il est sans doute trop tôt pour mesurer ce que sera l’ampleur du bouleversement lié à l’introduction d’un contrôle de proportionnalité avec lequel la prescription doit composer. La Cour de cassation se révèle attentive à d’autres choix que celui que le législateur français a lui-même fait en privilégiant des prescriptions courtes. Cela s’inscrit dans la même logique que d’autres évolutions jurisprudentielles : la prescription ne peut s’appliquer sans nuance et il faut s’ouvrir aux législations qui n’accordent pas la même place à la prescription que notre législation61.
Cathy POMART
MCF-HDR à l’université de La Réunion
Intermède de droit international privé
CA Metz, 24 mars 2015, n° 15/00165. L’action en désaveu de paternité, relatif à un enfant né en Algérie, ne relève pas de la compétence de la loi algérienne. En effet, l’article 13 bis de l’ordonnance du 26 septembre 1975 portant réforme du Code civil algérien prévoit que la filiation, la reconnaissance de paternité et le désaveu de paternité sont soumis à la loi nationale du père au moment de la naissance de l’enfant. Étant établi que le demandeur est Français, c’est donc la loi française qui s’applique.
Il est toujours étonnant de constater à quel point les mécanismes les plus élémentaires du droit international privé sont parfois méconnus des juridictions. En témoigne ce curieux arrêt de la cour d’appel de Metz du 24 mars 2015 rendu dans les circonstances suivantes. Deux personnes, M. Ouadah O. C. et Mme Farida A., se sont mariées en Algérie le 18 avril 2002. Leur divorce a été prononcé par une juridiction algérienne le 9 octobre 2004, mais une enfant naissait trois jours plus tard. Ce n’est pourtant que quelques années après, en 2008, que l’ex-époux engageait une action en contestation de paternité devant une juridiction française, l’ex-épouse demeurant toujours en Algérie avec sa fille, Maroua. Bien que les faits soient peu développés, il ressort de l’arrêt que M. Ouadah O. C. avait la nationalité française, et implicitement qu’il était domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance de Sarreguemines, lequel l’avait d’ailleurs débouté de sa demande. En appel, Mme Farida A. n’avait pas constitué avocat dans la procédure, de sorte que la compétence du juge français n’avait été à aucun moment contestée. C’est donc essentiellement la question de la loi applicable à l’action en contestation de paternité qui va nous retenir. Sur ce point, le contenu de l’arrêt mérite d’être entièrement reproduit :
« Sur l’action en contestation de paternité de M. Ouadah O. C. :
L’enfant est née en Algérie le 12 octobre 2004.
L’article 41 du Code de la famille algérien prévoit que l’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité de rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.
L’article 43 précise que l’enfant est affilié à son père s’il naît dans les dix mois suivant la date de la séparation ou du décès.
La présomption de paternité prévue par le code algérien s’applique et M. Ouadah O. C. est effectivement présumé être le père de Maroua.
L’article 13 bis de l’ordonnance du 26 septembre 1975 portant réforme du Code civil algérien prévoit que la filiation, la reconnaissance de paternité et le désaveu de paternité sont soumis à la loi nationale du père au jour de la naissance de l’enfant.
Il est établi que M. Ouadah O. C. est Français, c’est donc la loi française qui va s’appliquer ».
La suite de la décision n’intéresse plus l’internationaliste dans la mesure où la cour fait application du droit français aux faits de l’espèce et déboute, comme auparavant les premiers juges, l’appelant de son action en désaveu de paternité. C’est donc le cheminement de pensée qui a conduit à la désignation du droit algérien et du droit français que nous allons tenter de reconstituer.
Il faut bien dire immédiatement que le raisonnement de la cour d’appel de Metz est surprenant. La cour considère, dans un premier temps, que la présomption de paternité prévue par le Code de la famille algérien est applicable puis, dans un second temps, elle soumet la contestation de paternité à la loi française sur le fondement d’une règle de conflit de lois algérienne. Il est vrai que, en droit international privé français, la présomption de paternité relève de la loi applicable à l’établissement de la filiation, c’est-à-dire à la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l’enfant62, soit la loi algérienne. L’arrêt ne cite cependant pas l’article 311-14 du Code civil, applicable en l’absence de convention franco-algérienne en la matière, qui consacre cette solution. Il suggère plutôt que c’est la naissance en Algérie de l’enfant qui justifie la compétence de cette loi. La suite du raisonnement est plus surprenante encore. Il faut sans doute comprendre que, la loi algérienne étant jugée globalement compétente, la cour se fonde ensuite sur l’article 13 bis de l’ordonnance du 26 septembre 1975 portant réforme du Code civil algérien qui prévoit que le désaveu de paternité est soumis à la loi nationale du père au moment de la naissance de l’enfant. La loi algérienne désigne ainsi à son tour la loi française. On sait en effet que M. Ouadah O. C. est Français et que, même en cas de double nationalité, la Cour de cassation invite à ne tenir compte que de la nationalité française63. Quel que soit l’angle sous lequel on l’aborde, cette démarche ne convainc pas. On peut tout d’abord se demander si la cour n’a pas fait usage du mécanisme du renvoi. La loi algérienne, applicable à l’établissement de la filiation, renvoie à la loi française. Mais ce raisonnement ne peut être suivi car il est à peu près admis, quoique la Cour de cassation ne se soit pas prononcée clairement sur ce point et que la doctrine soit partagée, que le renvoi n’est pas applicable en matière de filiation64. Cela dit, même si l’on admet que le renvoi peut être mis en œuvre en la matière, on se heurte au contenu du texte algérien précité qui dispose que la loi nationale du père est applicable à la filiation ; c’est donc le droit français qui aurait dû être globalement déclaré compétent dès le départ et on ne comprend plus par quel moyen le droit algérien a été désigné dans un premier temps pour régir la présomption de paternité. En somme, pour dire les choses brutalement : ou le droit algérien était applicable à la présomption de paternité et à l’action en contestation de paternité par application de l’article 311-14 du Code civil français (sans renvoi), ou c’était la loi française qui était applicable à ces deux questions en vertu de l’article 13 bis de l’ordonnance portant réforme du Code civil algérien (avec renvoi).
Avec de l’imagination, on pourrait penser que la cour a fait preuve d’audace méthodologique en donnant directement compétence au droit algérien, sans passer par l’article 311-14 du Code civil, au motif que ce droit présente avec la situation les liens les plus étroits (lieu de naissance et de résidence habituelle de l’enfant, nationalité et résidence habituelle de la mère…). Mais cette démarche conduit au résultat paradoxal de soumettre finalement la question de fond au droit français par un effet de retour à la méthode conflictuelle classique. Raisonner en termes de proximité de la situation avec l’Algérie n’aurait-il d’ailleurs pas dû conduire le juge français à décliner sa compétence ? En l’absence de convention internationale, la transposition des règles de compétence territoriale interne (CPC, art. 42, al. 1) ne permettait pas de fonder cette compétence et l’article 14 du Code civil, d’application à la fois subsidiaire65 et facultative, ne pouvait être en principe appliqué d’office66. Le juge français aurait donc pu se déclarer incompétent sur le fondement de l’article 92 du Code de procédure civile. Il n’est pas utile d’essayer d’aller plus loin, car il est fort peu probable que la cour d’appel ait eu la perception de ces mécanismes. On retiendra donc cet arrêt comme un exemple, tout de même intéressant, d’une application inusuelle du droit international privé.
Éric KERCKHOVE
Professeur de l’université de Lille 2
Droits et Perspectives du droit
(EA 4487) – L’ERADP
B – L’enfant mineur : le contrôle de son « intérêt supérieur » dénaturé par les juges du fond
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Sur cet aspect, v. Godechot-Patris S., obs. sous Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27586 : RDC déc. 2015, n° 112p8, p. 902 ; Sauvage F., obs. sous Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10377 et Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-12553 : RJPF 2015/9, n° 35.
-
2.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27586 : Dr. famille 2015, comm. 80, note Maria I. ; Dr. famille 2015, comm. 75, note Nicod M. ; AJ fam. 2015, p. 237, obs. Vernières C. ; RDC 2015, n° 112p8, p. 901, note Godechot-Patris S. ; JCP G 2016, 134, spéc. n° 4, obs. Le Guidec R. ; JCP G 2015, 1176, spéc. n° 1, obs. Cermolace A. ; Gaz. Pal. 23 juin 2015, n° 229t3, p. 1850, note Weiss-Gout B. ; RTD civ. 2015, p. 354, obs. Hauser J. ; Dr. et patr. janv. 2016, p. 61, note Blanchard C. ; Dr. et patr. janv. 2016, p. 73, obs. Fulchiron H. ; RLDC 2015/125, n° 5815, obs. Jaoul M.
-
3.
Cass. 1re civ., 10 juin 2015, nos 14-10377 et 14-12553 : Dr. famille 2015, comm. 173, note Nicod M. ; Dr. famille 2015, comm. 174, note Maria I. ; JCP G 2016, 134, spéc. n° 4, obs. Le Guidec R. ; AJ fam. 2015, p. 551, note Casey J. ; RTD civ. 2015, p. 585, obs. Hauser J. ; RTD civ. 2015, p. 668 et 670, obs. Grimaldi M. ; D. 2015, p. 1827, note Dissaux N. ; RDC 2015, n° 112s2, p. 913, note Goldie-Genicon C. ; JCP G 2015, 995, note Le Normand-Caillère S. ; JCP N 2015, 1186, note Nicod M. ; Procédures 2015, comm. 301, note Douchy-Oudot M. ; RLDC 2015/129, n° 5958, obs. Desolneux M. ; RJPF 2015/9, n° 35 et 2015/9, n° 36, note Sauvage F. ; Dr. et patr. janv. 2016, p. 61, note Blanchard C. ; Dr. et patr. janv. 2016, p. 73, obs. Fulchiron H.
-
4.
Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille : JO, 16 oct. 2015, p. 19304.
-
5.
Peterka N., « Enjeux et principales difficultés de la gestion du patrimoine d’autrui », JCP N 2013, 1190, spéc. n° 7.
-
6.
Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-26728 : Bull. civ. I, n° 36 ; AJ fam. 2013, p. 239, obs. Massip J. ; Dr. famille 2013, comm. 57, note Mangiavillano A. ; D. 2013, p. 2075, obs. Gouttenoire A. ; RJPF 2013/4, n° 37, obs. Sauvage F. ; Defrénois 15 avr. 2013, n° 111c4, p. 365, note Randoux N. ; RTD civ. 2013, p. 421, obs. Grimaldi M. ; RTD civ. 2013, p. 346, obs. Hauser J. ; RLDC 2013/104, n° 5097, obs. Pouliquen E. ; RLDC 2013/104, n° 5101, obs. Chaudhot-Rozier G. V. égal. Boulanger D., « L’enfant gratifié, l’administrateur aux biens et la réserve héréditaire », JCP N 2013, 1121.
-
7.
Fulchiron H., obs. préc., Dr. et patr. janv. 2016, p. 74.
-
8.
Grimaldi M., obs. sous Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10377 et Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-12553 : RTD civ. 2015, p. 670.
-
9.
Cass. req., 30 janv. 1878 : S. 1880, 1, p. 208.
-
10.
Fulchiron H., obs. préc., Dr. et patr. janv. 2016, p. 74 ; Maria I., obs. sous Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27586 : Dr. famille 2015, comm. 20.
-
11.
Grimaldi M., obs. sous Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10377 et Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-12553 : RTD civ. 2015, p. 670.
-
12.
Fulchiron H., obs. préc., Dr. et patr. janv. 2016, p. 74.
-
13.
Vernières C., obs. sous Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27586 : AJ fam. 2015, p. 238.
-
14.
Favier Y., « La constitution du patrimoine du mineur par les libéralités », AJ fam. 2002, p. 361 ; Raymond G., « Administration légale et tutelle (droit de jouissance légale) », Rép. civ. Dalloz 2009, n° 48.
-
15.
Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 11-25946 : Bull. civ. I, n° 137 ; AJ fam. 2013, p. 512, note Mornet H. ; Dr. famille 2013, comm. 124, note Maria I. ; Defrénois 26 juin 2013, n° 113v7, p. 972, note Massip J. ; D. 2013, p. 2074, obs. Gouttenoire A. ; RTD civ. 2013, p. 575, obs. Hauser J. ; RJPF 2013/10, 10, obs. Corpart I. ; Dr. et patr. 2014, n° 242, p. 88, obs. Fulchiron H. ; RLDC 2013/108, n° 5249, obs. Paulin A. ; RLDC 2013/108, n° 5241, obs. Pouliquen E.
-
16.
Grimaldi M., obs. sous Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10377 et Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-12553 : RTD civ. 2015, p. 669.
-
17.
Massip J., obs. sous Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 11-25946 : Defrénois 26 juin 2013, n° 113v7, p. 973.
-
18.
Goldie-Genicon C., obs. sous Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10377 et Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-12553, p. 915 ; Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Droit civil – Les successions – Les libéralités, 4e éd., 2013, Paris, Précis Dalloz, n° 871, p. 782.
-
19.
Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., op. cit., n° 871, p. 782.
-
20.
Bahurel C., Les volontés des morts – Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, t. 557, 2014, Paris, LGDJ-Lextenso éditions, Bibl. dr. privé, n° 304, p. 198 ; Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., op. cit., n° 871, p. 782 ; Wicker G., « Successions – Mandats successoraux – Mandat à effet posthume », JCl. Civil, art. 812 à 812-7, 2014, n° 39.
-
21.
Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., op. cit., n° 871, p. 782.
-
22.
La nullité si la condition fait défaut dès l’origine (Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., op. cit., n° 877, p. 788 ; Grimaldi M., « Le mandat à effet posthume », Defrénois 15 janv. 2007, n° 38509, p. 7, spéc. note 19).
-
23.
C. civ., art. 1315, al. 1er.
-
24.
Wicker G., art. préc., n° 37.
-
25.
Bruggeman M., obs. sous Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10377 et Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-12553 : Dr. famille 2015, comm. 174.
-
26.
C. civ., art. 812, al. 1er.
-
27.
V. Granet-Lambrechts F., « Filiation. Actions relatives à la filiation. Dispositions générales », JCl. 2015, § 19 et 22.
-
28.
Même si seule l’action en réclamation d’état d’enfant légitime était expressément déclarée imprescriptible (C. civ., art. 328 anc.).
-
29.
Elles étaient alors soumises au droit commun de la prescription, soit trente ans, sauf dispositions spécifiques (C. civ., art. 311-7).
-
30.
« Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ».
-
31.
Une comparaison avec la prescription de droit commun se révèle intéressante : cette dernière a été ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (C. civ., art. 2224). Finalement, la prescription des actions ayant trait à la filiation, même ramenée à dix ans, demeure longue lorsque l’on adopte cette perspective.
-
32.
Cette loi n’aura résolument pas fait que ratifier l’ordonnance de 2005.
-
33.
V. Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-20790 : JCP G 2015, p. 1647 et s., spéc. n° 38, obs. Murat P.
-
34.
V. Cass. 1re civ., 24 févr. 2011, n° 10-40068 : D. 2011, p. 1586, obs. Granet-Lambrechts F. ; RTD civ. 2011, p. 334, obs. Hauser J. ; AJ fam. 2011, p. 213, obs. Chénedé F. V. Granet-Lambrechts F., « Filiation. Actions relatives à la filiation. Dispositions générales », préc., § 22.
-
35.
V. Murat P., préc.
-
36.
V. CEDH, 6 juill. 2010, nos 17038/04 et 36498/05, Grönmark c/ Finlande et Backlund c/ Finlande.
-
37.
V. CEDH, 18 févr. 2014, n° 28609/08, A. L. c/ Pologne.
-
38.
V. Labrusse-Riou C., « Filiation (1° Généralités) », Rép. Dalloz, 2015, 6, 130.
-
39.
C’est d’ailleurs le raisonnement de la Cour de cassation lorsqu’elle appréhende l’article 333 du Code civil en évoquant l’équilibre recherché par le législateur : Cass. 1re civ., 24 févr. 2011, n° 10-40068, supra note 8.
-
40.
V. CEDH, 13 juill. 2006, n° 58757/00, Jäggi c/ Suisse : RTD civ. 2007, p. 99, obs. Hauser J.
-
41.
V. CEDH, 18 mai 2006, n° 55339/00, Róńaźski c/ Pologne : Dr. famille 2006, alerte 54 ; RLDC 2006/33, p. 33, obs. Flauss-Diem J.
-
42.
V. CEDH, 24 nov. 2005, n° 74826/01, Shofman c/ Russie.
-
43.
V. CEDH, 12 janv. 2006, n° 26111/02, Mizzi c/ Malte ; CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie : RJPF 2007, n° 41, obs. Dekeuwer-Défossez F.
-
44.
V. plus récemment encore CEDH, 25 févr. 2014, n° 12547/06, Ostace c/ Roumanie : cette affaire concernait l’impossibilité pour le requérant de faire réviser un jugement qui avait établi sa paternité, en dépit d’une expertise médico-légale postérieure prouvant le contraire. La demande fut rejetée au motif que ledit document n’existait pas au moment de la procédure initiale. La Cour a jugé qu’en déclarant irrecevable la demande du requérant de rouvrir la procédure en recherche de paternité, les autorités ont contrevenu au droit au respect de sa vie privée.
-
45.
V. CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France : JCP G 2011, 797, obs. Milano L. ; AJ fam. 2011, p. 429, obs. Chénedé F. ; RTD civ. 2011, p. 526, obs. Hauser J.
-
46.
D’autres sont à prévoir. On peut ainsi raisonnablement craindre la remise en cause de l’article 321 du Code civil qui ne prévoit aucune prorogation du délai de prescription.
-
47.
V. Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, n° 13-20906.
-
48.
V. Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n° 13-21018 : LPA 6 août 2015, p. 17, note Dekeuwer-Défossez F., « Chronique de droits de l’enfant n° 11 » ; Dr. famille 2015, comm. 9, obs. Neirinck C. ; JCP G 2014, 49, Douchy-Oudot M. ; Dr. famille 2015, chron. 1, n° 21, Égea V. ; AJ fam. 2015, p. 54, obs. Chénedé F. ; RJPF janv. 2015, p. 20, obs. Garé T.
-
49.
V. Fulchiron H., « Les actions du préteur : la Cour de cassation, l’article 8 de la Convention EDH et le droit à la reconnaissance de son ascendance génétique », D. 2015, p. 1070.
-
50.
On peut y voir une illustration du phénomène de subjectivisation du droit mis en exergue par Carbonnier J., Droit et passion du droit sous la Ve République, 1996, Flammarion, Forum, p. 125.
-
51.
V. CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France, préc., supra note 19 ; CEDH 13 juill. 2006, n° 58757/00, Jäggi c/ Suisse, préc. supra note 14 ; CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France et Labassée c/ France : JCP G 2014, 877, note Gouttenoire A.
-
52.
V. Pomart C., « Les techniques législatives de résolution des conflits familiaux », in La résolution des conflits. Justice publique et justice privée : une frontière mouvante, 2008, ouvrage collectif, p. 178-193.
-
53.
V. Hyest J.-J., Rapport d’information fait au Sénat au nom de la Commission des lois n° 392 (2005-2006), Les nouvelles formes de parentalité et le droit, 14 juin 2006 ; v. plus précisément l’audition de Dekeuwer-Défossez F. : « Si le principe structurant de l’autorité parentale était l’intérêt de l’enfant, apprécié in concreto, le droit de la filiation n’appréciait en revanche jamais l’intérêt concret d’un enfant précis, mais l’intérêt général de l’enfant, in abstracto ». V. égal. Dekeuwer-Défossez F., « L’intérêt de l’enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l’affaire Mandet », RLDC 2016/4, p. 39, note sous CEDH, 14 janv. 2016, n° 30955/12, Affaire Mandet c/ France : « (…) Le défaut commun de toutes les appréciations in abstracto de l’intérêt de l’enfant est de se confronter, dans la pratique, à des situations dans lesquelles les intéressés ont une vision de leur intérêt radicalement opposée au postulat législatif ou jurisprudentiel ».
-
54.
V. Pomart C., « Légiférer autrement en droit des personnes et de la famille ? Le législateur français à la croisée des chemins », in Mélanges F. Dekeuwer-Défossez, 2012, Montchrestien, p. 334 et s.
-
55.
V. Pomart-Nomdedeo C., « Volte-face législative, ou chronique de la mort annoncée du principe de survie du couple parental au-delà du couple conjugal. Réflexions sur les dispositions de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 ayant trait à la protection des enfants », LPA 1er juin 2011, p. 8-12, « Chronique de droits de l’enfant n° 7 ».
-
56.
V. Renchon J.-L., « Peut-on déterminer l’intérêt de l’enfant ? », LPA 7 oct. 2010, p. 29-34.
-
57.
V. Gouezel A., « Les actions en contestation de filiation, nouveau champ d’intervention pour l’intérêt supérieur de l’enfant ? », Dr. famille 2014, étude 6 : Mobilisations de l’article 3 de la CIDE pour tenter de contrer des dispositions législatives que les intéressés estimaient être gravement préjudiciables à leur intérêt supérieur ; Gardey de Soos B., « L’influence du droit européen sur le droit de la famille : vers la fin du droit français de la filiation ? », RJPF 2015/9, n° 4.
-
58.
V. CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie.
-
59.
V. pour illustration, la censure de la CEDH dans l’hypothèse d’un délai de prescription très court : v. CEDH, 12 janv. 2006, n° 26111/02, Mizzi c/ Malte.
-
60.
V. CEDH, 6 juill. 2010, nos 17038/04 et 36498/05, Grönmark c/ Finlande et Backlund c/ Finlande : Dalloz actualité, 16 sept. 2010, obs. Gallmeister I. La Cour européenne fustige l’application d’un délai d’introduction rigide de l’action en recherche de paternité sans tenir compte des circonstances de l’espèce.
-
61.
Le droit français accepte l’application de lois étrangères (en l’espèce, la loi allemande) qui n’intègrent pas cette logique de prescription des actions en matière de filiation (Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-14702 : D. 2015, p. 2072 ; Dr. famille 2016, comm. 15, note Farge M. ; LEFP nov. 2015, n° 10, p. 4, note Gosselin-Gorand A.).
-
62.
V., par ex. Loussouarn Y., Bourel P. et de Vareilles-Sommières P., Droit international privé, 10e éd., 2013, Dalloz, n° 528 ; Audit B. et d’Avout L., Droit international privé, 7e éd., 2013, Economica, n° 806 ; Mayer P. et Heuzé V., Droit international privé, 11e éd., 2014, Montchrestien, n° 636.
-
63.
Cass. 1re civ., 17 juin 1968, n° 66-13674, Kasapyan : Rev. crit. DIP 1969, p. 59, note Batiffol H. ; Ancel B. et Lequette Y., Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, n° 46, p. 412.
-
64.
V. not. Loussouarn Y., Bourel P. et de Vareilles-Sommières P., op. cit., n° 536 ; Audit B. et d’Avout L., op. cit., n° 800 ; Mayer P. et Heuzé V., op. cit., n° 642.
-
65.
Cass. 1re civ., 19 nov. 1985, n° 84-16001, Sté Cognacs and Brandies from France : Ancel B. et Lequette Y., op. cit., n° 71, p. 639.
-
66.
Il est vrai que la position de la Cour de cassation n’est pas nette sur cette question. V. les décisions citées in Mayer P. et Heuzé V., op. cit., n° 307, note 46. Les auteurs eux-mêmes apparaissent divisés : v. Mayer P. et Heuzé V., op. et loc. cit. ; Loussouarn Y., Bourel P. et de Vareilles-Sommières P., op. cit., n° 734.