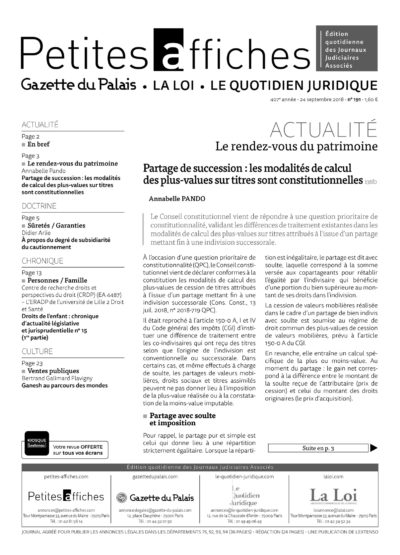Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 15 (1re partie)
S’il faut retenir un mot des débats publics les plus enflammés qui ont dominé la fin d’année 2017, c’est assurément celui de « consentement » : le consentement donné par l’enfant à une relation sexuelle avec un adulte peut-il être libre ? En droit civil, le consentement du mineur est aussi un grand sujet : il vient limiter le pouvoir de décision des titulaires de l’autorité parentale. Si les enjeux de la question du consentement de l’enfant diffèrent logiquement en droit pénal et en droit civil, les deux branches du droit se retrouvent sur un principe élémentaire : la capacité de consentir suppose la capacité de discerner, à laquelle certains textes font produire des effets spécifiques, dans un but de protection de l’enfant, parfois détournés par les parents…
Prolégomènes : Le consentement de l’enfant : comparaisons pénalo-civilistes
1. S’il faut retenir un mot des débats publics les plus enflammés qui ont dominé la fin d’année 2017, c’est assurément celui de « consentement » : le consentement donné par l’enfant à une relation sexuelle avec un adulte peut-il être libre ? Les deux faits divers médiatisés1 concernaient tous deux des fillettes de moins de 15 ans (11 ans), âge en dessous duquel la relation sexuelle consentie est constitutive, pour le partenaire majeur, du délit d’atteinte sexuelle. Mais encore faut-il que le consentement de l’enfant ait été librement donné ! Sinon, la qualification criminelle de viol prend le relais. Mais en matière de viol, la preuve du défaut de consentement est tellement délicate à apporter que la loi vise quatre circonstances censées couvrir toutes les hypothèses dans lesquelles le consentement est nécessairement absent (menace, violence, surprise, contrainte). Dans les deux affaires évoquées, les magistrats avaient justement écarté la qualification criminelle de viol, faute de « contrainte »… Le débat médiatique était alors lancé et le gouvernement de s’emparer de la question : il faut légiférer ! D’où le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles présenté le 21 mars 2018 au Conseil des ministres (art. 2)2. Mais une réforme est-elle nécessaire ? Les magistrats exploitent-ils suffisamment les potentialités des textes, qui ont le mérite d’indiquer le vrai problème : non pas directement le consentement de la victime, mais le comportement de l’auteur qui, en l’occurrence, profite de la différence d’âge et du discernement incertain de l’enfant ? Si les mots ont un sens, la contrainte morale ou la surprise ne sont-elles pas forcément caractérisées ? C’est d’ailleurs ainsi que les juges ont raisonné dans cette affaire d’agression sexuelle mettant en cause le grand-père d’une enfant âgée de 5 à 8 ans au moment des faits : la contrainte a été déduite de la différence d’âge et la surprise, de « la connaissance très limitée de la sexualité » de la part de l’enfant (Cass. crim., 18 oct. 2017, n° 16-86570)3.
Cette effervescence nous en ferait presque oublier les fondamentaux : en droit pénal, le consentement de la victime est indifférent en ce sens qu’il ne fait pas disparaître l’infraction4. Ainsi, le consentement du mineur à subir une mutilation sexuelle, pour un motif autre que médical (religieux), n’exonère ni le médecin (auteur), ni les parents (complices) de leur responsabilité pénale du chef de violences volontaires aggravées. Encore faut-il que la loi pénale française soit applicable, les faits étant bien souvent commis à l’étranger. C’était assurément le cas dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juin 20175, mais le père de l’enfant, que la mère a fait circoncire lors d’un voyage en Algérie, n’a pas choisi le terrain pénal pour régler ses comptes avec la mère : simple demande en dommages et intérêts en ce que celle-ci aurait fait procéder à l’opération sans son accord. On ne saura donc toujours pas si la circoncision rituelle qui, en soi, peut être assimilée à une mutilation sexuelle, continue de bénéficier d’une certaine tolérance, sur le fondement de la coutume justificative. Aucun doute concernant l’excision, en revanche : c’est elle qui était réellement visée par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 ayant consacré l’appellation de « mutilation sexuelle » à l’occasion de la création de deux délits-obstacles6. Tolérance zéro donc pour l’excision, d’ailleurs assimilée à une persécution7 dont la menace ouvre droit au statut de réfugié. Cette question de la prise en compte du risque de « mutilations sexuelles féminines » chez les mineures qui demandent l’asile pour ce motif, a mobilisé le législateur en 2015 : le nouvel article L. 752-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile8 prévoit la réalisation d’un examen médical visant à constater l’absence de mutilation, tout refus de s’y soumettre ou tout constat de mutilation étant transmis au procureur de la République. Bien sûr, la cause est beaucoup moins médiatique en ces temps de « crise des réfugiés »… L’arrêté du 23 août 20179, définissant les modalités de cet examen médical, ne pouvait passer que totalement inaperçu sur les écrans radars des médias.
2. En droit civil, le consentement du mineur est aussi un grand sujet, avec des enjeux bien sûr différents. Lorsque les textes l’exigent, il vient limiter le pouvoir de décision de ses parents, pouvoir qu’ils doivent exercer dans l’intérêt de l’enfant10, quant à lui frappé d’une incapacité d’exercice l’empêchant de décider pour lui-même. Les parents décident donc pour l’enfant, sauf droit de veto accordé par la loi à ce dernier, mais uniquement dans certains domaines (changement de nom, adoption) et à partir d’un certain âge (13 ans). Toutefois, l’empire parental sur la volonté de l’enfant s’effrite ces dernières décennies. Depuis 2002, l’article 371-1 précise que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » (al. 3). Ce devoir parental d’« associer » l’enfant, qui ne lui confère a priori aucun droit particulier, prend toute sa mesure en matière médicale : le Code de la santé publique amplifie la directive du Code civil au sein des articles L. 1111-2, alinéa 5, et L. 1111-4, alinéa 7, également réformés en 2002 : droit du mineur de participer à la prise de décision le concernant ; obligation pour le médecin de rechercher systématiquement le consentement du mineur. Le pouvoir de décision parental en est d’autant entravé… sauf si le mineur n’a pas encore la maturité suffisante pour être associé au processus de décision. C’est par exemple le cas des enfants intersexes auxquels les parents décident de faire subir des opérations chirurgicales de « normalisation sexuelle », le plus tôt possible. À condition de tomber juste ! Ainsi entend-on parler d’enfants assignés à un sexe qu’ils rejettent, plus tard, comme ne correspondant pas à leur « identité de genre ». L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans sa résolution n° 2191 (2017) Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes intersexes11, préconise justement d’interdire de tels actes chirurgicaux sans le « consentement éclairé » des enfants (sauf nécessité médicale), ce qui suppose de reporter l’opération à un moment où ils sont en âge de le donner. Plus qu’un droit de consentir (à la décision des parents), il est question d’un véritable « droit à l’autodétermination », c’est-à-dire d’un pouvoir de décider pour soi. Le Code de la santé publique n’est pas loin de reconnaître ce genre de prérogative à certains mineurs – ceux, de plus de 16 ans, dont « les liens de famille sont rompus »12 et ceux qui s’opposent à la consultation parentale en invoquant le droit au secret13. Toutes ces dispositions issues de la loi de 2002 ne sont malheureusement pas adaptées aux soins de santé mentale, problème que soulève le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport sur « Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale »14 : aucun texte spécifique concernant l’association du mineur aux décisions qui le concernent, recherche de son consentement inopportune, droit au secret, difficulté de mise en œuvre s’agissant d’une décision d’hospitalisation etc. D’ailleurs, en cas d’hospitalisation en soins dits « libres », la décision n’appartient qu’en apparence aux parents, lesquels subissent les pressions des services sociaux : l’autorité parentale fait pâle figure…
La loi de 2002 limite également l’autorité parentale en octroyant au médecin un pouvoir de décision, neutralisant celui des parents. En effet, en dehors même de l’hypothèse des soins urgents, le médecin peut passer outre le refus parental « risquant d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur », en administrant les soins indispensables15. Mais lorsque l’état de santé du mineur est tel que les soins « apparaissent inutiles, disproportionnés ou (…) n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie », se pose la question de l’arrêt des traitements. Comment s’articulent les dispositions du Code de la santé publique, issues de la loi Léonetti Claeys de 201616, avec l’autorité parentale, en particulier lorsque le mineur est hors d’état de manifester sa volonté ? La volonté des parents se substitue-t-elle à la volonté du mineur, a fortiori quand elle est impossible ? La question n’est pas saugrenue. On sait bien que la représentation légale des parents est une représentation imparfaite : « les parents possèdent plus que le simple droit d’agir à [la place de l’enfant], ils possèdent la faculté de l’exclure de ses droits »17 – sauf à considérer que ce système trouve ses limites lorsqu’il est question du « droit [du mineur] d’avoir une fin de vie digne »18, ce qui n’a rien de saugrenu non plus. Le Conseil d’État s’est prononcé par quatre fois sur la question. L’arrêt des soins d’un patient hors d’état de manifester sa volonté, même mineur, est une décision médicale, prise collégialement selon la procédure légale. L’accord des parents doit certes être recherché par le médecin, mais leur refus est impuissant à lui seul à empêcher l’exécution de la décision médicale – qu’il s’agisse d’ailleurs de l’arrêt des soins ou du choix du traitement le plus approprié : la loi ne reconnaît pas au patient le droit de choisir son traitement, encore moins aux parents du patient mineur (CE, 26 juill. 2017, n° 41261819) ! Leur seule marge de manœuvre consiste à démontrer l’absence d’obstination déraisonnable à poursuivre les traitements devant le juge administratif, lequel n’hésitera pas à remettre en cause la décision médicale (CE, 8 mars 2017, n° 40814620), l’intérêt supérieur de l’enfant étant pour lui une considération primordiale (CE, 6 déc. 2017, n° 40394421). Pour autant, si le recours des parents est rejeté, « il appartiendra au médecin d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si et dans quel délai la décision d’arrêt de traitement doit être exécutée » (CE, 5 janv. 2018, n° 41668922). Pragmatisme et humanisme du Conseil d’État : l’autorité parentale n’est pas complètement bafouée.
Elle l’est en revanche totalement lorsque les soins sont imposés par la loi : les parents ne peuvent refuser de soumettre leur enfant aux obligations légales de vaccination, dont le champ vient d’être étendu à huit nouveaux vaccins par l’article 49 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité sociale pour 201823 – réduisant d’autant le pouvoir de décision des parents en la matière. Certes, la loi a abrogé l’incrimination spécifique du refus parental24, mais pour remplacer la sanction pénale par une sanction autrement plus efficace : l’exclusion de l’enfant de « toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants » si les vaccins n’ont pas été réalisés dans le délai de 3 mois25 – sans compter les incriminations générales (au titre de la mise en danger de l’enfant).
3. Si les enjeux de la question du consentement de l’enfant diffèrent logiquement en droit pénal et en droit civil, les deux branches du droit se retrouvent sur un principe élémentaire : la capacité de consentir suppose la capacité de discerner. Cela dit, les seuils d’âge retenus pour faire produire effet au consentement/refus de l’enfant sont suffisamment élevés (13 ou 15 ans) pour que la question du discernement ne se pose pas. L’émergence (progressive) chez l’enfant de la capacité de discerner produit des effets propres, et non des moindres : accès à la responsabilité pénale26, prise en compte de sa parole en justice27. À tel point que l’on pourrait s’étonner du fait que le droit français ne prend jamais la peine de fixer précisément l’âge du discernement de l’enfant. C’est qu’a priori le discernement n’est pas qu’une question d’âge : au juge d’apprécier au cas par cas, en fonction du degré de maturité de l’enfant appréciée in concreto en considération de l’acte envisagé. Par exemple, un enfant de 11 ans, sous l’emprise d’une mère fusionnelle dont il adoptait le discours négatif sur le père, sans être en mesure de le critiquer, sur fond de litige relatif à la résidence de l’enfant attribuée au père et contestée en appel par la mère, peut-il vraiment être considéré comme doué de discernement, et avoir le droit d’être entendu en justice ? Malheureusement, dans son arrêt du 14 septembre 201728, la première chambre civile de la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de répondre à cette question, l’enjeu du débat étant d’ordre procédural.
Le discernement n’est pas une question d’âge… sauf en matière de capacité pénale. Le droit pénal prévoit en effet plusieurs paliers : avant 13 ans, le mineur est présumé ne pas avoir la maturité suffisante pour tirer profit d’une peine ; de 13 à 16 ans, oui, mais il bénéficie de l’excuse de minorité (peine divisée par deux) ; à partir de 16 ans, la présomption d’insuffisance de maturité peut être renversée et l’excuse de minorité écartée, le mineur étant alors traité comme un majeur. C’est du moins ce que prévoit l’article 122-8 du Code pénal. L’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) du 27 mars 2018 sur la privation de liberté des mineurs29 nous ramène cependant à la réalité : l’excuse de minorité est de plus en plus souvent écartée pour les mineurs de 16 à 18 ans, créant « un abaissement insidieux de la majorité pénale à 16 ans »30. Et la jurisprudence administrative de nous faire prendre conscience des enjeux dramatiques de cette question : violence du détenu contre lui-même (suicide) ou contre autrui (agression de codétenus). En cas de passage à l’acte, il ne reste plus qu’à rechercher la responsabilité de l’administration pénitentiaire, dont le régime varie en fonction des circonstances : responsabilité pour faute, lorsque le mineur retourne la violence contre lui (suicide) (CAA Nancy, 24 oct. 2017, n° 16NC0077531) ; sans faute, lorsqu’il la retourne contre autrui (agression physique) (CAA Versailles, 23 mai 2017, n° 16VE0626532). La détention est ainsi identifiée, aujourd’hui, comme un risque majeur de vulnérabilité pour le mineur.
Quoi qu’il en soit, en matière de responsabilité pénale, la solution de l’article 122-8 du Code pénal donne parfois de belles idées aux parents, ce qu’illustre l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 novembre 201733. Voilà, en effet, des parents qui n’ont pas hésité à indiquer comme titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule qu’ils utilisaient leur propre enfant de 5 ans ! La pratique est connue : elle permet d’échapper au fatidique retrait de points qui ne peut frapper qu’une personne titulaire d’un permis de conduire, forcément majeure. Pratique si fréquente que le législateur a réagi en 2016 en interdisant l’immatriculation d’un véhicule au nom d’un mineur34. Mais l’enjeu était différent en l’espèce : l’enfant avait été déclaré coupable par le juge de proximité des chefs de stationnements irrégulier et gênant. La violation de l’article 122-8 du Code pénal était flagrante : faute de discernement, ces infractions ne pouvaient être imputées à l’enfant. Mais soyons rassurés : la réforme de 2016 rend désormais impossible cette instrumentalisation de l’enfant.
De l’instrumentalisation de l’enfant à la manipulation de celui-ci, il n’y a qu’un pas… Le droit de la parole de l’enfant en justice en fournit quelques exemples jurisprudentiels qui démontrent que l’exigence légale du discernement de l’enfant n’est pas forcément une garantie suffisante pour éviter tout risque de manipulation de la part d’un parent. Dans l’absolu, on peut sans doute regretter l’absence de recours possible contre le refus par le juge d’auditionner l’enfant, mais dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt précité du 14 septembre 2017, cette insuffisance du droit, au regard des droits de l’enfant, a tout de même permis de couper court aux tentatives procédurales de la mère de remettre en cause le transfert de résidence de l’enfant chez son père. Cette « insuffisance du droit » combinée à l’absence d’effet dévolutif de l’appel en la matière, rendait nécessaire une nouvelle demande d’audition devant la cour d’appel, saisie du litige sur la résidence, demande que la mère a sans doute jugée trop risquée…
Rien, là, qui ne mérite d’être incriminé pénalement, contrairement à ce cas particulier de manipulation : le « terrorisme par incitation parentale »35, qui a fini par retenir l’attention d’un législateur si friand de nouvelles incriminations en matière de terrorisme. En effet, le nouvel article 421-2-4-1 du Code pénal issu de la loi n° 2017-510 du 30 octobre 2017 renforçant la lutte contre le terrorisme36, érige en crime le fait, pour une personne ayant autorité sur un mineur, de l’inciter à participer à un groupement terroriste et punit ce cas spécial d’instigation plus sévèrement que celui a priori plus général de l’article 421-2-4 (simple délit). Dans un tel cas de figure, quelle est la responsabilité pénale du mineur lui-même – sachant que la participation à un groupement terroriste est un crime37 ? S’il n’est pas doué de discernement, la question est réglée : il est irresponsable. Dans le cas contraire, il ne lui restera plus qu’à tenter de démontrer la contrainte (morale), rarement admise, pour échapper à une responsabilité pénale qui dérange. Certes, l’ordonnance de 1945 adapte le sort pénal du mineur, mais le problème se situe en amont : où est le libre arbitre d’un enfant incité à agir par un adulte « ayant autorité » sur lui, a fortiori ses propres parents ?
C’est que notre droit repose sur le postulat libéral : je suis responsable car libre d’avoir agi comme je l’ai fait. Mais peut-on agir de manière totalement libre, a fortiori lorsque l’on est mineur ? Un consentement peut-il être entièrement libre, a fortiori lorsqu’il émane d’un mineur ? Les sciences humaines et sociales, et aujourd’hui les sciences « dures » (les neurosciences), n’ont de cesse de mettre en évidence nos déterminismes, avec plus ou moins de nuances. Mais le droit reste campé sur son fondement libéral, véritable paradigme dont la pratique judiciaire et les fabricants de projets de lois ont du mal à se défaire – la concentration du débat relatif aux violences sexuelles sur mineurs sur la question du consentement le démontre…
Christine DESNOYER
I – La dignité de l’enfant en fin de vie
CE, 8 mars 2017, n° 408146 ; CE, 26 juill. 2017, n° 412618 ; CE, 6 déc. 2017, n° 403944 ; CE, 5 janv. 2018, n° 416689. Les quatre décisions référencées ci-dessus ont donné l’occasion aux juges du Palais Royal de se prononcer sur la mise en œuvre, pour le moins délicate, de la loi Léonetti Claeys du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie38, dans l’hypothèse où le patient est un mineur, hors d’état de manifester sa volonté en raison de son jeune âge ou de son tableau médical.
Cette loi reprend très largement les apports du Conseil d’État dans l’affaire Vincent Lambert39. Aussi pour l’application des articles 2, 3 et 8 de la loi, le législateur a adopté un décret le 3 août 201640 précisant l’organisation de la procédure collégiale encadrant les décisions, d’une part, d’arrêt et de limitation en cas d’obstination déraisonnable lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et, d’autre part, de recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès du patient. Les articles R. 4127-36 et R. 4127-37 et suivants du Code de la santé publique (CSP) ont été modifiés en conséquence. En substance, lorsque le médecin en charge d’un patient, qu’il soit majeur ou mineur, envisage la limitation ou l’arrêt de traitement, il doit engager une procédure collégiale qui prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, étant précisé qu’il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. À la demande de l’un ou l’autre des médecins, il est possible de demander un autre avis auprès d’un deuxième médecin consultant. Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt des traitements concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.
Le législateur a fait un choix de société en reconnaissant au profit du corps médical le pouvoir de décider la limitation ou l’arrêt des traitements dans les différentes hypothèses où le patient ne serait pas en mesure d’exprimer sa volonté41, sans être lié par les différents avis ou consultations sollicités auprès de la famille ou des proches. Ces avis n’ont alors pour seule finalité que d’éclairer et d’aider le médecin en charge du patient dans la décision qu’il va prendre et qui sera lourde de conséquences. Aux questionnements intimes, éthiques, philosophiques, religieux, ou encore moraux auxquels sont confrontés les médecins dans leur pratique, vont s’ajouter les questionnements particulièrement douloureux pour l’entourage du jeune patient confronté au dilemme qui se pose entre vouloir maintenir les traitements ou entreprendre de nouveaux traitements, au nom de l’espoir d’une potentielle amélioration suscitée par les progrès sans cesse croissants de la recherche ou encore, se résoudre à l’inacceptable.
L’ensemble du dispositif a fait l’objet d’un contrôle opéré par le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une QPC42 sur question transmise par le Conseil d’État lui-même43, d’un contrôle de conventionnalité par le Conseil d’État44 et enfin d’un contrôle de la Cour EDH45. Les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité ont été l’occasion pour les juges de préciser certains points de la loi, afin de rassurer sur les garanties entourant la décision médicale. Toutefois, ce dispositif suscite des interrogations et de vives critiques, en particulier, lorsqu’il y a un conflit entre le corps médical et la famille sur le devenir de l’enfant mineur. Sur le plan du droit de la famille et des droits reconnus aux parents dans le cadre de l’autorité parentale, la critique porte principalement sur le poids du pouvoir reconnu au médecin, considéré comme une ingérence injustifiée dans l’exercice des prérogatives parentales46. En effet, dans l’hypothèse d’une décision médicale impliquant la limitation ou l’arrêt d’un traitement, le consentement parental ne va pas s’imposer au corps médical en cas de désaccord, tel un veto. Cette ingérence n’est pas en soi une nouveauté, il existe bien d’autres situations dans lesquelles l’autorité parentale va céder face au pouvoir médical dans le seul intérêt du mineur47 (I). Quoi qu’il en soit, nul ne peut prétendre que le pouvoir médical va alors s’exercer de manière arbitraire. En cas de conflit, le juge, gardien des droits et libertés du mineur, pourra être saisi. Il apparaît comme un garde-fou contre tout arbitraire, contre l’erreur médicale qui pourrait être commise par excès ou par défaut. À l’instar du médecin, il devra lui aussi faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans le conflit opposant le corps médical et les parents (II).
I. La consécration du pouvoir médical au détriment de l’autorité parentale
Malgré l’émotion, voire l’indignation que peuvent susciter les dispositions de la loi Leonetti Claeys chez certaines personnes, il faut garder à l’esprit que la loi de 2016 s’inscrit dans un mouvement amorcé depuis plusieurs années.
Selon les termes de l’article 371-2 du Code civil, les père et mère disposent du droit et du devoir de surveiller la santé du mineur. Ils ont le droit, ainsi que le devoir de le faire soigner et d’éviter sa mise en danger. Concrètement, chaque parent exerçant l’autorité parentale est habilité à décider d’un traitement médical bénin, le consentement des deux parents étant nécessaire pour les interventions plus graves. Tel est le principe admis en jurisprudence48.
En application des règles relatives à l’autorité parentale, dans des cas graves comme la séropositivité, la toxicomanie ou encore une maladie sexuellement transmissible d’un mineur, l’impossibilité de commencer un traitement sans le consentement des parents devrait obliger le médecin, soit à trahir la confiance du malade, en prévenant les parents afin d’obtenir leur consentement, soit risquer de voir celui-ci se soustraire aux soins avec des conséquences graves pour sa santé. Pourtant l’article 42 du Code de déontologie49 précise qu’un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. On remarquera que selon la formule employée, le médecin doit déployer tous ses efforts afin de rendre possible le recueil du consentement parental, mais qu’il ne s’agit pas d’un impératif, ni d’une quelconque obligation de résultat.
Pour résoudre ces difficultés, la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit un article L. 1111-5 au Code de la santé publique qui prévoit que le mineur peut s’opposer à la consultation des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, ce qui permet au médecin de se dispenser du consentement des titulaires de l’autorité parentale lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur50. L’objectif visé par la loi Kouchner est de permettre à des adolescents en situation difficile d’avoir accès aux soins et d’aider les professionnels à faire face à la détresse des mineurs51. Contrairement à ce qu’on l’on pourrait croire, ce n’est pas la volonté de l’enfant qui est source de dérogation à l’autorité parentale, mais la nécessité médicale, le devoir de préserver le secret du mineur sur son état de santé. Si le secret médical répond à un intérêt privé52, il répond également à un intérêt public, selon lequel chacun doit pouvoir être convenablement soigné et avoir la garantie de pouvoir se confier à un médecin, quel que soit son âge, son sexe, ou encore son origine ethnique, même s’il est dans une situation sociale irrégulière, voire marginale, pour bénéficier de soins, sans craindre d’être trahi ou dénoncé53.
Inversement, le médecin peut soigner un enfant alors même que ses parents se seraient opposés à l’acte médical54. La loi Kouchner permet donc au médecin de passer outre le refus de consentement des parents, dès lors que l’état de santé du mineur l’exige.
En revanche, le Code de la santé publique vise des situations bien précises dans lesquelles le consentement parental est nécessaire. Ainsi par exemple, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement parental en matière de prélèvement de cellules dans la moelle osseuse ou le sang d’un mineur55 ou encore dans le domaine de la recherche biomédicale impliquant un mineur56. Dans ces hypothèses, le mineur, s’il est en mesure de le faire, doit également consentir.
Dans l’hypothèse de la décision de limitation ou de l’arrêt de traitement, décision d’une extrême gravité, le législateur a fait le choix de ne pas faire du consentement parental une condition de licéité de la décision médicale. La réponse à la question de savoir pourquoi le législateur a choisi ce parti-pris semble devoir être recherchée dans les affres de l’affaire Vincent Lambert. Est-il nécessaire de rappeler les discordes, les rancœurs, ainsi que la bataille médiatique et judiciaire qui ont ôté tout pouvoir au corps médical et toute dignité à la personne de Vincent Lambert ? Nous ne le pensons pas. Dans un sens, la loi de Léonetti Claeys n’a pas fait que reprendre les apports de la jurisprudence du Conseil d’État, confortée, il convient de le souligner, par la Cour EDH57.
Mais que l’on se rassure, la procédure telle qu’elle a été prévue par le législateur, renforcée par les décisions du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 et du Conseil d’État le 6 décembre 201758, offre les garanties nécessaires contre l’arbitraire du pouvoir médical. Les conditions de licéité de la décision médicale sont relativement strictes et traduisent le souci du législateur de trouver une position consensuelle entre le corps médical et les parents. Ainsi, à l’occasion de la concertation avec l’équipe de soins et le médecin consultant, le médecin en charge du mineur devra tenir compte d’éléments médicaux et non médicaux, appréciant la situation dans sa singularité, afin de caractériser l’obstination déraisonnable qui commanderait une telle décision. Lorsque le médecin se rapprochera des parents de l’enfant afin de recueillir leur avis, il devra, conformément à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, leur délivrer une information complète, claire, loyale et intelligible portant sur les traitements suivis, les traitements alternatifs, palliatifs, l’interprétation des différents examens médicaux, l’évolution de l’état de santé de l’enfant, les possibles causes de souffrance, etc. Les parents sont donc associés au processus décisionnel. Si la décision est prise de limiter ou d’arrêter les traitements, le médecin en charge de l’enfant devra la motiver, quel que soit le positionnement des parents, la joindre au dossier médical et la notifier aux personnes qui auront été consultées, donc les parents, pour qu’ils puissent exercer un éventuel recours en cas de désaccord. Aux conditions de forme, enrichies par la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d’État59 a ajouté deux autres obligations de fond qui ne sont en rien novatrices ou ignorées des services de soins. D’une part, le médecin doit être guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à l’égard de son patient et, d’autre part, lorsque le patient est un mineur, il doit faire de l’intérêt de l’enfant une considération primordiale.
L’obligation pour le médecin d’être guidé par le souci de la plus grande bienfaisance est en effet une composante du serment d’Hippocrate, rédigé au IVe siècle avant J.-C. que prête tout futur praticien : « (…) Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité (…). Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément (…) ». La bienfaisance, définie comme la volonté d’optimiser la qualité de vie, fait également partie des quatre principes qui gouvernent la réflexion éthique60. Ainsi, face à une décision de limitation ou d’arrêt de traitement, le médecin, moralement et juridiquement responsable, se doit de prendre d’infimes précautions afin de conclure au caractère déraisonnable d’un traitement. Aux yeux de la loi, la décision médicale n’est pas le résultat d’un choix arbitraire, le choix d’un seul médecin. La procédure collégiale imposée par la loi doit lui permettre de recueillir l’avis des professionnels médicaux et paramédicaux qui s’occupent du patient au quotidien et partage son intimité. À ce titre, la notion « d’équipe de soins » doit être entendue au sens large ; celle-ci comprend les différents médecins, les internes, les infirmier(e)s de jour et de nuit, les aides-soignant(e)s, voire encore les kinésithérapeutes, etc. L’avis du médecin consultant est d’autant plus important qu’il est supposé neutre, impartial parce qu’il n’est pas impliqué émotionnellement dans la prise en charge du patient. En outre, dans de très nombreuses structures de soins, cette procédure collégiale peut être doublée de la consultation d’un comité d’éthique. La création de ces comités est largement encouragée depuis les années 199061. Dans ce cadre, le médecin peut ainsi interpeller d’autres personnes, membres du corps médical, travailleurs sociaux, psychologues, juristes, philosophes, représentants du culte afin de bénéficier d’une aide à la décision62. Le rôle de ces comités, parfois convoqués dans l’urgence, n’est pas d’apporter une réponse toute prête, mais de réfléchir aux enjeux éthiques de la situation au regard des éléments médicaux et non-médicaux, afin de dégager la « moins mauvaise solution » pour le patient, pour ses proches et les soignants face à la singularité d’une situation de soins. Si la bienfaisance et la bientraitance sont au cœur des préoccupations des professionnels de santé et de ces comités, il en est de même de l’intérêt supérieur de l’enfant. Et à supposer que, malgré ces multiples garanties, le médecin ait pris une décision à laquelle les parents s’opposent, ces derniers ont la possibilité de saisir le juge qui devra trancher ce conflit dans le respect des droits fondamentaux du mineur. L’enfant, quel que soit son âge, est au cœur de la décision médicale.
II. Le juge : gardien des droits et libertés de l’enfant mineur
Nombreuses sont les dispositions figurant dans le chapitre préliminaire du Code de la santé publique qui se fondent sur le principe l’intervention du juge. En effet, parce que le droit fondamental à la protection de la santé suppose que soient mis en œuvre tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne63, parce que la personne malade a droit au respect de sa dignité64, parce que les décisions médicales de limitation ou d’arrêt de traitement entraînent des conséquences souvent irréversibles, l’intervention du juge, gardien naturel des droits et libertés fondamentales au sens de l’article 66 de la constitution, apparaît donc justifiée. Mais c’est sans conteste la décision du Conseil constitutionnel et ses réserves d’interprétation relatives notamment à la saisine du juge qui confortent le rôle du juge, érigé en rempart naturel contre un éventuel arbitraire médical.
Ainsi, dans l’hypothèse où le médecin décide de limiter ou d’arrêter les traitements, il doit motiver cette décision et la notifier aux personnes qui ont été consultées afin que les parents puissent, en cas de désaccord, exercer un recours en temps utile, c’est-à-dire avant l’exécution de la décision médicale. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs précisé que ce recours devait être examiné dans les meilleurs délais par la juridiction compétente, administrative ou judiciaire statuant en référé. Dans un premier temps, le contrôle du juge portera sur le respect de la procédure, c’est-à-dire que le juge devra vérifier que la procédure collégiale a bien été mise en œuvre et qu’un second médecin, ne présentant aucun rapport hiérarchique avec le premier, a bien donné son avis sur la situation. Dans un second temps, le contrôle du juge portera sur le fond, c’est-à-dire qu’il devra vérifier si le médecin a apprécié la singularité de la situation65, faisant œuvre de bienfaisance et que ce dernier a fait de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale, afin d’éviter les erreurs par excès (le maintien des traitements relève de l’obstination déraisonnable) ou les erreurs par défaut (le médecin renonce trop vite). Si les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéficie escompté et qu’ils ne doivent pas être mis en œuvre lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable, il n’en reste pas moins que toute personne doit recevoir les soins qui sont les plus appropriés à son état de santé. Dans sa décision du 8 mars 201766, à l’issue de son contrôle, le juge des référés a suspendu la décision d’arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales (alimentation artificielle et ventilation mécanique) au motif que malgré le pronostic extrêmement péjoratif établi par les experts médicaux, compte tenu des éléments d’amélioration constatés de l’état de conscience de l’enfant âgé de moins d’un an et de l’incertitude à la date de la décision sur l’évolution future de cet état, l’arrêt des traitements ne pouvait être regardé comme pris au terme d’un délai suffisamment long pour évaluer de manière certaine les conséquences de ses lésions neurologiques. Alors que l’enfant a été admis le 25 septembre 2016 en réanimation pédiatrique en raison d’un choc cardiogénique, la décision d’arrêt de la poursuite des thérapeutiques actives a été décidée le 4 novembre 2016. Inversement, dans la décision du 26 juillet 201767, le juge des référés a conclu que toutes les précautions avaient bien été prises par le médecin et qu’aucune obligation tirée de l’article 2 de la convention EDH, garantissant le droit à la vie, ne lui imposait de prescrire un traitement plutôt qu’un autre. En l’espèce, la décision médicale de mettre en place un traitement palliatif, unanimement décidée par trois équipes médicales de trois établissements hospitaliers (Nice, Marseille et Montpellier) était motivée par la certitude qu’une chimiothérapie, réclamée par le père de l’enfant, ne constituait pas le traitement le plus approprié compte tenu de la très forte probabilité de son inutilité, des grandes souffrances, ainsi que des risques élevés qu’il entraînerait sur l’enfant. Pour le juge, les éléments médicaux figurant au dossier étaient à eux seuls suffisants.
D’une manière générale, dans les situations soumises au Conseil d’État, il convient de reconnaître que le contrôle du juge dont la nécessité est reconnue par le Conseil constitutionnel n’est pas un contrôle stéréotypé, in abstracto, mais bien un contrôle in concreto, à l’instar du contrôle de proportionnalité opéré par la Cour EDH. Dans tout acte de prévention, d’investigation ou de soins, les médecins doivent effectuer un bilan en tenant compte à la fois des risques et du bénéfice escompté pour la santé et le bien-être du patient. Ce contrôle est d’autant plus important que l’exécution ou non d’une décision médicale au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant en dépend.
On relèvera que le Conseil d’État a clairement introduit le critère supérieur de l’enfant dans le processus de la décision médicale. En soi, cette position est conforme à l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être l’un des premiers éléments à prendre en compte dans toutes les décisions concernant l’enfant, en particulier, lorsqu’il s’agit de sa santé, puisque la décision qui sera prise aura une incidence sur son pronostic vital. Est-il bien nécessaire de rappeler que, selon les termes mêmes de l’article 371-1 du Code civil, « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » ?
Mais l’intérêt supérieur de l’enfant va également permettre, en dernier recours, de trancher un conflit entre le corps médical et les parents. En effet, il doit rester, dans l’esprit des juges français mais aussi européens, une référence normative sur laquelle ils peuvent s’appuyer pour fonder leur interprétation d’un texte, pour en écarter l’application le cas échéant, voire pour interpréter une catégorie juridique68. Le Conseil d’État n’est pas le seul à reconnaître un tel rôle à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans un arrêt en date du 15 mars 201769, la Cour de cassation a elle aussi considéré qu’un conflit parental dans le domaine de la santé devait être tranché en considération du seul intérêt de l’enfant. En l’espèce, la mère d’un enfant, alors âgé de 11 ans, avait assigné son ex-mari afin d’être autorisée à faire bénéficier leur fils d’un traitement médical à base d’hormones de croissance. Face aux craintes exprimées par l’enfant à l’occasion de son audition et en prenant en compte son ressenti par rapport à sa petite taille, les juges du fond en ont déduit que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait de rejeter la demande de la mère.
Certains craignent un déséquilibre de la place de l’autorité parentale au profit du corps médical. Pour autant, les prérogatives liées à l’autorité parentale sont loin d’être absolues et peuvent souffrir d’ingérences dans le seul intérêt de l’enfant. Certes, l’enfant n’est pas un adulte en réduction70, mais il n’en reste pas moins une personne dont la dignité doit être respectée. Il revient aux parents, médecins, juges, le cas échéant, de le protéger contre les affres de la douleur et de la souffrance.
Fanny VASSEUR-LAMBRY
II – L’intégrité de l’enfant
A – L’intégrité corporelle de l’enfant
1 – Les vaccinations obligatoires
2 – Circoncision et intersexualité
3 – Droit d’asile et examen médical de non-excision
B – L’intégrité sexuelle de l’enfant
C – L’intégrité psychique de l’enfant
1 – L’intégrité psychique altérée : l’admission de l’enfant en établissement de santé mentale
2 – L’intégrité psychique en formation ou la question du discernement
a – L’irresponsabilité pénale de l’enfant
b – La parole de l’enfant manipulée
c – L’endoctrinement terroriste de l’enfant
III – La liberté de l’enfant
A – La détention, facteur de vulnérabilité du mineur
1 – La responsabilité de l’État à raison du suicide d’un détenu mineur
2 – La responsabilité de l’État en raison des violences commises par un détenu mineur
B – La privation de liberté des mineurs en question
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
C. assises Seine-et-Marne, 7 nov. 2017 et T. corr. Pontoise, 13 févr. 2018.
-
2.
Commentaire par Cathy Pomart.
-
3.
Commentaire par Marion Majorczyk.
-
4.
Sauf à ce que le défaut de consentement soit érigé en élément constitutif de celle-ci, comme en matière de viol.
-
5.
Commentaire par Roxanne Allain.
-
6.
C. pén., art. 227-24-1 : « Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée ».
-
7.
Au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
-
8.
Issu de la L. n° 2015-925, 29 juill. 2015, sur la réforme du droit d’asile.
-
9.
Commentaire par Valérie Mutelet.
-
10.
Et d’un commun accord, l’exercice commun de l’autorité parentale étant conjoint. Et peu importe que l’acte litigieux soit un acte usuel de l’autorité parentale : la coparentalité doit être respectée par les deux parents quelle que soit la nature de l’acte, qui ne conditionne que la responsabilité du tiers de bonne foi (C. civ., art. 372-2). À la lecture de l’arrêt précité du 1er juin 2017, on voit que la confusion arrive vite…
-
11.
Commentaire par Roxanne Allain.
-
12.
CSP, art. L. 1111-5, al. 2.
-
13.
CSP, art. L. 1111-5, al. 1er.
-
14.
Commentaire par Françoise Dekeuwer-Defossez.
-
15.
CSP, art. L. 1111-4, al. 7.
-
16.
L. n° 2016-87, 2 févr. 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
-
17.
Bonfils P. et Gouttenoire A., Droit des mineurs, 2e éd., 2014, Dalloz, Précis, n° 1091.
-
18.
CSP, art. L. 1110-5.
-
19.
Commentaire par Fanny Vasseur-Lambry.
-
20.
Ibid.
-
21.
Ibid.
-
22.
Ibid.
-
23.
Commentaire par Cathy Pomart.
-
24.
Abrogation de CSP, art. L. 116-4.
-
25.
D. n° 2018-42, 25 janv. 2018, relatif à la vaccination obligatoire.
-
26.
C. pén., art. 122-8.
-
27.
C. civ., art. 388-1.
-
28.
Commentaire par Blandine Mallevaey.
-
29.
Commentaire par Nadia Beddiar.
-
30.
Avis CNCDH, p. 6.
-
31.
Commentaire par Anne Jennequin.
-
32.
Commentaire par Nadia Beddiar.
-
33.
Commentaire par Alexandre Grégoire.
-
34.
C. route, art. L. 322-1-1, issu de la L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle.
-
35.
Expression du professeur Mayaud Y., cité par Perrier J.-B., « La loi renforçant la lutte contre le terrorisme et l’atteinte à l’État de droit », D. 2018, p. 24.
-
36.
Commentaire par Sophie Visade.
-
37.
C. pén., art. 421-2-1 et C. pén., art. 421-5.
-
38.
L. n° 2016-87, 2 févr. 2016 : Cheynet de Beaupré A., « Fin de vie : l’éternel mythe d’Asclépios », D. 2016, p. 472.
-
39.
CE, 24 juin 2014, n° 375081 : Lebon 2014, p. 32, concl. Keller R. ; LPA 4 avr. 2014, p. 7, note Mémeteau G. ; Dr. famille 2014, comm. 141, note Binet J.-R. ; Vigneau D., « L’affaire Vincent Lambert et le Conseil d’État », D. 2014, p. 1856.
-
40.
D. n° 2016-1066, 3 août 2016 : JO, 5 août 2016 ; JCP A 2016, act. 666 ; Vialla F., « Penser sa mort ? À propos des décrets du 3 août 2016 », D. 2016, p. 1869.
-
41.
Trois hypothèses sont visées à l’article R. 4127-37-2 du Code de la santé publique : le patient majeur hors d’état d’exprimer sa volonté en raison du tableau médical ; le patient mineur qui, en raison de bas âge ou de son état de santé, ne pourrait exprimer son souhait et le patient majeur sous tutelle.
-
42.
Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-632 QPC : Dr. famille 2017, alerte 48, note Lamarche M. ; D. 2017, p. 1194, note Vialla F.
-
43.
CE, 3 mars 2017, n° 403944 : Dr. famille 2017, comm. 117, note Binet J.-R.
-
44.
CE 6 déc. 2017, n°403944, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés (UNAFTC) : Jurisdata n°2017-003869 ; JCP A 2017, act.844 ; M.-L. Moquet-Anger, « Décision d’arrêt de traitement d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté : conditions de légalité et de mise en œuvre », JCP, éd. A, n°6, 12 févr. 2018. 2050.
-
45.
CEDH, 23 janv. 2018, n° 1828/18, Afiri et Biddarri c/ France (décision d’irrecevabilité de la requête) : D. 2018, p. 245, note Vialla F.
-
46.
CE, ord., 6 déc. 2107, n° 403944 : Dr. famille 2018, comm. 51, note Le Gouvello A.
-
47.
Vialla F., « Relation de soin et minorité », LPA 20 mars 2015, p. 10 et s.
-
48.
CA Paris, 29 sept. 2000, Juris-Data n°2000-145100, D. 2001, p. 1985, note C. Duvert .
-
49.
CSP, art. R. 4127-42.
-
50.
Rey-Salmon C., « Secret médical et personnes vulnérables : le cas du mineur », D. 2009, p. 2651.
-
51.
V. les travaux parlementaires de la loi Kouchner du 4 mars 2002 : art. 2 bis (CSP, art. L. 1111-5-1 : Dispenses de consentement des titulaires de l’autorité parentale pour la réalisation d’actes médicaux sur un mineur : www.senat.fr/rap/a14-628/a14-6285.html).
-
52.
Le secret médical dérive du principe de liberté personnelle consacré à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et consacré à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
-
53.
Kahn A., « Le secret médical : d’Hippocrate à internet », D. 2009, p. 2623.
-
54.
CSP, art. L. 1111-4, al. 7.
-
55.
CSP, art. L. 1241-3.
-
56.
CSP, art. L. 1122-2, II.
-
57.
CEDH, 5 juin 2015, n° 46043/14, Lambert et a. c/ France : D. 2015, p. 1625 ; JCP G 2015, 805, note Sudre F.
-
58.
CE, 6 déc. 2017, n° 403944.
-
59.
Ibid, cons. n° 11.
-
60.
Les trois principes sont : la non maltraitance, l’autonomie et la justice, v. Svandra P., Le soignant et la démarche éthique, 2009, Estem, p. 71-80 ; Beauchamp T. et Childress J., Les principes de l’éthique biomédicale, 2008, Les Belles Lettres.
-
61.
Selon le CCNE (Recommandation sur les comités locaux, Rapport n° 13, 7 nov. 1988), les comités d’éthique ont pour objet de faciliter la décision des médecins qui ont à résoudre des problèmes d’ordre éthique à l’occasion de l’exercice de leur activité, notamment dans leurs rapports avec les malades et leur famille : http://www.erebfc.fr/userfiles/files/avis013_ccne_sur_comite_local.pdf.
-
62.
Quelques exemples : http://www.ethique-npdc.fr/ch_douai/dateFilter/2017/03/ (CH de Douai) ; http://www.ch-bourg-en-bresse.fr/le-comite-d-ethique.htm (CH de Bourg en Bresse) ; http://www.ch-dax.fr/Presentation/Notre-demarche-qualite-et-securite/Les-sous-commissions/Le-comite-d-ethique (CH de Dax) ; http://hopital-georgespompidou.aphp.fr/vie-lhopital/ethique/ (CHU de Paris Ouest).
-
63.
CSP, art. L. 1110-1.
-
64.
CSP, art. L. 1110-2.
-
65.
CE, ord., 5 janv. 2018, n° 416689 : JCP A 2018, n° 6, note Castaing C. ; AJDA 2018, p. 578, note Bioy X.
-
66.
CE, ord., 8 mars 2017, n° 408146 : Dr. famille 2017, comm. 114, note Mirkovic A. ; RDSS 2017, p. 698, note Thouvenin D.
-
67.
CE, ord., 26 juill. 2017, n° 412618 : Lebon ; AJDA 2017, p. 1887, chron. Odinet G. et Roussel S.
-
68.
« Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant : ce qu’il signifie et ce qu’il implique pour les adultes », conférence de Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Strasbourg 30 mai 2008, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp ?p=&id=1313889&Site=&direct=true.
-
69.
Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n° 16-24055, D.
-
70.
Thouvenin D., « L’arrêt de traitement qui mettrait fin à la vie d’un très jeune enfant : un bébé n’est pas un adulte en réduction », RDSS 2017, p. 698.