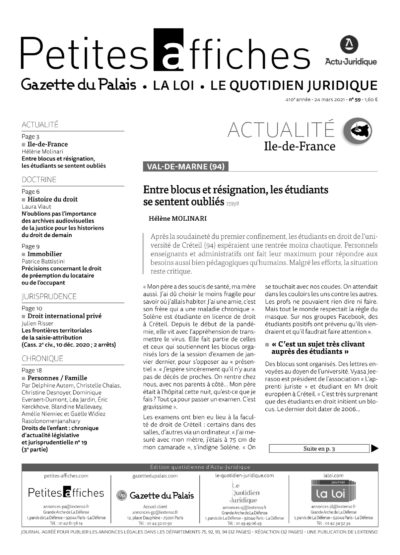Droits de l’enfant : chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 19 (3e partie)
La constitutionnalisation en 2019 de l’intérêt supérieur de l’enfant par le juge constitutionnel est l’occasion de se pencher sur la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’intérêt de l’enfant devant les différents ordres de juridictions. L’impression d’ensemble est celle d’un Conseil constitutionnel qui tente de rattraper son retard, derrière un juge judiciaire toujours en prise avec les subtilités du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant et un juge administratif qui conquiert de nouveaux domaines en matière de plein contentieux.
I – Le juge constitutionnel : le nouvel impératif constitutionnel de l’« exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant »
A – L’enfant migrant : un impératif hypocrite ?
1 – L’âge de l’enfant migrant
2 – Le fichage de l’enfant migrant
B – L’enfant né sous X : un impératif relativisé par le « pouvoir souverain d’appréciation » du législateur
1 – Les droits du père de naissance à l’épreuve du placement de l’enfant en vue de son adoption
2 – Les droits de l’enfant à l’épreuve du droit à l’anonymat de la mère
II – Le juge judiciaire et les subtilités du contrôle concret de l’intérêt de l’enfant
A – La définition par la loi de l’intérêt de l’enfant : la hiérarchie légale des intérêts de l’enfant
1 – La primauté légale de l’intérêt concret sur l’intérêt abstrait : l’exception au retour de l’enfant déplacé illicitement
Cass. 1re civ., 19 déc. 2019, n° 19-18148 ; Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-19388 ; Cass. 1re civ., 27 juin 2019, n° 19-14464 ; Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-20850 ; Cass. 1re civ., 14 févr. 2019, n° 18-23916. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant fêtera cette année ses 40 ans d’existence. À cette occasion vient d’être publié le Guide de bonnes pratiques sur l’application de l’article 13, alinéa 1er, b), de la convention, qui pose l’exception de « risque grave », soit l’une des exceptions restreintes au retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle1. L’article 13, alinéa 1er, b), précise ainsi que le retour de l’enfant peut être refusé par l’autorité de l’État de refuge si le défendeur au retour établit « qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ». Mis au point par le bureau permanent de la conférence de La Haye, le Guide de bonnes pratiques vise principalement à aider les juges dans la mise en œuvre de cette exception très sensible, systématiquement invoquée par le parent ravisseur pour s’opposer au retour de l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle.
Après une période laxiste dans les années 1990, marquée par une tolérance judiciaire à l’égard de l’appréciation du danger et plusieurs décisions de refus de retour fondées sur l’article 13, alinéa 1er, b), de la convention, la jurisprudence française a opéré un tournant dans les années 2000 et, depuis, la tendance est d’interpréter restrictivement l’exception liée au risque grave de danger ou de situation intolérable. Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, n’est probablement pas étranger à ce virage jurisprudentiel. En effet, lorsque l’enlèvement de l’enfant se produit entre deux États membres de l’Union européenne, le règlement Bruxelles II bis a complété le dispositif conventionnel dans le but d’en améliorer l’efficacité en favorisant le retour immédiat de l’enfant dans l’État membre qui était celui de sa résidence habituelle juste avant son déplacement ou son non-retour. Ainsi, la juridiction de l’État membre de refuge ne peut refuser le retour de l’enfant sur le fondement de l’article 13, alinéa 1er, b), s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour dans l’État membre de sa résidence habituelle. De même le retour de l’enfant pourra-t-il être ordonné par les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant malgré le refus de retour initialement décidé par les juridictions de l’État membre de refuge sur le fondement de l’article 13 de la convention de La Haye (Règl. (CE) n° 2201/2003, art. 11, pt 8). Le dernier mot en faveur du retour de l’enfant (mécanisme dit du « retour nonobstant ») est ainsi conféré aux juridictions de la résidence habituelle d’origine de l’enfant, qui sont, par ailleurs, les seules compétentes pour prendre une décision au fond sur la responsabilité parentale (Règl. (CE) n° 2201/2003, art. 10).
Les arrêts rendus en 2019 par la Cour de cassation dans des affaires d’enlèvement international d’enfants portent tous, à l’exception d’un seul, sur l’interprétation de l’exception de risque grave de danger physique ou psychique posée par l’article 13, alinéa 1er, b). Faisant montre de sa rigueur habituelle, mais non d’insensibilité, la Cour de cassation défend une conception équilibrée du risque de danger. Ce dernier est, en principe, unilatéralement apprécié par les juridictions de l’État de refuge (ici françaises), en première ligne pour ordonner le retour de l’enfant. Mais, il arrive que les juridictions de l’État membre de refuge et celles de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant se prononcent l’une et l’autre sur le risque de danger ; lorsque leurs appréciations divergent, la confiance mutuelle est mise à rude épreuve.
La caractérisation unilatérale du risque de danger. Depuis que la Cour de cassation a reconnu le caractère directement applicable de l’article 3, § 1, de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)2, elle combine cette disposition avec l’article 13, alinéa 1er, b), de la convention de La Haye et exige des juges du fond qu’ils apprécient les circonstances de nature à caractériser un risque grave de danger en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant. La dialectique ainsi instaurée entre les deux articles permet d’appréhender l’intérêt de l’enfant dans ses deux dimensions, abstraite et concrète, mais sans les opposer. L’intérêt abstrait de l’enfant, sur lequel repose le dispositif conventionnel, est d’être ramené le plus immédiatement possible, après son déplacement illicite, dans l’État de sa résidence habituelle3. Ce postulat est confirmé aussi bien par la CEDH que par la CIDE (art. 9, § 2) et la charte des droits fondamentaux de l’UE (art. 24, § 3) au nom du droit de l’enfant à maintenir des relations avec ses deux parents. L’exception au retour prévue par la convention de La Haye répond, elle aussi, au souci de protéger l’intérêt de l’enfant si celui-ci se trouve en danger ou dans une situation intolérable dans l’État de sa résidence habituelle, mais son appréhension est plus concrète. Au risque de priver leur décision de base légale, les juges du fond doivent en effet « caractériser » le grave danger ou la situation intolérable qu’engendrerait le retour de l’enfant. Pour que le refus de retour soit justifié, il faut donc que le risque concret de danger que l’enfant encourrait à son retour dans l’État de sa résidence habituelle l’emporte sur son intérêt abstrait à entretenir des relations avec ses deux parents.
Dans son arrêt du 19 décembre 2019, qui se situe dans le prolongement de plusieurs arrêts antérieurs4, la Cour de cassation censure les juges du fond pour s’être déterminés « par des motifs impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard ». En l’espèce, les juges du fond s’étaient appuyés, d’une part, sur les excellentes conditions de vie de l’enfant dans l’État de refuge (en France) où il s’était très bien intégré et partageait la vie de son jeune frère et, d’autre part, sur « la grande angoisse » qu’engendrait chez lui l’idée d’un retour en Roumanie auprès de son père avec lequel la communication était difficile et impliquait une séparation d’avec sa mère et son frère. Que le retour soit douloureux pour un enfant qui s’est bien intégré dans le pays où il a été enlevé n’est guère contestable bien sûr, mais cela ne suffit pas à considérer qu’il serait exposé à un risque grave de danger ou placé dans une situation intolérable justifiant qu’il soit fait exception au retour.
En revanche, comme il ressort de l’arrêt de rejet du 14 février 2019, il est bien évident qu’il existe un risque grave que le retour aux États-Unis de trois enfants déplacés par leur mère en France les expose à des dangers physiques et psychiques alors que des documents médicaux américains établissent que le père a consulté des services spécialisés pour des épisodes dépressifs et suicidaires nécessitant des soins d’urgence, qu’il était dépendant à l’alcool et se montrait très irritable envers ses enfants. À l’inaptitude du père à prendre en charge les enfants s’ajoutaient des éléments de preuve établissant le réel danger physique et psychique auquel les enfants se trouveraient exposés en cas de retour aux États-Unis auprès de leur père, l’un ayant été victime de sévices et l’autre souffrant d’importants troubles du comportement, notamment d’anorexie, nécessitant des soins hospitaliers.
Moins caricatural, l’arrêt du 21 novembre 2019 conduit la Cour de cassation à se prononcer sur le risque de danger engendré par la situation juridique susceptible d’être créée par une instance en divorce au Japon. La mère, qui avait quitté le Japon pour la France avec son enfant en violation du droit de garde du père, faisait valoir dans son moyen de cassation que si elle « était amenée à retourner au Japon et à y demander le divorce, la garde de l’enfant et l’autorité parentale seraient indiscutablement confiées au père, qu’elle se trouverait privée de ses droits parentaux et de tout contact avec son fils et qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir un visa permanent qui lui permettrait de demeurer à proximité de son fils ». La Cour de cassation approuve la cour d’appel de n’avoir pas retenu l’exception de danger dès lors « qu’il ne peut être préjugé de la situation juridique susceptible d’être créée par une instance en divorce au Japon » et que l’impossibilité pour la mère de séjourner au Japon n’était pas démontrée. Une telle réponse s’impose dans la mesure où le risque pour l’enfant d’être privé de liens avec l’un de ses parents à l’issue de la procédure de divorce entamée au Japon n’est qu’hypothétique, alors qu’il est avéré qu’il n’entretient plus de relations avec son père resté au Japon depuis son déplacement en France. La Cour de cassation et la cour d’appel ont également relevé dans leur arrêt que le Japon a signé et ratifié la convention de La Haye du 25 octobre 1980. Au demeurant, l’inquiétude du parent français est aisément compréhensible car il est notoire que le maintien du lien familial entre le parent non japonais et son enfant est menacé en cas de séparation ou de divorce lorsque l’autre parent est japonais. Dans un discours prononcé à Tokyo devant la communauté française le 26 juin 2019, le président de la République a lui-même dénoncé cette difficulté. Certes, depuis son adhésion à la convention de La Haye de 1980 et à la CIDE, le Japon a assoupli sa législation par une loi du 10 mai 2019, entrée en vigueur le 1er avril 2020. Celle-ci prévoit que l’enfant pourra être confié au parent détenteur de l’autorité parentale en l’absence de l’autre parent et que les agents de la force publique devront veiller à ce que la remise de l’enfant ne nuise pas à son bien-être mental ou physique, mais le texte n’envisage toujours pas en revanche que l’autorité parentale soit partagée entre les deux parents, ni que soit mise en place une résidence alternée. Cette situation préoccupante est à l’origine du dépôt par un groupe de sénateurs d’un projet de résolution européenne dénonçant la privation de tout lien entre l’enfant et son parent européen à la suite d’un enlèvement commis par un parent japonais5.
La double appréciation du risque de danger. L’article 13 de la convention de La Haye prévoit dans son dernier alinéa que dans l’appréciation des circonstances s’opposant au retour de l’enfant, dont celle du risque grave de danger, les autorités judiciaires ou administratives de l’État de refuge doivent tenir compte des informations fournies par les autorités compétentes de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale. Le dialogue entre les autorités de l’État de refuge et celles de la résidence habituelle est renforcé par le règlement Bruxelles II bis lorsque l’enlèvement s’est produit entre deux États européens. Ainsi, en cas de refus de retour décidé par les autorités de l’État de refuge, les autorités de l’État de la résidence habituelle peuvent certes déjuger les premières et imposer le « retour nonobstant » de l’enfant, mais l’article 42, § 2, du règlement impose que les secondes aient rendu leur décision en tenant compte des motifs et des éléments de preuve sur la base desquels avait été rendue la décision [de non-retour] en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980.
Dans un arrêt du 20 mars 2019, hors champ d’application du règlement Bruxelles II bis, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir ordonné le retour en Suisse de l’enfant enlevé par sa mère en France, aucun risque de grave danger n’étant établi par les pièces versées au débat. En outre, la Cour relève que les mesures d’investigation et d’audition des parents réalisées par les juridictions helvétiques permettaient de mettre en évidence « que la mère ferait passer ses propres intérêts avant ceux de son enfant en cas de déménagement et qu’il y avait urgence à élargir le droit de visite de M. X afin de ne pas mettre en danger la relation père-fille ». Dans cette affaire, l’analyse du service enquêteur helvétique est donc prise en compte par le juge français pour apprécier l’absence de tout danger auquel l’enfant serait exposé en cas de retour en Suisse et, partant, pour ordonner un tel retour.
L’entente mutuelle s’est malheureusement avérée moins bonne entre juridictions européennes, en l’occurrence françaises et luxembourgeoises, au sujet d’une affaire d’enlèvement intra-européen ayant donné lieu à l’arrêt du 27 juin 2019 de la Cour de cassation. Un couple de Français vivant au Luxembourg s’était vu fixer les modalités d’exercice de leur autorité parentale commune sur leur enfant selon un jugement luxembourgeois rendu en 2015. Au cours de l’été 2018, la mère a déplacé l’enfant en France en violation du droit de garde du père. Ce dernier a demandé au juge français d’ordonner le retour de l’enfant au Luxembourg, où se trouvait sa résidence habituelle. Conservant leur compétence au fond (art. 10), les juridictions luxembourgeoises ont rendu en novembre 2018 un jugement attribuant la garde définitive de l’enfant à son père au motif que, contrairement à la mère, il n’avait pas agi au détriment de l’intérêt de l’enfant et qu’il disposait de capacités éducatives, l’enfant ayant une bonne relation avec lui. La mère avait pourtant fourni au juge luxembourgeois un rapport d’expertise pédopsychiatrique réalisé en juillet 2018 établissant que l’enfant serait exposé à un risque grave de danger psychique en cas de retour au Luxembourg auprès de son père. Le juge luxembourgeois a visiblement fait peu de cas de ce rapport malgré son caractère alarmant (les détails fournis dans l’arrêt sont éclairants).
Devant les juridictions françaises saisies de la demande de retour de l’enfant, ce même rapport était appuyé de nouveaux éléments de preuve caractérisant un risque grave de danger physique et psychique (l’enfant allant jusqu’à exprimer des idées suicidaires à l’idée de retourner chez son père). La Cour de cassation approuve alors la cour d’appel d’avoir refusé d’ordonner le retour, sur le fondement de l’article 13, alinéa 1er, b), de la convention de La Haye et de l’article 3, § 1, de la CIDE, et, partant, d’avoir admis un risque de danger là où le juge luxembourgeois avait refusé d’en voir un. En réponse au moyen du pourvoi, la Cour précise que la cour d’appel « n’était tenue ni par les motifs de la décision luxembourgeoise ni par l’appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle ».
Dans cet arrêt de rejet, la Cour de cassation ne fait pas mention de la règle conventionnelle susmentionnée. Il serait pourtant excessif de dire que ladite règle est contournée. En effet, ce n’est pas la même chose de prendre en compte des informations fournies par les autorités étrangères sur la situation sociale de l’enfant dans leur pays et de s’aligner sur l’appréciation judiciaire portée par un juge étranger sur les éléments de preuve produits devant lui et les motifs qui ont dicté sa décision. Dans le premier cas, les autorités de l’État de refuge apprécient librement les informations fournies sur la situation sociale de l’enfant, dans le second elles sont liées par l’appréciation judiciaire portée sur la situation de l’enfant. Or même lorsque l’enlèvement est intra-européen, le règlement Bruxelles II bis ne prévoit pas que le juge de l’État de refuge doive tenir compte de l’appréciation du danger opérée, le cas échéant, par le juge de l’État d’origine statuant au fond. « Victoire de l’intérêt de l’enfant et/ou défaite du principe de confiance mutuelle ? », s’interroge fort justement Michel Farge au sujet de cet arrêt6.
L’avenir nous le dira peut-être car le bras de fer judiciaire pourrait se poursuivre avec une décision de retour imposée par les autorités luxembourgeoises nonobstant le refus des autorités françaises (art. 11, § 8 du règlement Bruxelles II bis). Mais, cette fois, le règlement Bruxelles II bis exige que les juges de la résidence habituelle de l’enfant tiennent compte des motifs et éléments de preuve sur lesquels a été rendue la décision de non-retour en application de l’article 13. Les juges luxembourgeois restent libres de leur appréciation puisqu’il ne s’agit que d’une prise en compte et qu’en tout état de cause leur point de vue sur le retour de l’enfant l’emportera. Il faut espérer néanmoins que, statuant au regard des mêmes pièces, en application des mêmes règles et s’exprimant dans une même langue, juges luxembourgeois et français n’adoptent pas une vision diamétralement opposée du danger auquel l’enfant serait exposé en cas de retour au Luxembourg. L’intérêt de l’enfant et la confiance en ressortiraient l’un et l’autre gagnants.
Christelle CHALAS
2 – La primauté légale de l’intérêt abstrait sur l’intérêt concret : le contentieux de la contestation de filiation
a – La non-paternité biologique du défendeur, critère légal déterminant du bien-fondé de l’action
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-18473. Il se peut qu’action en contestation et action en recherche de paternité soient entremêlées lorsqu’un enfant – dans le respect du principe chronologique posé par l’article 320 du Code civil – conteste la paternité du père et cherche à établir celle d’un tiers. À cet effet, le demandeur peut requérir une expertise biologique entre lui et son père dans le cadre de l’action en contestation de paternité, et entre lui et le tiers dans le cadre de l’action en recherche de paternité. En revanche, la situation est plus complexe lorsque c’est un tiers qui conteste la paternité et qui requiert une expertise génétique pour établir celle d’une tierce personne en lieu et place du père. Dans cet arrêt du 19 septembre 2019, la Cour de cassation rappelle le cadre strict au sein duquel une telle demande d’expertise biologique peut s’inscrire. En l’espèce, la mère et le frère du de cujus assignent l’enfant de ce dernier et sa mère en annulation de la reconnaissance de paternité. Ils demandent qu’une expertise génétique soit ordonnée à l’égard d’un tiers – appelé en la cause – présupposé père biologique de l’enfant. La cour d’appel de Fort-de-France a rejeté les demandes et retenu que « la filiation (…) étant établie par l’acte de reconnaissance (…), la demande d’expertise (…) pour établir une filiation contraire (…) était en conséquence irrecevable ». Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation soutient qu’« une demande d’expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être déclarée recevable, l’engagement par cet enfant d’une action en recherche de paternité, qu’il a seul qualité à exercer ». Par l’arrêt annoté, la Cour affine sa jurisprudence en matière d’expertise génétique. Après avoir rappelé qu’« une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation »7, la Cour va plus loin en exigeant que seule la personne qui a qualité à agir pour intenter une action relative à la filiation puisse solliciter une expertise génétique. Dès lors, la demande d’expertise génétique formulée par un tiers afin de procéder à une chaise musicale de paternité ne peut qu’être rejetée car il n’est pas en droit d’intenter une action en recherche de paternité (i). Ne pouvant prouver ni la paternité du tiers ni la non-paternité du de cujus, l’action en contestation de la reconnaissance ne peut aboutir (ii).
(i) Le rejet de la demande d’expertise biologique. Bien que tous les moyens de preuve soient recevables8, la paternité se prouve dans la plupart des cas par une expertise biologique. Cette dernière « est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder »9. Toutefois, en vertu de l’article 16-11, alinéa 2, du Code civil, elle ne peut être réalisée « qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation (…) ». Ainsi, étant donné qu’a été formulée devant le juge une demande en contestation d’une reconnaissance, il semblerait – à première vue – qu’une expertise génétique puisse être ordonnée : la preuve biologique de la paternité de l’un confortera les éléments permettant de conclure à la non-paternité de l’autre. En cela, le raisonnement retenu par la cour d’appel de Fort-de-France est fort intéressant10. Après avoir constaté qu’il « n’existait pas de faisceau d’éléments concordants permettant de caractériser une possession d’état d’enfant naturel paisible, publique et non équivoque », la cour déclare recevable l’action des tiers en contestation de la reconnaissance de paternité. En effet, à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action peut être engagée par toute personne qui y a intérêt11 dans un délai de 10 ans12. Toutefois, la cour a considéré que l’action en contestation était infondée à défaut d’éléments suffisants prouvant la fausseté de la reconnaissance. Elle soulève que si la maladie du père décédé est confirmée, les documents apportés par les appelants ne corroborent pas l’allégation selon laquelle une personne atteinte de drépanocytose de type SS et soumise à un traitement lourd est dans l’impossibilité de procréer. De plus, elle retient que « les divers témoignages des membres de la famille (…) procèdent (…) pour prouver que le défunt n’est pas le père de l’enfant par affirmation ». Excessive, elle exige même que « la preuve requise doi[ve] également permettre d’apprécier le caractère frauduleux ou mensonger de la reconnaissance », alors qu’un homme peut – en toute bonne foi – croire que l’enfant était le sien et contester par la suite sa paternité. Les juges déboutent alors la mère et le frère du de cujus de leur demande d’annulation de l’acte de reconnaissance et retiennent que, « la filiation de (…) l’enfant étant établie par l’acte de reconnaissance, leur demande d’expertise pour établir une filiation contraire (…) est en conséquence irrecevable ». Dit autrement, puisque l’acte de reconnaissance est jugé valable, la demande d’expertise destinée à établir la filiation avec un tiers est irrecevable et ce en vertu du principe chronologique. Là est l’erreur de raisonnement qui a conduit à la substitution de motifs. Puisque le père est décédé, les demandeurs n’ont pas sollicité une expertise génétique entre le de cujus et l’enfant à l’occasion de leur action en contestation de la reconnaissance. En réalité, seule l’action en recherche de paternité était assortie d’une demande d’expertise génétique entre le tiers et l’enfant. Cependant, une telle expertise ne peut être ordonnée par le juge que si l’action en recherche de paternité est recevable13. En l’espèce, l’action est engagée par des tiers alors qu’elle est réservée à l’enfant14. Par conséquent, la demande d’expertise génétique est rejetée, non pas (seulement) parce que l’enfant a déjà une filiation légalement établie comme le soutient la cour d’appel, mais parce que l’action en recherche de paternité intentée par un tiers est irrecevable. Seul l’enfant peut solliciter une expertise génétique susceptible de révéler un lien de filiation avec le père présupposé dans le cadre d’une action en établissement de la filiation. Dépourvus de la qualité à agir pour engager une action en recherche de paternité, les demandeurs ne peuvent pas solliciter une expertise génétique entre l’enfant et le tiers afin de rapporter la preuve de la non-paternité du père décédé dans leur action en contestation de la reconnaissance.
(ii) Le rejet de l’action en contestation de paternité. Dans le cadre d’une action en contestation de paternité, on peut prouver la fausseté de la reconnaissance en apportant des éléments démontrant la paternité d’un autre. Cette preuve – comme les autres – sera soumise à l’appréciation du juge. En revanche, un tiers ne peut pas demander à la juridiction d’ordonner une expertise génétique entre l’enfant et le prétendu père afin de prouver la non-paternité du père. Ce tiers peut tout de même solliciter – dans le cadre de la seule action en contestation de reconnaissance – une expertise génétique qui visera l’enfant et le père, c’est-à-dire les deux personnes concernées par le lien à détruire. Partant, deux options étaient alors à la disposition des demandeurs. D’une part, ils pouvaient demander qu’un prélèvement post mortem soit ordonné. Ayant peu de chances d’aboutir, une telle demande n’a guère été formulée. En effet, tirant les leçons de l’affaire Montand15, l’article 16-11, alinéa 2, du Code civil interdit toute identification par empreintes génétiques après la mort « sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant »16. Si cette interdiction de l’examen post mortem est bien conforme à la Constitution17, se pose tout de même la question de sa compatibilité avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme (convention EDH). Dans l’arrêt Jäggi c/ Suisse de 200618, la Cour de Strasbourg (la CEDH) retient que le refus de faire exhumer le corps en vue de réaliser une expertise génétique porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée du requérant compte tenu des circonstances de l’espèce (§ 44). Il ne faut tout de même pas exagérer la portée de cette décision étant donné que la Cour a pris soin de mettre en exergue les spécificités de l’espèce. D’un côté, elle souligne le droit du requérant – qui « a tenté tout au long de sa vie d’acquérir une certitude (…) » quant à l’identité de son père – à connaître son ascendance (§ 40). D’un autre côté, elle observe que « la famille du défunt n’a invoqué aucun motif d’ordre religieux ou philosophique à l’appui de son opposition à la mesure litigieuse » (§ 41). Elle considère même qu’un prélèvement d’ADN constitue « une ingérence relativement peu intrusive » dès lors que la concession de la tombe du défunt a été prolongée grâce au requérant et que la dépouille sera exhumée à l’expiration de la concession actuelle (§ 41). Enfin, la Cour constate le caractère totalement désintéressé de la démarche du requérant, animé seulement par le besoin de connaître son ascendance, et non par l’obtention de droits successoraux. En effet, la « reconnaissance de la paternité biologique serait sans aucun effet sur les registres de l’état civil » (§ 43). Cet arrêt est riche d’enseignements pour notre cas d’espèce. Rappelons que l’action est engagée par des tiers sans doute animés par des motifs d’ordre successoral – qui demandent d’ailleurs l’annulation de l’acte de notoriété en date du 23 novembre 2010 déclarant l’enfant héritier. Un refus d’exhumation du corps qui serait prononcé ne porterait aucunement une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention EDH19. D’autre part, et face à la difficulté d’un prélèvement post mortem, les demandeurs – qui sont une ascendante et un collatéral du défunt – pouvaient solliciter une expertise génétique entre eux et l’enfant. Certes, les résultats ne peuvent, à eux seuls, permettre d’exclure de façon certaine la paternité du défunt20. D’autant plus que la fiabilité d’une telle expertise suppose que les membres de la famille impliqués et le de cujus aient un réel lien de sang non entaché par un secret de famille inavouable. Ces résultats constituent tout de même des renseignements à la disposition du juge pouvant orienter a décision.
Puisque les certificats médicaux et témoignages n’ont pas su convaincre les juges, que le prélèvement post mortem semble impossible – et sûrement non voulu par les demandeurs – et que l’expertise biologique entre l’enfant et la famille du défunt n’apparaît pas comme une preuve infaillible, force est de constater que la parade juridique trouvée par les conseils des demandeurs est très ingénieuse. Elle se heurte à la rigueur de la Cour de cassation, qui recadre le recours à l’expertise génétique lors des actions en filiation afin d’éviter les dérives du « tout biologique ».
Gaëlle WIDIEZ-RASOLONOMENJANAHARY
b – L’indifférence du dévoiement incestueux de la relation père-fille en matière de possession d’état
Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13642. Si la contestation d’une filiation est enfermée dans des limites strictes afin de préserver la stabilité de l’état des personnes, cet encadrement présente tout de même l’inconvénient de verrouiller une filiation mensongère qui ne correspond plus à la réalité sociale et familiale. Inflexible, la Cour de cassation affirme dans l’arrêt du 3 avril 2019 qu’un père ne peut « démissionner » ou « se confesser » d’une paternité mensongère au-delà du délai préfix imposé même s’il a eu un comportement indigne à l’égard de sa fille.
En l’espèce, dès 1995, un homme a élevé la fille de sa compagne, et l’a même reconnue le 26 juillet 2005. Presque 10 ans après – soit le 24 juillet 2015 –, il a assigné sa fille en annulation – plutôt en contestation – de la reconnaissance de paternité. Les juges du fond estiment que, conformément à l’article 333 du Code civil, alinéa 1er, l’action est prescrite car le titre a été conforté par une possession d’état conforme qui a duré plus de 5 ans. De plus, ils considèrent que la forclusion opposée à l’action ne portait pas atteinte au droit au respect dû à la vie privée et familiale dès lors que la fausse paternité découle d’une reconnaissance volontaire. Dans son pourvoi, le demandeur remet en cause l’existence de la possession d’état en soulignant sa condamnation pour viols et agressions sexuelles sur l’enfant et la nature plutôt amoureuse que filiale de leur relation. De plus, il soutient que « les règles qui restreignent le droit d’une personne à voir établie sa filiation biologique portent atteinte au respect dû à sa vie privée et familiale ». Se pose alors la question de savoir si les abus sexuels commis par le père sur l’enfant empêchent la constitution d’une possession d’état ? Autrement dit, peut-on opposer la forclusion prévue par l’article 333, alinéa 1er, du Code civil à un père qui conteste une reconnaissance de paternité mensongère en avançant son indignité à l’égard de l’enfant ? Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation soutient que la « cour d’appel a souverainement estimé que les témoignages constatant le comportement anormal de M. A. envers sa fille ne remettaient pas en cause l’existence d’une possession d’état conforme au titre de naissance ». De plus, « le principe conventionnel (…) selon lequel la vérité biologique doit primer sur un texte légal instituant une présomption contraire à la réalité et aux vœux des personnes concernées, n’est pas applicable dès lors que Mme O. s’est opposée à la demande d’annulation de la reconnaissance et que le lien de filiation résultait d’une démarche volontaire de M. A. et non de l’application d’un texte légal instituant une présomption contraire à la réalité ». Ainsi, le père ne réussit à esquiver l’application de l’article 333, alinéa 1er, ni sur le terrain de la possession d’état – son comportement anormal étant indifférent – (i), ni sur celui de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme (convention EDH) –, la fille s’opposant à la remise en cause du lien (ii).
(i) L’indifférence du comportement anormal. L’action en contestation de reconnaissance est soumise à un régime strict cherchant un équilibre difficile entre vérité biologique et stabilisation rapide des filiations. Dès lors, si la possession d’état est conforme au titre, le délai de prescription prévu est de 5 ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance21 ; à défaut de possession d’état conforme au titre, le délai est ramené à 10 ans22. En l’espèce, la possession d’état de plus de 5 ans est conforme au titre car l’homme « avait participé à l’entretien et l’éducation de sa fille dès 1995 et jusqu’au 15 décembre 2011 »23. Ainsi, au moment où l’action est exercée, la filiation est déjà cristallisée. En revanche, le délai de 10 ans n’était pas expiré et l’action en contestation de paternité était recevable si on considère que la possession d’état n’était pas conforme au titre. D’où la critique de l’existence de la possession d’état formulée par le pourvoi et dont les conditions sont précisées à l’article 311-1 du Code civil. Le père tentait de jouer sur le « dévoiement incestueux » de sa relation avec sa fille pour contester l’existence de la possession d’état. Effectivement, le doute est permis. Le tractatus constitue l’élément le plus caractéristique de la possession d’état. Ce dernier suppose que la personne « a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents »24. Dès lors, est-ce qu’agissent comme parent-enfant un père qui se comporte avec sa fille « comme s’ils entretenaient une liaison amoureuse, ne jouant pas son rôle de père » et sa fille qui a « pris une place qui n’était pas la sienne, à savoir celle de femme de la maison » ? Aussi, la condition de la fama exige que l’enfant soit reconnu comme celui d’un tel homme et/ou telle femme « dans la société et par la famille »25. Pourtant, n’est-il pas vrai que le père se comportait avec sa fille « en présence de leurs proches, comme s’ils entretenaient une liaison amoureuse » ? On peut sans doute soutenir que, malgré le « comportement anormal » du père à l’égard de sa fille, il n’apparaît pas que l’entourage proche ait cautionné cette attitude au point de ne plus les considérer comme père-fille. Il est vrai qu’au-delà du cas particulier du nomen, il n’est pas nécessaire que les trois éléments constitutifs de la possession d’état soient nécessairement réunis, l’article 311-1 du Code civil exige simplement « une réunion suffisante de faits ». En réalité, la malléabilité de la notion de possession d’état permet aux juges du fond de plus ou moins caractériser ses différents éléments, et ce en fonction des circonstances de l’espèce mais aussi des finalités recherchées26. Dans cet arrêt, la Cour se range d’ailleurs à l’appréciation des juges du fond constatant que les agissements criminels du père à l’égard de l’enfant ne remettaient pas en cause l’existence d’une possession d’état conforme au titre. Si la solution peut susciter le malaise, il va de soi que l’existence de relations sexuelles – même contraintes – ne déchoit pas un parent de son titre. Des sanctions pénales et d’autres mesures civiles sont prévues afin de réprimer un père indigne, telles que, notamment, le retrait de l’autorité parentale, la suppression de l’obligation alimentaire de l’enfant à l’égard de son père ou l’interdiction de tout contact. Somme toute, le comportement criminel du père envers sa fille n’empêche pas la constitution d’une possession d’état… du moins si l’enfant souhaite préserver le lien filial.
(ii) L’importance de la volonté des intéressés. La Cour européenne des droits de l’Homme, tout en reconnaissant l’intérêt légitime des législateurs nationaux à « garantir la sécurité juridique (…), la stabilité des liens familiaux et (…) la nécessité de protéger les intérêts de l’enfant »27, exerce un contrôle de proportionnalité afin de s’assurer que – dans chaque affaire – la prescription opposée par l’État à l’action tardive est proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, en fonction des circonstances de l’espèce, le juge étatique doit « avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble »28. L’État russe a déjà été condamné pour avoir déclaré prescrite l’action en contestation de paternité du requérant qui n’a découvert qu’il ne pouvait être le père que plus de 1 an après l’enregistrement de l’enfant29. Aussi, la Slovaquie a été condamnée pour avoir déclaré prescrite l’action en contestation de paternité du requérant actionnée 38 ans après son établissement dès lors qu’il était en possession de nouveaux éléments prouvant qu’il n’était pas le père de l’enfant devenu adulte30. Malte a également été condamné pour avoir fait prévaloir sur la réalité biologique une présomption légale sans laisser au père « au moins une occasion de contester la paternité d’une enfant qui, selon les preuves scientifiques, n’est pas de lui »31. Dans cette lignée, la Cour de cassation a retenu qu’« il appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de ces délais légaux de prescription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu »32. L’atteinte est proportionnée aux buts légitimes poursuivis lorsque, notamment, l’enfant auteur de l’action en contestation est décédé et que l’action reprise par ses héritiers ne poursuivait qu’un intérêt patrimonial33, ou lorsque la personne avait la possibilité d’agir après avoir appris la vérité sur sa filiation biologique34 ou lorsque l’enfant avait disposé d’un délai de 30 ans à compter de sa majorité pour contester la paternité, ce qu’elle n’a pas fait et qu’elle a même hérité de l’intéressé au décès de celui-ci35.
En l’espèce, la Cour de cassation retient que « le principe conventionnel invoqué (…) selon lequel la vérité biologique doit primer sur un texte légal instituant une présomption contraire à la réalité et aux vœux des personnes concernées, n’est pas applicable »36. Pour arriver à cette conclusion, la Cour souligne, d’une part, que « le lien de filiation résultait d’une démarche volontaire de M. A. et non de l’application d’un texte légal instituant une présomption contraire à la réalité », et, d’autre part, que l’enfant « s’est opposée à la demande d’annulation de la reconnaissance »37. Puisque la filiation a été établie par une reconnaissance volontaire – mensongère – et non une présomption légale, le père ne saurait venir confesser sa propre imposture. De plus, étant donné que la fille souhaite préserver le lien filial38, le père incestueux demeurera le sien. En revanche, si la fille avait clairement approuvé l’action de son père, est-ce que la solution aurait été tout autre ? Autrement dit, est-ce qu’un accord entre les parties pourrait conduire à la destruction du lien de filiation ? La réponse pourrait bien être affirmative dès lors que la Cour de cassation, en suivant la ligne tracée par la CEDH, semble attacher une grande importance « aux vœux des personnes concernées »39. Il apparaît tout de même surprenant de faire jouer un rôle important à la volonté dans une matière où le droit est indisponible. En réalité, loin de faire dépendre le sort de la filiation du seul bon vouloir des parties, il s’agit pour la Cour de mettre en balance les divers intérêts en présence. En voulant garantir la sécurité des filiations, le législateur français – à travers l’article 333, alinéa 1er, du Code civil – a surtout créé une règle un peu trop rigide. Finalement, il semble surtout que la Cour de cassation, tout en essayant de préserver l’esprit du texte, tente de lui donner une certaine souplesse.
Gaëlle WIDIEZ-RASOLONOMENJANAHARY

B – L’absence de définition légale de l’intérêt de l’enfant : le rôle de l’intérêt concret de l’enfant
1 – Contribution à l’entretien de l’enfant en cas de choix éducatif décidé unilatéralement par l’autre parent : la porte étroite
CA Riom, 19 mars 2019, n° 18/01220 ; CA Montpellier, 7 mars 2019, n° 18/03968. Le rôle de l’accord entre parents en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. La séparation des parents aura inévitablement une incidence sur les modalités d’exécution de leur obligation d’entretien et d’éducation à l’égard de leur enfant. Le principe de l’exécution selon les « facultés respectives » de l’un et de l’autre, d’après les critères besoins/ressources de l’article 371-2 du Code civil40, en raison de la séparation, se traduira par le versement d’une pension alimentaire du parent le plus fortuné entre les mains de l’autre parent ou de la personne à laquelle l’enfant mineur aura été confié (C. civ., art. 373‐2‐2).
S’inscrivant dans un mouvement de déjudiciarisation qui vise à réduire l’aspect conflictuel des séparations, l’accord des parents paraît être le mode à privilégier lors la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (CEEE) et de ses modalités41, en le bornant des deux limites classiques que sont l’intérêt de l’enfant et le respect de la liberté du consentement.
Les parents pourront ainsi fixer les modalités, montant et garanties de la pension alimentaire dans une convention homologuée par le juge aux affaires familiales (JAF) (C. civ., art. 373‐2‐7) ou dans une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire (C. civ., art. 229‐1). Il est à souligner également, depuis la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut donner force exécutoire à l’accord par lequel les parents (hors cadre d’un divorce) ont fixé le montant de la pension (CSS, art. L. 582‐2)42.
À défaut d’accord entre les parents, la mission de fixation de la pension et de ses modalités reviendra classiquement au JAF, ce qui n’empêche pas de soumettre certains choix éducatifs ou prises en charge de frais exceptionnels à un accord préalable des deux parents ou de valider l’accord d’un parent qui se propose de payer plus que sa part.
Le défaut d’accord préalable quant au choix éducatif. Le litige tranché par la cour d’appel de Riom le 19 mars 2019 concerne un jeune de 16 ans en résidence alternée depuis la séparation de ses parents. Son père versait déjà pour son entretien une pension de 200 € par mois et, selon une disposition du jugement, les « dépenses quotidiennes et également exceptionnelles relatives à l’éducation de l’enfant devaient être partagées par moitié » entre les parents « après discussion et accord préalables ». La mère ayant décidé de faire intégrer à l’enfant un campus aux États-Unis pour une durée de 1 an et moyennant un coût de 25 000 €, elle demande au père le paiement de la moitié de cette somme. Elle sera déboutée de sa demande car « elle ne justifie pas que le père ait donné son accord pour que l’enfant poursuive ses études à l’étranger dans les conditions et modalités choisies par elle ».
Sur le choix et le partage des frais liés aux études suivies par l’enfant, le premier juge avait posé le principe d’une nécessaire concertation entre les parents. En effet, le jugement avait prévu le partage par moitié « des dépenses quotidiennes, mais également exceptionnelles, relatives à l’éducation de l’enfant » sous réserve de « discussion et accord préalables » entre les parents. En l’espèce, la mère n’avait pas jugé bon de requérir l’accord du père pour engager l’enfant dans une scolarité coûteuse (25 000 €/an), ce qui lui vaut de devoir supporter seule les frais (exceptionnels) de cette scolarité, le père s’acquittant déjà d’une contribution de 200 € par mois pour l’entretien de l’enfant.
Cette solution n’est pas nouvelle. En s’appuyant sur un principe de coparentalité, il a déjà été jugé qu’un choix éducatif n’avait pas à être opposé au père qui avait été tenu à l’écart du cursus de son enfant43. À l’inverse, dès lors que le choix de l’école a été fait alors que les parents n’étaient pas séparés, chaque parent se doit de contribuer en fonction de ses facultés à la poursuite de ce projet d’avenir « décidé en commun »44.
La nécessité d’un accord « commun et préalable » se comprend aisément en l’espèce, tant par l’importance des sommes à engager pour la scolarité, que par l’existence d’une disposition du premier jugement allant en ce sens. Le partage par moitié des frais supposait une concertation préalable dans un schéma de garde alternée. La cour d’appel de Riom a ainsi fait strictement application des termes du premier jugement. Mais si le choix éducatif n’avait pas été pareillement forcé par la mère, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur le sort réservé au refus du père s’il avait été formulé à l’origine du projet. La vraie question aurait été celle de l’intérêt de l’enfant et le critère décisif aurait été celui de l’état de « fortune » de ses parents. Dans l’hypothèse où le père aurait disposé des ressources suffisantes, il aurait difficilement pu échapper au partage par moitié des frais de scolarité45. Il faut penser qu’en l’espèce la mère avait la capacité de faire face seule à la dépense, ce qui n’a pas contrarié le projet de l’enfant (et donc son intérêt).
L’accord d’un parent de payer plus que sa part. Après une période de résidence alternée, la cour d’appel de Montpellier, par un arrêt rendu le 7 mars 2019, décide de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, leur mère étant partie s’installer au Portugal en laissant les enfants « aux bons soins du père ». La mère ne justifiant d’aucun revenu fixe, alors que le père dispose d’un haut niveau de revenus et d’un patrimoine important, la cour d’appel entérine la proposition faite par le père de continuer à verser une contribution de 1 000 € pour l’entretien et l’éducation des enfants. En effet, même si la cour relève « qu’il est inhabituel de laisser à la charge d’un parent chez qui la résidence est fixée une CEEE », les enfants doivent pouvoir vivre « selon le niveau de vie qu’ils auraient eu si les parents ne s’étaient pas séparés », ce qui peut amener à fixer à 1 000 € la contribution que « le père propose de continuer à verser ».
En préalable, il convient de relever qu’une convention emportant renonciation définitive de l’un des parents à réclamer des aliments à l’autre au nom de l’enfant serait contraire à l’ordre public. Une telle disposition contreviendrait au principe de l’indisponibilité de l’obligation d’entretien46.
L’hypothèse inverse, celle d’un parent qui se proposerait de payer plus que sa part, ne se heurte pas aux mêmes réticences, sauf à s’exposer, en cas d’« appauvrissement significatif », à une requalification en intention libérale pour une part de la contribution47. Toutefois, le plus souvent, la référence du « maintien du train de vie » ou du « niveau social » de l’enfant pourra justifier d’aller au-delà du chiffrage du barème (indicatif) de la table de référence. D’ailleurs, il convient de rappeler que cette table à elle seule ne saurait fonder une décision48. Elle reste un indicateur qui ne saurait se substituer au pouvoir d’appréciation du juge. Ainsi, ce dernier peut parfaitement accueillir la proposition d’un parent de continuer à verser une contribution, même s’il est « inhabituel de [la] laisser à la charge d’un parent chez qui la résidence est fixée ». Une telle solution peut se concevoir au titre de la prise en considération des « besoins » de l’enfant et se justifier par des considérations de train de vie. En disposer de la sorte peut permettre aux enfants de continuer à vivre selon le niveau de vie qu’ils auraient pu avoir si les parents ne s’étaient pas séparés. La jurisprudence a toujours adopté une vision large des « besoins » couverts par la CEEE qui est destinée à procurer aux enfants une éducation « en relation avec leur niveau de vie et leur milieu familial »49 ou leurs « habitudes de vie »50. En l’espèce, le maintien d’une contribution doit permettre aux enfants d’être accueillis par leur mère, lors de l’application de son droit de visite et d’hébergement, dans des conditions habituelles de vie. L’idée est de maintenir un équilibre dans les conditions d’accueil, et, plus largement, la question peut être posée de la reconnaissance d’un « intérêt de l’enfant à trouver un équilibre dans sa vie quotidienne », même si cette formule a été utilisée par la Cour de cassation en matière de garde alternée51 et non pour un droit d’hébergement.
Dominique EVERAERT-DUMONT
(À suivre)
2 – L’exclusion du contrôle concret du juge
III – Le juge administratif : l’extension du domaine du plein contentieux aux refus de prise en charge par l’ASE des jeunes majeurs
Notes de bas de pages
-
1.
Guide de bonnes pratiques en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, Partie VI, Article 13 (1) (b), mars 2020, téléchargeable en français et en anglais sur le site de la conférence de La Haye, www.hcch.net, onglet « Publications ».
-
2.
Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 04-16942 : JCP G 2005, II 10115, concl. Petit C. et note Chabert C. ; JDI 2005, p. 1131, note Chalas C. ; Rev. crit. DIP 2005, p. 679, note Bureau D. ; Defrénois 30 sept. 2005, n° 38230, p. 1418, obs. Massip J. ; RTD civ. 2005, p. 750, chron. Rémy-Corlay P.
-
3.
V. Perez-Vera E., rapp. explicatif, nos 20 et s.
-
4.
Cass. 1re civ., 19 nov. 2014, n° 14-17493 : JDI 2005, comm. 13, p. 1131, note Chalas C. ; Cass. 1re civ., 13 févr. 2013, n° 11-28424.
-
5.
Sénat, prop. de résolution européenne, n° 147, 20 nov. 2019. V. Couard J, « Vers une dénonciation de l’enlèvement d’enfant par un parent japonais », Dr. famille 2020, alerte 15.
-
6.
Farge M., « Appréciation de l’exception de danger dans un enlèvement d’enfant intra-européen », Dr. famille 2019, comm. 212.
-
7.
Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-16696 : D. 2016, p. 1310 ; AJ fam. 2016, p. 388, obs. Saulier M.
-
8.
C. civ., art. 310-3, al. 2.
-
9.
Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12806 : D. 2000, p. 731, note Garé T. ; D. 2001, p. 1427, obs. Gaumont-Prat H. ; D. 2001, p. 2868, note Desnoyer C. ; LPA 27 nov. 2000, p. 13, note Daburon C. ; RTD civ. 2000, p. 304, obs. Hauser J. – Confirmation, v. not. Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-23170 ; Cass. 1re civ., 29 mai 2012, n° 12-15901 ; Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, n° 13-28256 : Dr. famille 2015, comm. 51, note Neirinck C.
-
10.
CA Fort-de-France, 16 janv. 2018, n° 16/00066.
-
11.
C. civ., art. 334.
-
12.
C. civ., art. 321.
-
13.
C. civ., art. 310-3, al. 2.
-
14.
C. civ., art. 327, al. 2.
-
15.
CA Paris, 6 nov. 1997 : D. 1998, Jur., p. 122, note Malaurie P. ; RTD civ. 1998, p. 87, obs Hauser J. – Clôturant cette affaire, v. Cass. 1re civ., 3 juill. 2001, n° 00-10254.
-
16.
Cass. 1re civ., 2 avr. 2008, nos 06-10256 et 07-11639 : D. 2008, p. 1145, obs. Gallmeister I. ; RTD civ. 2008, p. 464, obs. Hauser J. : la Cour a affirmé que « l’article 16-11 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 (…) est immédiatement applicable aux situations en cours » et conduit à interdire une identification génétique post mortem sur des échantillons déposés auprès du CECOS.
-
17.
Cons. const., 3 sept. 2011, n° 2011-173 QPC : JO, 1er oct. 2011, p. 16528 ; D. 2012, p. 1434, obs. Granet-Lambrechts F.
-
18.
CEDH, 13 juill. 2006, n° 58757/00 : RTD civ. 2006, p. 727, obs. Marguénaud J.-P. ; RTD civ. 2007, p. 99, obs. Hauser J.
-
19.
Afin de prévenir une éventuelle condamnation par la CEDH, le Conseil d’État a proposé de « modifier (…) les conditions de l’identification génétique des personnes après le décès en modifiant (…) l’article 16-11 alinéa 2 du Code civil : “(…) L’opposition expressément manifestée de son vivant par une personne à une telle identification fait obstacle à toute mise en œuvre de celle-ci après le décès de l’intéressé. En l’absence d’opposition expresse manifestée de son vivant par l’intéressé, le juge statue sur la demande d’identification post mortem en tenant compte de l’intérêt invoqué par le demandeur, du respect dû au corps du défunt et de la protection des droits des tiers” », in Conseil d’État, La révision des lois de bioéthique, 2009, Paris, La Documentation française, p. 142, § 15.
-
20.
V. not. Cass. 1re civ., 17 mars 1992, n° 90-16359 : D. 1993, p. 29, note Massip J. ; RTD civ. 1992, p. 548, obs. Huet-Weiller D.
-
21.
C. civ., art. 333, al. 1.
-
22.
C. civ., art. 334.
-
23.
Il est étonnant que les juges du fond aient pris comme point de départ une date antérieure à la reconnaissance. Certes, la fille a été élevée par l’homme depuis 1995 mais le délai de 5 ans ne commence à courir qu’au jour de la reconnaissance, soit le 26 juillet 2005. Dans tous les cas, la possession d’état de 5 ans est bien constatée.
-
24.
C. civ., art. 311-1, 1°.
-
25.
C. civ., art. 311-1, 2°.
-
26.
Fulchiron H. et Malaurie P., Droit de la famille, 6e éd., 2018, Paris, LGDJ, Droit civil, p. 467, n° 997.
-
27.
CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie, § 44.
-
28.
CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie, § 43.
-
29.
CEDH, 24 nov. 2005, n° 74826/01, Shofman c/ Russie.
-
30.
CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie.
-
31.
CEDH, 12 janv. 2006, n° 26111/02, Mizzi c/ Malte, § 112.
-
32.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25938 : D. 2019, p. 505, obs. Douchy-Oudot M. ; RTD civ. 2019, p. 87, obs. Leroyer A.-M. – V. aussi not. Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-20790 ; Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19853 : D. 2016, p. 1980, note Fulchiron H. ; RTD civ. 2016, p. 831, obs. Hauser J. – Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19853.
-
33.
Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19853.
-
34.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25938.
-
35.
Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25507.
-
36.
V. not. CEDH, 12 janv. 2006, n° 26111/02, Mizzi c/ Malte, § 113 : selon la Cour, « une situation dans laquelle une présomption peut prévaloir sur la réalité biologique ne saurait être compatible avec l’obligation de garantir le “respect” effectif de la vie privée et familiale ».
-
37.
CEDH, 6 déc. 2011, n° 2899/05, Iyilik c/ Turquie, § 35 : selon la Cour, « l’absence d’une quelconque manifestation de la part de l’enfant démontrant son souhait de voir vérifier sa paternité (…) joue en l’espèce en faveur de l’intérêt de la fille putative du requérant, consistant à ne pas être privée d’une paternité biologique distincte de la filiation » – CEDH, 10 oct. 2006, n° 10699/05, Paulik c/ Slovaquie, § 46 : en l’espèce, la fille, âgée de 40 ans et mariée ne dépendait plus de son père et avait accepté les tests ADN et ne s’opposait pas à la destruction du lien de filiation.
-
38.
Soulignons tout de même que la jeune femme ne s’est pas directement opposée à l’action de son père. En réalité, elle « s’en remettait à droit sur la demande », ce que les juges du fond ont analysé comme une contestation.
-
39.
CEDH, 27 oct. 1994, n° 18535/91, Kroon c/ Pays-Bas, § 40 ; CEDH, 24 nov. 2005, n° 74826/01, Shofman c/ Russie, § 44.
-
40.
« Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
-
41.
Douchy‐Oudot M., Procédures 2018, comm. 303, p. 36.
-
42.
Possibilité ouverte uniquement en l’absence de titre antérieur ou d’ouverture de procédure judiciaire, et de respect d’un barème plancher.
-
43.
CA Agen, 19 avr. 2012, n° 11/00855 : LPA 12 août 2013, p. 3, obs. Dekeuwer‐Défossez F.
-
44.
CA Limoges, 12 avr. 2012, n° 11/00445 : LPA 12 août 2013, p. 3, obs. Dekeuwer‐Défossez F.
-
45.
Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-13135 ; Cass. 3e civ., 3 oct. 2019, n° 18-23078.
-
46.
Cass. 2e civ., 4 mars 1987, n° 86-10453 : Bull. civ. II, n° 60 – Cass. 2e civ., 2 mai 2001, n° 99-15714 : Dr. famille 2001, comm. 78, note Lécuyer H. – Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 04-14185 : D. 2006, p. 2122 – Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, n° 11-19779.
-
47.
Cass. 1re civ., 1er févr. 2012, n° 10-25546 : Dr. famille 2012, comm. 72, obs. Beigner B. ; JCP G 2012, 512, note Donnier J.‐B.
-
48.
Cass. 1re civ., 7 déc. 2011, n° 10-26105 : RLDC 2012/90, n° 4562 – Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-25301 : Bull. civ. I, n° 203 ; JCP G 2013, 1269, obs. Bazin E. ; RTD civ. 2014, p. 77, obs. Deumier P. ; RJPF 2013/12, n° 28, obs. Corpart I.
-
49.
CA Versailles, 31 mai 2012, n° 11/01565.
-
50.
Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-13135 : Bull. civ. I, n° 140 ; D. 2005, p. 1112 – Cass. 1re civ., 6 févr. 2008, n° 07-14275.
-
51.
Cass. 3e civ., 3 oct. 2019, n° 18-23078.