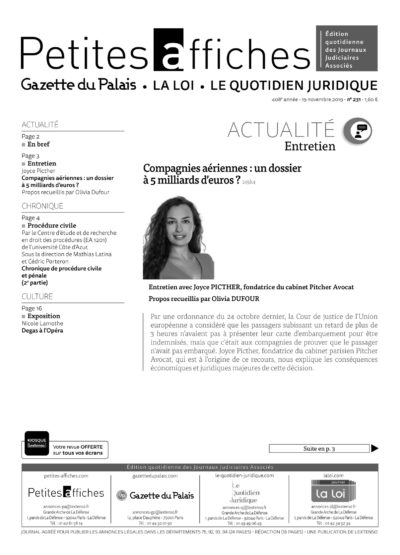Chronique de procédure civile et pénale (2e partie)
Dans le cadre d’une chronique d’une périodicité semestrielle, le Centre d’études et de recherches en droit des procédures (EA 1201) de l’université Côte d’Azur a décidé de mettre en valeur des décisions de juges du fond comme de la Cour de cassation se rattachant à la procédure civile (incluant la procédure devant les juridictions civiles mais aussi commerciales et sociales) et à la procédure pénale. Selon un ordonnancement qui sera suivi systématiquement, des décisions portant sur les modes alternatifs à la procédure judiciaire, l’introduction de la procédure, l’instruction du procès, l’audience et les voies de recours, seront abordées au gré des choix réalisés par les auteurs.
I – Les modes alternatifs à la procédure judiciaire
A – Les MARDs
B – L’arbitrage et la transaction
II – L’introduction de la procédure
A – Les modes d’introduction de la procédure
1 – Procédure civile
2 – Procédure pénale
B – Les modes (ou les moyens) de résistance à la procédure introduite
1 – En procédure civile
Contentieux de l’expertise CHSCT et délai de forclusion (Cass. soc., 20 mars 2019, nos 17-27663 et 17-23027 et Cass. soc., 29 mai 2019, n° 17-21556).
Le délai de forclusion, érigé en fin de non-recevoir, conditionne l’action de l’employeur en contestation de la décision du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de recours à un expert1 à la charge de l’employeur, depuis la loi du 8 août 20162, dite loi Travail. Cette réforme du régime juridique de l’action en contestation de la décision du CHSCT de recours à un expert fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 27 novembre 20153 ayant retenu que la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et de l’absence de délai d’examen de ce recours conduit à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours. Il en résultait, pour le Conseil constitutionnel, que la procédure tirée des dispositions de l’article L. 4614-134 du Code du travail alors applicables, méconnaissait les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et privait de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Pour remédier à l’inconstitutionnalité du texte, la loi Travail du 8 août 2016 a soumis l’action en contestation de l’employeur à un délai de forclusion de 15 jours à partir de la délibération du CHSCT et la décision du président du tribunal de grande instance saisi à un délai de 10 jours, avec effet suspensif sur l’exécution de la décision du CHSCT.
Encore fallait-il préciser les modalités de mise en œuvre de l’action de l’employeur. C’est ce que la chambre sociale de la Cour de cassation précise en terminant de forger le régime juridique issu de la loi Travail du droit à contestation de l’employeur contre la décision de recours à expertise du CHSCT : les trois arrêts sous commentaire y participent en envisageant le droit transitoire (I), le point de départ (II) et la cause interruptive du délai de forclusion (III).
I. Droit transitoire : modalités d’application du délai de forclusion plus court aux situations en cours
Par l’une des décisions du 20 mars 20195, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les modalités d’application des nouvelles dispositions attachées au délai de forclusion de l’action en contestation de l’employeur contre la décision du CHSCT de recours à expertise, faisant suite au délai de prescription de droit commun applicable auparavant. Le délai de forclusion de 15 jours, plus court que le délai de prescription de droit commun, s’applique, aux situations en cours, à compter de l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue, la loi du 8 août 2016, soit à compter du 10 août 2016 en considération de l’absence de dispositions particulières régissant la mise en œuvre de ce délai, ne nécessitant pas de décret d’application.
II. Point de départ du délai de forclusion
Il ne suffit pas de réformer l’action en contestation en l’enfermant dans un délai de forclusion permettant la suspension de la décision du CHSCT attaquée, pour rendre le droit d’agir effectif : encore faut-il préciser le point de départ du délai de forclusion en fonction des termes de la décision attaquée.
En effet, aucune disposition n’interdit au CHSCT d’élaborer les modalités de l’expertise dans des décisions distinctes après avoir adopté le principe du recours à l’expertise6 lors d’une première réunion. Il fallait donc, pour rendre effectif le droit d’agir de l’employeur, préciser que le délai de 15 jours pour contester les modalités d’expertise ou son étendue ne court qu’à compter du jour de la délibération les ayant fixées. C’est le sens de l’une des décisions rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 mars 20197.
La haute juridiction suit en cela ce qu’elle avait déjà retenu sur le fondement des articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1 du Code du travail issus de la loi du 8 août 2016 interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dans un arrêt du 28 mars 20188. Elle a considéré qu’il résulte de ces textes que le délai de 15 jours pour contester le coût prévisionnel de l’expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur en a été informé. Dès lors, pour que soit effectif le droit de contester la décision du recours à l’expert ou la décision en fixant les modalités (coût prévisionnel, mission de l’expert, désignation de l’expert), le délai de contestation ne saurait courir avant la décision qui les fixe ou les détermine.
Dans sa décision du 20 mars 20199, la chambre sociale précise également que la contestation du périmètre de l’expertise induit la contestation de son coût prévisionnel, même si l’employeur, dans son assignation en contestation du périmètre, n’a pas expressément contesté le coût prévisionnel. Sa contestation n’est pas irrecevable, même formulée tardivement dans des conclusions en cours d’instance initiée au titre de la contestation du périmètre de l’expertise.
III. Cause interruptive du délai de forclusion
Dans sa décision du 29 mai 201910, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’est fixée au jour de l’assignation et non de sa remise au greffe, la date de saisine du juge interrompant le délai de forclusion. L’article L. 4614-13 du Code du travail, issu de la loi du 8 août 2016, fixe l’interruption du délai de forclusion à la saisine du juge. Or la demande en justice est portée par voie d’assignation tel que cela résulte de l’article 485 du Code de procédure civile, appliqué à la saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. L’article 485 du même code est visé par la chambre sociale dans son arrêt du 29 mai 2019. En procédure civile, une demande initiale peut, en effet, être faite par assignation11, laissant supposer que la date retenue de cette demande soit celle de sa délivrance et non celle de son dépôt au greffe conditionnant la saisine valable du juge. Dans sa décision du 29 mai 2019, la haute juridiction reprend une solution déjà arrêtée par elle précédemment12. La position de la chambre sociale de la Cour de cassation n’est pas différente de celle retenue en procédure civile concernant la date fixée pour l’interruption du délai de forclusion par la demande en justice13. Cette interprétation, favorable au demandeur, devrait pouvoir être la même après la réforme issue des ordonnances dites Travail du 22 septembre 2017 dans la mesure où le délai de forclusion ramené à 10 jours par les nouveaux textes applicables14 au CSE est également interrompu par la saisine du juge par l’employeur.
Les contestations introduites auprès du juge judiciaire à compter du 1er janvier 2020 saisiront le président du tribunal judiciaire « statuant selon la procédure accélérée au fond »15. Reste à modifier les dispositions réglementaires du Code du travail16.
Christine GAILHBAUD
Durée et point de départ du délai de prescription de l’action en fixation des honoraires d’avocat (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-11372).
Durée et point de départ de la prescription de l’action en restitution d’honoraires (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-10767).
La Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence du 26 mars 2015 et du 4 octobre 201817 que nous avions commentée dans la précédente chronique18.
1. On sait que depuis trois arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 201519, la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires est recevable dans le délai de prescription de 2 ans édicté à l’article L. 218-2 du Code de la consommation20. Dans ces trois précédents, le client était un « consommateur », au sens de ce texte, de telle sorte que la Cour en déduit qu’est « soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 [devenu L. 218-2] du Code de la consommation la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Dans la première affaire jugée le 7 février 2019 par la Cour de cassation (n° 18-11372), l’avocat avait deux clients, une personne physique et une société. Dans son ordonnance, le premier président avait déclaré « prescrite la demande de fixation d’honoraires de l’avocat à l’encontre de la société » en faisant « application des dispositions de l’article L. 137-2 [devenu L. 218-2] du Code de la consommation en retenant que cette société ayant pour secteur d’activité les installations sportives doit être regardée comme un consommateur au sens de ce texte ». La Cour casse cette ordonnance au motif que « le client de l’avocat était en l’espèce une personne morale, ce dont il se déduisait qu’il n’avait pas la qualité de consommateur ». Ainsi le délai de prescription de l’action en fixation des honoraires d’avocat varie selon que le client est ou n’est pas consommateur au sens de l’article L. 218-2 du Code de la consommation : 2 ans dans le premier cas, 5 ans dans le second (délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil).
2. Tel n’est pas le seul intérêt de l’arrêt n° 18-11372 du 7 février 2019. En effet, à propos du point de départ du délai de prescription, l’arrêt du 4 octobre 2018 l’avait fixé « au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture » (préc.). Mais il s’agissait alors d’un cas de prescription biennale, le client de l’avocat étant un « consommateur ». La question se posait donc de savoir si le même point de départ devait être retenu lorsque le client est soit une personne morale, soit une personne physique ayant fait appel à l’avocat dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. La Cour confirme que « le point de départ du délai de la prescription de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture »21.
3. Dans la note de bas de page n° 23 de notre précédente chronique de procédure civile et pénale (janvier-décembre 2018)22, nous indiquions : « En revanche, lorsque c’est le client qui veut agir en contestation de la facture d’honoraires de son avocat ou en restitution des honoraires qu’il estime avoir payés en trop, le délai de prescription applicable est certainement le délai de droit commun édicté à l’article 2224 du Code civil : 5 ans ». Cette analyse résultait d’un raisonnement a contrario puisque l’article L. 218-2 du Code de la consommation réserve la prescription biennale à la seule « action des professionnels » (avocats) contre les « consommateurs » (clients). S’agissant d’un délai spécial de prescription, il s’interprète stricto sensu, donc dans le seul cadre des actions en fixation d’honoraires engagées par l’avocat contre son client-consommateur et non dans le cadre de l’action du client en contestation ou en restitution d’honoraires trop payés.
Effectivement, dans son second arrêt du 7 février 2019 (n° 18-10767), la Cour de cassation confirme le délai quinquennal de la prescription dans ce cas en considérant comme non prescrite l’action de la cliente engagée près de trois ans après la rupture des relations avec son avocat. Au passage, la Cour retient sans surprise le même point de départ du délai de prescription qu’en matière d’action en fixation des honoraires engagée par l’avocat : « Le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat ». En l’espèce, la date de fin de mandat était facile à démontrer puisqu’elle correspondait à la date de dessaisissement de l’avocat par sa cliente.
Philippe KAIGL
Pour faire courir le délai de 6 mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature (Cons. prud’h. Grasse, sec. activités diverses, 7 févr. 2019, n° F 17/00636).
Les délais de prescription extinctive imposés par le droit du travail sont multiples. Nous rappellerons decrescendo :
-
le délai de 10 ans (à compter de la consolidation) prévu à l’article 2226 du Code civil pour agir en réparation d’un dommage corporel s’applique évidemment aux dommages corporels causés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail ;
-
le délai de 5 ans prévu à l’article L. 1134-5 du Code du travail en matière d’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination et à l’article 2224 du Code civil en matière de harcèlement moral ou sexuel ;
-
le délai de 3 ans prévu à l’article L. 3245-1 du Code du travail en matière d’action en paiement ou en restitution du salaire ;
-
le délai de 2 ans prévu à l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail en matière d’action portant sur l’exécution du contrat de travail ;
-
le délai de 12 mois prévu pour contester un licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1235-7), pour tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation d’une rupture conventionnelle individuelle (C. trav., art. L. 1237-14) ou collective (C. trav., art. L. 1237-19-8) et pour contester la rupture d’un contrat de sécurisation professionnelle (C. trav., art. L. 1233-67) et plus généralement pour toute action portant sur la rupture du contrat de travail (C. trav., art. L. 1471-1, al. 2) ;
-
enfin le délai de 6 mois pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte (C. trav., art. L. 1234-20 : « Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».).
Le point de départ de ce délai est la date de la signature, « peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine »23. Même si le Code du travail prévoit que « le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée »24, il est depuis longtemps admis qu’il s’agit d’une forme requise ad probationem25 et que le salarié peut aussi le dénoncer en saisissant le conseil de prud’hommes26.
1. Dans l’affaire jugée par le conseil de prud’hommes de Grasse le 7 février 2019, l’employeur opposait une fin de non-recevoir aux demandes de paiement d’heures supplémentaires. Certes, le salarié avait déposé sa requête introductive d’instance 6 mois jour pour jour après la signature (supposée) du reçu, mais l’employeur n’avait évidemment été destinataire de la convocation en conciliation que quelques jours plus tard, donc au-delà du délai légal.
La question se pose donc de définir l’acte interruptif du délai de 6 mois lorsque le salarié conteste le solde de tout compte en saisissant le conseil de prud’hommes : est-ce le jour du dépôt de la requête introductive d’instance au greffe du Conseil de prud’hommes ou est-ce le jour de notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ?
Dans un récent arrêt censurant les juges du fond, la Cour de cassation considère que « si la convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l’article L. 1234-20 du Code du travail, c’est à la condition qu’elle ait été reçue par l’employeur dans le délai de 6 mois »27. Ce n’est donc pas l’acte de saisine du conseil de prud’hommes (le dépôt de la requête introductive d’instance) qui interrompt le délai de 6 mois, mais la notification à l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Il y a matière à s’interroger sur le bien-fondé de cette jurisprudence.
En effet, d’une part la circonstance que l’arrêt du 7 mars 2018 soit un arrêt de cassation permet de supposer une certaine résistance des juges du fond qui, dans cette affaire, avaient jugé que la saisine du conseil de prud’hommes par un salarié produisait les effets d’une dénonciation.
D’autre part, la Cour de cassation a certes reproduit sa jurisprudence habituelle (mais ancienne) en cette matière28, mais elle ne la justifie pas davantage. En effet, l’arrêt du 7 mars 2018 est seulement rendu au visa de l’article L. 1234-20 du Code du travail, lequel se contente de consacrer l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte dénoncé dans les 6 mois de sa signature. D’où la question légitimement posée par la doctrine : « Pourquoi la Cour de cassation juge-t-elle au contraire que le délai de dénonciation du reçu pour solde de tout compte ne peut être interrompu que par la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et non par l’introduction de la demande en justice ? »29.
Il convient de rappeler que l’interruption de la prescription extinctive résulte en règle générale de la « demande en justice »30. Or selon l’article R. 1452-5 du Code du travail, « la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice ». Demande en justice et citation en justice ne sont pas synonymes. La demande correspond à l’initiative31 du demandeur de saisir la juridiction. La citation en justice correspond au support procédural formant la demande32 et informant le défendeur qu’un procès lui est intenté. Autrement dit, dans la procédure prud’homale, la citation en justice est matérialisée par la convocation du défendeur. Mais le même texte ajoute : « sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 1452-1 », aux termes duquel « la saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription ». Ainsi, la règle spéciale de R. 1452-1, alinéa 2, du Code du travail (la prescription est interrompue dès la saisine du conseil de prud’hommes) rejoint la règle de droit commun édictée à l’article 2241 du Code civil (la demande en justice interrompt le délai de prescription) et illustre la tendance mise en évidence par la doctrine selon laquelle « l’interruption du délai procède désormais essentiellement de la manifestation de volonté du demandeur et non de la connaissance de la demande en justice par le défendeur »33. Cette analyse qui paraît très respectueuse des textes conduit la doctrine à conclure très légitimement : « En définitive, aucun texte ne paraît de nature à fonder la solution de la Cour de cassation fixant l’interruption du délai de dénonciation seulement à la date à laquelle l’employeur en a connaissance »34.
2. Dans l’affaire jugée le 7 février 2019, le conseil de prud’hommes de Grasse a contourné cette difficulté. En effet, si en l’espèce le reçu pour solde de tout compte avait bien été signé par l’employeur et le salarié, il était dépourvu de date. Certes, quelques indices permettaient de le situer à la date du certificat de travail, de l’attestation pour Pôle Emploi et de l’expiration de la période de préavis (17 février 2017), mais ce n’était qu’une spéculation. L’article L. 1234-20 du Code du travail est très explicite : « Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature ». Le conseil de prud’hommes en déduit très justement que « le reçu pour solde de tout compte non daté qui n’apporte pas la preuve qu’il a été signé après l’expiration du contrat est sans effet libératoire pour l’employeur. En l’espèce, il n’est pas daté, ce qui implique que la date effective de fin de la relation de travail n’est pas établie ; en conséquence, aucun délai de prescription et de forclusion concernant le reçu pour solde de tout compte ne saurait s’appliquer » et a déclaré le salarié recevable en ses demandes. Autrement dit, à défaut de date de signature, le délai de 6 mois n’a pas pu commencer à courir. Ce raisonnement de bon sens a d’ailleurs été entériné quelques jours plus tard par la Cour de cassation « pour faire courir le délai de 6 mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature »35.
Affaire à suivre car le jugement a été frappé d’appel.
Philippe KAIGL
Le délai de forclusion prévu à l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 s’applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblée générale, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière (CA Aix-en-Provence, 1-5, 25 avr. 2019, n° 17/15242).
La compétence du tribunal de grande instance pour annuler des décisions d’assemblée générale de copropriétaires est une « compétence de principe » et non une compétence exclusive (J. prox. Cannes, 9 mai 2017, RG n° 91-16-000206).
Initialement pleine propriétaire de ses lots, une copropriétaire n’en avait plus qu’un droit d’usage et d’habitation après les avoir vendus en viager le 1er février 2012. Un conflit ayant opposé la crédirentière et le débirentier sur la clé de répartition des charges de copropriété en raison de la mauvaise qualité rédactionnelle de l’acte de vente, le syndicat des copropriétaires avait fini par les assigner devant la juridiction de proximité de Cannes pour demander leur condamnation solidaire à payer en principal 2 287,19 €.
En défense, la crédirentière contestait devoir les charges de copropriété réclamées en invoquant la nullité des cinq assemblées générales successives auxquelles elle n’avait pas été convoquée en dépit des dispositions formelles du règlement de copropriété36. La crédirentière avait donc été écartée de la participation aux votes des assemblées générales depuis qu’elle avait vendu ses lots en viager, en violation du droit fondamental de tout copropriétaire de participer à l’assemblée générale, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le vote du copropriétaire « écarté » aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi37.
Cette demande reconventionnelle d’annulation des assemblées générales était parfaitement recevable devant la juridiction de proximité. En effet, aucune des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou de son décret d’application n’attribue compétence exclusive au tribunal de grande instance pour se prononcer sur une demande d’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires. La Cour de cassation a jugé que la compétence du tribunal de grande instance en cette matière n’était qu’une « compétence de principe », ce qui ne veut pas dire une compétence exclusive38. Dans un arrêt du 10 juin 2015, la Cour de cassation a confirmé que la demande d’annulation d’une décision d’assemblée générale ne relevait pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et admis la recevabilité d’une telle demande présentée à titre reconventionnel devant une juridiction de proximité39.
Mais là n’était pas le cœur du débat puisqu’aucune des parties n’avait soulevé l’incompétence de la juridiction de proximité pour statuer sur cette demande reconventionnelle. La question majeure portait sur la recevabilité de cette demande d’annulation formée évidemment au-delà du délai de forclusion de 2 mois mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour décider qu’il appartenait à la crédirentière « d’agir dans le délai préfix dès l’année 2012 », la juridiction de proximité s’était référée à « deux arrêts de principe » de la Cour de cassation selon lesquels « même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdites décisions »40 et « le délai de forclusion de l’article 42, alinéa 2, s’appliquait aux actions qui avaient pour objet de contester les décisions d’assemblée générale même fondées sur une absence de convocation »41.
Le jugement s’est mépris sur la portée des deux arrêts de la Cour de cassation des 12 octobre 2005 et 19 décembre 2007. En effet, cette jurisprudence de la Cour de cassation ne s’applique au copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué que s’il a reçu notification du procès-verbal d’assemblée générale. Or en l’espèce, le syndic n’avait plus jamais notifié les procès-verbaux d’assemblée générale à la crédirentière depuis que celle-ci avait vendu en viager, portant ainsi « atteinte au droit fondamental de tout copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l’assemblée générale »42. C’est donc le délai décennal de droit commun pour agir, visé à l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, qui devait s’appliquer dans cette hypothèse.
Quoique critiquable, le jugement de la juridiction de proximité de Cannes avait au moins le mérite d’être motivé. Tel n’est pas le cas de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 avril 2019 qui s’en tient à une motivation rudimentaire. Après avoir rappelé la teneur de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour se contente de décider que « le délai de forclusion prévu par cet article s’applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblée générale, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière ».
La motivation extrêmement sommaire de l’arrêt de la cour crée un malaise. En effet, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne vise que le cas des copropriétaires « opposants ou défaillants ». Or pour être « opposant », il faut être présent ou représenté et voter contre ; pour être « défaillant », il faut être absent régulièrement convoqué. En l’espèce, la crédirentière n’était ni l’une ni l’autre. En outre, le délai de 2 mois ne court qu’à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale. Or aucun PV n’a été régulièrement notifié à la crédirentière de 2012 à 2016. Par sa motivation superficielle, la cour donne l’impression qu’elle a voulu éviter de semer le désordre qui aurait suivi l’annulation de toutes les assemblées générales de 2012 à 2016.
Il y a incompatibilité de fait entre le principe autorisant le copropriétaire défendeur à demander à titre reconventionnel l’annulation d’une assemblée générale et l’exigence du respect du délai de 2 mois. En effet, en pratique, comment le délai de 2 mois pourrait-il être respecté alors que la date de cette demande reconventionnelle dépendra de la chronologie imposée par le syndic agissant en paiement des charges ? L’effectivité du droit d’interrompre le délai de forclusion de 2 mois par une demande reconventionnelle est quasi inexistante.
En outre, il ne faut pas oublier que si la demande reconventionnelle aux fins d’annulation de l’assemblée est formée devant une juridiction où la procédure est orale, les conclusions contenant cette demande reconventionnelle ne seront interruptives du délai de forclusion qu’à la date de l’audience des plaidoiries ou à tout le moins à l’une ou l’autre des audiences intermédiaires à la condition que l’auteur de la demande reconventionnelle se fasse donner acte par le tribunal de l’effet interruptif qu’il prétend attacher à sa demande reconventionnelle. En effet, l’oralité de la procédure a pour conséquence que le juge n’est saisi que par les prétentions et moyens énoncés oralement à l’audience43.
Philippe KAIGL
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-14736).
On connaissait la cassation par voie de conséquence44. Il existe aussi une solution prétorienne consacrant un « effet interruptif de prescription par voie de conséquence ».
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Si l’effet interruptif de prescription attaché à la signification de l’assignation et plus généralement à la demande en justice est une solution acquise, la question se pose de déterminer la portée de cette interruption.
Dans l’affaire jugée le 9 mai 2019 par la Cour de cassation, trois actions avaient été successivement engagées aux dates suivantes : le 19 juillet 2011, l’acquéreur (une société civile) d’une machine à vendanger et d’un pulvérisateur achetés en juillet 2009 et fabriqués par la société Grégoire avait assigné son vendeur direct (société commerciale) en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Le 20 avril 2012, le vendeur assigné en garantie des vices cachés avait à son tour assigné le fabricant devant le tribunal de commerce de Bordeaux, mais sur le seul fondement de l’article 1134 du Code civil, aux fins d’être relevé et garanti d’éventuelles condamnations.
Après intervention volontaire du fabricant devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 septembre 2014, le revendeur avait à son tour demandé par conclusions du 7 novembre 2014 la résolution de la vente conclue avec le fabricant. Ce dernier avait alors opposé la prescription au motif que la résolution de cette vente avait été demandée plus de 2 ans après la découverte des vices cachés. L’arrêt ne nous renseigne pas sur la date de « découverte » des vices cachés au sens de l’article 1648 du Code civil, mais les équipements incriminés ayant été achetés en juillet 2009, nul doute que la première action en garantie des vices cachés engagée le 19 juillet 2011 était bien interruptive du délai de prescription biennale. L’action du revendeur du 20 avril 2012 aux fins d’être relevé et garanti par le fabricant avait étrangement été fondée sur l’article 1134 ancien du Code civil alors qu’elle aurait dû reposer d’emblée sur les articles 1641 et suivants du Code civil. Ce n’est que dans ses conclusions du 7 novembre 2014 devant le tribunal de grande de Bordeaux que le revendeur a précisé le contour de son action contre le fabricant, probablement après lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 juin 2013, en sollicitant la résolution du contrat le liant au fabricant sur le fondement de l’action rédhibitoire de l’article 1644 du Code civil.
Cherchant à exploiter le « hiatus » de l’assignation du 20 avril 2012 qui ne se référait pas explicitement à la garantie des vices cachés, le fabricant a prétendu que l’action rédhibitoire du revendeur à son encontre matérialisée par les conclusions du 7 novembre 2014 était atteinte par la prescription biennale qui n’aurait pas été interrompue par l’assignation du 20 avril 2012. Par arrêt du 1er février 2018, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la résolution de la vente conclue entre le revendeur et son client, mais a déclaré prescrite la demande de résolution de la vente conclue entre le fabricant et son revendeur.
Pour casser l’arrêt d’appel « en ce qu’il dit l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés » du revendeur contre le fabricant « irrecevable comme prescrite », la Cour de cassation déclare que « si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ».
Le critère retenu par la Cour est l’identité d’objectif entre les deux actions45. Toutes les chambres de la Cour de cassation ont déjà accepté cet effet interruptif par voie de conséquence dans des circonstances diverses. C’est ainsi que depuis 2017, la Cour de cassation a jugé que :
-
« l’action en responsabilité délictuelle tendait aux mêmes fins indemnitaires que l’action en responsabilité contractuelle »46 ;
-
« l’action civile engagée… devant la juridiction répressive avait eu pour effet d’interrompre la prescription biennale applicable en matière d’accident du travail, même si cette juridiction était incompétente pour statuer sur ce litige »47 ;
-
« l’action en nullité, bien que distincte de l’action en résolution, tendait à un même but, l’anéantissement de la vente »48 ;
-
« la demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale, présentée par Mme Z. dans son assignation, avait pour but d’empêcher M. A. d’échapper aux obligations relatives au solde débiteur de son compte courant d’associé et la demande de condamnation de M. A. à payer à la société le montant du solde débiteur de ce compte courant avait le même but ; qu’en cet état, la cour d’appel a pu retenir que l’assignation à jour fixe délivrée par Mme Z. devant le tribunal pour l’audience du 11 mai 2011 avait interrompu le délai de prescription de l’action en paiement dirigée contre M. A. »49 ;
-
« les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail »50.
Cette solution prétorienne présente un lien de parenté avec les dispositions de l’article 565 du Code de procédure civile en matière d’appel : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Cependant, dans l’affaire jugée le 9 mai 2019, la Cour de cassation élargit sensiblement le périmètre de cet effet interruptif de prescription « par voie de conséquence » en étendant l’effet interruptif d’une action en garantie des vices cachés à une simple action aux fins de « relever et garantir » dotée d’un fondement juridique pour le moins évasif51.
Philippe KAIGL
L’opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire (avant la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) à la prescription décennale résultant de la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal n’a pas pour effet de soumettre l’action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, ce délai étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu’à la date de sa clôture (Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-14002, F-PBR).
Lorsqu’un débiteur est placé en procédure collective, le créancier doit être particulièrement vigilant tant dans ses rapports avec le débiteur principal que dans ses rapports avec la caution qui vient garantir le paiement de la dette. En effet, si la situation de la caution est très souvent calquée sur celle du débiteur principal, nombreux sont les cas dans lesquels la situation de la caution est au contraire déconnectée de celle du débiteur principal. Cet arrêt du 16 janvier 2019 illustre avec une acuité particulière la difficulté pour le créancier de déterminer si les règles applicables au débiteur principal en matière de prescription ont vocation ou non à être étendues à la caution.
Il est admis depuis longtemps que l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance au passif jusqu’à la clôture de la procédure collective joue aussi bien dans les rapports créancier-débiteur principal que dans les rapports créancier-caution. L’article L. 622-25-1 du Code de commerce dispose que : « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective ». Ce texte, introduit par l’ordonnance du 12 mars 2014, a consacré une solution traditionnelle de la Cour de cassation52, laquelle avait pris le soin de préciser que cet effet interruptif de prescription de la déclaration de créance s’appliquait tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard de la caution53. Dans cet arrêt en date du 16 janvier 2019, la haute juridiction réaffirme une nouvelle fois cette solution : le délai pour agir dont dispose le créancier contre la caution est, comme à l’encontre du débiteur principal, interrompu pendant toute la durée de la procédure collective jusqu’à la date de sa clôture. L’action du créancier contre le débiteur et contre la caution est donc prescrite à l’expiration d’un nouveau délai commençant à courir à compter de la clôture de la procédure collective.
Toutefois, la durée du délai reconnu au créancier pour poursuivre la caution après la clôture de la procédure collective n’est pas identique à la durée du délai reconnu au créancier pour agir contre le débiteur principal après cette même clôture. Le délai de prescription de l’action en paiement contre la caution, qui recommence à courir à compter de la clôture de la procédure collective, est en effet distinct de celui applicable à l’opération principale.
Sans entrer dans le détail des faits, précisons seulement que ceux-ci se sont produits avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription en date du 17 juin 2008. Or il était admis en jurisprudence que l’admission au passif de la créance principale entraînait, comme toute décision de justice, un effet interversif de prescription. La prescription attachée à la créance déclarée, par exemple une prescription décennale pour une créance commerciale de droit commun, devenait trentenaire54. Il en résultait que le créancier disposait d’un délai de 30 ans, à compter de la clôture de la procédure collective, pour poursuivre le débiteur principal en paiement.
L’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2019 pose alors la question suivante : ce mécanisme d’interversion de la prescription attaché à la décision d’admission de la créance au passif doit-il être transposé dans les rapports entre le créancier et la caution ? La Cour de cassation répond négativement à cette question. Dans les rapports entre le créancier et la caution, le délai de prescription est indépendant de la substitution de prescription opérée par la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective qui ne joue que dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal. Le délai du créancier pour agir en paiement contre la caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution. Ainsi, dans la présente affaire, c’est la prescription commerciale résultant de l’article L. 110-4 du Code de commerce (réduite de 10 ans à 5 ans par la loi du 17 juin 2008) qui devait recevoir application.
Appelé à une très large diffusion, cet arrêt de principe s’inscrit dans la lignée de décisions récentes qui ont affirmé dans le même sens que le délai de prescription de l’action du créancier contre la caution, qui recommence à courir à compter de la clôture de la procédure collective, est le même que celui initialement applicable en raison de la nature de la créance55. La solution assure un véritable équilibre entre les intérêts du créancier et ceux de la caution : s’il y a bien interruption du délai de prescription de l’action contre la caution pendant toute la durée de la procédure collective, il n’y a point, en revanche, transformation de ce délai en un délai plus favorable à compter de la clôture de la procédure.
Diane BOUSTANI
2 – En procédure pénale
Lorsqu’une infraction, constatée à l’aide d’un appareil de contrôle automatique, a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, sauf circonstances prévues par la loi, indiquer, par lettre recommandée ou de façon dématérialisée, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu’il s’agit du représentant légal lui-même (Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 18-82380).
Dans le cas d’espèce, un avis de contravention pour un excès de vitesse a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule verbalisé, une société X. L’amende forfaitaire minorée a été réglée par carte de paiement sans désignation du conducteur. La société a reçu un avis pour la contravention prévue par l’article L. 121-6 du Code de la route. Son gérant, M. Y, a adressé une requête en exonération. La personne morale poursuivie a été relaxée.
Dans sa décision la Cour considère que la décision encourt la censure. Pour relaxer des fins de la poursuite, le jugement retient que la contravention initiale d’excès de vitesse ayant été payée par le représentant légal de la société, il s’est ainsi auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant, d’où il résulterait que la personne morale a bien répondu, par son représentant légal, à l’obligation de désigner le conducteur puisqu’elle a reconnu l’infraction et payé l’amende, éteignant ainsi l’action publique.
Cette position ne pouvait qu’être soumise à censure : en payant, la société n’avait pas indiqué l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule56, fût-elle son gérant. Le tribunal de police a donc méconnu le sens et la portée des textes. Fort logiquement, la Cour considère que les articles L. 121-6 du Code de la route, ensemble les articles A. 121-1 à A. 121-3 dudit code ont été violés.
Ces articles sont clairs et déterminent les obligations lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du Code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale. Le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu’il établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de cet avis, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule. C’est le cas, y compris lorsqu’il s’agit du représentant légal lui-même. Il n’y a pas lieu de distinguer là où le texte ne distingue pas. Cette désignation doit alors être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, en utilisant le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l’avis ou en utilisant les informations y figurant, à l’aide du formulaire en ligne. Dès lors, le fait de contrevenir au présent article, qui ne crée pas une présomption de culpabilité57 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cédric PORTERON
Il résulte de l’article 1142-7 du Code de la santé publique que la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim., 8 janv. 2019, n° 18-82235).
Pour casser un arrêt rendu par une chambre de l’instruction, la chambre criminelle rappelle un point important sur la base d’un moyen soulevé d’office, pris de la violation, notamment, de l’article L. 1142-7 du Code de la santé publique.
Il résulte de ce texte que la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux suspend le délai de prescription de l’action publique. Ceci est mentionné clairement. Le principe est rappelé par la chambre criminelle.
Or pour confirmer une ordonnance de non-lieu et déclarer les faits prescrits, l’arrêt s’est contenté d’énoncer qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans les 3 ans qui ont suivi le jour du décès de la victime, la plainte de ses parents auprès du procureur de la République n’ayant pas le caractère d’un acte interruptif de la prescription de l’action publique, tandis que le premier acte interruptif d’enquête est intervenu plus tard.
En se prononçant ainsi, sans s’expliquer sur les conséquences sur le délai de la prescription de l’action publique de la saisine de la CRCI par les parents de la victime, la chambre de l’instruction n’a manifestement pas justifié sa décision. Intervenu au sujet d’une décision rendue avant la réforme de la prescription en matière pénale58, la solution apportée serait la même aujourd’hui.
Cédric PORTERON
La déclaration de créance ne constitue pas une action exercée devant une juridiction civile au sens de l’article 5 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 30 janv. 2019, n° 18-81460).
Dans le cas d’espèce, une société a conclu avec une autre, dirigée par M. X, un contrat de crédit-bail portant sur une pelle à chenille et ses accessoires. À la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la société a déclaré sa créance à la procédure collective. Cette société reprochant à M. X d’avoir vendu le matériel à un tiers, elle l’a directement fait citer devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance. Elle a sollicité, en réparation de son préjudice, le paiement d’une somme correspondant au montant du prix de vente. Le prévenu a soulevé in limine litis une fin de non-recevoir prise de l’application de la règle una via electa. Les premiers juges l’ont reçue. Ils ont déclaré la société irrecevable en son action. La partie civile a interjeté appel. La cour d’appel a infirmé la décision et rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action civile fondée sur l’article 5 du Code de procédure pénale. Elle a retenu que la constitution de partie civile du chef d’abus de confiance tendant à la réparation du dommage né de cette infraction diffère quant à son objet de la déclaration de créance préalablement effectuée devant le tribunal de commerce59.
Pour la chambre criminelle, le moyen qui reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir recherché, pour écarter l’application de la règle una via electa, si la déclaration par la société, partie civile, de sa créance née d’un contrat de crédit-bail, et son action civile devant le juge pénal tendant à la réparation de son dommage résultant de l’abus de confiance, visaient à obtenir le paiement de la même créance et avaient donc le même objet est inopérant. Pour la Cour de cassation, la déclaration de créance ne constitue pas une action exercée devant une juridiction civile au sens de l’article 5 du Code de procédure pénale.
On sait que selon les dispositions de l’article du Code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Toutefois, cette règle n’est applicable à la victime d’une infraction que si l’action qu’elle a portée devant la juridiction civile comporte une identité de parties, de cause et d’objet avec celle exercée par elle contre la même partie devant le tribunal correctionnel.
Lors d’une procédure collective, la Cour de cassation va plus loin. Pour elle, cette identité de partie, de cause et d’objet n’a pas à être recherchée pour une déclaration de créance. Cette déclaration ne constitue pas une action au sens de l’article 5 du Code de procédure pénale. Ceci permet donc d’exclure toute comparaison quant à l’objet et la cause des deux actions. Une déclaration de créance est une demande en paiement. Pour autant, elle n’est pas une action « au sens de l’article 5 du Code de procédure pénale ». Cette précision est importante. Elle marque l’autonomie du juge pénal dans l’interprétation de concept de nature civile. Cette décision est aussi marquée sous le sceau du bon sens. La déclaration de créance permet de participer au plan de redressement éventuellement décidé. Elle a un caractère automatique, dans l’intérêt de celui qui y procède. L’action pénale vise à faire reconnaître et juger l’existence d’une infraction. Par la citation directe, ou une plainte avec constitution de partie civile, c’est l’action publique qui est mise en mouvement.
Cédric PORTERON
III – L’instruction du procès
A – Le régime des preuves
1 – En procédure civile
2 – En procédure pénale
B – L’instance civile (…)
1 – Les incidents d’instance (…)
2 – La mise en état (…)
C – L’instruction pénale
IV – L’audience de jugement.
A – La convocation à l’audience
1 – En procédure civile (…)
2 – En procédure pénale
B – Le déroulement de l’audience
1 – L’audience civile
2 – L’audience pénale
C – L’issue de l’audience (…)
V – Les voies de recours
A – Les voies de recours ordinaires
1 – En matière civile
2 – En matière pénale
B – Les voies de recours extraordinaires
1 – En matière civile
2 – En matière pénale
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
C. trav., art. L. 4614-13, issu de L. 8 août 2016 : contestation de la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue et le délai de l’expertise.
-
2.
L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : JO, 9 août 2016.
-
3.
D. n° 2015-500 QPC, 27 nov. 2015.
-
4.
C. trav., art. L. 4614-13, 1er alinéa et première phrase du 2e alinéa : « Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.
-
5.
L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire (…) ».
-
6.
Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-27663.
-
7.
Cass. soc., 5 juill. 2018, n° 17-11829.
-
8.
Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-23027.
-
9.
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-28561.
-
10.
Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-23027.
-
11.
Cass. soc., 29 mai 2019, n° 17-21556.
-
12.
CPC, art. 54.
-
13.
Cass. soc., 6 juin 2018, nos 16-28026, nos 17-17594 et 17-10497.
-
14.
Not. Cass. 2e civ., 29 nov. 1995, n° 93-21063 : concernant le délai de prescription extinctive et les délais pour agir ; Cass. 3e civ., 15 mai 2002, n° 00-22175 ; Cass. 3e civ., 15 juin 2005, n° 03-17478 : concernant la prescription acquisitive et les délais pour agir ; puis C. civ., art. 2241 issu de la loi du 17 juin 2008.
-
15.
C. trav., art. L. 2315-86 et C. trav., art. R. 2315-49.
-
16.
Ord. n° 2019-738, 17 juil. 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, modifiant l’article L. 2315-86 du Code du travail.
-
17.
C. trav., art. R. 2315-50.
-
18.
Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20508.
-
19.
LPA 29 mai 2019, n° 143d4, p. 6.
-
20.
Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 13-28359 ; Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15013 ; Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11599.
-
21.
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
-
22.
Sur la notion de « fin de mandat », V. Kaigl P., « Chronique de procédure civile et pénale », LPA 29 mai 2019, n° 143d4, p. 6, commentaire de Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20508.
-
23.
LPA 29 mai 2019, n° 143d4, p. 6.
-
24.
Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-27600 : Juris-Data n° 2019-002439.
-
25.
C. trav., art. D 1234-8.
-
26.
CA Agen, 29 janv. 2002, n° 00/01798.
-
27.
Cass. soc., 5 juill. 1989, nos 86-42845 et 86-43633.
-
28.
Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-13194 : JCP S 2018, act. 80 ; D. 2018, p. 564 ; Dr. soc. 2018, p. 481, obs. Mouly J. ; Procédures n° 150, obs. Bugada A. ; RJS 5/2018, n° 322 ; SSL 2018, n° 1808, p. 12, obs. Caro M. ; JSL 2018, n° 452-5, obs. Lhernould J.-P. ; RTD civ. 2018, p. 728, obs. Cayrol N.
-
29.
Cass. soc., 16 févr. 1987, n° 83-46065 : Bull. civ. V, n° 82 – Cass. soc., 15 nov. 1989, n° 87-40105 : Bull. civ. V, n° 663 – Cass. soc., 10 déc. 1997, n° 95-41974 : Bull. civ. V, n° 430 ; D. 1998, p. 42 ; Dr. soc. 1998, p. 291, obs. Marraud C.
-
30.
Cayrol N., « Droit à un procès équitable et dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte », RTD civ. 2018, p. 728 et s.
-
31.
C. civ., art. 2241 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
-
32.
Au sens de l’article 53 du Code de procédure civile : « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions ».
-
33.
Au sens de l’article 54 du Code de procédure civile : « La demande initiale est formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction » (en matière prud’homale, la demande initiale est formée par requête, exceptionnellement par assignation).
-
34.
Cayrol N., op. cit., p. 734
-
35.
Cayrol N., op. cit. et loc. cit. et les références citées : Amrani Mekki S. et Strickler Y., Procédure civile, 2014, PUF, n° 128 ; Chainais C., Ferrand F. et Guinchard S., Procédure civile, 33e éd., 2016, Dalloz, Précis, n° 334 ; Cadiet L. et Jeuland E., Droit judiciaire privé, 8e éd., 2013, LexisNexis, n° 475 ; Héron J. et Le Bars T., Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015, LGDJ, n° 582.
-
36.
Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-27600.
-
37.
« En cas de démembrement de la propriété d’un lot, toutes convocations seront valablement adressées à l’usufruitier comme aussi au bénéficiaire d’un droit d’usage ou d’habitation ».
-
38.
Cass. 2e civ., 22 févr. 1989 : Loyers et copr. 1989, comm. 199.
-
39.
Cass. 3e civ., 5 févr. 1985 : D. 1985, p. 431, obs. Giverdon C. ; Gaz. Pal. Rec. 1985, 2, somm. p. 245, note Guinchard S. et Moussa T.
-
40.
Cass. 3e civ., 10 juin 2015, n° 14-19218 : JCP G 2015, act. 756, Cholet D. ; Procédures 2015, comm. 253, Strickler Y.
-
41.
Cass. 3e civ., 12 oct. 2005, n° 04-14602.
-
42.
Cass. 3e civ., 19 déc. 2007, n° 06-21410.
-
43.
Cass. 3e civ., 22 févr. 1989, n° 87-17497 : Bull. civ. III, n° 47 ; D. 89, IR p. 87 ; RTD civ. 1989, p. 254 ; V. Atias C., « La vocation des copropriétaires à participer au vote en assemblée générale », IRC oct. 1995, p. 23.
-
44.
Cass. 2e civ., 4 mars 2004, n° 02-11423 ; Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 12-27035.
-
45.
CPC, art. 625, al. 2 : « [la cassation] entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».
-
46.
Il suffit qu’elles « tendent aux mêmes fins ».
-
47.
Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-31546 : « Les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ».
-
48.
Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11955, X c/ Caisse primaire d’assurance maladie du Var et a. : Juris-Data n° 2017-004075.
-
49.
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-10883 : « l’assignation du 20 août 2012 sur le fondement du dol avait interrompu la prescription de l’action en garantie des vices cachés ».
-
50.
Cass. com., 31 janv. 2018, nos 15-22466 et 15-24122.
-
51.
Cass. soc., 19 déc. 2018, nos 16-28765, 16-28766, 16-28767 et 16-28768.
-
52.
On me pardonnera d’employer ce qualificatif pour désigner feu l’article 1134 du Code civil.
-
53.
Par ex. : Cass. com., 3 févr. 2009, n° 08-13168 : LPA 26 janv. 2010, p. 13, note Sortais J.-P. – Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-17783 : JCP E 2005, chron. 1860, n° 7, obs. Delebecque P. et Simler P. ; Gaz. Pal. 6 juill. 2005, n° F6553, p. 29, obs. Le Corre P-M.
-
54.
Par ex. : Cass. com., 26 sept. 2006, n° 04-19751 : D. 2006, AJ, p. 2460, obs. Lienhard A. ; JCP E 2007, chron. 1004, n° 10, obs. Cabrillac M. ; Act. proc. coll. 2006/17, n° 207, note Le Corre P.-M.
-
55.
Par ex. : Cass. com., 12 mai 1998, n° 96-12194 : « dès lors qu’un créancier est admis au passif de la liquidation des biens, la prescription trentenaire découlant de l’ordonnance du juge-commissaire portant admission de la créance se substitue à la prescription décennale édictée par l’article 189 bis du Code de commerce, ou à toute prescription relative à la nature de la créance ».
-
56.
Dans l’ordre chronologique : Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-21295 : Gaz. Pal. 12 avr. 2016, n° 262f7, p. 67, note Le Corre P.-M. ; Act. proc. coll. 2016/2, comm. 19, note Vallansan J. – Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-20205 : D. 2018, p. 1829, obs. Lucas P.-M. et Cagnoli P. ; AJCA 2018, p. 438, obs. Piette G. ; Rev. sociétés 2018, p. 534, obs. Henry L.-C. – Cass. com., 3 oct. 2018, n° 16-26985 : D. 2018, p. 1965, obs. Lienhard A. ; AJCA 2018, p. 545, obs. Mouial-Bassilana E. ; Act. proc. coll. 2018, comm. 253, obs. Ghandour B. ; JCP E 2019, 1000, n° 17, obs. Pétel P. – Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 16-24742.
-
57.
Pour une décision récente voir not. Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-86837.
-
58.
Cass. crim., 19 mars 2019, n° 19-90005.
-
59.
Sur la réforme de la prescription voir not. Courtin C. et Demarchi J.-R. (dir.), La réforme de la prescription pénale, 2018, L’Harmattan.
-
60.
V. pour un autre exemple dans lequel la constitution de partie civile en vue de réparer le préjudice né d’une escroquerie a été jugé différent d’une action civile en annulation de contrat : Cass. crim., 16 janv. 2002, n° 00-87826.