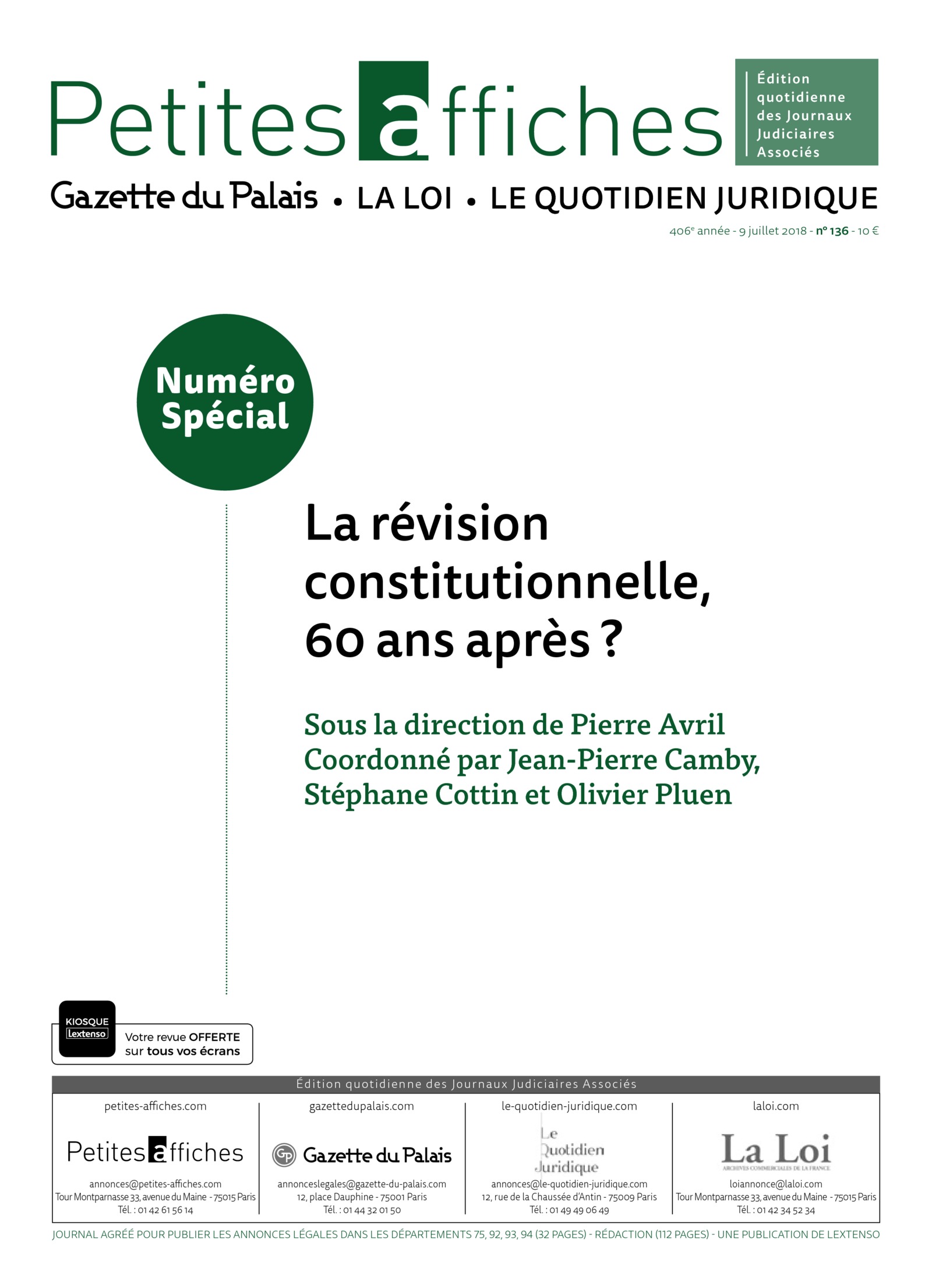Supprimer la Cour de justice de la République ?
La suppression de la Cour de justice de la République (CJR) semble faire consensus. Mais par quoi la remplacer ? Le projet du gouvernement est de reprendre, à quelques adaptations près, le texte présenté en 2013, qui soumettait les ministres, pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, à une juridiction pénale de droit commun. Un tel dispositif méconnaît cependant le caractère très spécifique des actes accomplis dans l’exercice de fonctions gouvernementales, notamment de ceux qui s’inscrivent dans des processus complexes de choix de politiques publiques susceptibles d’être constitutifs d’infractions involontaires. Comme l’a estimé le Conseil d’État en mars 2013, une juridiction spécialisée, de composition non exclusivement judiciaire, reste nécessaire.
Alors que le président de la République bénéficie pendant toute la durée de son mandat, en vertu de l’article 67 de la constitution, d’une double protection judiciaire (irresponsabilité pour les actes accomplis en sa qualité de chef de l’État et inviolabilité pénale et civile pour les actes détachables de sa fonction), les membres du gouvernement répondent pénalement de leurs actes à tout moment :
-
devant les juridictions de droit commun si les infractions qui leur sont reprochées sont détachables de leurs fonctions, soit qu’elles aient été commises avant celles-ci, soit qu’elles ne présentent pas de lien direct avec elles ;
-
devant la Cour de justice de la République pour les actes indétachables de leurs fonctions.
Pour la seconde fois en 5 ans, un projet de loi constitutionnelle entend non seulement supprimer la Cour de justice de la République (CJR), mais encore faire juger les ministres, pour les actes inséparables de leurs fonctions, par une juridiction pénale ordinaire.
Pour bien mesurer la portée de la suppression de la CJR, il convient de faire un rappel historique (I) et de se demander par quoi la remplacer (II).
I – D’un rapport à l’autre
A – Le comité Vedel
La Cour de Justice a repris en 1993 les compétences de la Haute cour de justice en matière de responsabilité pénale des ministres. Ce transfert de compétence a pour origine une proposition du comité consultatif présidé par le doyen Georges Vedel, dont il n’est pas indifférent de reproduire l’argumentaire.
À propos de la Haute cour, le rapport du comité note que « l’institution elle-même est tellement différente des juridictions de droit commun qu’elle en devient incompréhensible pour le public, sauf à lui laisser penser que la loi réserve aux ministres un sort privilégié par rapport aux simples citoyens. La réaction contre cet état de fait entraîne un fort courant favorable à la soumission des ministres au pur et simple régime de droit commun des juridictions ordinaires. Cette banalisation totale comporterait toutefois le risque de paralyser le fonctionnement de l’État par l’utilisation des procédures à des fins partisanes, notamment par l’usage abusif des constitutions de partie civile. En outre, la nature de l’action gouvernementale rend nécessaire, selon le comité, la création d’une juridiction proche des juridictions ordinaires mais spécifique ».
Le comité était donc favorable à l’application du droit commun, mais dans les limites qu’appelait « la nécessité de ne pas mettre en cause le fonctionnement régulier des pouvoirs publics par un risque de harcèlement processuel à l’encontre des ministres ».
Il recommandait donc :
-
de réserver la mise en œuvre des poursuites au procureur général près la Cour de cassation ;
-
de prévoir l’obligation de saisir une commission d’instruction ;
-
enfin et surtout, de faire juger les affaires « par une juridiction dont la composition évoque celle des cours d’assises, mais avec la particularité de comprendre huit « jurés » parlementaires, siégeant aux côtés de trois magistrats issus de la Cour de cassation, dont l’un présiderait la juridiction. Un recours devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation devrait être aménagé tant à la phase d’instruction qu’à la phase de jugement afin d’assurer le respect des engagements internationaux de la France ».
B – La loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 et la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993
Le dispositif finalement organisé par les articles 68-1 et 68-2 de la constitution reprend la philosophie du rapport Vedel, mais avec quelques différences. Ainsi, la mise en œuvre des poursuites est confiée à une commission des requêtes, composée, en vertu de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d’État et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, élus par leurs pairs (respectivement, l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, l’assemblée générale du Conseil d’État et la chambre du conseil de la Cour des comptes). Cette commission se prononce soit sur plainte de la personne qui s’estime lésée, soit sur demande du procureur général près la Cour de cassation lorsque celui-ci décide de saisir d’office la Cour de justice, ce qu’il ne peut faire qu’avec l’avis conforme de la commission des requêtes.
Autre différence avec les propositions du comité Vedel : la proportion des parlementaires au sein de la Cour de justice est nettement plus élevée que ce qu’avait suggéré le comité : douze parlementaires (au lieu des huit envisagés par le comité) siègent avec les trois magistrats de la Cour de cassation. La loi organique prévoit en outre, conformément cette fois aux recommandations du rapport Vedel, l’irrecevabilité de toute constitution de partie civile devant la Cour de justice de la République, compensée par une instruction obligatoire de toutes les poursuites autorisées par la commission des requêtes. Cette instruction est confiée à une commission de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation élus par leurs collègues.
Le ministère public devant la Cour de justice est exercé par le procureur général de la Cour de cassation. Les arrêts de la commission d’instruction et ceux de la Cour de justice peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, tandis que les décisions de la commission des requêtes ne sont susceptibles d’aucun recours.
Les actions en réparation des dommages ayant résulté des crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice relèvent des juridictions de droit commun. Dans sa décision n° 93-327 DC du 19 novembre 1993, qui déclare la loi organique conforme à la constitution, le Conseil constitutionnel juge que cette disposition préserve le droit au recours des plaignants et compense l’exclusion de toute constitution de partie civile devant la Cour de justice.
Enfin, la loi organique fait largement prévaloir le droit commun dans la procédure devant la commission d’instruction et devant la Cour de justice. En rétablissant une procédure de poursuite et d’instruction confiée à des magistrats professionnels, en lieu et place de la mise en accusation jusqu’alors réservée au Parlement, en dépolitisant partiellement la formation de jugement et en soumettant pour l’essentiel la procédure au Code de procédure pénale, le nouveau dispositif a donc « judiciarisé » sensiblement la mise en cause de la responsabilité pénale des ministres et s’est efforcé d’éviter l’écueil de la justice politique tout en conservant le privilège de juridiction des membres du gouvernement. Ce compromis, à notre sens heureux, n’a cependant pas convaincu à l’usage.
C – La CJR à l’épreuve des soupçons
Appelée à juger les ministres poursuivis dans l’affaire dite du sang contaminé (l’article 68-3 de la constitution lui donne en effet compétence pour juger les faits commis avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif), la Cour de justice suscite d’âpres critiques en raison de son arrêt du 9 mars 1999, par lequel elle relaxe deux des trois mis en cause (Laurent Fabius et Georgina Dufoix) et dispense de peine le seul dont elle retient la culpabilité (Edmond Hervé).
La déception qui en résulte n’épargne pas Georges Vedel. Dans un article qu’il cosigne dans Le Monde avec Olivier Duhamel, le doyen propose de remplacer la Cour de justice par une commission des requêtes chargée de statuer sur les plaintes en classant celles qui ne révèlent pas de fautes pénales et en renvoyant les autres devant les tribunaux ordinaires1.
Ultérieurement, la Cour de justice de la République a prononcé, le 16 mai 2000, la relaxe d’une ancienne ministre de l’Enseignement scolaire (Ségolène Royal), qui était poursuivie en diffamation par des enseignants.
Le 7 juillet 2004, elle prononce une peine de prison avec sursis assortie d’une amende et de la privation pour 5 ans de droits civiques et d’éligibilité, à l’encontre d’un ancien secrétaire d’État aux Handicapés (Michel Gillibert) convaincu d’escroquerie au préjudice de l’État. En avril 2010, saisie de trois plaintes pour corruption, complicité d’abus de biens sociaux et recel, dirigées contre un ancien ministre de l’Intérieur (Charles Pasqua), elle prononce une peine de prison avec sursis dans l’une des trois affaires, tout en le relaxant dans les deux autres. Le 17 décembre 2016, dans l’affaire dite de l’arbitrage Tapie, et contrairement à la position du parquet qui avait requis la relaxe, elle rend un jugement déclarant coupable de « négligence » une ancienne ministre de l’Économie (Christine Lagarde), celle-ci étant cependant dispensée de peine.
Peut-être en raison de la rareté de ses arrêts ou de la fréquence de la dispense de peine, le fonctionnement pourtant équilibré de la Cour de justice n’a pas réussi à désarmer les oppositions : ni de ceux qui estiment que la CJR constitue une compensation insatisfaisante à l’absence de mise en cause de la responsabilité politique individuelle des ministres ; ni surtout des secteurs qui militent plus radicalement pour l’abandon de tout privilège judiciaire en faveur de la classe politique, y compris au plus haut niveau des responsabilités publiques.
Ces deux types de critiques sont résumées par Olivier Beaud dans sa contribution au dossier thématique du cinquantenaire de la constitution, mis en ligne en 2008 par le Conseil constitutionnel. Il y souligne que la demande de pénalisation des actes des gouvernants, née dans les années 1990 (et dans lequel s’inscrit paradoxalement la création de la Cour de justice de la République), « a été suscitée en grande partie par l’insatisfaction croissante de l’opinion publique devant la multiplication des scandales politico-financiers et l’absence choquante de sanction politique. La faiblesse du contrôle politique a fait croire à certains que la solution serait une réponse judiciaire, mais celle-ci s’est avérée, après-coup, non sans risques, en raison d’une certaine “immaturité” de la magistrature (ou d’une partie d’entre elle) grisée par une nouvelle (et provisoire ?) indépendance et peu habituée à pratiquer le self-restraint. L’instauration de protections, que ce soit par un privilège de juridiction en faveur des membres du gouvernement ou par une large immunité pénale au profit du président de la République, peut à la fois choquer tous ceux qui érigent le principe d’égalité devant la loi en absolu constitutionnel et se justifier par la nécessité d’endiguer un possible harcèlement judiciaire. Il en résulte néanmoins un sentiment de malaise chez le juriste-citoyen ».
Bien que, comme le notait Olivier Beaud, la question de la responsabilité pénale des ministres ait été largement éclipsée, dans les années 2000, par celle de l’immunité et de l’inviolabilité du président de la République, la lettre de mission adressée à Lionel Jospin en juillet 2012 l’a mise au nombre des questions à traiter par la « commission de rénovation et de déontologie de la vie publique ».
D – La commission Jospin
La lettre de mission de la commission Jospin l’invitait notamment à « se prononcer sur les conséquences d’une suppression de la Cour de justice de la République ».
La réponse de la commission Jospin constitue la proposition n° 19 de son rapport. Elle recommande d’appliquer le droit commun au jugement des actes commis par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions, sous certaines conditions nécessaires pour « assurer aux ministres une protection appropriée contre les risques de mises en cause abusives ». Cette protection résulterait du maintien d’un filtrage par une commission de hauts magistrats proche de l’actuelle commission des requêtes instituée par l’article 68-2 de la constitution et de l’attribution du jugement des poursuites ainsi autorisées au TGI de Paris statuant obligatoirement en formation collégiale : cinq juges en correctionnelle, quatre assesseurs et neuf jurés en matière criminelle.
En revanche, la commission proposait de « coller » au plus près du droit commun en instituant un appel et en autorisant la constitution de partie civile, tout en maintenant l’obligation d’instruction, confiée là aussi à une formation collégiale.
Pour justifier sa proposition, la commission estimait que « les nombreuses critiques dont la Cour de justice de la République fait l’objet sont en grande partie fondées ». Le dispositif actuel poserait un problème de légitimité, en raison de la composition de la Cour, qui en fait « une juridiction de jugement hybride et majoritairement composée de parlementaires » exposée de ce fait au « soupçon de partialité ». Toujours selon la commission Jospin : « le principe même d’un jugement des ministres par une juridiction politique s’oppose nécessairement à ce que ses décisions, quel que soit leur sens, soient pleinement acceptées et revêtues d’une légitimité suffisante ».
La commission en concluait « qu’une simple réforme de la Cour de justice de la République ne saurait suffire ». Elle se prononçait pour qu’il soit mis fin au privilège de juridiction des ministres. Le maintien de la CJR était donc écarté par la commission, même assorti d’une possibilité de constitution de partie civile et d’un élargissement de la compétence de la Cour aux coauteurs et aux complices ainsi qu’aux faits connexes. Ces améliorations, exposait-elle, « ne répondraient pas à la critique essentielle que suscite la Cour de justice, qui porte sur sa légitimité même ». Qui veut noyer son chien…
E – Le projet de loi constitutionnelle soumis au Conseil d’État en 2013 (conseil des ministres du 13 mars 2013)
L’article 4 du projet de loi constitutionnelle dont a été saisi le Conseil d’État au début de l’année 2013 (v. son rapport public d’activité pour l’année 2013) remaniait profondément le titre X de la constitution relatif à la responsabilité pénale des membres du gouvernement, en suivant pour l’essentiel les préconisations de la commission Jospin.
Le dispositif proposé s’inscrivait tout entier dans l’article 68-1 de la constitution, supprimait le privilège de juridiction et renvoyait le jugement des actes des ministres aux « juridictions de Paris compétentes », statuant obligatoirement dans une formation collégiale d’au moins trois juges.
Le projet maintenait l’obligation de soumettre les poursuites à l’autorisation d’une commission des requêtes, constituée comme aujourd’hui, mais dont la composition et la présidence étaient précisées dans la constitution elle-même et non plus renvoyées à la loi organique.
La commission des requêtes serait saisie par la juridiction d’instruction, le ministère public ou la personne s’estimant lésée, ce qui n’excluait donc pas la constitution de partie civile. La loi organique ne préciserait plus désormais que le fonctionnement de cette commission et le mode de désignation de ses membres.
Rien n’était dit de la compétence de la juridiction parisienne à collégialité renforcée en ce qui concerne les infractions connexes des ministres ou celles commises par des coauteurs ou des complices.
L’article final du projet renvoyait à la loi organique les conditions d’entrée en vigueur du nouveau dispositif. La commission Jospin avait préconisé, sur ce point, qu’il soit rendu applicable, comme le précédent, aux faits commis avant son entrée en vigueur et que des procédures de dessaisissement soient organisées entre la commission d’instruction de la Cour de justice de la République au profit du juge d’instruction de Paris et entre la Cour et, selon le cas, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises de Paris.
F – La position du Conseil d’État en 2013
Tout en comprenant le souci du gouvernement, au regard des critiques que suscitait la composition de la CJR, de se rapprocher des procédures du droit commun, le Conseil d’État considéra que des aménagements étaient nécessaires pour assurer la protection des fonctions gouvernementales et que, en l’espèce, ils étaient insuffisants.
Les aménagements proposés se réduisaient en effet à l’intervention de la commission des requêtes prévue par l’article 68-1, laquelle, dans le silence de la constitution sur les motifs de rejet des plaintes, devrait autoriser les poursuites qui ne seraient pas manifestement infondées.
Le projet du gouvernement n’assortissant par ailleurs la soumission des poursuites au droit commun que de la réserve de leur attribution aux juridictions parisiennes statuant dans une formation d’au moins trois juges – ce qui n’exclut, en pratique, que le recours au juge unique –, la constitution de partie civile redeviendrait possible. Plus rien ne protégerait donc les ministres, notamment ceux qui sont en exercice, contre un harcèlement judiciaire qui rendrait impossible leur maintien au gouvernement. Un tel mécanisme pourrait porter atteinte au bon fonctionnement des institutions.
Disjoignant les dispositions qui lui étaient soumises, le Conseil d’État estima que la CJR n’en pouvait pas moins être remplacée par une juridiction spécialisée composée de juges professionnels issus de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes et dont les attributions pourraient s’étendre aux infractions connexes commises par les ministres, voire aux infractions commises par les co-auteurs ou les complices. Il proposait un dispositif en ce sens dans son avis.
II – Par quoi remplacer la Cour de justice de la République ?
C’est tout sauf un détail, même si le débat public a jusqu’ici (assez étonnamment d’ailleurs) éludé la question.
Le projet de loi constitutionnelle reprend à peu de chose près le texte présenté en 2013. L’un comme l’autre méconnaissent le caractère très spécifique des actes accomplis dans l’exercice de fonctions gouvernementales, notamment de ceux qui s’inscrivent dans des processus complexes de choix de politiques publiques susceptibles d’être constitutifs d’infractions involontaires (la mise en danger de la vie d’autrui peut être fréquemment invoquée dans les domaines ministériels comme ceux de la défense, de la sécurité, de la santé, etc.).
Le droit commun dont se réclame le projet de 2018 est au demeurant bancal, puisque, d’une part, il maintient un filtre et que, d’autre part, il déroge doublement aux règles de droit commun : double degré de juridiction et (pour le jugement des crimes inséparables des fonctions) jury populaire.
Il serait donc sage de reprendre les propositions du Conseil d’État de 2013, sans céder à l’illusion d’une loi Fauchon constitutionnelle applicable aux infractions involontaires des ministres.
A – La sagesse commande de reprendre le dispositif proposé par le Conseil d’État il y a cinq ans
Trois raisons plaident en ce sens.
En faisant juger indirectement les politiques publiques par des magistrats judiciaires peu au fait des mécanismes interministériels, on compromettrait le bon fonctionnement des institutions et la conduite des politiques publiques. Comme en 2013, le projet du gouvernement confie à la seule commission des requêtes la responsabilité de protéger les ministres en classant sans suite les procédures judiciaires abusives relatives aux actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions.
Pour des raisons psychologiques (pression de l’opinion) autant que juridiques (absence de critères de classement autres que ceux qui vont de soi : requête irrecevable ou manifestement dépourvue de sérieux), la commission des requêtes ne classerait que les recours fantaisistes et transmettrait les autres affaires, surtout si elles sont médiatisées. Il est plus compromettant de classer que de transmettre, car, dans ce dernier cas, on renvoie la décision à d’autres.
Certes, cette commission a pu, dans la même composition que celle prévue par le projet, effectuer sereinement un tri jusqu’à ce jour2. Mais, aujourd’hui, la plainte non classée est renvoyée à une juridiction spécialisée, alors que, dans le projet de 2018, comme dans celui de 2013, elle serait soumise à une juridiction de droit commun. Ce n’est pas la même chose. Le renvoi à la CJR est évidemment moins « excitant », pour les médias et les groupes de pression, que le renvoi devant le tribunal correctionnel. Les décisions de la commission auraient donc, dans le nouveau dispositif, une portée émotionnelle plus grande que dans le dispositif actuel. Le classement d’une plainte très médiatisée serait rapidement perçu comme la résurgence d’une justice d’exception.
Qui plus est, rien n’exclut que la commission des requêtes soit saisie par la juridiction d’instruction en présence de parties civiles. Osera-t-elle alors opposer le désaveu d’un classement au travail d’instruction ? Rester imperturbable face aux doléances de victimes ou d’associations qui auront défrayé l’actualité ?
La commission des requêtes sera donc conduite à limiter les classements pour éviter l’opprobre, notamment dans les affaires relatives à des problèmes de santé publique ou à des morts violentes. Dans le doute, elle sera tentée de transmettre. Sa fonction de filtre serait d’autant plus rapidement mise en cause qu’elle apparaîtrait comme le dernier obstacle à l’application intégrale du droit commun. La tentation de transmettre toutes les plaintes autres que fantaisistes pourrait être d’autant plus forte que, dans le silence du projet du gouvernement sur les motifs possibles de refus d’autorisation des poursuites, la commission des requêtes ne disposerait pas d’une habilitation constitutionnelle claire pour les classer au nom d’un intérêt supérieur. Une telle habilitation serait au demeurant délicate à énoncer dans la constitution et difficile à concilier avec le principe du retour au droit commun pour les poursuites elles-mêmes.
La protection pénale des membres du gouvernement au nom d’un intérêt supérieur ne peut être correctement garantie que si elle est assurée à tous les stades de la procédure et surtout à celui du jugement. C’est donc au sein de la formation de jugement elle-même qu’il faut marier logique pénale et intérêt public, en ménageant l’équilibre entre responsabilité effective et protection des institutions contre la judiciarisation excessive de la vie publique.
Or comme en 2013, la formation prévue sera une juridiction de droit commun (cour d’appel de Paris). Un tel dispositif, s’il était gravé dans le marbre de la constitution, battrait en brèche le principe de la séparation des pouvoirs et, par l’insécurité juridique qu’il créerait, inciterait les ministres à la pusillanimité par crainte de verdicts judiciaires davantage sensibles aux mouvements de l’opinion qu’aux enjeux d’intérêt général ou aux contraintes de l’action publique.
B – Le privilège de juridiction est justifié
Aux yeux des hommes de 1789, le privilège de juridiction des ministres, pour les actes commis dans l’exercice de leur mandat, va de soi. Il est consubstantiel à la séparation des pouvoirs. C’est ainsi que Le Chapelier déclare devant la constituante que, s’il n’existait pas de garanties pénales, les ministres seraient « perpétuellement troublés dans l’exercice de leur fonction ».
On sait en quels termes l’article 13 du titre II des lois des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire dresse une muraille entre fonctions judiciaires et administratives : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Le privilège de juridiction dont bénéficient les ministres pour les actes (ou omissions) accomplis dans l’exercice de leurs fonctions trouve une puissante justification dans le caractère très particulier de tels actes (ou de telles omissions), qui s’inscrivent dans des processus décisionnels politico-institutionnels complexes (surtout lorsque sont en cause des choix de politiques publiques comportant des arbitrages entre intérêts collectifs différents) et dont les tenants et aboutissants sont souvent difficiles, voire impossibles, à appréhender. Or ce sont ces choix – ou ces non choix – qui sont le plus souvent en question lorsqu’un ministre se voit reprocher une infraction involontaire dans l’exercice de ses fonctions.
Les difficultés d’allocation du temps ministériel, le manque de visibilité quant aux effets de l’action (ou de l’inaction) publique, les contraintes inhérentes aux procédures interministérielles, les rapports entre un ministre, son cabinet et son administration, la chaîne ramifiée des responsabilités dans les processus de décision politique ou de préparation des textes, le bien-fondé des arbitrages (inséparable de leur inévitable collégialité), ne peuvent être par ailleurs justement analysés et compris que par des juges suffisamment au fait des politiques et des institutions publiques. C’est la raison pour laquelle le constituant a institué, et conserverait, pour procéder au premier examen des plaintes dirigées contre les actes des ministres et en déterminer le caractère sérieux, une commission des requêtes où siègent des membres de la juridiction administrative aux côtés des magistrats judiciaires.
Ces mêmes raisons ont justifié la composition de la Cour de justice elle-même, où le rôle des praticiens est exercé par les parlementaires siégeant eux aussi aux côtés des magistrats judiciaires, garants des droits des plaignants et du caractère équitable du procès. On peut critiquer le poids respectif des praticiens et des magistrats dans le dispositif actuel sans récuser le principe même d’une telle réunion de compétences et de sensibilités. Le renvoi aux tribunaux ordinaires (tribunal correctionnel, cour d’appel ou cour d’assises), même assorti d’une collégialité renforcée, ne permettrait pas de mettre les ministres à l’abri d’une interprétation techniquement erronée ou idéologiquement biaisée de leur rôle. Il conduirait ces tribunaux à se prononcer sur des arbitrages de nature politique, ce qui ne peut que porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs et perturber gravement le fonctionnement des pouvoirs publics.
Il suffit de songer à quelques hypothèses : plainte de parents de militaires tués en Afghanistan ou au Mali qui mettrait en cause le ministre de la Défense pour mise en danger de la vie d’autrui ; mise en cause, pour non-assistance à personne en danger ou homicide involontaire (en matière de santé, de transports publics, d’énergie, d’alimentation, d’environnement, de maintien de l’ordre), de ministres accusés de ne pas avoir pris, à la première alerte, les mesures de précaution appropriées, ou d’avoir privilégié des considérations économiques ou liées à l’emploi sur les préoccupations de santé.
La commission de filtrage ne rejetterait pas de telles plaintes car elles ne seraient pas manifestement infondées.
Le juge de droit commun devrait alors trancher des questions de politiques publiques sur lesquelles le juge administratif, pourtant plus aguerri, répugne à exercer un contrôle trop poussé. Cela le conduirait à juger non pas seulement un ministre, mais une politique.
On obtiendrait ainsi ce que le chef de l’État actuel a dit craindre lors de ses vœux à la Cour de cassation en janvier 2018 : une « génération de prudents ou d’empêchés » qui, dans l’exercice de leurs fonctions ministérielles, seraient freinés sans cesse par la perspective de poursuites à l’issue incertaine et déstabilisatrices (pendant tout le temps de la procédure) quelle que soit cette issue.
On multiplierait également les cas dans lesquels le titulaire serait obligé de quitter prématurément ses fonctions, alors même que les accusations lancées contre lui se révéleraient sans fondement par la suite. Bien sûr, le constituant peut faire ce qu’il veut, mais accepte-t-on d’exposer l’action ministérielle au harcèlement de plaignants de tous poils, sans un filtre approprié et une formation de jugement équilibrée dans sa composition ? Assume-t-on d’avance les inévitables empiétements des juges judiciaires ordinaires sur une gestion ministérielle qui ne leur est pas familière, alors pourtant qu’existent un juge administratif et un juge des comptes publics qui peuvent l’y aider et ont démontré depuis longtemps leur indépendance ?
Est-on prêt à abandonner les principes républicains fondateurs qui soustrayaient les opérations de l’exécutif à la tutelle des anciens parlements ?
C – L’alternative proposée en 2013 par le Conseil d’État
Il existe une alternative au droit commun, tout aussi apte que celui-ci à dissiper le soupçon de justice complaisante : reprendre le texte adopté par le Conseil d’État en 2013. Celui-ci permet de remplacer la CJR par un tribunal composé de juges professionnels. Un tel projet mettrait en œuvre la mesure annoncée dans le programme du président de la République (suppression de la CJR), tout en conjurant le risque majeur du projet (faire peser sur les ministres une épée de Damoclès paralysante).
Le texte établi en 2013 par le Conseil d’État habilite par ailleurs la loi organique à faire juger par une seule instance les actes des ministres commis dans l’exercice des fonctions, leurs actes connexes et ceux de leurs collaborateurs co-auteurs ou complices, ce qui présente un grand intérêt du point de vue de la bonne administration de la justice et règle un des problèmes les plus irritants posés par la dispersion actuelle des compétences juridictionnelles (voir l’affaire du sang contaminé).
Le remplacement de la Cour de justice de la République par une juridiction spécialisée disposant d’une compétence pénale d’attribution pourrait s’autoriser de nombreux précédents étrangers au champ politique. Il en existe pour les mineurs, les armateurs (tribunaux maritimes commerciaux), pour les militaires, ainsi que pour certains types de litiges liés au fonctionnement même de la justice pénale (commissions et cours près la Cour de cassation instituées par les articles L. 451-1 et 2 du Code de l’organisation judiciaire, et notamment la commission compétente en matière de discipline des officiers de police judiciaire). Même si la situation d’un ministre n’est pas comparable à celle d’un mineur ou d’un armateur, ces exemples montrent qu’il est abusif de confondre juridiction pénale spécialisée et « justice d’exception ».
La nouvelle juridiction spécialisée échapperait au reproche de partialité fait à la Cour de justice de la République. On peut en effet partager le diagnostic de la commission Jospin sur le soupçon d’illégitimité que suscite la composition de l’actuelle CJR. La prépondérance écrasante des parlementaires (12 sur 15) a permis de nouer un compromis politique en 1993, mais ce compromis n’avait pas nécessairement vocation à durer au-delà de ce qui était nécessaire pour accoutumer les esprits à une procédure dans laquelle des ministres seraient soumis, pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, à une instruction menée par des juges judiciaires et à un jugement auxquels participeraient d’autres magistrats.
Cette acclimatation étant désormais faite, une formation de jugement composée majoritairement, voire exclusivement, de magistrats professionnels paraît désormais acceptable, sans que ces magistrats professionnels soient tous des magistrats judiciaires intervenant dans le cadre de leurs attributions habituelles. Elle serait de nature à répondre de l’accusation de justice politique que la réforme de 1993 n’a pu exorciser. Une telle composition suffit en effet à changer radicalement la nature de la juridiction chargée de juger les actes des ministres. Elle en fait un vrai tribunal.
Les juges professionnels, membres de ce tribunal, doivent être recrutés au niveau le plus élevé de la hiérarchie, où ils ont le plus de chance d’avoir pu participer au fonctionnement des institutions et d’être en mesure de résister à la pression médiatique. Ils doivent émaner des deux ordres de juridiction, afin de réunir l’ensemble des compétences spécialisées mobilisées par ce type de litiges.
Ces objectifs militent pour une composition du tribunal qui, comme la commission des requêtes, réunisse des magistrats de la Cour de cassation et des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
Pour mettre en œuvre ces principes, le Conseil d’État proposait en 2013 un tribunal sensiblement resserré de cinq juges (contre quinze actuellement), composé de trois magistrats du siège à la Cour de cassation (hors hiérarchie), un membre du conseil d’État et un membre de la Cour des comptes, soit cinq juges professionnels.
Il ne serait pas choquant d’y faire siéger aussi deux, voire quatre parlementaires. Le maintien d’une présence des parlementaires, en proportion minoritaire, dans la formation de jugement éviterait de rompre trop radicalement avec la philosophie de la CJR. Milite en ce sens, le fait que, pour juger de la responsabilité pénale des ministres dans l’exercice de leurs fonctions, le tribunal de l’article 68-1 devra apprécier les conséquences d’arbitrages politiques, exercice sur lequel les parlementaires disposent d’une expérience que n’ont pas, sauf exception, les juges professionnels, quel que soit leur ordre juridictionnel.
Les juges professionnels seraient élus par leur juridiction respective (l’assemblée des magistrats hors siège pour la Cour de cassation, l’assemblée générale pour le Conseil d’État, la chambre du conseil pour la Cour des comptes), précision qui ne figure actuellement que dans la loi organique, mais qu’il serait convenable d’inscrire dans la constitution, dès lors qu’elle constitue une garantie d’indépendance.
Le tribunal élirait son président parmi les magistrats de la Cour de cassation, autre garantie d’indépendance qu’il conviendrait d’inscrire dans la constitution plutôt que, comme actuellement, dans la loi organique. Le dispositif proposé maintiendrait le principe d’une large application du Code de procédure pénale dans l’instruction et le jugement des actes des ministres, mais en conservant certaines des adaptations jugées nécessaires en 1993.
Outre le filtrage de la recevabilité des plaintes (effectué par la commission des requêtes qui, conformément au projet du gouvernement, continuerait d’être prévu par la constitution), la constitution de partie civile serait explicitement exclue. La loi organique prévoirait en contrepartie une instruction obligatoire, confiée à un collège de trois magistrats du siège à la Cour de cassation, comme c’est déjà aujourd’hui le cas. La constitution de partie civile ne serait pas cohérente avec l’existence d’une commission de filtrage, qu’elle contribuerait fortement à fragiliser.
En conséquence de l’exclusion de la constitution de partie civile, il faudrait maintenir le droit pour les personnes lésées de porter devant les juridictions de droit commun leurs actions en réparation des dommages ayant résulté des crimes et délits poursuivis devant le tribunal de l’article 68-1. On resterait ainsi conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 1993.
Le ministère public serait encore confié au procureur général de la Cour de cassation. Les arrêts de la formation de jugement ne seraient toujours susceptibles que d’un pourvoi devant la chambre plénière de la Cour de cassation. Il en irait de même des décisions de la commission d’instruction.
Les décisions de classement prises par la commission des requêtes demeureraient pour leur part, comme aujourd’hui, insusceptibles de recours.
La loi organique continuerait de fixer la composition de la commission des requêtes : s’agissant d’une commission de filtrage et non d’une juridiction pouvant prononcer des peines privatives de liberté, la « remontée » de sa composition au niveau constitutionnel n’est pas indispensable.
La solution est inverse pour le tribunal, compte tenu de ce que, comme la Cour de justice de la République, il ne serait pas exclusivement composé de magistrats judiciaires. Il faut en effet être explicite au niveau constitutionnel pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les implications de l’article 66 de la constitution quant à la composition des juridictions répressives (Déc. n° 2004-510 DC, 20 janv. 2005, sur la loi relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, cons. 16 et 17).
La commission des requêtes pourrait par ailleurs être allégée. Actuellement composée de sept juges (trois magistrats de la Cour de cassation, deux membres du Conseil d’État et deux membres de la Cour des comptes), elle pourrait passer à quatre juges (deux magistrats de la Cour de cassation, un membre du Conseil d’État et un membre de la Cour des comptes), le président continuant d’être choisi parmi les magistrats judiciaires et disposant d’une voix prépondérante, ce qui ne contrevient à aucun principe constitutionnel du droit pénal, s’agissant d’une commission de filtrage et non de jugement.
Il reviendrait aussi à la loi organique d’étendre, le cas échéant, la compétence du tribunal de l’article 68-1 aux infractions connexes et indivisibles imputables au ministre contre lequel la commission des requêtes aura autorisé les poursuites.
Le cas des infractions commises à raison des mêmes faits par les coauteurs et complices qui ne sont pas ministres est plus délicat.
D – Quel est le niveau de norme adéquat pour en attribuer la connaissance à la formation de jugement spécialisée ?
Dans la version initiale de l’article 68 de la constitution (où la mise en cause de la responsabilité pénale des ministres relevait de la Haute cour), c’était ce même article qui étendait sa compétence aux complices des ministres en cas de complot contre la sûreté de l’État.
On peut légitimement en déduire que, s’il est envisagé d’attribuer au tribunal de l’article 68-1 le jugement des poursuites contre d’autres personnes que les ministres, fussent-elles coauteurs ou complices des mêmes faits, la constitution ne peut rester muette à ce sujet : la composition du tribunal doit répondre aux exigences de l’article 66 de la constitution. La réunion des compétences au sein du tribunal de l’article 68-1 présenterait un grand intérêt pour l’appréciation des responsabilités respectives du ministre et de ses collaborateurs, des membres de son cabinet ou de son administration, pour les mêmes faits. Il n’est pas satisfaisant que les coauteurs et complices des infractions imputées aux ministres dans l’exercice de leurs fonctions soient jugés selon une autre procédure et que deux juridictions différentes soient conduites à se prononcer sur les mêmes faits.
Une telle situation est source de complexité et d’incohérences, d’autant que, dans le projet de 2018, l’une de ces juridictions rendra sa décision en premier et dernier ressort.
E – La solution peut-elle être trouvée dans une définition stricte des infractions involontaires des ministres
Plutôt qu’en instituant une formation de jugement spécialisée, on pourrait être tenté de rechercher une solution respectueuse des intérêts publics – dans l’esprit de la loi Fauchon du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence – en définissant strictement le défaut de diligence fautif.
Pourraient être ainsi explicitement exonérés :
-
d’une part, les actes dont les membres du gouvernement n’étaient pas en mesure d’apprécier les conséquences lorsqu’ils les ont accomplis ;
-
d’autre part, les inactions ne procédant pas d’une démarche volontaire de leur part, notamment parce qu’elles ne résultent pas d’une décision (positive ou négative, formalisée ou non) qui leur soit directement et personnellement imputable (pensons à la continuation de pratiques sur lesquelles le ministre avait certes le pouvoir d’influer, mais sur la nocivité desquelles son attention n’a pas été appelée).
C’est ainsi que, dans le projet arbitré après avis du Conseil d’État, le gouvernement fait dire à l’article 68-1 que la responsabilité pénale des ministres « ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir résulte d’une décision qui leur est directement et personnellement imputable ».
Toutefois, outre que l’exigence d’un acte de volonté ou d’une faute délibérée pour qualifier une négligence ministérielle mordrait sur les dispositions de l’article 121-3 du Code pénal3, elle n’opposerait qu’un obstacle relatif à la propension du juge judiciaire à interpréter largement les dispositions pénales à l’encontre d’un ministre. La notion de « négligence d’un dépositaire de l’autorité publique ayant permis un détournement de fonds publics » (C. pén., art. 432-15 et C. pén., art. 432-16) n’a-t-elle pas été interprétée de façon « constructive » par la Cour de cassation4, puis par la CJR elle-même, à l’encontre de Christine Lagarde 5 ?
Surtout, une telle solution fait toujours du jugement des ministres, pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et inséparables de celles-ci, une question trop purement pénale, tant sur le fond que sur la procédure, pour que le principe de séparation des pouvoirs n’en sorte meurtri.
Notes de bas de pages
-
1.
Suggestion critiquée par Carcassonne G. qui, dans une contribution aux Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, publiée en 2003, souhaitait assigner à cette commission un strict « rôle d’aiguillage » consistant à renvoyer les actes d’un ministre ayant « entièrement agi dans l’exercice du pouvoir exécutif » à une commission d’enquête parlementaire, et les autres au droit commun de la procédure pénale.
-
2.
Entre sa création et le 31 octobre 2017, la commission des requêtes a été saisie de 1 439 plaintes émanant de particuliers ou d’associations. Elle a émis 40 avis favorables à la saisine de la commission d’instruction, soit un taux de saisine de la commission d’instruction de 3 %. Les 40 saisines de la commission d’instruction ont donné lieu à l’ouverture de 15 informations : 7 affaires ont donné lieu à arrêt de renvoi devant la formation de jugement ; 5 se sont terminées par un non-lieu ; une a donné lieu à un arrêt d’incompétence ; une s’est achevée par un arrêt constatant l’extinction de l’action publique ; une affaire, dite Karachi, composée de deux dossiers, est actuellement examinée par la commission d’instruction.
-
3.
C. pén., art. 121-3, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
-
4.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
-
5.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
-
6.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
-
7.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »
-
8.
V. Cass. ass. plén., 22 juill. 2016, n° 16-80133, rendu sur le pourvoi formé contre la décision de la commission d’instruction de la CJR. Cet arrêt juge que la CJR doit statuer sur la négligence de la ministre (C. pén., art. 432-16) avant même que soit jugé le détournement de fonds commis par des tiers, lequel fait l’objet d’une procédure distincte.
-
9.
V. de Béchillon D., « À propos de la conformité à la constitution du délit de négligence prévu à l’article 432-6 du Code pénal », in Mélanges en l’honneur du Pr Frédéric Sudre, 2018, LexisNexis.